Sema Nassar, lors d’une conférence organisée par la Fondation Heinrich Böll, en juillet 2016, résumait les violences et les tortures sexuelles infligées aux femmes par le régime dictatorial de Bachar el-Assad comme «une arme de destruction massive». La stricte et terrible réalité. Un an plus tard, les «leaders de la communauté internationale» font du dictateur un élément «nécessaire» d’une dite transition en Syrie.
Hala Kodmani résume ainsi les traits de cette «Realpolitik»: «C’est en accueillant pour la première fois Vladimir Poutine à Versailles que le nouveau Président a tracé une très hypothétique nouvelle “ligne rouge” sur la Syrie. C’est aussi en soulignant la nécessité de s’entendre avec Moscou pour “éradiquer le terrorisme” qu’il a relégitimé dans son interview le bourreau de Damas. Ses propos ont été d’ailleurs salués par le très officiel site Russia Today, comme “offrant un large écho à la position défendue par Moscou, qui estime qu’il n’existe pas d’alternative à Bachar al-Assad”. Mais pour renouer avec la Russie, Macron a-t-il besoin d’aller jusqu’à humilier les Syriens en parlant ainsi d’Al-Assad: “Personne ne m’a présenté son successeur légitime.”?»
Les témoignages – qu’il est malaisé de qualifier – recueillis dans l’enquête de Camille Neveux constituent à eux seuls cette « ligne rouge», sombre, qu’Obama puis Macron ont invoquée… à propos de l’utilisation d’armes chimiques. Elles furent utilisées par Bachar avec l’aide de ses alliés russes et iraniens; et furent ignorées. «Illuster», décrire, sans répit, la politique réelle de Bachar est un des moyens de mettre en cause la Realpolitik complice – ou directement collaboratrice – de cette «communauté de responsables» qui négocient, sans fin à Genève, si ce n’est d’attendre l’anéantissement «des corps et des âmes» de celles et ceux visés par toutes les armes de Bachar, de ses complices et de Daech comme de ses semblables. La plus élémentaire «ligne rouge» implique, par principe, l’engagement selon lequel ces crimes contre l’humanité, ces crimes de guerre seront punis, ce qui est une condition pour une paix véritable. (Rédaction A l’Encontre)
*****
Il y a deux ans encore, Safa et Marwa ne savaient pas ce qu’était un feutre ou du papier à dessin. A 3 ans, elles ne distinguaient pas les couleurs. Depuis qu’elles ont intégré une école turque, à la frontière syrienne, les jumelles s’en donnent à cœur joie, brandissant leurs crayons dans le salon familial, taquinant au passage leurs frères et sœurs, Waith (8 ans), Mouna (6 ans) et Batoul (5 ans).
Le quotidien n’est pourtant pas toujours simple. «Mes enfants n’arrivent pas à jouer une heure sans devenir violents, confie leur mère, Rasha Sharbaji, âgée de 35 ans. Quelque chose d’hostile s’est développé en eux. Ils ne lavent plus leurs mains, ils lèchent leur assiette comme des animaux. L’aîné parle difficilement, comme s’il était handicapé, car il a peur que les services de renseignement reviennent… Ils ont eu des difficultés à me reconnaître, car nous avons été séparés. Je pleure quand je les regarde. Il faudra du temps.» Les enfants de Rasha ont eu dans leur existence un départ bouleversé: ils ont grandi – et sont nées, pour les deux dernières – dans les geôles du régime syrien de Bachar El-Assad, un des plus violents au monde.
Cette mère de famille a été arrêtée le 22 mai 2014 par les renseignements militaires syriens alors qu’elle se rendait à la préfecture de Damas, avec ses deux belles-sœurs et ses aînés, pour renouveler son passeport. «Pendant l’interrogatoire, toutes les questions ou presque portaient sur mon époux, qui est un activiste, raconte-t-elle. Grâce aux écoutes, ils savaient que j’étais enceinte de huit mois, de jumeaux. Ils m’ont menacé de taper fort sur mon ventre pour que je perde mes bébés, de tuer mes trois enfants. “Vous oubliez tout, votre nom, votre mari, qui vous êtes m’a dit l’interrogateur. Vous vous souvenez juste de ce numéro: 714. C’est votre identité maintenant.”»
Avortements forcés
La famille est alors transférée au centre de détention de l’aéroport militaire de Mezzeh, un des plus durs, surplombé par le palais de Bachar El-Assad. Séparée de ses belles-sœurs, Rasha se retrouve à l’isolement avec ses trois enfants, sous terre, dans une cellule de 9m². «Les draps étaient très sales, se souvient-elle. Il y avait des blattes et des poux partout. Les enfants n’arrêtaient pas de pleurer. Nous allions aux toilettes trois fois par jour, sinon nous faisions nos besoins sur place. Nous avons eu plusieurs fois de grosses poussées de fièvre. Les rations de nourriture n’étaient pas suffisantes. J’ai tout fait pour que mes enfants s’adaptent, mais ils n’y arrivaient pas. Très vite, ceux qui m’interrogeaient ont compris que mon point faible, c’était les petits…» «Si tu ne dis pas la vérité, on te jette par la fenêtre», lui répétaient ses geôliers.
La jeune femme a accouché un mois et demi plus tard à l’hôpital militaire, attachée au lit avec des menottes, par césarienne et dans un bain de sang. «Je me suis réveillée et j’ai vu mes deux bébés dans du coton, sans aucun vêtement, s’émeut-elle encore. Je voulais les recouvrir des miens, mais ils étaient pleins de poux.» Lorsque l’hiver arrive, les plus grands déambulent dans la cellule en culotte, car leurs habits sont déchirés. Les nouveau-nés ne cessent de régurgiter le lait de leur mère. «Puis un jour, un médecin me dit: “Préparez vos enfants, je les prends pour le vaccin.” Je savais que c’était faux, qu’il les emmènerait tous dans un orphelinat. Ce fut le pire jour de ma vie. Mes deux enfants étaient en plus sans papiers, sans état civil. Comment ferais-je pour les retrouver?»
Rasha Sharbaji intégra finalement la liste de «cellule des négociations» cinq mois plus tard, prélude à un échange de prisonniers entre le régime et l’opposition. Dehors, l’ambassadrice américaine de l’ONU, Samantha Power, s’active en intégrant son nom parmi ceux des 20 prisonnières politiques à libérer dans le monde dans le cadre de la campagne Free the 20, lancée en 2016. «Une soldate visiblement dérangée entrait et sortait de la cellule vingt fois par heure, nous ordonnant de nous lever à chaque fois, souffle encore avec peur la mère de famille. Une adolescente de 15 ans a reçu des seaux d’eau bouillante puis glacée, avant de rester nue dans le froid. On nous a demandé d’enlever nos pulls, de laver les toilettes avec, puis de les remettre.» Jusqu’à la délivrance, le 8 février 2017, dans un bus en direction de Hama, où Rasha a retrouvé ses petits sortis de l’orphelinat.

Dans la Syrie d’Assad, son cas n’est pas isolé. Des dizaines de femmes ont accouché dans les centres de détention militaire et les geôles du régime depuis le début de la révolution. «Rien qu’à la prison d’Arda, à 30 km de Damas, nous avons recensé 31 naissances entre 2011 et 2015», souligne Sema Nassar, chercheuse pour le réseau EuroMed Right. Dans cet univers concentrationnaire, où se faire oublier est une des seules chances de survie, être enceinte devient un danger. La dictature attaque les femmes dans ce qu’elles ont de plus intime, de plus vulnérable. Selon des chiffres publiés en avril par le Réseau syrien des droits de l’homme (SNHR), 6177 prisonnières sont toujours détenues dans des conditions déplorables, dont 107 avec leurs enfants et 319 mineures.
Les différents témoignages que nous avons recueillis en Europe et au Moyen-Orient, lors de rencontres ou via Skype, font état d’avortements forcés, de bébés mourant de faim faute de nourriture et de soins, de tortures psychologiques et physiques. Sema Nassar rapporte ainsi le cas d’une mère originaire d’une ville rebelle du Nord, qui a accouché à Arda d’un bébé mort-né à la suite de tortures. Celui d’une autre, venue de la côte, dont la petite fille, en souffrance fœtale, est décédée une semaine après sa naissance. «Certains centres, comme celui de la Branche Palestine, sont connus pour être particulièrement violents envers les femmes enceintes, relate la chercheuse syrienne. Lorsqu’elles ont des symptômes naturels de grossesses, comme les vomissements, on les laisse avec les autres prisonnières et on ne nettoie pas. Une détenue qui est partie accoucher n’est jamais revenue.»
Amina Khoulani, membre de l’association Women Now, fondée par l’écrivaine syrienne Samar Yazbek, a, elle aussi, été emprisonnée pendant six mois en 2013 à Arda. Une prison civile dotée d’une section pour les «terroristes», selon la terminologie du régime, mais qui «accueille en réalité des prisonnières politiques». La jeune Amina se souvient de la détenue frappant aux grilles pour appeler au secours lorsque la vie d’une femme enceinte en dépendait. De l’unique comprimé de paracétamol remis à une adolescente partie «accoucher » auprès du «médecin» de la prison, en réalité victime d’un avortement forcé. D’une mère incapable de donner du lait à son bébé faute de pouvoir se nourrir elle-même, devenue folle lorsque les soldats ont fait disparaître son petit dans un état de famine avancé. D’une fermière incarcérée sans son nourrisson quatre jours après son accouchement. «Elle souffrait d’importantes montées de lait qui tachait ses vêtements, se souvient Amina. L’odeur était insupportable, tout le monde restait éloigné d’elle. A chaque montée de lait, elle pleurait encore plus, car cela lui rappelait que son bébé avait faim, quelque part, sans elle.»
La hantise du viol
Il y a aussi ce que chaque détenue redoute, la plus cruelle des armes de guerre: être violée et se retrouver enceinte. «Le nombre de femmes dans ce cas n’est pas anodin, mais peu en parlent, souligne Jalal Nofel, psychiatre au Mental Health Center de Gaziantep (Turquie, à la frontière avec la Syrie), une structure qui accueille des réfugiés syriens. Elles ont honte et se sentent coupables, elles sont rejetées par leurs familles et par la société. Le viol humilie et donne du pouvoir aux agresseurs du régime d’Assad, qui se vengent sur ces prisonnières venant de zones rurales soutenant la rébellion. Les enfants qui naîtront seront souvent abandonnés. Ils rappellent des choses trop sales.»
Punition collective
Le viol a parfois lieu en prison, comme ce fut le cas pour cette jeune de 26 ans originaire de Damas, qui a pu avorter à sa sortie avant de rejoindre les Emirats arabes unis pour fuir l’opprobre. Ou cette autre, violée dans le centre de détention de la 4e division militaire, dirigée par Maher El-Assad, le frère de Bachar El-Assad, et qui a accouché prématurément d’un enfant mort-né. «Le bébé était déjà décédé dans son ventre depuis longtemps, souffle Sema Nassar. Son état de santé était déplorable.»
Parfois, les jeunes proies sont violées à des check-points où lors des rafles par des soldats ou des miliciens du régime, les chabihas. Comme cette Syrienne aujourd’hui réfugiée en Europe, originaire d’une banlieue rurale de Damas et abusée de multiples fois, ou cette autre, qui a osé porter plainte après son agression sexuelle. Toutes deux ont été incarcérées en guise de punition.
Selon les activistes, l’objectif de ces détentions sans procès et sans charge est clair: anéantir toute opposition. «Le régime utilise les femmes et les enfants pour faire pression sur les maris, les fils, les frères afin qu’ils arrêtent la révolution, qu’ils rejoignent ses rangs ou se suicident, décrypte l’opposante Amina Khoulani. En sachant que ces épouses et ces sœurs, ce qu’ils ont de plus cher, seront battues ou violées.» Selon la chercheuse Sema Nassar, 25% d’entre elles sont arrêtées parce qu’elles sont elles-mêmes militantes, 75% parce que leurs proches le sont. «Elles sont en réalité des otages, un moyen de dissuader l’entourage de continuer la révolution. Ce n’est pas une question de classe ou de situation sociale, mais de région où il y a de l’activisme local, et que les milices veulent soumettre. C’est une punition collective.»
Arrêtée lorsqu’elle avait 15 ans, emprisonnée pendant neuf ans, l’avocate Louma Anadane, 52 ans, rappelle que la loi civile appliquée aux délinquantes de droit commun est totalement différente. «Ces prisonnières peuvent aller à l’hôpital, les visites médicales sont autorisées. Les détenues politiques, elles, n’ont aucun droit. A leur sortie, elles ne peuvent ni voyager ni travailler, elles doivent rendre des comptes aux services de renseignement. Elles sont rejetées et abandonnées par leurs proches, à tel point qu’on enregistre des cas de suicide. L’Etat a vis-à-vis de ces prisonnières un comportement barbare. »
Directrice de l’institut Tastakel, détenue elle-même pendant onze ans dans les années 1980, Aziza Jaloud a élevé son enfant en prison pendant trois ans et demi. «Le nombre de naissances s’est aujourd’hui multiplié car les femmes sont plus nombreuses à être emprisonnées du fait de leur activité militante et de la politique d’arrestations systématiques du régime, témoigne-t-elle. Les moyens de torture sont aussi plus forts et plus cruels que par le passé.» L’avocate Louma Anadane est persuadée que la répression dont les Syriennes sont victimes a contribué à faire échouer la révolution. «Au début, la participation féminine était très importante, c’était un élément positif. Mais cette politique de détention et de viols les a empêchées de continuer. Sinon les choses auraient évolué différemment.»
De mère en fille
Diana Ashour en sait quelque chose. Cette étudiante de 23 ans est arrivée à Paris il y a deux ans et demi avec ses parents pour reprendre ses études de gestion. Lorsque la révolution a éclaté, elle a manifesté pendant plusieurs mois à l’université d’Alep, avant d’arrêter «pour ne pas répéter l’histoire familiale». «J’avais une haine particulière de ce régime qui me poussait encore plus à m’engager, confie-t-elle. Je me demandais quand on allait rendre justice à ces gens emprisonnés à tort. Mais avec tout ce que j’avais vécu, j’étais prudente. Le traitement qui me serait infligé si j’étais arrêtée serait encore plus dur que pour les autres.» Et pour cause: Diana est née en 1993 à la prison de Douma, à 20 km de Damas, dans les geôles de Hafez El-Assad, le père de Bachar El-Assad.
Sa mère, Doha Ashour, était membre du Parti du travail communiste (PTC). Elle a été arrêtée en février 1993, dans la rue, alors qu’elle était enceinte de trois mois, puis condamnée à six ans de prison. C’était il y a près de vingt-cinq ans, ce pourrait être aujourd’hui. «Quelqu’un m’a dénoncée, sans doute sous la torture, raconte-elle. Les services de sécurité ne savaient pas que j’étais mariée et enceinte. Mon mari était aussi en prison et notre relation n’était pas publique pour ne pas me mettre en danger.» Incarcérée dans le froid de l’hiver, Doha garde ses pulls et son manteau pour cacher son ventre qui s’arrondit, malgré le printemps qui arrive. «J’étais à l’isolement, ma peau était abîmée avec la chaleur et la saleté de la prison, se souvient-elle. J’avais tous les symptômes de grossesse démultipliés à cause de l’humidité. Je m’inquiétais beaucoup à propos de l’alimentation. Je faisais de l’anémie, l’évolution du poids du bébé n’était pas normale.»
Lorsque le travail commence, ses geôliers mettent huit heures à l’envoyer à l’hôpital, qui jouxte pourtant la prison. «Elle va accoucher d’un nouvel opposant. Qu’il soit mort ou vivant on s’en fout!», scandent-ils. Deux heures après être entrée en salle d’accouchement, Doha retourne dans une cellule, cette fois-ci avec d’autres détenues. «J’ai eu des séquelles temporaires. Pour que j’allaite, on devait porter le bébé jusqu’à mes bras. Il était très, très petit, dit-elle d’une voix brisée. Ce n’était pas un accouchement, il n’y avait pas de famille, pas d’amis, pas de voisins, pas de préparatifs ni de chambre pour le nourrisson. C’était très triste.» Doha demande alors au tribunal de garder sa fille auprès d’elle pendant quatre ans, faveur accordée. «Tout le monde l’adorait, qu’elle était belle! Diana s’est développée très vite au contact des autres prisonnières. Elle a commencé à parler au bout de un an et deux mois. Mais tout cela n’était pas de son âge. Il fallait qu’elle découvre ce qu’était la lumière, la lune, un légume. J’ai pris la décision de la laisser partir à un an et demi.» Tous les quinze jours, son père la ramène en prison passer la nuit avec sa mère. Jusqu’à la sortie, enfin.
Diana a attendu ses 18 ans avant de dévoiler pour la première fois son histoire à quelqu’un. «Lorsque j’étais petite, je disais que maman étudiait dans un internat, car la prison c’était pour les gens mauvais. Je me rappelle tous les détails, où je dormais, où on faisait du café. Je l’appelais maman Doha, car je n’avais pas beaucoup l’occasion de prononcer ce mot, “maman”… C’était quelque chose de précieux, la preuve qu’elle existait. A chaque départ, j’avais l’impression que je ne la reverrais jamais.» De retour chez elle, Doha explique à sa fille qu’elle a été incarcérée car elle défendait les droits des enfants. «Pendant longtemps j’en ai beaucoup voulu aux gamins! sourit Diana. Vers 10 ans, j’ai compris la vraie histoire. Ma famille avait des problèmes sur le plan politique, elle n’avait rien fait de mal, elle défendait des choses nécessaires, mais c’était tabou.» Elle dénonce une double peine: non seulement être née en prison, mais aussi avoir été obligée de porter ce secret pendant dix-huit ans. «Beaucoup d’enfants sont dans le même cas, déplore-t-elle. Le régime crée des robots qui mangent et dorment, qui n’ont pas le droit d’écrire, de parler ou de se confier, sans émotions ni réflexion. Il nous fait peur et nous humilie pour étouffer toute opposition. De père en fils, il reste le même.» (Enquête publiée dans le JDD du 16 juillet 2017)

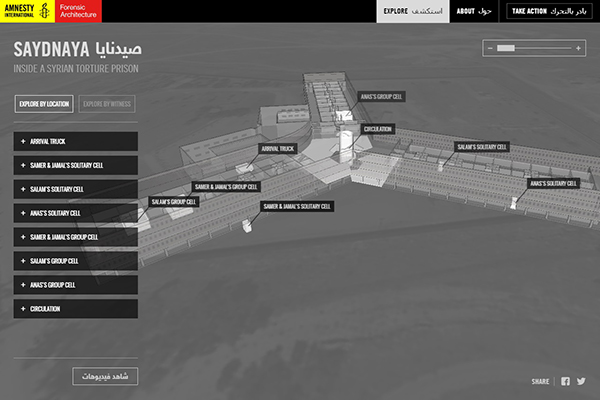
Soyez le premier à commenter