Il n’existe évidemment pas de « théorie marxiste » de la guerre, mais les développements de Marx sur le procès d’ensemble de la production capitaliste, la mise en valeur, la circulation et la reproduction du capital ont conduit à un certain nombre prolongements permettant de resituer et d’expliquer l’économie d’armement dans le contexte global d’évolution du capitalisme, de ses contradictions et ses crises. Ce sont les thèmes que nous développerons dans cette deuxième partie de notre triptyque. La première étant parue le 15 mai 2016, sur ce site, sous le titre général: «Géopolitique et économie de la guerre et du terrorisme».
Ce qui distingue fondamentalement cette approche des précédentes, c’est que le point de départ de l’analyse est la prise en compte du profit et de sa nécessaire réalisation dans le cadre du capitalisme. Dans un système régi par la loi du profit, il est nécessaire d’extraire la plus-value tirée du travail afin que les détenteurs de capitaux puissent réaliser un profit suffisant afin, non seulement d’amortir les capitaux engagés dans la production, mais aussi d’assurer la reproduction du système lui-même. Cette contrainte, inhérente au mode de production capitaliste, est d’autant plus pressante en période de crise.
A/ LE MILITARISME : UN CHAMP HISTORIQUE D’ACTION DU CAPITAL
Historiquement, on l’a vu, les activités de guerre ont toujours eu un rôle déterminant dans l’histoire du capitalisme. Elles ont soutenu toutes les étapes de l’accumulation du capital et de l’expansion économique et souvent territoriale des Etats en cours d’industrialisation. Le militarisme a servi notamment à élargir les sphères d’investissement et d’intérêt du capital européen dans de nouveaux territoires avec une phase d’expansionnisme colonial très marquée dès la fin du XIXème siècle. Il a par exemple permis d’imposer des concessions de chemins de fer dans des pays économiquement arriérés afin d’en exploiter les matières premières. Il est aussi intervenu pour faire respecter les droits du capital européen dans les emprunts internationaux. C’est certainement Rosa Luxembourg qui, dès le début du XXème siècle, a le mieux analysé cette dimension impérialiste du capitalisme en faisant du militarisme «un champ historique d’action du capital »[1].
B/ L’INCONTOURNABLE REPRODUCTION ÉLARGIE DU CAPITAL
Les processus généraux de l’accumulation du capital et de la reproduction ne peuvent être appréhendés qu’au niveau de l’économie globale. Rappelons simplement que la condition première pour que l’investissement se réalise, c’est que la rentabilité du capital investi puisse être assurée, c’est-à-dire que les marchandises produites trouvent un débouché sur un marché d’acheteurs solvables. En cela, la production des marchandises, dans une économie marchande, ne peut être dissociée de sa réalisation, c’est-à-dire de sa vente sur le marché. Ce décalage entre production et réalisation est un des premiers éléments de « rupture » dans la mise en valeur du capital et constitue un des éléments à l’origine des crises périodiques de surproduction. Ce principe général vaut aussi pour le « marché » spécifique de l’armement[2].
Le capital n’a pas seulement pour vocation d’assurer une production « vendable », il lui faut aussi se reproduire comme capital, c’est une nécessité pour que le capitalisme puisse non seulement se maintenir comme système mais aussi se développer comme tel. L’accumulation du capital ne saurait donc être dissociée de sa reproduction : reproduction simple et reproduction élargie selon la distinction proposée par les schémas de Marx [3].
Bien que ces schémas soient présentés de façon statique et en « économie fermée », ils mettent en évidence la rupture de proportionnalité entre les deux sections, celle des moyens de production d’un côté, celle des moyens de consommation, de l’autre. La reproduction simple suppose que l’ensemble des biens produits (de la première et de la seconde section) soient absorbés par le marché, le capital utilisé étant remplacé à l’identique et continuant à produire dans les mêmes conditions, en postulant notamment la technologie inchangée. Cette situation, purement théorique, ne correspond évidemment pas à la réalité de la vie économique.
Il faut donc considérer le passage à la reproduction élargie. Très schématiquement, c’est au niveau de l’accumulation du capital dans la section I, celle des moyens de production, que le problème doit être analysé[4]. En régime capitaliste, c’est en effet là que la reproduction du capital se fait en priorité. Elle ne peut se faire à l’identique dans la mesure où le capital, pour se valoriser, n’a pas seulement besoin de réaliser le profit issu de la plus-value, il lui faut aussi se « reproduire » comme capital, quelque soient les circonstances. Ce n’est pas seulement une nécessité pour le capitaliste individuel qui doit dégager un bénéfice de son investissement, c’est aussi valable pour la classe capitaliste considérée dans son ensemble. Dans cette optique, il est nécessaire de trouver des « champs » de mise en valeur où les mécanismes de la surproduction puissent être, au moins en partie, surmontés.
Ce qui pousse à la « reproduction élargie » dont précisément l’industrie d’armement nous fournit, dans un secteur spécifique, un exemple, c’est la nécessité de surmonter la crise d’un système dont une des manifestations les plus tangibles est la surproduction de biens d’équipement et de marchandises. Cette surproduction n’apparaît pas toujours physiquement sur le marché sous forme de stocks d’invendus, elle est latente dans la mesure où elle découle naturellement des impératifs de valorisation des capitaux disponibles et de la concurrence, désormais mondialisée, entre firmes et producteurs. Cette surproduction latente ne signifie évidemment pas que les besoins de la population soient satisfaits. Une de ses causes provient précisément de la faiblesse des salaires et des revenus du travail qui découlent de la mise en valeur. L’insuffisance de la « demande solvable » issue du revenu salarial (en intégrant aussi le fait qu’une partie du salariat puisse être sans emploi) empêche que le marché soit en mesure d’absorber la masse des biens de consommation produits. La surproduction se manifeste aussi indirectement par le taux d’utilisation des capacités productives, c’est-à-dire l’utilisation plus ou moins importante des équipements déjà installés. Avec la crise, s’est révélée, dans la plupart des grands pays industriels, une sous-utilisation chronique du potentiel de production qui se révèle souvent au moment de la crise (voir aujourd’hui l’exemple de la Chine avec ses énormes surcapacités industrielles et immobilières).
Rappelons aussi que la production capitaliste n’a pas pour but la consommation en elle-même, elle a pour objectif de créer de la valeur. Procès de production et procès de reproduction sont régis par des rapports de valeur. D’un point de vue capitaliste, la reproduction élargie, bien qu’elle prenne la forme de marchandises ou de biens est d’abord un moyen d’augmenter la production de plus-value et de profit qui en découle. On conçoit également que les changements dans la productivité du travail pendant la reproduction modifient les relations entre production de marchandises et production de valeur[5].
C/ L’ÉTAT : SUPPORT OBLIGÉ DE L’ÉCONOMIE DE GUERRE
On aboutit donc à une situation particulière : la consommation des salariés (les « moyens de consommation nécessaires » selon Marx, celle qui consiste à entretenir la force de travail selon les standards de chaque époque) est limitée par le niveau d’emploi et de salaire (hors éventuelle redistribution mais en tenant compte des impôts reversés à l’Etat). L’extension du secteur II des biens de consommation trouve là ses limites car la consommation « nécessaire » pour la classe capitaliste n’est pas extensible.
Pourtant cette classe privilégiée dispose, héritée de la période antérieure, d’une plus-value disponible qu’elle doit utiliser, d’une manière ou d’une autre. Une part de cette « plus-value réalisée » peut bien évidemment faire l’objet de dépôts en banque ou de placements financiers ou boursiers, rapporter « passivement » intérêts ou dividendes. Encore faut-il que les marchés de la finance soient en mesure d’offrir une rémunération suffisante[6].
Mais, en tout état de cause, il ne s’agira pas là d’une « valorisation productive » permettant de reproduire le capital. Il faut, pour ce faire, « retrouver » le marché du travail (au sens large) et en extraire une plus-value nouvelle, en dégager de nouveaux bénéfices. C’est là la condition incontournable de la reproduction élargie.
 C’est en ce sens que Marx proposait de considérer à côté des moyens de consommation nécessaires, les « moyens de consommation de luxe » qui, nous dit-il, « n’entrent que dans la consommation de la classe capitaliste et ne peuvent donc être échangés que contre de la plus-value, qui n’échoit jamais à l’ouvrier »[7]. Les biens de luxe peuvent en effet constituer une demande supplémentaire, une « troisième demande » qui va stériliser une partie des profits non réinvestis. Cette consommation, souvent ostentatoire, réservée aux plus riches, aux gros patrimoines, fait l’objet d’un marché spécifique qui peut tenter d’échapper en partie aux lois générales de la concurrence[8].
C’est en ce sens que Marx proposait de considérer à côté des moyens de consommation nécessaires, les « moyens de consommation de luxe » qui, nous dit-il, « n’entrent que dans la consommation de la classe capitaliste et ne peuvent donc être échangés que contre de la plus-value, qui n’échoit jamais à l’ouvrier »[7]. Les biens de luxe peuvent en effet constituer une demande supplémentaire, une « troisième demande » qui va stériliser une partie des profits non réinvestis. Cette consommation, souvent ostentatoire, réservée aux plus riches, aux gros patrimoines, fait l’objet d’un marché spécifique qui peut tenter d’échapper en partie aux lois générales de la concurrence[8].
Parce qu’elle est assurée avec des profits déjà acquis, financée en fait grâce à un revenu déjà distribué, cette consommation de luxe n’est pas susceptible de contribuer à la mise en œuvre d’un nouveau cycle productif. Pour certains auteurs marxistes elle apparaît même négativement comme un obstacle à ce processus de reproduction la considérant comme une « consommation improductive ».
En fait, après la répartition « primaire » du produit entre salariés et détenteurs du capital qui, on l’a vu, a trouvé ses limites, il faut envisager pour que l’accumulation puisse se poursuivre, qu’elle s’opère d’une autre manière. L’Etat, comme expression politique des intérêts des classes dirigeantes, intervient ici pour générer et financer de nouveaux champs d’investissement où, condition indispensable, les biens produits pourront être, sinon toujours vendus, mais payés.
Le rôle de l’Etat découle naturellement de son pouvoir politique et de sa fonction de collecteur de l’impôt et de taxes au compte de la société dans son ensemble. La redistribution de revenu qui va alors s’opérer ne concerne pas seulement la classe salariée au sens large mais aussi les différentes catégories de commerçants, d’artisans, d’indépendants soumis à l’impôt direct, en particulier l’impôt sur le revenu. Il concerne aussi les différentes formes d’imposition qui peuvent peser sur les sociétés mais, aujourd’hui, dans tous les grands pays capitalistes, ce sont les impôts indirects, notamment les impôts sur la consommation, ainsi que les impôts sur la propriété foncière ou immobilière qui constituent la plus grande part du produit fiscal.
C’est cette manne financière qui permet à l’Etat d’assurer les principales fonctions régaliennes ; justice, police, sécurité, de payer les fonctionnaires, d’assurer une certaine redistribution sociale en faveur de certaines catégories de la population. Mais elle lui permet aussi de financer certains services liés à la sécurité nationale et à la défense du territoire ainsi que les matériels et équipements militaires qui lui sont liés.
Il y a là, incontestablement, une sphère particulière de réalisation de la plus-value et de bénéfices réalisés à la « demande » de l’État et qui présente l’attrait d’une nouvelle sphère de réalisation de profits. Les profits qui n’ont pu, faute d’une rentabilité escomptée suffisante, être réinvestis dans des branches en difficulté pourront s’investir dans les activités « nouvelles » que constituent les équipements et les services d’armement. Bien évidemment, ce « transfert » s’effectue à une échelle globale. Il suppose, pour son financement, le recours au crédit et au système bancaire, ainsi que des relais dans les instances de décision des programmes liés aux fournitures d’armes. Il nécessite le plus souvent des compétences et des expertises que ne pourront fournir que les entreprises industrielles et les sociétés importantes et déjà implantées. Ce sont elles qui pourront ensuite organiser, sous leur contrôle, les différentes opérations de sous-traitance vers des unités de production plus petites.
En tenant compte du système d’imposition et de la redistribution qu’il pouvait opérer, Rosa Luxembourg pouvait considérer que, du point de vue social, le militarisme remplissait une double fonction : « en abaissant le niveau de vie de la classe ouvrière, il assurait d’une part l’entretien des organes de la domination capitaliste, l’armée permanente, et d’autre part il fournissait au capital un champ d’accumulation privilégié ».
L’équilibre » recherché des budgets publics est souvent difficile, voire impossible à réaliser, surtout en période d’austérité. La crise rampante actuelle se traduit donc par une pression à la baisse de toutes les formes de prélèvement fiscal : impôts directs sur les revenus salariaux ou immobiliers, impôts indirects notamment les impôts sur la consommation en berne, sur les sociétés qui voient baisser leur chiffre d’affaires. Donc, c’est la dette publique qui va, comme dans d’autres secteurs, permettre d’assurer une partie des financements.
L’endettement public, sous ses différentes formes, est donc, pourrait-on dire, consubstantiel au financement des industries d’armement et des opérations militaires. Bons de guerre, bons d’armement, emprunts « patriotiques » ou de la défense nationale : autant de formules du passé qui ont permis historiquement d’orienter l’épargne disponible vers le financement de la guerre. Aujourd’hui, les méthodes de collecte de l’épargne des citoyens, via les banques ou les différentes formules de crédit, ont changé mais les processus d’endettement, interne mais aussi externe, restent fondamentalement les mêmes.
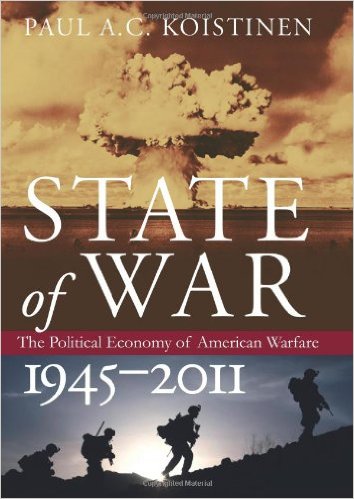 Le secteur de l’armement, parce qu’il est largement impulsé et financé par les commandes et les programmes d’Etats souverains dont les objectifs ne sont pas seulement économiques mais aussi politiques, géopolitiques ou tributaires d’impératifs d’hégémonie ou de puissance, est un support privilégié d’investissement pour les entreprises ou les groupes orientés vers des productions d’équipements ou de services militaires dont on sait à l’avance que le « débouché », la guerre, sera assuré.
Le secteur de l’armement, parce qu’il est largement impulsé et financé par les commandes et les programmes d’Etats souverains dont les objectifs ne sont pas seulement économiques mais aussi politiques, géopolitiques ou tributaires d’impératifs d’hégémonie ou de puissance, est un support privilégié d’investissement pour les entreprises ou les groupes orientés vers des productions d’équipements ou de services militaires dont on sait à l’avance que le « débouché », la guerre, sera assuré.
Car, pour un investisseur, qu’il soit entrepreneur, banquier ou gestionnaire de fonds, peu importe le secteur d’activité s’il est en mesure d’en tirer un bénéfice[9]. Les investissements de la production pour la guerre font certes passer les profits de certains capitalistes dans la poche des autres mais ils ont surtout pour résultat de contribuer à leur concentration. Mais au niveau économique, il ne s’agit que d’une modification dans la forme matérielle de la reproduction.
Tels sont les mécanismes fondamentaux du capitalisme qui font de l’industrie de guerre, un « mal obligé », une forme d’ exutoire pour capitaux en quête de placement et de mise en valeur. Les circuits financiers qui alimentent ces processus sont certes devenus plus complexes et sophistiqués. Il faut en particulier tenir compte du rôle devenu essentiel du système de crédit et de banque dans le financement des contrats d’armement. Il faut aussi considérer le rôle essentiel des multiples formes d’aide de l’Etat, directes (subventions) ou indirectes (crédits ou reports d’impôts, exemptions fiscales). Souvent peu transparentes, elles n’en sont pas moins essentielles dans les processus de décision. Ce sont ces mécanismes économiques qui sont à l’œuvre et qui permettent de comprendre que les guerres ne sont pas simplement « absurdes » ou « irrationnelles », menées par des politiciens inconscients ou immoraux, mais qu’elles découlent, en régime capitaliste, des lois fondamentales de la concurrence.
D/ L’ARMEMENT : STIMULANT DE LA PRODUCTION OU GASPILLAGE IMPRODUCTIF ?
On peut maintenant tenter de préciser le rôle de l’économie de guerre dans le fonctionnement global du capitalisme, en particulier dans un contexte de crise. Les dépenses d’armement contribuent-elles à la reproduction élargie du capital telle que définie précédemment ou doit-on les considérer comme improductives ? En quoi pourraient-elles, à certains moments, constituer une réponse à la crise du mode de production ou permettre de surmonter, pour un temps, les obstacles à la mise en valeur du capital ?
Pour Boukharine, un des premiers théoriciens de l’ère pré-soviétique à aborder, à partir de l’expérience de la première guerre mondiale, les questions de la guerre et de l’impérialisme, l’économie de guerre aurait un rôle franchement régressif, conduisant à une « sous-production » croissante ou une « reproduction élargie négative » du capital. Il estimait que les dépenses d’armement ne pouvaient, en aucune manière favoriser le système productif. Ces dépenses étaient non seulement improductives mais destructives car détournant les ressources de la société d’usages plus utiles. Cet aspect destructif ne pouvait donc constituer la base d’un nouveau cycle puisque « ni les canons, ni la poudre » ne pouvaient réapparaître dans le cycle productif suivant. Il en allait de même pour le « travail vivant du soldat » : à la différence du travail dans la production, il ne servira plus dans le futur à créer de la valeur et à générer de la plus-value[10]. La guerre engendre donc un procès de reproduction « régressif », perverti, puisque produisant une marchandise bien particulière, un moyen de destruction, qui n’est ni un moyen de consommation, ni un moyen de production reproductible.
On ne saurait nier que, du point de vue de sa « valeur d’usage », l’armement doive être considéré comme un bien de « destruction » puisque destiné à tuer. Mais, du point de vue de l’économie capitaliste, produire des moyens de « destruction », c’est continuer à produire. On l’a rappelé plus haut : lors du réarmement de l’après-guerre et de la Guerre froide, les dépenses militaires avaient alimenté, pendant un temps, un « boom » de l’économie dans les pays en conflit, contribuant à relever leur taux de croissance. Les tenants de « l’économie permanente d’armement » avaient même vu là un moyen d’éloigner, pour un temps », « la crise finale » du capitalisme[11].
Mais les avantages économiques de court-moyen terme de la production de guerre ne sont bénéfiques que pour les entreprises de guerre. Car, à plus long terme, comme cela s’est produit en Indochine et au Vietnam, ainsi que plus tard en Afghanistan et en Irak, le bilan des « désengagements » et des défaites a été politiquement très lourd. Plus particulièrement au Vietnam, outre les destructions massives effectuées, le coût humain, politique et sociétal de la guerre a été considérable. Les « bénéfices » politiques et économiques, en particulier pour les Etats-Unis, avaient été largement négatifs pour la société et suscité un mouvement mondial d’indignation et de protestation qui a non seulement contribué à la remise en question de leur hégémonisme militaire en Asie et dans le monde mais aussi exacerbé les tensions sociales dans le pays lui-même.
E/ LA GUERRE ET LA DESTRUCTION-DEVALORISATION DU CAPITAL
Un autre moyen d’appréhender l’économie de la guerre consiste à questionner la nature même du capital et la manière dont il peut, dans le cadre d’un régime régi par la loi du profit, se mettre en valeur.
Le capital, au sens large du terme, c’est-à-dire comme forme générale de la valeur accumulée dans la société et pouvant prendre différentes formes (capital marchandise, capital productif, capital argent) possède un caractère éminemment contradictoire qui peut permettre d’illustrer la spécificité de la « production pour la guerre ». Cette contradiction, inhérente à la mise en valeur, concerne le processus de valorisation-dévalorisation. Selon une formule de Marx : « Le procès de valorisation est en même temps son procès de dévalorisation »[12]. Cette notion de dévalorisation est assez facile à appréhender, elle consiste en fait dans une forme de purge permanente du système, ce qui permet en quelque sorte à ce système de se régénérer. Schumpeter en est proche lorsqu’il parle de « destruction créatrice ». Mais c’est peut-être Henryk Grossman qui, dès 1929, dans une vision considérée par beaucoup comme catastrophiste, en donnait la description la plus cohérente :
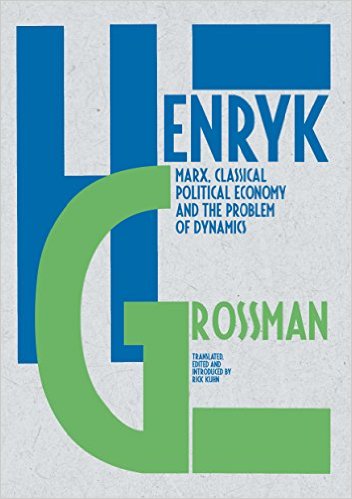 « Les destructions et la dévalorisation dues à la guerre sont un moyen de prévenir l’effondrement [du système], de créer un espace de respiration pour l’accumulation du capital..La guerre et la destruction de valeurs-capital qui lui sont liées retardent l’effondrement du système et fournissent une nouvelle impulsion à l’accumulation.. Le militarisme est une sphère de consommation improductive. Au lieu d’être sauvées, les valeurs sont pulvérisées »[13].
« Les destructions et la dévalorisation dues à la guerre sont un moyen de prévenir l’effondrement [du système], de créer un espace de respiration pour l’accumulation du capital..La guerre et la destruction de valeurs-capital qui lui sont liées retardent l’effondrement du système et fournissent une nouvelle impulsion à l’accumulation.. Le militarisme est une sphère de consommation improductive. Au lieu d’être sauvées, les valeurs sont pulvérisées »[13].
Cette destruction de la valeur-capital à travers les crises est un phénomène récurrent. Elle l’est aussi à travers les guerres et leur financement. Il y a, dans la production d’armements, une forme d’absurdité, mais c’est en fait l’absurdité du mode capitaliste de production lui-même qui, à tout moment, a besoin de s’autodétruire pour se régénérer, de « purger » le capital en excédent. « La barrière du capital, c’est le capital lui-même » selon la formule bien connue de Marx : pour les nécessités de la mise en valeur, il faut remettre en cause l’existence du capital existant.
Le processus de dévalorisation du capital est un processus continu qui procède des mécanismes généraux de la concurrence et des mutations technologiques qui en découlent. Particulièrement marqué en période de crise, il se traduit par une « destruction » permanente de la valeur de capitaux déjà investis dans la production et qui, suite à des pertes de marché de certains biens ou de la mise en œuvre de nouvelles technologies moins coûteuses, ne sont plus compétitifs vis-à-vis de leurs concurrents. Les capitaux concernés , qu’ils prennent la forme d’équipements, de bâtiments, de machines, mais aussi de logiciels ou de procédés exclusifs de production (brevets) , « sortent » en fait du circuit productif et, devenus obsolètes, ne rapportent plus rien à leurs détenteurs. La dévalorisation du capital peut être très rapide. Elle doit être, au plan comptable, distinguée de l’obsolescence du capital, processus « normal » d’usure qui peut bénéficier d’un amortissement périodique, c’est-à-dire être organisé de manière à pouvoir renouveler ce capital en vue d’un nouveau cycle.
Face à ce constat, le sempiternel débat sur la logique économique de l’industrie de guerre ne manque jamais de resurgir. Pourquoi les canons plutôt que le beurre? Stiglitz et Bilmes dans l’ouvrage précité (p.148) l’expriment à leur manière :
« L’argent dépensé en armements est de l’argent jeté par les fenêtres : s’il avait servi à faire des investissements dans des usines et des machines, dans des infrastructures, dans la recherche, dans la santé, dans l’éducation, on aurait accru la productivité de l’économie et la production future aurait été supérieure »
Qui ne saurait souscrire à ce constat d’évidence ? Mais cette vision irénique s’oppose aux contraintes du système et aux lois générales de l’accumulation évoquées plus haut. La logique du capitalisme, son « carburant », n’est pas « d’améliorer la productivité » mais de réaliser des investissements « rentables », c’est-à-dire des profits. Nous touchons là aux limites même du capitalisme et au fait que l’argent disponible ne peut s’investir que dans des secteurs pouvant lui assurer un rendement suffisant, ce qui n’est évidemment pas le cas de la plupart des activités « sociales » ou à but non lucratif. Dans le cadre d’un système régi par la loi du profit, dominé la recherche à tout prix de la rentabilité, il n’est malheureusement pas possible de choisir entre « le beurre et les canons »[14].
F/ L’ARMEMENT : UN SECTEUR CLÉ DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Au plan technologique, la guerre a toujours été dépendante du degré de développement des sociétés et de leurs capacités productives. Aux armées de l’Ancien régime qui faisaient un large appel au mercenariat succédera, au moment de la Révolution française, le « soldat-citoyen » mis au service la Nation, dans le cadre d’une armée de conscription mais le « service de guerre » reste assuré par l’homme au prix de pertes considérables.
Les techniques de guerre n’évolueront véritablement qu’avec les progrès de l’artillerie mais les masses mobilisées restent relativement réduites. Ainsi pendant les guerres napoléoniennes, la France n’a jamais mobilisé plus d’un demi-million de soldats (dix fois moins pour l’Angleterre). C’est certainement la Guerre de Sécession américaine qui constitue la première guerre « moderne », tant au niveau de l’armement qu’au niveau des pertes humaines que des destructions occasionnées. Mais c’est la Première Guerre mondiale qui sera l’archétype de la véritable « économie de guerre » non pas seulement par rapport aux soldats mobilisés (5 millions pour la France, 40 fois plus qu’époque napoléonienne) mais aussi quant à l’implication de la population dans la guerre et la mise en œuvre de moyens matériels lourds dans tous les secteurs.
La technologie des armes n’a cessé depuis lors de se perfectionner avec souvent, pendant les guerres elles-mêmes et sous la pression du déroulement des opérations militaires, la mise en service de nouveaux armements plus performants et destructeurs[15]. Les préparatifs et le déroulement de la seconde guerre mondiale conduiront à l’essor d’une énorme « économie d’arsenal », notamment en Allemagne et aux Etats-Unis avec une production militaire de masse. Dans les grandes unités de production où les travailleurs non-soldats sont concentrés, il est possible d’augmenter considérablement la productivité du travail, puis de tester sur le champ de bataille, presqu’en temps réel, l’efficacité des matériels fabriqués. Les contraintes de la guerre font de la militarisation de la main-d’œuvre, notamment féminine, la composante d’une nouvelle organisation du travail préfigurant le fordisme de l’après-guerre. Le système est souple, capable d’adaptation rapide, ce qui explique la progression spectaculaire des fabrications à certaines périodes. On a donc une forme de « cycle militaire » qui subordonne toute la production aux exigences de l’économie de guerre, pas seulement pour la fourniture des matériels militaires mais aussi pour la production et la répartition des biens alimentaires de base.
Les progrès de la technologie, en matière militaire moins qu’ailleurs, ne peuvent donc être analysés en eux-mêmes, ils doivent être considérés en relation avec les « évènements de guerre » et la dynamique globale du système d’accumulation. Il y a déjà 30 ans, un auteur pouvait affirmer concernant la France :
« l’armement est de toute évidence un secteur à technologie de pointe; d’une part les matériels eux-mêmes incorporent les plus récentes avancées technologiques, d’autre part les processus de production font appel aux techniques les plus sophistiquées. La maîtrise technologique est, dans l’armement, un facteur de succès déterminant, le moindre retard technologique peut rendre un matériel obsolète »[16].
Cette analyse reste parfaitement actuelle et, dans le prolongement de la démarche théorique que nous avons adoptée jusqu’ici, nous pouvons également considérer que, globalement, dans le secteur de l’armement considéré comme tel, la composition organique du capital sera plus élevée que dans d’autres secteurs de production (davantage de capital associé à une part relativement moindre de travail). D’où à terme, là encore, dans un contexte de concurrence (et toutes choses égales par ailleurs) une nouvelle pression à la baisse du taux de profit.
Au-delà d’un certain niveau de complexité, la production d’armements modernes est seulement possible dans des pays possédant les industries d’ingénierie, les centres de recherche les plus développés, les mieux équipés et les plus innovants. C’est un processus qui s’auto-renforce et qui se traduit par une plus forte intensité en capital, en fait vers des technologies de plus en plus sophistiquées. De ce point de vue, comme le rappelle un économiste anglais, l’explosion de la bombe d’Hiroshima n’a pas été un évènement isolé, elle était l’aboutissement logique des recherches de pointe sur la bombe, de l’industrie de guerre de son époque[17]. En période de conflit, on l’a notamment constaté durant la seconde guerre mondiale en Allemagne et aussi aux Etats-Unis, on peut assister à des reconversions massives de matériels, ne serait-ce qu’en raison de leur inefficience ou de leur destruction par l’ ennemi (voir l’exemple des avions de combat pendant la guerre americano-japonaise).
Les spécificités de l’armement en font un secteur où, grâce aussi aux dépenses de recherche-développement financées par l’Etat, certaines innovations technologiques pourront être rapidement mises en œuvre. L’exemple parfois cité de « l’invention » de l’ordinateur qui aurait été largement déterminé par les besoins de l’armée américaine pendant la Guerre froide est certainement trop simpliste. Mais, pour les défenseurs de l’économie d’armement, l’intervention de l’Etat dans le secteur a souvent été justifiée par les retombées positives que ces innovations de pointe pourront avoir notamment sur le secteur civil. L’exemple de l’aviation militaire où l’évolution des technologies en matière de matériaux, de motorisation, de systèmes électroniques de guidage ou autres pourraient aussi bénéficier à l’aviation civile vient immédiatement à l’esprit, ne serait-ce que parce que les deux catégories d’appareils sont souvent produites par les mêmes firmes multinationales. Au niveau mondial, comme en France, la plupart des firmes d’armement sont « multi-produits », avec le plus souvent une filière dominante. C’est au niveau des producteurs de la sous-traitance, très dépendants des donneurs d’ordre que s’opère la spécialisation. En fait, plusieurs études, notamment aux Etats-Unis, ont montré que les retombées civiles d’innovations dérivées du militaire étaient beaucoup plus réduites qu’escomptées compte tenu de coûteux processus d’adaptation.
Sans approfondir ici ces problèmes, nous évoquerons simplement deux innovations en cours de mise au point et même déjà mises en œuvre dans certaines armées : les drones et les robots. Là encore il est nécessaire de ne pas considérer la technologie en elle-même mais de chercher à l’inscrire dans les processus d’ensemble de la mise en valeur analysés plus haut. En cela, la démarche proposée par A. Krishnan est très stimulante car elle montre que la technologie n’est pas seulement déterminante dans le mode d’action des armées mais qu’elle est aussi un facteur d’impulsion décisif dans les processus actuels de privatisation de l’action militaire [Krishnan, 2008][18].
Le premier exemple concerne la dernière innovation issue de la révolution cybernétique : le drone comme instrument de surveillance de l’ennemi mais qui peut très vite devenir drone « armé » ou drone « chasseur-tueur ». La guerre contre le terrorisme, forme de guerre asymétrique, devient alors « unilatérale » puisqu’il devient possible de tuer sans mourir. Comme le rappelle G. Chamayou, on n’est plus dans le combat, avec ses « risques » humains , on entre dans l’extermination. Non plus seulement « surveiller et punir » mais surveiller et anéantir[19]. Il ne s’agit plus de l’action militaire de la guerre conventionnelle mais d’un pouvoir de police « létal » qui n’a plus de frontières, une guerre bien particulière assimilable à «un télétravail pour employés de bureau » si l’on se réfère au rôle des militaires comme pilotes de drones[20].

Alliée à la technologie des drones, l’automatisation croissante de la guerre débouche sur l’utilisation des « robots tueurs », robots létaux autonomes (RLA) définis par l’ONU comme « systèmes d’armes pouvant sélectionner et attaquer des cibles sans intervention humaine ». Désormais, les hommes seraient considérés comme les « maillons faibles » de l’arsenal militaire. En effet, l’usage des robots au sein des forces armées doit s’analyser comme un changement radical dans la « combinaison productive » de l’institution : davantage de capital technologique au détriment du travail. Utiliser des robots c’est permettre à la ressource humaine (rare et coûteuse) de se concentrer sur les tâches où elle peut apporter une valeur ajoutée spécifique et de la décharger d’activités annexes pouvant être confiées à la machine. Cela suppose évidemment un bouleversement complet de l’organisation militaire terrestre[21]
Selon une directive de l’ONU de fin 2012, les robots militaires devraient rester « supervisés par l’homme, agissant dans le respect des traités et des lois de la guerre ». Une campagne d’opinion mondiale a été engagée pour interdire les robots tueurs mais le marché des drones et des robots à usage militaire concerne, aux Etats-Unis, un marché de plusieurs milliards de dollars avec plusieurs grandes sociétés en concurrence. Pour l’heure, l’avance technologique américaine dans le domaine lui donne un avantage incontestable[22] mais tous les autres pays sont concernés.
Les considérations éthiques à propos de l’usage des drones et des robots-tueurs questionnent à nouveau le sens du progrès technologique appliqué à la guerre. Elles rejoignent toutes les questions liées à la nouvelle « guerre sécuritaire », aux nécessités de préserver les libertés individuelles et la vie privée qui ne seront pas abordées ici.
G/ POLITICIENS DE GUERRE ET COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL
On a déjà relevé comment, notamment à l’occasion des deux grands conflits mondiaux du XXème siècle, l’économie de guerre s’était organisée et développée sous l’égide de l’Etat et du pouvoir politique. Pour nous, l’Etat ne saurait être ici simplement considéré, dans une vision purement fonctionnaliste, comme l’exécutant neutre et impartial des tâches régaliennes habituelles de police, de justice ou de défense. Il est certes traversé d’intérêts contradictoires mais, dans un système libéral de marché, il représente d’abord des intérêts privés extrêmement puissants, ceux-là mêmes capables de faire prévaloir les impératifs économiques et politiques du militarisme. La dimension idéologique des conflits doit évidemment être prise en compte. Il faut convaincre de la légitimité de la guerre et c’est l’Etat qui sera l’initiateur et l’instrument principal de la « propagande de guerre », mettant notamment l’accent sur la dimension patriotique du conflit ou « l’intérêt national ».
L’économie de guerre, au sens strict, conduit au dirigisme de guerre. Au moment de la 1ère guerre mondiale, on a pu même pu parler de « socialisme de guerre ». La militarisation du temps de guerre n’implique pas seulement une production massive d’armements, elle suppose aussi la remise en cause des acquis sociaux et du niveau de vie de la population. Le contrôle des sources d’approvisionnement, la fixation des prix des biens de base, le rationnement de la consommation font partie des mesures qui pourront être mises en œuvre. Des exemples historiques de ce type de situation ont déjà été évoqués: l’économie nazie sous la dictature d’Hitler, l’économie russe sous Staline mais aussi aux Etats-Unis et en Europe pendant la seconde guerre mondiale. On a constaté précédemment que, dans ces situations, des institutions « ad’hoc » se mettent en place, le plus souvent sous le contrôle direct du pouvoir politique, ouvrant de fait la voie à des mesures d’exception.
Ce « dirigisme de guerre tend à se prolonger dans l’après-guerre, que ce soit pour les besoins de la reconstruction économique et des infrastructures ou en raison de la volonté politique de « solder » les comptes du conflit, en particulier par des mesures de « réparation » ou des indemnités de guerre imposées aux « vaincus »[23].
Dans un contexte différent, il y a des exemples plus récents comme celui des Etats-Unis de l’après 11 Septembre 2001 où la politique intérieure du pays a été en partie adaptée pour faire face aux impératifs de la nouvelle guerre, proclamée « sans fin, sans limites et sans frontières contre le terrorisme » par le Président américain Bush. Elle s’est traduite par une réorientation du mode de gouvernance du secteur de la Défense américain et un infléchissement très net de la politique économique.
La politique de défense et de sécurité mise en œuvre va se faire dans le sens des conceptions des « néo-conservateurs », fraction « ultra » du parti républicain, déjà très active au moment de la guerre du Golfe. Les instances de décision habituelles, comme le NSC (National Security Council) sont court-circuitées au profit d’un « cabinet de guerre » dominé par ces « faucons » dont une partie possède des intérêts dans le lobby texan du pétrole. C’est aussi une des raisons qui fera que la nouvelle guerre contre le terrorisme sera d’emblée conçue pour être financée en partie par des intérêts privés[24].
Comme l’indique E. Lahille, cette vision néo-conservatrice de l’économie contredit l’orthodoxie néolibérale qui, elle, est fondée sur le marché et donc rejette, par principe, le Politique et l’Etat[25]. Il y a un tournant dans la régulation politique se répercute ainsi sur les décisions de politique économique de façon spectaculaire et rapide.
Les effets négatifs des attentats s’ajoutant à la récession amènent les autorités publiques à abandonner le modèle de « policy mix » des années 1990, imposé par la Fed et fondé sur le primat de la politique monétaire active et la neutralité budgétaire. Le nouveau régime de politique économique consiste en une politique monétaire et budgétaire expansionnistes en rupture avec les pratiques des gouvernements démocrates et même l’orthodoxie néolibérale elle-même. A partir de 2002, la Réserve Fédérale va, pour la première fois depuis 1945, fixer des taux d’intérêts négatifs pour favoriser la dépense publique et le déficit budgétaire se creuse fortement. Certains économistes ont même cru voir là un retour à une politique keynésienne. D’autres, plus lucides, ont mis en évidence la signification hautement politique de cette évolution[26].
On peut estimer que cette nouvelle orientation va favoriser l’émergence d’une « bulle sécuritaire » de financement, largement spéculative, qui contribuera, à son niveau, à la crise financière américaine initiée en 2007-2008[27].
Cette discussion nous incite également à revenir sur l’utilisation du terme « Complexe militaro-industriel », pour désigner l’ensemble des inter-relations entre l’économie de la guerre, le système politique et institutionnel, la hiérarchie militaire et les différentes catégories d’agents (dont les experts) pouvant intervenir dans le processus de production et de vente des armements. Ce terme, hérité d’un discours de Eisenhower, mais avec des racines plus anciennes [Koistinen, 1977][28] mettait en cause le rôle néfaste d’un « lobby » militaire puissant et vorace, susceptible de menacer les prérogatives de l’Etat et même d’attenter à la liberté des citoyens. Même si cette dimension n’a certainement pas disparu, le terme, qu’il faut supposer évolutif, exprime bien la complicité-duplicité , la symbiose pourrait-on dire, entre les magnats de l’industrie d’armement, les hommes politiques au pouvoir et les responsables militaires[29].
_____
[1] LUXEMBOURG Rosa [1967]: « L’accumulation du capital » , Tomes I et II, [1967] Ed. Maspéro. Paris.
[2] Dès l’instant où l’on admet que le capitalisme se caractérise par la recherche du profit, il faut aussi tenir compte d’une contrainte inhérente au système lui-même. L’accumulation du capital, compte tenu de la concurrence, doit se faire de manière à utiliser les moyens les plus efficaces pour produire à moindre prix. Soit en baissant le coût de travail, soit en en utilisant une technique de production plus efficiente (plus de capital engagé par rapport au travail). Ce dernier moyen conduit à l’élévation de la « composition organique du capital ». Moins de travail face à davantage de machines pour le dire simplement. Mais le profit ayant pour origine la plus-value issue du travail, le capitaliste voit, dans le même temps, se réduire la « base d’extorsion » de cette plus-value, et donc diminuer son profit, « baisse tendancielle du taux de profit ». Pour comprendre les mécanismes conduisant à la guerre, il nous faudra tenir compte de l’évolution divergente de ces deux éléments. Une tendance permanente, indépendante de la conjoncture mais d’autant plus prégnante en temps de crise.
[3] MARX K. : « Le Capital », Livre II, chap.XX et XXI, pp. 46-167, Editions Sociales.
Cette reproduction découle du classique « partage » entre la production des “moyens de production” (section 1) et la production “des moyens de consommation” (section 2). A l’issue de chaque phase de l’accumulation, il est nécessaire d’écouler les biens produits, qu’il s’agisse des équipements « pour produire » (machines, matières premières) du secteur I ou des « biens de consommation » destinés à renouveler la force de travail dans les deux secteurs. Sous la pression continue de la concurrence, la composition organique du capital tend à s’élever, ce qui conduit notamment à ce que les biens de consommation produits excédent les capacités d’achat des travailleurs remettant ainsi en cause la « profitabilité » des investissements dans le secteur II. De la même manière, le secteur I, secteur « traditionnel » des biens de production rapportera des profits en baisse. (p.56-57).
Il est donc nécessaire de trouver de nouveaux champs rentables pour l’accumulation du capital et sa valorisation.
[4] En termes très généraux, Marx résume ainsi le processus : « Pour qu’on puisse passer de la reproduction simple à la reproduction élargie, la production dans la section I doit être capable de fabriquer moins d’éléments du capital constant pour II, mais d’autant plus pour I. Cette transition, qui n’ira pas toujours sans difficultés, est facilitée par le fait qu’un certain nombre de produits de I peuvent servir de moyens de production dans les deux sections », Le Capital, op.cit., L.II, tome V, p. 143. Editions Sociales.
[5] La formule générale de la reproduction élargie sous le règne du capital pourrait donc se formuler ainsi: C + V+ S/X + S’ , C étant le capital constant (les équipements de production), V le capital variable (la main d’œuvre), S la plus-value, S/X étant la plus-value appropriée dans une période antérieure de production et S’ la plus-value additionnelle créée par le nouveau investi. Une partie de cette plus-value est capitalisée à nouveau et la reproduction élargie est ainsi, du point de vue du capitaliste, un procès constant et fluide (et fluctuant) d’appropriation alternée et de capitalisation de plus-value.
[6] Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui compte tenu de taux d’intérêt historiquement bas et de l’abondance des liquidités sur le marché, due pour partie à la politique des banques centrales.
[7] MARX K. : « Le Capital…», op. cit ., Tome V, p. 55 et suiv. .
[8] Ainsi, plusieurs années après la crise de 2008, la production de luxe a continué à se développer, portée par la croissance relative de nouveaux « émergents » et la croissance chinoise. En période de crise, les biens de luxe peuvent en outre temporairement constituer des « valeurs-refuge » pour faire face à l’incertitude.
[9] Comme l’indique R. LUXEMBOURG : « Tant que l’on envisage le capitaliste individuel, il importe peu à celui-ci que la production soit orientée vers telle ou telle branche. Pour lui, il n’existe pas de sections de la production globale telles que les établit le schéma [de reproduction]. Il n’y a que des marchandises et des acheteurs, il lui est donc tout à fait indifférent de produire des vivres ou des engins de mort, des conserves de viande ou des plaques blindées ». «L’accumulation du capital », op.cit. Chap.32: Le militarisme, champ d’action du capital
[10] BOUKHARINE N.I. [1915] : « Imperialism and World Economy », Chap.13: War and Economic Evolution, www.marxists.org. archive .
[11] Ainsi Tony CLIFF qui considérait comme improductives les dépenses d’armement mais qui, du point de vue de l’accumulation du capital, estimait qu’elles avaient comme résultat direct un effet de « boom » qui venait s’ajouter au cycle économique global et lui permettaient de fonctionner à plein rendement, contribuant ainsi à résoudre la question de l’emploi (op.cit.)
[12] Textes de 1856-1857 rassemblés en français dans : MARX K. : « Fondements de la critique de l’économie politique », Editions Anthropos , 1969. Paris. Tomes I et II. p.380, tome 1.
[13] GROSSMAN H. [1929] : « The Law of Accumulation and Breakdown », marxists.org.archive
[14] Paul MATTICK, indique ainsi, à propos de la Seconde Guerre mondiale : « Considérée dans ses effets, la production de guerre…fut un instrument pour relancer le processus d’accumulation. En ce sens, les subventions versées à l’industrie de guerre eurent pour conséquence d’améliorer à plus long terme la rentabilité du capital. Telle est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les capitalistes s’opposent au lancement de programmes de travaux publics utiles ou d’assistance sociale mais non à l’accroissement du budget de la défense ». MATTICK P. [1970] « Marx et Keynes », Nouvelle édition 2010, Gallimard, page 71.
[15] Ainsi, pendant la 1ère guerre mondiale, le « saut technologique » dans l’artillerie (portée des canons et des obus) et pendant la seconde, la surenchère engagée en matière de navires, de sous-marins et d’avions de combat, en particulier entre les Etats-Unis et le Japon.
[16] DUSSAUGE Pierre [1985] : « L’industrie française de l’armement ». Economica. Paris.
[17] MILWARD A.S. : [1977] : « War, Economy and Society: 1939-1945 » Allen Lane. London Chap. 6: War, Technology and Economic Change.
[18] KRISHNAN A. [2008] : « War as Business. Technological Change and Military Service Contracting». Ashgate.
[19] CHAMAYOU G. [2013] : « Théorie du drone ». La Fabrique. Paris.
[20] Très intéressant, de ce point de vue, le récent film [2014] : « Good Kill » de Andrew NICOL, cinéaste américain, montrant, dans sa base « paisible » de Las Vegas, la conversion d’un ancien pilote de chasse en « pilote » de drone. Une situation avec des objectifs de « morts anonymes» si traumatisante qu’elle le conduit à la folie.
[21] DANET D., HANON J.P. G. BOISBOISSEL, [2012] : « La guerre robotisée », Economica. DOARE R., DANET D., BOISBOISSEL G. [2015] : « Drones et killer robots. Faut-il les interdire ? » . Presses Universitaires de Rennes.
Ces ouvrages collectifs coordonnés par des chercheurs et des militaires de haut rang proviennent du Centre de recherche de Saint-Cyr, ce qui tendrait à montrer que la France n’entend pas se laisser dépasser dans ce domaine.
[22] Voir le dossier « Géo et Politique » : « Le spectre des robots tueurs »., Le Monde, 20 juin 2013.
[23] L’exemple le plus révélateur est celui l’Allemagne du début des années 1920 incapable de verser les indemnités de guerre demandées par les Alliés, ce qui se traduira en 1923 par l’invasion temporaire de la Ruhr par la France en 1923.
[24] Des membres de l’administration Bush, dont le Secrétaire à la Défense D. Rumsfeld, qui avait siégé dans les Conseils d’administration de grandes firmes comme Halliburton ou Blackwater, spécialistes de « services à l’armée » et de reconstruction vont permettre à ces firmes de bénéficier, le plus souvent sans adjudication, de la manne des contrats de guerre et de fournitures.
Voir : KLEIN Naomi [2008] : « La stratégie du choc. La montée d’un capitalisme du désastre ». Actes Sud. Chap. 15 : Un Etat corporatiste (ou comment remplacer la porte à tambour par un portail), p.371 et suiv.
[25] LAHILLE E. [2014] : « Le rôle du mode de régulation politique états-unien dans le déclenchement de la crise économique » Revue de la Régulation, 2ème sem. Automne 2014. https ://regulation.revues.org
[26] CYPHER J.M. [2007] : « From Military Keynesianism to Global-Neoliberal Militarism ». Monthly Review, 59, n°2, Juin.
[27] « De la même façon qu’Internet avait lancé la bulle « point com » , les attentats du 11 Septembre lancèrent celle du capitalisme du désastre…Désormais l’Etat, au lieu d’assurer la sécurité, l’achèterait au prix de marché..» Naomi KLEIN, op. cit., pp.360-61.
[28] KOISTINEN P. A. [1980] : « The Military-Industrial Complex. A Historical Perspective ». Praeger Publishers. New York.
[29] En ce sens, ce terme nous semble mieux adapté que celui de « méso-système », trop directement issu de la « boite à outils » de la théorie industrielle des organisations et évacuant la dimension économique et surtout politique de cette configuration. Voir : SERFATI C. [1995]: “Production d’armes, croissance et innovation” . Economica, chap. 4, p.87 et suiv.


Soyez le premier à commenter