A la lumière des connaissances actuelles en neurosciences, on serait tenté de croire que les vieux préjugés sur les différences biologiques entre les hommes et femmes ont été balayés. Ce n’est manifestement pas le cas: médias et ouvrages de vulgarisation prétendent que les femmes sont «naturellement» bavardes et incapables de lire une carte routière, tandis que les hommes seraient nés bons en maths et compétitifs. Ces discours laissent croire que nos aptitudes, nos émotions, nos valeurs sont câblées dans des structures mentales immuables depuis les temps préhistoriques.
Il est nécessaire de replacer le débat autour de la différence des sexes sur un terrain scientifique rigoureux au-delà des idées reçues. L’enjeu est de comprendre le rôle de la biologie mais aussi l’influence de l’environnement social et culturel dans la construction de nos identités d’hommes et de femmes. [Voir entretien – intitulé «Les neurones ont-ils un genre?» – avec Catherine Vidal sur notre site, publié en date du 27 février 2016.]
Nous les humains, femmes et hommes, avons tous des personnalités et des façons de penser différentes. Mais d’où viennent ces différences? Sont-elles innées ou sont-elles acquises? Quelle est la part de la biologie et quelle est celle de l’environnement social et culturel dans la construction de nos identités? Ces questions sont l’objet de débats passionnés depuis des siècles. Il serait tentant de croire qu’avec les progrès des connaissances, tant en biologie qu’en sociologie, les arguments se clarifient, les polémiques s’apaisent. Il n’en est rien. Idées reçues et fausses évidences continuent de proliférer sur ces sujets. Médias et magazines nous abreuvent de vieux clichés qui prétendent que les femmes sont «naturellement» douées pour le langage, multi-tâches mais incapables de lire une carte routière, alors que les hommes seraient par essence bons en maths et compétitifs. Ces discours laissent croire que nos aptitudes, nos goûts, nos comportements, seraient câblées dans des structures mentales immuables depuis la naissance. Or les progrès des recherches en neurosciences montrent le contraire: grâce aux techniques d’imagerie cérébrale par IRM (Imagerie par résonance magnétique), on sait désormais que le cerveau fabrique sans cesse des nouveaux circuits de neurones en fonction des apprentissages et des expériences vécues. Ces propriétés de «plasticité cérébrale», découvertes il y a une quinzaine d’années, ont révolutionné nos conceptions du fonctionnement du cerveau (Vidal 2015). Rien n’est à jamais figé ni programmé dans nos neurones. La plasticité cérébrale est un concept clef pour comprendre comment se construisent nos identités de femmes et d’hommes.
Le cerveau a-t-il un sexe?
Au XIXe siècle, la forme du crâne et la taille du cerveau ont été utilisées pour justifier la hiérarchie entre les sexes. On pensait les hommes, prétendument plus intelligents, étaient naturellement dotés d’un cerveau plus gros que celui des femmes. Certains médecins, en particulier Paul Broca, ont alimenté ces thèses par des mesures comparatives de cerveaux soigneusement sélectionnés pour conforter leur démonstration. Bien qu’à la même époque d’autres études avaient clairement montré que la taille du cerveau n’était pas la cause de l’intelligence, l’idéologie conservatrice l’emportait sur la rigueur scientifique (Gould 1997).
Que répondre aujourd’hui à la question: le cerveau a-t-il un sexe? La réponse scientifique est oui et non (Vidal 2015, Vidal et Benoit-Browaeys 2015). Oui, parce que le cerveau contrôle les fonctions associées à la reproduction sexuée, qui sont évidemment différentes chez les femmes et chez les hommes. Dans les cerveaux féminins, on trouve des neurones qui s’activent chaque mois pour déclencher l’ovulation, ce qui n’est pas le cas chez les hommes. Mais concernant les fonctions cognitives, la réponse est non. Les connaissances actuelles sur le développement du cerveau et la plasticité cérébrale démontrent que les filles et les garçons ont les mêmes capacités de raisonnement, de mémoire, d’attention.
La plasticité cérébrale
Les études par IRM ne cessent de s’accumuler pour montrer comment l’expérience façonne le cerveau, tant chez les enfants que chez les adultes (May 2011, Vidal 2010). Le petit humain vient au monde avec un cerveau largement inachevé: il possède un stock de cent milliards de neurones mais peu de voies nerveuses pour les faire se connecter entre eux. Seulement 10% de ces connexions – les synapses – sont présentes à la naissance. Cela signifie que 90% des synapses se fabriquent à partir du moment où le bébé entre en contact avec le monde extérieur. Les influences de la famille, de l’éducation, de la culture, de la société, jouent un rôle majeur sur le câblage des neurones et la construction du cerveau. Le terme de plasticité décrit cette propriété du cerveau humain à se modeler en fonction des apprentissages et des expériences vécues. Par exemple, chez les pianistes, on observe un épaississement des régions du cortex cérébral spécialisées dans la motricité des doigts et l’audition. Ce phénomène est dû à la fabrication de connexions supplémentaires entre les neurones. De plus, ces changements du cortex sont directement proportionnels au temps consacré à l’apprentissage du piano pendant l’enfance. La plasticité cérébrale est à l’œuvre également pendant la vie d’adulte. Ainsi chez des sujets qui apprennent à jongler avec trois balles, on constate après trois mois de pratique, un épaississement des zones qui contrôlent la coordination des bras et la vision. Et si l’entraînement cesse, les zones précédemment épaissies rétrécissent.

Ces exemples, et bien d’autres, montrent comment l’histoire propre à chacun s’inscrit dans son cerveau. Il en résulte qu’aucun cerveau ne ressemble à un autre. L’IRM a permis de révéler que les différences cérébrales entre les personnes d’un même sexe sont tellement importantes qu’elles dépassent les différences entre les sexes (Kaiser 2009, Joel 2015). Chacun des 7 milliards d’individus sur la planète possède un cerveau unique en son genre, indépendamment du fait d’appartenir au sexe féminin ou masculin.
Le concept de plasticité permet de dépasser le dilemme classique qui tend à opposer nature et culture. En fait, dans la construction du cerveau, l’inné et l’acquis sont inséparables. L’inné apporte la capacité de câblage entre les neurones, l’acquis permet la réalisation effective de ce câblage. Toute personne humaine, de par son existence et son expérience, est simultanément un être biologique et un être social (Rose 2006, Kahn 2007). Tous ces acquis de la neurobiologie confortent et enrichissent les recherches en sciences humaines et sociales sur le genre. Le sexe et le genre ne sont pas des variables séparées, mais s’articulent dans un processus d’incorporation («embodiment») qui désigne l’interaction entre le sexe biologique et l’environnement social, et ce dès la naissance (Fausto-Sterling 2012a-b).
Développement du cerveau et identité sexuée
Les propriétés de plasticité du cerveau apportent un éclairage nouveau sur les processus qui contribuent à forger nos identités. A la naissance, le petit humain n’a pas conscience de son sexe. Il va l’apprendre progressivement à mesure que ses capacités cérébrales se développent. Ce n’est qu’à partir de l’âge de deux ans et demi que l’enfant devient capable de s’identifier à l’un des deux sexes (Fausto-Sterling 2012a, Le Maner-Idrissi 1997).
Or depuis la naissance, il évolue dans un environnement sexué: la chambre, les jouets, les vêtements diffèrent selon le sexe de l’enfant. De plus, les adultes, de façon inconsciente, n’ont pas les mêmes façons de se comporter avec les bébés. Ils ont plus d’interactions physiques avec les bébés garçons, alors qu’ils parlent davantage aux filles. C’est l’interaction avec l’environnement familial, social, culturel qui va orienter les goûts, les aptitudes et contribuer à forger les traits de personnalité en fonction des modèles du masculin et du féminin donnés par la société.
Mais tout n’est pas joué pendant l’enfance. Les schémas stéréotypés ne sont pas gravés dans les neurones de façon immuable. À tous les âges de la vie, la plasticité du cerveau permet de changer d’habitudes, d’acquérir de nouveaux talents, de choisir différents itinéraires de vie. La diversité des expériences vécues fait que chacun de nous va forger sa propre façon de vivre sa vie de femme ou d’homme. En matière d’identité sexuée, l’évolution actuelle des mœurs, des normes culturelles et des lois (parité entre les femmes et les hommes, mariage homosexuel) est un exemple de plus de nos capacités de plasticité cérébrale.
Hormones et cerveau
L’action des hormones sur le cerveau est régulièrement invoquée pour expliquer la vie amoureuse, les rencontres, les liens sociaux, les conflits etc. Ainsi l’hormone dénommée ocytocine serait responsable du coup de foudre, de la fidélité, de l’instinct maternel. Quant à la testostérone, c’est elle qui rendrait les hommes dragueurs, compétitifs, coléreux et violents. En fait, les données expérimentales sur le rôle de ces hormones sur le cerveau et les comportements sont bien moins solides que le laissent croire certains discours de vulgarisation scientifique (Jordan-Young 2016).
L’ocytocine, hormone du lien social?
L’hormone ocytocine, qui est sécrétée dans le sang par la glande hypophyse, est connue pour agir sur les contractions de l’utérus au moment de l’accouchement et sur les glandes mammaires pour l’allaitement. Chez les animaux (brebis, rats, souris) cette hormone a aussi des effets sur le comportement. Des expériences ont montré que l’injection d’ocytocine directement dans le cerveau renforce les reniflements réciproques, le toilettage, les interactions entre mères et petits et entre mâles et femelles. C’est ainsi que l’ocytocine a été qualifiée «d’hormone de l’attachement et des liens sociaux» (Ross et Young 2009).
 Mais qu’en est-il chez les humains? Le problème est qu’il est impossible de mesurer la concentration d’ocytocine dans le cerveau ou bien de l’injecter à l’intérieur pour voir ses effets, contrairement aux expériences chez les animaux… On ne peut pas non plus l’injecter dans le sang car l’ocytocine ne passe pas la «barrière hémato-encéphalique» qui protège le cerveau. Des expériences ont tenté de l’administrer par un spray nasal, mais l’accès direct de l’ocytocine au cerveau à travers la muqueuse du nez n’est pas démontré. De plus la présence de récepteurs à l’ocytocine sur la membrane des neurones n’a pas été détectée dans le cerveau humain (Galbally 2011).
Mais qu’en est-il chez les humains? Le problème est qu’il est impossible de mesurer la concentration d’ocytocine dans le cerveau ou bien de l’injecter à l’intérieur pour voir ses effets, contrairement aux expériences chez les animaux… On ne peut pas non plus l’injecter dans le sang car l’ocytocine ne passe pas la «barrière hémato-encéphalique» qui protège le cerveau. Des expériences ont tenté de l’administrer par un spray nasal, mais l’accès direct de l’ocytocine au cerveau à travers la muqueuse du nez n’est pas démontré. De plus la présence de récepteurs à l’ocytocine sur la membrane des neurones n’a pas été détectée dans le cerveau humain (Galbally 2011).
Au final, les arguments scientifiques en faveur d’un rôle de l’ocytocine dans l’instinct maternel, l’attachement, la communication sociale, l’empathie, sont loin d’être établis, contrairement à ce qu’en disent les médias (Fillod 2012). Concernant les liens mère-enfant, les cas de maltraitance, d’abandon et d’infanticide montrent que l’instinct maternel ne relève pas d’une loi biologique universelle et incontournable. Ce qui n’enlève rien au plaisir que peut procurer le fait d’allaiter et de s’occuper de son bébé. Il ne s’agit pas là d’instinct mais bien d’amour, maternel et paternel, construit biologiquement, psychologiquement et socialement. Les liens affectifs se façonnent et évoluent selon les expériences de vie qui s’inscrivent dans un contexte culturel et social. L’ocytocine n’y est pour rien.
La testostérone, hormone de tous les pouvoirs?
La testostérone a sans conteste des effets sur le corps, en agissant en particulier sur le volume et la force musculaire. Mais quant à son action sur le cerveau et les comportements, on est loin d’un consensus scientifique.
Dans la population générale d’hommes adultes en bonne santé, il n’y a pas de relation statistiquement significative entre le désir sexuel et la concentration de testostérone dans le sang (Van Anders 2013). Certes, dans des conditions pathologiques de castration, il n’y a plus d’érection, mais cela n’entraîne pas nécessairement la perte du désir ni la disparition de toute activité sexuelle. Car chez les humains, l’organe sexuel le plus important, c’est le cerveau… Ses capacités cognitives confèrent à la sexualité humaine des dimensions multiples qui mettent en jeu la pensée, le langage, les émotions, la mémoire… Le désir sexuel d’abord est le fruit d’une construction mentale qui varie selon la vie psychique et les évènements de la vie. Rien à voir avec un simple réflexe déclenché par la testostérone.
Quant au prétendu rôle de la testostérone dans l’agressivité et la violence, là aussi les études scientifiques ne sont pas concluantes. Des enquêtes réalisées chez des garçons adolescents de 13 à 16 ans, montrent que la concentration de testostérone dans le sang n’est pas associée à des comportements agressifs ou de prise de risque, souvent présents bien avant la puberté. Chez les hommes auteurs d’actes de délinquance, le taux de testostérone n’est pas corrélé avec le degré de violence des comportements. En revanche, une corrélation forte est observée avec les facteurs sociaux tels que le niveau d’éducation et le milieu socio-économique (Archer 2006).
Tous les rôles attribués à la testostérone, qui justifieraient l’appétit sexuel et l’agressivité des hommes, ne sont pas étayés par des preuves expérimentales qui fassent consensus dans la communauté scientifique (Jordan-Young 2016). En revanche, les recherches en sociologie et en ethnologie montrent que si nombre d’hommes adoptent ces comportements, c’est le résultat d’une longue histoire culturelle de domination masculine alliée à des facteurs sociaux, économiques et politiques qui favorisent l’expression des violences (Héritier 1996).
Les avancées des neurosciences permettent de mieux comprendre pourquoi l’être humain échappe à la loi des hormones. L’Homo sapiens possède un cerveau unique en son genre qui le distingue de celui des grands singes. La différence est due au développement du cortex cérébral qui recouvre le reste du cerveau. Au cours de l’évolution de l’espèce humaine, la surface du cortex s’est tellement agrandie qu’il a dû se plisser en formant des sillons pour arriver à tenir dans la boîte crânienne. Aujourd’hui, par des méthodes informatiques, on sait déployer le cortex virtuellement: il mesure 2 mètres carrés de surface, sur 3 millimètres d’épaisseur, soit 10 fois plus que chez le singe. C’est grâce à son cortex cérébral que l’Homo sapiens a pu développer ses capacités de langage, de conscience, de raisonnement, de projection dans l’avenir, d’imagination… Autant de facultés qui ont permis à l’humain d’acquérir la liberté de choix dans ses actions et ses comportements (Rose 2006, Kahn 2007).
Une des conséquences du développement du cortex cérébral est qu’il contrôle les régions profondes du cerveau impliquées dans les instincts et les émotions. De ce fait, l’être humain est capable de court-circuiter les programmes biologiques instinctifs qui sont régis par les hormones. Chez nous, aucun instinct ne s’exprime à l’état brut. La faim, la soif ou l’attraction sexuelle sont certes ancrées dans la biologie, mais leurs modes d’expression sont contrôlés par la culture et les normes sociales. L’être humain peut décider de faire la grève de la faim ou de renoncer à la sexualité. Les hommes et les femmes, dans leurs vies personnelles et sociales, utilisent des stratégies intelligentes, fondées sur des représentations mentales qui ne sont pas dépendantes de l’influence des hormones.
Cerveau, science et société
En dépit des progrès scientifiques sur la plasticité cérébrale, l’argument des différences de «nature» est toujours bien présent pour expliquer les différences entre les femmes et les hommes dans la vie sociale et privée. L’environnement médiatique contemporain contribue activement à renforcer la «biologisation» des comportements humains (Fillod 2015, Jurdant 2012). Télévision, presse écrite, sites internet nous abreuvent régulièrement de «découvertes» scientifiques qui expliqueraient nos émotions, nos pensées, nos actions: gène de l’homosexualité, hormone du désir, neurones de l’empathie etc. Ce contexte est forcément propice à la promotion des thèses essentialistes orchestrées par les mouvements conservateurs qui s’opposent aux nouvelles formes de la famille, au mariage des couples homosexuels, à la légalisation de l’avortement etc.
Ces idées ont des implications sociales et politiques lourdes de conséquences. Invoquer des raisons biologiques (génétiques, cérébrales ou hormonales) aux comportements des femmes et des hommes, sous-entend leur caractère normal et immuable. A quoi bon, dès lors, lutter contre notre nature?
Or si les filles et les garçons ne font pas les mêmes choix d’orientation scolaire et professionnelle, ce n’est pas à cause de différences de capacités cognitives de leur cerveau (Vouillot 2014). Affirmer qu’il est plus naturel pour une femme que pour un homme de s’occuper de ses enfants à cause de l’ocytocine, c’est remettre en cause les lois sur l’égalité, les congés parentaux, la légalisation de l’homoparentalité. C’est aussi freiner les ambitions professionnelles des femmes, encourager leur travail à temps partiel qui va de pair avec des salaires réduits. Prétendre que la testostérone donne aux hommes plus d’appétit sexuel que les femmes, ou encore que la violence résulte de pulsions hormonales irrépressibles, conduit à accepter cette violence comme inéluctable et remettre en cause les lois réprimant le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes.
Dans le contexte actuel où les thèses essentialistes ressurgissent pour attaquer les études de genre, il est crucial que les biologistes s’engagent aux côtés des sciences humaines et sociales pour remettre en cause les fausses évidences qui voudraient que l’ordre social soit le reflet d’un ordre biologique. Aborder de front les préjugés essentialistes est indispensable pour combattre les stéréotypes, mener des actions politiques et construire ensemble une culture de l’égalité. (2 juin 2017)
(Cette contribution est parue dans la revue Les Utopiques, de l’Union syndicale Solidaires. Celle et ceux qui, en Suisse, sont intéressé·e·s par cette revue et voudraient s’y abonner peuvent contacter les Editions Page deux – editions@page2.ch – en indiquant dans objet: Revue Les Utopiques. Nous ferons le nécessaire pour «résoudre» les modalités d’abonnement: 25 euros par année. L’adresse postale exacte, en Suisse, doit être indiquée.)
_____
Bibliographie
Archer John, 2006 «Testosterone and human aggression: an evaluation of the challenge hypothesis», Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 30: 319-345.
Fausto-Sterling Anne, Garcia C and Lamar M, 2012a «Sexing the baby: Part 1. What do we really know about sex differentiation in the first three years of life?», in Social Science & Medecine, 74: 1684-92.
Faust-Sterling Anne, 2012b «Corps en tout genre», Paris, La Découverte
Fillod Odile, 2012 «Ocytocine et instinct maternel: suite », http://allodoxia.blog.lemonde.fr/
Fillod Odile, 2015 «Observatoire critique de la vulgarisation», http://allodoxia.blog.lemonde.fr/
Galbally Megan et al., 2011 «The role of oxytocin in mother-infant relations: a systematic review of human studies», Harvard Review of Psychiatry, 19: 1-14.
Gould Stephen Jay, 1997, La mal-mesure de l’homme, Paris, Odile Jacob, nouvelle édition.
Héritier Françoise, 1996, Masculin/Féminin, Éditions Odile Jacob.
Joel Daphna et al., 2015 «Sex beyond the genitalia: The human brain mosaic», Proceedings of the National Academy of Sciences, 112:15468-73
Jordan-Young Rebecca, 2016, Hormones, sexe et cerveau, Paris, Belin.
Jurdant, B., Ternay, J.-F., 2012 «Du scientisme dans les médias, la double réduction» , Alliage, 71: 12-25
Kaiser Anelis et al., 2009 «On sex/gender related similarities and differences in fMRI language research», in Brain Research Reviews, 61: 49-59
Kahn Axel, 2007, L’homme, ce roseau pensant, Paris, Odile Jacob
Le Mkner-Idrissi Gaid,1997, L’identité sexuée, Paris, Dunod
May Anne, 2011, «Experience-dependent structural plasticity in the adult human brain», Trends in Cognitive Sciences, 15: 475-82.
Rose Steven, 2006, Lifelines: Biology, freedom, determinism, New York: Vintage Books.
Ross Heather and Young Larry J., 2009 «Oxytocin and the neural mechanisms regulating social cognition and affiliative behavior», Frontiers in Neuroendocrinology, 30: 534-547
Tricker Ray et al., 1996 «The effects of supraphysiological doses of testosterone on angry behavior in healthy eugonadal men», Clin. Endocrinol. Metab., 81: 3754-3758.
Van Anders Sari M., 2013 «Beyond masculinity: Testosterone, gender/sex, and human social behavior in a comparative context», Frontiers in Neuroendocrinology, 34: 198-210.
Vidal Catherine, 2010, Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie?, Paris, Le Pommier
Vidal Catherine, 2015, Nos cerveaux, tous pareils, tous différents!, Paris, Belin, collection Egale à Egal
Vidal Catherine et Benoit-Browaeys Dorothée, 2015, Cerveau, Sexe et Pouvoir, Paris, Belin, nouvelle édition
Pouillot Françoise, 2014, Les métiers ont-ils un sexe?, Paris, Belin, collection Egale à Egal


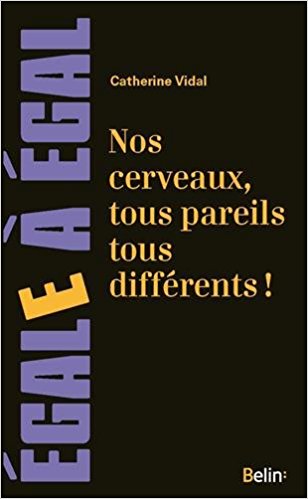
Soyez le premier à commenter