Nous publions ci-dessous une contribution d’Alain Bihr. Elle renvoie à une partie de son intervention – que nous publierons dans les semaines à venir – sur la question de l’Etat faite lors de Forum international qui s’est tenu à Lausanne du 20 au 22 mai. L’intervention d’Alain Bihr a été faite à partir d’une lecture critique du chapitre de l’ouvrage d’Ernest Mandel, Der Spätkapitalismus (1972), consacré à l’analyse de l’Etat dans le contexte du «capitalisme du troisième âge». La contribution publiée ci-dessous met l’accent sur la pluralité d’Etats dans laquelle le capital s’est toujours développé, avec les conflits qui en découlent et l’émergence difficile du principe de prédominance hégémonique. C’est un élément d’une analyse du devenir monde du capitalisme. (Rédaction A l’Encontre)
*****
Qui considère le capital de ses origines à nos jours constate que jamais il n’a prospéré dans un seul et même État englobant en lui tout l’espace de sa reproduction. Au contraire, partout et toujours, il ne s’est développé que dans le cadre d’une pluralité d’États, qui plus est rivaux entre eux, leur rivalité procédant à et d’une hiérarchisation qui ne cesse d’ailleurs d’évoluer, quelquefois de manière spectaculaire. L’universalité de ce constat conduit à former l’hypothèse qu’il trouve son fondement dans les spécificités de ce rapport de production qu’est le capital et de son procès global de reproduction. Celles-ci expliquent en effet tant l’existence nécessaire d’une pluralité d’États, leur rivalité permanente et leur hiérarchie mouvante que les principes qui les régulent[1]
Une pluralité d’États rivaux
Le capital est un rapport social profondément contradictoire. Fondé sur l’expropriation des producteurs, il implique simultanément l’appropriation privative (la propriété privée) des moyens de production, du procès de production et du produit du travail et la socialisation de la production : toute marchandise est une valeur d’usage sociale (elle répond à un besoin social) et c’est à travers un travail social (des moyens sociaux de production, des procès de travail socialisés, une force sociale de travail) que la valeur se forme et que le capital se valorise. Cela explique que le capital ne puisse jamais se présenter que sous la forme d’une multiplicité de capitaux singuliers qui, sur le marché, se combinent (par l’échange de leurs produits), s’attirent (ils s’associent voire se réunissent par fusion ou absorption) mais aussi se repoussent en entrant en concurrence et finissent même par se livrer une véritable lutte à mort – le marché capitaliste étant ainsi lui-même à la fois un espace de socialisation et un espace de consolidation et de confrontation des intérêts privés.
Le champ de cette contradiction et, avec elle, celui de la rivalité intercapitaliste ne cessent d’ailleurs de s’étendre (spatialement et socialement) au fur et à mesure où le capital s’accumule, se concentre et se centralise. De la concurrence entre capitaux d’une même localité ou région et d’une même branche, on passe ainsi à la concurrence entre capitaux de plus en plus éloignés et de branches de plus en plus diverses, au fur et à mesure que les capitaux deviennent capables de se désinvestir d’une branche ou d’un territoire donnés, offrant des conditions de valorisation moins favorables, pour s’investir dans une autre branche ou un autre territoire offrant des conditions de production plus favorables ; ou encore, dès lors que, la concentration et la centralisation du capital aidant, il se constitue des conglomérats de capitaux opérant simultanément au sein de multiples branches ou territoires à la fois.
Dans ces conditions, chaque fragment du capital social tente d’échapper, autant que faire se peut, aux effets de la concurrence et de la rivalité des autres fragments. En particulier, il tente d’ériger des barrières pour entraver leur libre circulation, de manière à se mettre à l’abri de leurs effets menaçants. Si cette tentative n’a pratiquement aucune chance d’aboutir tant qu’elle n’est le fait que de capitalistes isolés (si ce n’est sous la forme et dans les limites de la constitution de monopoles ou d’oligopoles), elle gagne en consistance et en force dès lors qu’elle est l’œuvre de coalitions de multiples capitalistes, d’autant plus si et quand celles-ci peuvent prendre appui sur un pouvoir politique, en définitive un État, ou compter sur son appui. Ainsi en va-t-il, par exemple, de la coalition des capitalistes d’une même branche de production, à l’intérieur d’un État donné, à l’encontre des capitalistes des autres branches, voire de l’ensemble des capitalistes ressortissant d’un même État à l’encontre des capitalistes ressortissants d’autres États.
Cela laisse clairement entendre que l’action de telles coalitions capitalistes ne peut aboutir que par l’intermédiaire de pouvoirs politiques souverains, en définitive d’appareils d’États, qu’il leur faut, selon les cas, appuyer en en obtenant un appui réciproque, subvertir par corruption, diriger, s’approprier ou, à la limite même, créer de toutes pièces. Seuls de tels pouvoirs sont en effet capables de déployer des moyens (matériels, juridiques, administratifs, fiscaux, policiers et en définitive militaires) pour défendre les prérogatives et intérêts d’un groupe de capitalistes donnés contre ceux d’autres groupes à l’intérieur de leur espace de souveraineté. A fortiori seuls de tels pouvoirs sont capables d’imposer des limites à la circulation des capitaux sous forme de frontières, dont le franchissement (par des hommes, des marchandises, de l’argent, du capital-argent, etc.) est soumis à une autorisation préalable et à des conditions déterminées, voire purement et simplement interdit. Et évidemment chaque coalition capitaliste tendra à s’assurer ainsi le concours d’un appareil d’État favorable à ses intérêts, ou éventuellement de plusieurs mêmes, en jouant de leurs rivalités. Bref, la fragmentation du capital social et la concurrence entre ses multiples fragments contribuent à engendrer la multiplicité et la rivalité des pouvoirs souverains, des États. Tout cela s’observe déjà pendant la période protocapitaliste : tel a été notamment le sens de l’adoption par les États modernes de politiques mercantilistes, permettant à chacun d’entre eux d’appuyer les positions de la fraction du capital dont la propriété et l’activité se localisent sur le territoire et dans la population sur lesquels s’exerce sa souveraineté.
Ainsi s’explique la forme contradictoire sous laquelle se réalise l’unification économique du monde capitaliste, celle-ci s’accompagnant nécessairement de la fragmentation du marché capitaliste mondial (au fur et à mesure où il se constitue) en une multiplicité de marchés délimités, entre lesquels la circulation du capital reste toujours formellement possible mais en étant réellement subordonnée à l’autorisation, aux conditions et au contrôle de pouvoirs d’États qui en définissent et en défendent les frontières constitutives en affirmant leur souveraineté à l’intérieur de ces frontières. Au sein de chacun de ces compartiments du marché mondial, certains capitaux (les capitaux indigènes ou les capitaux allogènes y ayant obtenu droit de cité et d’exercice) sont autorisés à opérer librement, dans le cadre des lois en vigueur : à s’investir et se désinvestir, à se concurrencer réciproquement tout comme à se combiner (s’associer, fusionner, etc.) réciproquement, alors que les autres capitaux se voient imposer certaines conditions (plus ou moins défavorables) et certaines restrictions (plus ou moins importantes) à leur accès à ce marché, pouvant aller jusqu’à l’interdiction pure et simple d’y opérer. Ainsi, du point de vue de chaque fragment du capital social, le marché mondial (l’espace économique au sein duquel circule et s’accumule le capital social) se subdivise-t-il toujours en définitive en un marché intérieur, auquel il peut librement accéder et sur lequel il peut librement circuler tout en y étant soumis à la concurrence d’autres capitaux, et en une multiplicité de marchés extérieurs auxquels, au contraire, il n’accède lui-même que de manière conditionnelle et limitée, voire dont l’accès lui est refusé.
Mais la fragmentation de l’espace mondial en unités politiques territoriales distinctes et rivales n’est pas seulement liée aux exigences du procès immédiat de reproduction du capital, notamment à l’inévitable concurrence à laquelle il soumet en permanence les différents fragments du capital social. Y concourent aussi, en deuxième lieu, les conditions générales de la reproduction du capital : les éléments socialisés du travail vivant (les éléments socialisés de la reproduction de la force de travail : par exemple les appareils sanitaire ou scolaire) ou du travail mort (par exemple les infrastructures de transport ou de télécommunication), mais aussi les moments socialisés de la circulation du capital (par exemple la monnaie et le système juridique). Car ces conditions générales se caractérisent par leur enracinement territorial aussi bien que par leur encastrement social et institutionnel ; et, à ce titre, elles constituent un facteur de localisation du procès global de reproduction, en freinant par conséquent l’expansion spatiale de ce dernier. De plus, de par leur nature même, ces conditions sont dépendantes quant à leur formation, leur entretien ou leur gestion, ou tout simplement leur fonctionnement, des pouvoirs politiques dont la souveraineté s’étend sur les territoires dans lesquels elles sont enracinées et sur les formations sociales au sein desquelles elles sont encastrées. A ce double titre, ces conditions générales de la reproduction du capital constituent un facteur supplémentaire de fragmentation politique du monde capitaliste, qui vient se combiner aux effets de la concurrence intercapitaliste.

et ses colonies
Cette fragmentation se renforce, en dernier lieu, des effets propres à la reproduction des rapports de classes. Nous savons en effet que le procès de reproduction des rapports de classes conduit à la formation de blocs sociaux territorialisés, sous l’effet tant de la dynamique propre des alliances et des compromis entre les classes formant blocs que de la rivalité des différents blocs entre eux[2]. Mais nous comprenons désormais mieux pourquoi de tels blocs se forment et pourquoi il s’en présente nécessairement une multiplicité. C’est que le territoire sur lequel se forme chacun d’entre eux coïncide avec le marché intérieur propre à une fraction du capital, qui lui offre en quelque sorte sa base matérielle ; de même que l’appareil d’État, qui participe à la formation et à la consolidation de ce marché intérieur, lui offre son armature institutionnelle. Cela revient à dire qu’il tend à se former autant de blocs sociaux qu’il existe de fractions territoriales autonomes du capital, c’est-à-dire de fractions du capital qui sont parvenues à s’autonomiser dans le cadre et sur la base de leur propre marché intérieur. Et les rivalités persistantes entre ces différents blocs trouvent en définitive leurs raisons d’être dans la concurrence que se livrent les fractions territorialisées du capital sur la base desquelles ils s’édifient respectivement. Là encore, la chose se vérifie dès l’époque protocapitaliste : les incessants conflits qui ont dressé les États européens les uns contre les autres durant cette époque plongent leurs racines dans l’exacerbation de la concurrence entre fractions territoriales du capital produite tant par l’expansion commerciale et coloniale de l’Europe occidentale outre-mer que par l’amplification et l’accélération de l’accumulation du capital auxquelles cette expansion a conduit en Europe même.
Mais si le fractionnement de l’espace économique mondial, du marché mondial, en une pluralité de marchés intérieurs contribue à expliquer le fractionnement de l’espace politique mondial en une pluralité de blocs sociaux rivaux s’appuyant sur autant d’appareils d’État, la réciproque n’est pas moins vraie. Car, composant une multiplicité de classes, fractions de classe et couches sociales, chacun de ces blocs est le sujet collectif qui prend en charge le développement d’une fraction territorialisée du capital social (mondial). Ce sont les luttes à la fois internes et externes, aux péripéties souvent multiples et confuses, quelquefois dramatiques, menées conjointement par les protagonistes de ce bloc, qui seules permettent (ou non) l’édification d’un État autonome et, à travers lui, la constitution d’un marché intérieur servant de creuset au développement d’une fraction territoriale du capital. Et ce sont de même ces luttes qui vont permettre (ou non) aux différents éléments de ce bloc de se souder par le projet de défendre collectivement les positions de la fraction territoriale du capital social (mondial) qui lui sert de base, dans ses rapports de concurrence et de rivalité aux autres fractions territoriales : par le projet d’acquérir ou de maintenir pour lui la meilleure position possible dans la hiérarchie économique et politique mondiale.
Les formules précédentes ne doivent cependant pas nous abuser. Chacun de ces blocs continue bien évidemment à être traversé par des contradictions d’intérêts et des luttes entre les classes et fractions qui le composent, qu’il ne parvient au mieux qu’à réfréner et contenir dans certaines formes et limites. Mais cela signifie que la capacité d’une fraction territoriale de la bourgeoisie de défendre ses intérêts propres (ceux de la fraction territorialisée du capital qu’elle personnifie) dans sa concurrence et rivalité avec et contre d’autres fractions territoriales du capital dépend aussi de sa capacité à souder autour d’elle un tel bloc à travers un système d’alliances et de compromis avec les autres classes, autrement dit à mobiliser ces dernières dans la défense de ses propres intérêts – ce qui définit en propre sa capacité hégémonique. Ainsi l’issue de la concurrence entre les différentes fractions territorialisées du capital social dépend-elle autant de la qualité (de la solidité, du dynamisme, de la capacité de renouvellement, etc.) respective des différents blocs sociaux constitués par et autour des fractions territoriales de la bourgeoisie qui les personnifient que de la qualité des conditions générales de reproduction du capital qu’elles ont su s’y assurer.
Concluons. L’originalité paradoxale du monde capitaliste est de combiner une tendance constante à l’homogénéisation (unification et uniformisation) économique, notamment sous l’impulsion de l’universalisation des rapports capitalistes de production, avec sa fragmentation persistante, sans cesse mouvante mais sans cesse renaissante, en une pluralité d’unités politiques, une pluralité d’États. Chacune de ces unités constitue en définitive un marché intérieur, un compartiment du marché mondial, c’est-à-dire un espace autonome de socialisation du travail, de réalisation de la loi de la valeur, doublé d’un espace autonome de production des conditions générales de la reproduction du capital et d’un espace autonome de luttes, de compromis et d’alliances entre les classes, aboutissant à la constitution d’un bloc social original. Le tout se synthétisant à chaque fois en un État propre, souverain au sein de cet espace, défendant plus ou moins bien les intérêts de ce bloc social, soit ceux de la fraction socio-spatiale du capital sur lequel il prend appui, et, par-delà, les particularités de la population qui le compose, de son territoire, de son histoire, de sa culture, etc., dans des rapports de rivalité avec les autres blocs sociaux liés aux fractions socio-spatiales du capital concurrentes. En somme, la structure sociopolitique propre du monde capitaliste trouve le secret de sa permanence dans la structure socio-économique qui lui sert de base et dont elle assure en définitive la reproduction : elle n’est que le prolongement médiatisé de la pluralité des fragments concurrents du capital social entre lesquels celui-ci se trouve inévitablement éclaté du fait de sa nature contradictoire de rapport de production fondé sur l’appropriation privative d’une production socialisée.
Une hiérarchie mouvante des États
Les développements précédents laissent clairement entendre que les rapports entre les multiples États dont se compose le monde capitaliste sont des rapports inévitablement conflictuels : le capital ne donne pas naissance seulement à des États multiples mais encore à des États rivaux. L’enjeu de leur rivalité permanente n’est autre, comme le suggèrent également les développements précédents, que l’appropriation des différentes conditions de la production capitaliste (matières premières, sources d’énergie, forces de travail, innovations techniques et inventions scientifiques, circuits commerciaux, marchés et territoires) ainsi que le partage du surproduit social au niveau mondial, notamment sous sa forme capitaliste de plus-value. Cette rivalité se traduit par le choc des intérêts économiques des différents États tout comme par une certaine tendance expansionniste, qui dégénèrent régulièrement en conflits ouverts pouvant aller jusqu’à l’affrontement militaire. Quant à l’issue de cette rivalité permanente, elle est toujours fonction des rapports de forces existant entre les différents États ; et elle détermine évidemment la place relative qui va revenir à chacun d’eux et, par-delà eux, à leurs formations socio-spatiales respectives dans la hiérarchie mondiale. Ainsi, le système d’États capitaliste ne se présente pas seulement sous la forme d’une multiplicité d’États rivaux mais aussi sous celle d’une hiérarchie entre ces États, hiérarchie rendue cependant instable et mouvante précisément par la dynamique conflictuelle qui l’engendre.
Les rapports entre les multiples États dont se compose la structure capitaliste de l’État sont ainsi inévitablement des rapports inégaux, à la fois effets et causes des rapports de forces qu’ils entretiennent : il apparaît ainsi des États de puissance fort inégale, des puissances de premier ordre, côtoyant de puissances moyennes ou secondes et même des États de faible puissance. Au cœur de ces inégalités gisent une nouvelle fois les déterminations propres au procès global de reproduction du capital. C’est que les inégalités socio-spatiales de développement font partie des résultats et des conditions à la fois de ce procès. Les facteurs qui se combinent ici sont multiples.
Il y a, en premier lieu, les conditions naturelles (géologiques, climatiques, orographiques, etc.) différenciant les continents, zones, régions, etc., de peuplement humain qui y ont déterminé des inégalités de croissance et de développement des forces productives. Ainsi l’agriculture se développe-t-elle dans des conditions plus favorables au sein des régions au climat tempéré que dans les régions subissant un climat tropical ou semi désertique. De même, les régions placées en bordure d’une mer intérieure (le prototype en étant la Méditerranée) connaissent-elles des conditions particulièrement favorables au développement du commerce lointain.

Les différences socio-historiques dans le mode et le rythme de développement des sociétés précapitalistes, notamment du point de vue des conditions de formation et de maturation des rapports capitalistes de production, ont entraîné aussi bien des décalages temporels de transition au capitalisme que des différences dans les modalités de cette transition, qui ont également contribué, en deuxième lieu, à l’apparition d’inégalités de développement du capitalisme entre elles. J’ai eu l’occasion de montrer dans La préhistoire du capital que, de ce point de vue tous les rapports précapitalistes de production ne se valent pas ; et que les sociétés au sein desquelles ont pu se développer des rapports féodaux de production se sont trouvées favorisées sous ce rapport.
Il faut tenir compte, en troisième lieu, les rapports capitalistes de production une fois formés, de la spatialisation de la division capitaliste du travail et, partant, de la spatialisation des inégalités de développement entre les différentes branches de cette dernière. La division capitaliste du travail comprend en effet une dimension spatiale, elle donne lieu à une division spatiale du travail, dont le champ s’étend nécessairement avec le devenir-monde du capitalisme en devenant ainsi progressivement une division mondiale du travail, en impliquant la répartition inégale des différentes activités productives et des différentes branches entre les multiples territoires inclus au sein du monde capitaliste. L’inégal développement du capital entre les différentes branches de la division sociale du travail se double donc toujours d’un inégal développement entre les différents territoires, entre les différentes formations socio-spatiales incluses dans le champ du procès global de la reproduction du capital. Avec les effets d’échange inégal qui accompagnent inévitablement le développement inégal et qui vont permettre aux formations socio-spatiales les plus développées d’accaparer, par le biais et sous le couvert de banals échanges marchands, une partie du surproduit généré au sein des formations les moins développées – et ce indépendamment de tout rapport direct d’exploitation des secondes par les premières dans le cadre par exemple d’une domination coloniale.
Les facteurs déterminant cette division spatiale du travail sont eux-mêmes nombreux. Les particularités naturelles et historiques des différentes formations socio-spatiales, précédemment évoquées, y ont évidemment leur part. Les conditions générales extérieures du procès immédiat de reproduction du capital réunies au sein de ces différentes unités jouent ici également un rôle. La localisation voire la concentration sur un territoire donné de telles activités productives ou de telle branche de la division sociale du travail vont souvent se trouver conditionnées par la présence, sur ce même territoire, de conditions médiates du procès de production et de procès de circulation du capital particulièrement favorables : une population nombreuse et dense, un marché étendu et en expansion, des équipements collectifs et des services publics performants, de solides garanties juridiques et des conditions fiscales intéressantes offertes aux propriétaires du capital, etc.
De la même manière, la configuration des rapports de classes qui se nouent au sein des différentes formations socio-spatiales, et qui contribuent fortement à leur individualisation comme nous l’avons vu, est à ce niveau un autre facteur décisif. En gros, un territoire déterminé concentrera d’autant plus de branches développées de la division capitaliste du travail que l’hégémonie de la bourgeoisie y sera puissante, c’est-à-dire qu’elle sera parvenue, à travers un ensemble de compromis et d’alliances avec les autres classes et fractions, à faire accepter sa domination, y compris au prolétariat. La réciproque est d’ailleurs également vraie : la formation et la pérennité d’une telle hégémonie ont pour condition socio-économique de possibilité des branches développées de la division capitaliste du travail, par conséquent une position privilégiée au sein de la division spatiale du travail au niveau mondial.
Ce qui laisse entendre que cette division et les inégalités de développement qu’elle implique résultent aussi, en quatrième et dernier lieu, de facteurs spécifiquement politiques. En effet, les différents États, dont la position dans la hiérarchie des États se trouve déterminée par celle de leurs formations socio-spatiales respectives au sein de cette division du travail, sont capables de rétroagir sur cette dernière et ses inégalités constitutives en les faisant évoluer. D’une part, par les orientations stratégiques qui sont les leurs quant au développement de la fraction du capital sur laquelle s’exercent leur souveraineté (par exemple quant aux spécialisations productives retenues), en fonction de leurs ressources naturelles et sociales propres, des rapports de forces entre les différentes classes dont se composent sa base sociale (des alliances et compromis conclus entre elles), de leur position concurrentielle sur le marché mondial, etc. Orientations qui, selon le cas, permettront à certains États d’améliorer la position de leur formation socio-spatiale dans la division mondiale du travail et, partant, leur propre position dans la hiérarchie mondiale des États ou, inversement, en condamneront d’autres à une dégradation de leurs positions dans cette division ainsi qu’à une irrémédiable régression au sein de cette hiérarchie. D’autre part et peut-être surtout, de pareilles évolutions dépendront de la capacité de chaque État de mobiliser ses ressources propres (économiques, politiques, idéologiques) dans le rapport de forces qui le confronte à ses principaux rivaux, surtout lorsque ce rapport finit par déboucher sur la confrontation militaire directe avec l’un ou l’autre d’entre eux. C’est alors le sort des armes qui tranche et qui permet au vainqueur, par le butin pillé au vaincu, les conquêtes territoriales réalisées à son dépend, les concessions à lui imposées quant à l’accès à son marché intérieur, etc., de consolider une position déjà dominante mais aussi, la chose aura été plus fréquente qu’on ne l’imagine possible a priori, de renverser en sa faveur un rapport de forces primitivement défavorable.
Par conséquent, si le procès global de reproduction du capital engendre nécessairement une hiérarchie entre les multiples États auxquels il donne naissance, cette hiérarchie n’a jamais rien de définitif. Elle est au contraire rendue sans cesse mouvante par les conflits qui la travaillent, nés de l’inévitable rivalité entre les différents États, dont nous savons qu’elle ne fait qu’exprimer et prolonger la concurrence entre les différentes fractions socio-spatiales du capital que ces États représentent et défendent. Mais cette hiérarchie est aussi, plus souterrainement encore, travaillée par la dynamique propre au procès de reproduction du capital, dont nous savons depuis Marx qu’elle implique que le capital ne peut pas se reproduire à l’identique, qu’il lui faut pour se maintenir bouleverser au contraire de manière permanente non seulement ses conditions immédiates (les forces productives matérielles et humaines et leur agencement productif) mais plus largement l’ensemble des conditions d’existence des hommes, y compris en définitive au niveau mondial les rapports de force et la position hiérarchique entre ses différentes fractions socio-spatiales et les appareils d’État qui les encadrent.
Des principes régulateurs
Ainsi, la structure politique propre au capitalisme est-elle nécessairement celle d’une pluralité d’États à la fois rivaux et inégaux, en lutte incessante entre eux pour maintenir ou parfaire leur position dans la hiérarchie qu’ils constituent sur la base de la concurrence des fractions territoriales du capital social qu’ils représentent. Cependant pareille configuration risquerait de déboucher sur un chaos permanent, préjudiciable en définitive à la reproduction du capital qui en est la matrice, si la rivalité entre les États ne se trouvait en partie contenue par quelques principes régulateurs, dessinant une sorte d’ordre politique mondial. La structure spécifique de l’État capitaliste n’est donc pas seulement celle d’une pluralité hiérarchisée d’États rivaux mais plus précisément encore celle d’une pluralité organisée, autrement dit un système.
Le mot système doit être pris ici au sens que lui donne la théorie des systèmes : il désigne une unité résultant de l’organisation des interactions entre une multiplicité d’éléments et présentant des propriétés ou qualités irréductibles à celles de ces derniers, qui ne peuvent s’expliquer, pour partie au moins, que par ces interactions, leurs régulations ainsi que par les rétroactions de l’unité globale sur ses éléments composants. En somme, la structure spécifiquement capitaliste de l’État est telle que l’État ne s’y réalise qu’en se fragmentant et en s’opposant à lui-même dans le cadre d’une hiérarchie régulée qui n’exclut cependant ni les déséquilibres, ni les conflits ni en définitive l’expression des contradictions internes fondamentales de la reproduction du capital.
Trois principes essentiels assurent la régulation de ce système : le principe de reconnaissance et de respect réciproques de souveraineté par les États membres, le principe d’équilibre des puissances et le principe de prédominance hégémonique. Ce sont tels qu’ils se manifestent et se réalisent dans le contexte de l’Europe protocapitaliste que je les présenterai dans ce qui suit. Ils possèdent cependant une portée plus générale, coextensive à l’espace-temps du monde capitaliste ; ainsi s’universaliseront-ils dans le cours ultérieur du devenir-monde du capitalisme tout en s’infléchissant d’une période à l’autre.
1. Le premier principe régulateur du système d’États européen est la reconnaissance et le respect réciproques de leur souveraineté. Sur la base et dans le cadre du parachèvement des rapports capitalistes de production, tout État européen tend à prendre la forme d’un pouvoir politique souverain, ce qui suppose qu’il parvienne à instituer sinon le monopole de l’exercice du pouvoir politique du moins sa prééminence dans cet exercice à l’égard de tous les autres acteurs politiques (ordres, classes, pouvoirs locaux, etc.) au sein de la formation sociale qui lui sert de base[3]. C’est là en même temps la condition nécessaire pour qu’il puisse être membre du système d’États européens, figurer comme un acteur au sein de ce système.
Mais cette condition interne, absolument nécessaire, n’est pas encore suffisante pour établir et garantir définitivement la souveraineté des différents États, il faut lui adjoindre la condition externe de la reconnaissance et du respect par les autres États, les autres acteurs du système d’États, de sa souveraineté : un État souverain n’est pas seulement un État capable d’imposer sa prééminence à tous les acteurs politiques qu’il subsume en son sein, c’est encore un État capable de faire respecter cette même prééminence par les autres États rivaux et d’en obtenir la reconnaissance de leur part. Prééminence interne et indépendance externe sont ainsi les deux faces indissociables de la souveraineté étatique. L’équilibre des puissances, empêchant tout État européen d’englober le continent dans un empire dont il serait le maître, tout comme l’hégémonie de la puissance dominante, imposant un ordre déterminé dans les relations entre les États, sont d’ailleurs les conditions de cette reconnaissance réciproque qui permet à chaque État de se prévaloir de la garantie du respect de sa souveraineté par tous ses voisins, de la même manière qu’il reconnaît et respecte la leur. Sous ce rapport aussi, il existe une analogie formelle entre la souveraineté étatique et la propriété privée : la souveraineté d’un État est conditionnée par sa reconnaissance et son respect par les autres États de la même manière que le droit absolu et exclusif du propriétaire sur son bien n’existe que pour autant qu’il est reconnu et respecté par les autres propriétaires privés.
2. Exprimé négativement, le principe d’équilibre des puissances prescrit qu’il doit être impossible à l’un quelconque des États européens d’atteindre une puissance telle qu’il puisse imposer sa volonté à l’ensemble des autres États. En d’autres termes, il interdit la (re)naissance d’une structure impériale qui placerait tout le continent européen sous la domination d’un seul État dictant sa volonté à l’ensemble des peuples européens. Exprimé positivement, ce même principe prescrit de veiller à la pondération réciproque des puissances du continent, de sorte qu’aucune prépondérance éventuelle ne puisse se transformer en domination impériale : en « monarchie universelle » dit-on alors en Europe.
Deux facteurs essentiels assurent le respect de ce principe. D’une part, au cours de l’époque protocapitaliste, toute tentative impériale se heurte à l’inévitable éclatement et dispersion des foyers d’accumulation du capital sur le continent européen, qui plus est en concurrence les uns avec les autres, base matérielle de l’existence d’une multiplicité d’États de premier rang, concentrant tous les moyens (matériels, institutionnels, idéologiques) de la puissance et capables par conséquent de se tenir mutuellement en respect. En particulier, ses capacités à prélever une partie de la richesse produite par sa formation socio-spatiale ou accaparée par elle par l’intermédiaire de ses échanges extérieurs permettent à chacun de ces États de premier rang de se doter des moyens de se défendre face à une entreprise impériale, si ce n’est seul, du moins en se coalisant avec les autres États confrontés à la même menace. Et les États de moindre importance (les puissances secondes ou les États de faible puissance) peuvent en faire autant en se plaçant sous la protection de l’un ou l’autre des précédents.
D’autre part, en dépit des rivalités permanentes entre eux, les États européens (leurs souverains ou gouvernements) qui peuvent se trouver éventuellement menacés par le puissant d’entre eux ont toujours intérêt à et, par conséquent, la possibilité de se coaliser pour y faire échec. Ce qui fait dire à Immanuel Wallerstein que, par équilibre des puissances :
« (…) il faut entendre que les grandes et moyennes puissances du système interétatique tendaient toujours à tout moment à conserver des alliances (ou si besoin à les déplacer) de telle sorte qu’aucun État isolé ne puisse à lui tout seul soumettre tous les autres. »[4]
Ce principe implique et explique non seulement la récurrence des alliances qui, durant toute l’époque protocapitaliste, vont se constituer en Europe contre le plus puissant des États européens du moment, dès lors qu’il manifeste quelque tropisme impérial, mais encore et surtout le jeu non moins constant de bascule auquel vont se livrer les différents États européens, chacun passant d’alliances avec les uns à des alliances avec d’autres, quelquefois les ennemis de la veille, au gré de l’évolution de ses intérêts propres mais aussi des rapports de forces sur l’ensemble du continent, de manière à éviter autant que possible que le plus puissant d’entre eux ne devienne trop puissant et puisse s’imposer à tous les autres. Ces alliances et ces renversements d’alliance, garants de la permanence de l’équilibre de puissances, l’est aussi de la sécurité voire de la survie de chacun des États européens, surtout des puissances de second rang ; et leurs princes y veillent.
Car, l’idée que la sécurité de leur État dépend essentiellement du maintien d’un tel équilibre entre l’ensemble des puissances européennes, maintenu sinon garanti par un jeu permanent d’alliances les unes avec ou contre les autres, fait partie de la culture politique des souverains et de leurs conseillers, tout comme des principaux théoriciens du politique, au cours des temps modernes. Apparue en Italie dès la seconde moitié du XVe siècle, elle se diffuse à travers toute l’Europe au cours des deux siècles suivants : on la retrouve sous la plume de Jean Bodin (1529-1596) tout comme sous celle de Francis Bacon (1561-1626), elle est cœur de la vision et de l’action politiques d’un Sully (1559-1641) tout comme d’un Richelieu (1585-1642), pour finir par faire partie des principes cardinaux de la politique européenne des temps modernes, au point d’être explicitement formulée à l’article 2 du traité conclu à Utrecht le 13 juillet 1713 pour mettre fin à la guerre de Succession d’Espagne : « … les royaumes de France et d’Espagne doivent rester séparés pour assurer une paix ferme et stable et la tranquillité de la Chrétienté par un juste équilibre de la puissance qui est le fondement le meilleur et le plus solide d’une amitié mutuelle et d’une concorde durable ».

Dans ces conditions, la coalition des plus faibles reste toujours assez forte pour finir par vaincre le plus fort, dès lors que celui-ci est tenté d’abuser de sa prépondérance pour reconstituer l’unification impériale de l’Europe sous son égide. D’autant plus, enfin, que toute tentative impériale est inévitablement soumise à la « loi » qui veut que tout empire s’affaiblit au fur et à mesure où il s’étend parce que ses ressources ne croissent généralement pas dans les mêmes proportions que les charges grandissant générées par son extension. Bref, dans les conditions de l’Europe protocapitaliste, aucun État européen ne dispose d’une puissance suffisante pour vaincre durablement la coalition de l’ensemble des autres États et étendre sa domination impériale sur l’Europe – et encore moins au-delà d’elle. L’Espagne de Charles Quint et de ses successeurs, la France de Louis XIV puis celle de Napoléon, comme ultérieurement l’Allemagne wilhelmienne puis hitlérienne, en feront successivement l’expérience à leurs dépens.
3. On aura compris que l’équilibre des puissances qui peut s’établir entre les différents États européens modernes est, par définition, instable et précaire, périodiquement remis en cause et rétabli, parce qu’il est en proie à la rivalité permanente entre ces États et que les rapports de force entre eux évoluent constamment, au gré non seulement de leurs succès et de leurs échecs dans leurs confrontations mais de la dynamique protocapitaliste qui en constitue le moteur. C’est pour cela qu’il doit se compléter par un principe de prédominance hégémonique.
Car l’équilibre des puissances n’implique nullement que tous les États européens modernes se trouvent placés sur un pied d’égalité en fait, même s’ils sont tous déclarés formellement égaux en droit en tant que puissances souveraines, comme nous l’avons vu. Nous savons au contraire que l’inégalité de puissance (économique, politique, culturelle) entre eux est la règle, du fait notamment des inégalités de développement des fractions territorialisées du capital dont ils représentent et défendent les intérêts.
Qui plus est, le principe d’équilibre des puissances n’exclut pas que, périodiquement, l’un de ces États soit prépondérant : qu’il s’affirme comme plus puissant que tous les autres, sur différents plans (économique, militaire, diplomatique, culturel, etc.) Il exclut simplement que cette prépondérance puisse donner naissance à une prédominance de type impérial : qu’elle conduise à établir une structure impériale en Europe (une unification impériale du continent européen) sous son égide ; il ne tolère que la possibilité pour cette prépondérance de donner éventuellement naissance à une forme singulière de prédominance, celle de l’hégémonie.
Le concept d’hégémonie est d’origine grecque. En grec, hegemon signifie le chef, le leader. Dans la Grèce antique, le terme est utilisé notamment pour désigner le type de domination que, périodiquement, une des multiples cités-États composant ce monde pouvait conquérir et exercer, au moins provisoirement, sur un ensemble d’autres telles cités. C’est que, jusqu’à la conquête macédonienne, la Grèce se caractérisait par une forte unité culturelle, favorisant le développement des relations marchandes entre ses cités, en constituant ainsi une des sections les plus dynamiques du monde marchand méditerranéen, le tout contrastant cependant avec son caractère politiquement fragmenté, divisée qu’elle était en une pluralité de cités-États rivales, qui plus est fréquemment en guerre les unes contre les autres. Dans ce monde, il arrivait périodiquement que l’une des cités-États grecques prenne la tête d’une ligue ou d’une alliance regroupant une pluralité d’entre elles contre un ennemi commun (ce fut le cas d’Athènes face à la menace d’invasion médique) ou contre une ligue ou coalition rivale (ce fut le cas de Sparte contre Athènes lors de la guerre du Péloponnèse). Évidemment, une pareille position hégémonique valait souvent à la cité-État qui l’acquérait de faire triompher ses intérêts (économiques ou politiques) sur ceux des autres, tout en étant obligés de les ménager malgré tout et, bien évidemment, de respecter leur indépendance – en quoi la prédominance hégémonique se distingue de la domination impériale.
A l’époque contemporaine, le concept d’hégémonie a été repris par Antonio Gramsci. Celui-ci désigne par le terme d’hégémonie la capacité de la classe dominante à obtenir le consentement des classes dominées à leur propre domination. Pour lui, une classe dominante est une classe hégémonique au sens et dans la mesure où elle sait faire accepter par les autres classes sa direction de la société, notamment en élevant ses intérêts particuliers au rang d’intérêt général de la société. Et, selon Gramsci, cette capacité hégémonique passe par la constitution autour d’elle d’un bloc social : un agencement, souvent complexe, de classes, fractions, couches et catégories, en partie fusionnées par la défense d’un certain nombre d’intérêts mais aussi d’idées et de valeurs communs.
Transposée dans le champ des relations entre les différents États européens modernes, la notion d’hégémonie reprend les deux sens précédents tout en les infléchissant. Elle désigne ainsi la capacité pour l’un de ces États de réaliser autour de lui et sous sa conduite une alliance ou une coalition incluant l’ensemble ou du moins la plupart des autres États européens, lui permettant de réaliser ses intérêts propres tout en ménageant plus ou moins ceux des autres membres de la coalition. Ainsi définie, l’hégémonie peut cependant donner lieu à deux régimes différents, entre lesquels des formes intermédiaires et transitoires sont évidemment possibles. Au plus bas degré, une hégémonie faible se caractérise par la capacité de constituer et de conduire une coalition tournée contre une tentative de domination impériale de la part de l’un des États européens. En somme, sous cette forme minimale, l’hégémonie se définit par la capacité d’assurer, par un système d’alliances, l’équilibre des puissances nécessaire à l’existence du système d’États européen, de jouer en somme le rôle de l’arbitre au sein de ce système, chargé de faire respecter la règle cardinale. De la sorte, l’État hégémonique garantit la sécurité de l’ensemble des autres États et le respect de leur souveraineté.
Au degré supérieur, une hégémonie forte consiste, plus largement, dans la capacité de définir des règles qui prévaudront dans les rapports (économiques, politiques, culturels) entre les États européens, de manière à prévenir les conflits entre eux et à réguler l’ensemble du monde protocapitaliste, que ces États dominent conjointement bien qu’inégalement, de manière en définitive à stabiliser (au moins pour un temps) l’ensemble de ce monde. Cela revient donc pour la puissance hégémonique à diriger l’ensemble du monde capitaliste à différents niveaux : économiquement (en s’appuyant sur la fraction prépondérante du capital mondial, dans ses différentes composantes industrielle, commerciale et financière), politiquement (en étant capable de s’imposer aux autres États en les contraignant à respecter les règles communes sans recourir à la violence ou avec un minimum de violence, tout en disposant directement ou indirectement d’une puissance militaire généralement supérieure à celle de chacun des autres États européens) et culturellement (en étant capable d’imposer ou, mieux encore, de proposer à l’ensemble des États européens une commune vision du monde, un commun langage dans lequel seront posés et pensés les problèmes de leur commune domination sur le monde).
En régime d’hégémonie faible, il se peut donc que l’État prépondérant (l’État le plus puissant) ne soit pas l’État prédominant (celui qui réunit et conduit l’alliance assurant l’équilibre des puissances) et réciproquement. En effet, dès lors que l’État prépondérant vise à imposer une structure impériale à son bénéfice, il voit à coup sûr se constituer une coalition des autres puissances capable de lui tenir tête et même de le vaincre, réunie et conduite par un État qui, de ce fait, deviendra l’État hégémonique, donc l’État prédominant : en somme, la prédominance ne va pas à celui des États qui pèse le plus lourd dans la balance des rapports de forces mais à celui qui en contrôle le fléau. Mais c’est dire aussi qu’un tel régime d’hégémonie est imparfait parce que l’équilibre des puissances qu’il assure reste fragile et précaire. Ce n’est qu’en régime d’hégémonie forte que l’État prédominant est aussi l’État prépondérant et vice versa, rendant précisément ainsi l’hégémonie solide et durable.
Dans les conditions de l’Europe protocapitaliste, le principe de prédominance hégémonique peinera d’ailleurs à s’affirmer contre les tentatives de domination impériale, celle de l’Espagne puis celle de la France, en ne donnant du coup naissance qu’à des hégémonies faibles. Ainsi en ira-t-il de l’hégémonie néerlandaise dirigée successivement contre l’une et l’autre de ces deux puissances à tropisme impérial. Ce n’est qu’à partir du XVIIIe siècle que la Grande-Bretagne fera triompher le principe d’hégémonie comme conséquence et condition de sa propre prépondérance, en esquissant la première tentative d’une hégémonie forte. Mais ce n’est qu’au terme des guerres de et contre la Révolution française et l’Empire napoléonien, soit au-delà de la période protocapitaliste, que celle-ci s’établira définitivement.
[1] Ce texte est extrait d’un ouvrage en préparation, faisant suite à La préhistoire du capital, paru en 2006 aux Éditions Page 2. Cet ouvrage est consacré à la première période du devenir-monde du capitalisme, donnant naissance au protocapitalisme mercantile, au sein duquel l’État capitaliste émerge dans sa structure spécifique, structure qu’il conservera dans la suite de son développement historique, par delà la période protocapitaliste elle-même. C’est ce que s’efforce de montrer cet extrait.
[2] Cf. Les rapports sociaux de classe, Éditions Page 2, 2012, chapitre II.
[3] Ce point fera l’objet d’un développement spécifique dans le cadre de l’ouvrage en préparation.
[4] Le capitalisme historique, Paris, La Découverte, 2e édition, 2002, page 56.

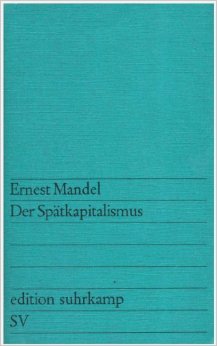
Soyez le premier à commenter