A peine reçu le courrier recommandé lui notifiant son licenciement pour faute grave, que Jean-François M.T. s’interroge à haute voix: «Comment ai-je fait pour tenir aussi longtemps?» Ce quadragénaire d’origine congolaise devenu chauffeur-livreur sur le tard a contacté Libération il y a quelques semaines après avoir lu notre enquête publiée le 5 octobre 2018 sur les conditions de travail des petites mains d’Amazon. On y décrivait de l’intérieur le quotidien de ces salariés employés par des sous-traitants de la multinationale et soumis à une cadence infernale. Jean-François en était un lui aussi, depuis bientôt deux ans. Dans son dépôt, l’article était passé de mains en mains, certains ayant l’impression de se reconnaître. «Je suis à peu près sûr que j’en ai formé quelques-uns dont vous parlez», assure celui que l’on considère comme un ancien dans l’entreprise en raison du turnover important. Selon un de ses collègues, «sept sur dix partent au bout d’un mois».
Vendredi, Jean-François, qui a pris un avocat, a décidé de contester son licenciement auprès du conseil des prud’hommes, entraînant dans son sillage une brochette d’anciens réfléchissant à leur tour à attaquer Star Service, la société qui les employait. Réunis dans un groupe WhatsApp, une dizaine de livreurs sont en train de s’organiser et d’accumuler les preuves pour réparer ce qu’ils appellent «les injustices subies» dans l’exercice de leur métier. Leur combat révèle en creux les pressions quotidiennes subies par les salariés des sous-traitants d’Amazon.
50 millions de colis
La livraison Prime, qui permet de recevoir un colis chez soi en moins de quarante-huit heures partout en France, est la pierre angulaire du système Amazon. Avec plus de 100 millions de clients dans 17 pays, la multinationale a par exemple livré 1,4 million de colis lors du dernier Black Friday, cette journée de novembre qui marque traditionnellement le coup d’envoi des achats de fin d’année. Pour satisfaire ses clients, Amazon délègue la gestion du «dernier kilomètre» séparant le dépôt du client à des sous-traitants spécialisés dans le transport, comme Star Service.
Spécialiste de la livraison fondé il y a une trentaine d’années en France, l’entreprise compte Monoprix ou Carrefour parmi ses autres clients et livre, chaque année en France, plus de 50 millions de colis. Face à une demande à la fois exponentielle et instable – le nombre de colis peut par exemple doubler à Noël – les sociétés de livraison sous-traitent elles-mêmes à des petites entreprises partout en France. Ce qui permet, d’un côté, au donneur d’ordre, Amazon, de fermer les yeux sur les conditions de travail et, de l’autre, prive les salariés de représentants syndicaux, étant donné la petite taille de ces boîtes.
Chaque jour, elles imposent aux chauffeurs de livrer jusqu’à 200 colis sans qu’aucun retour ne soit toléré même si le client est absent. Dans un enregistrement réalisé au cours d’un briefing du matin par un des livreurs que Libération a pu écouter, un chef de dépôt Amazon de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) sermonne ces livreurs salariés d’autres entreprises: «Pas plus de cinq retours par chauffeur s’il vous plaît. Et cinq retours, c’est déjà beaucoup! Nous, on va vous mettre la pression sur ça jusqu’à ce que ce soit bon!» Dans ces conditions, les livreurs ne restent souvent pas bien longtemps. «Ici, il n’y a que des jeunes en galère, sans études, dont certains repris de justice, et des vieux qui doivent nourrir leurs enfants et qui n’ont pas le choix», résume Jérôme (1), un ancien collègue de Jean-François.
«Liquider»
A 47 ans, ce dernier n’a pas vraiment le profil type du livreur Amazon. Il grandit dans une famille congolaise aisée lui permettant d’étudier le droit immobilier en France. Il travaille ensuite dans le bâtiment en tant qu’auto-entrepreneur. Lorsqu’il souhaite diversifier ses activités dans le transport, il envoie son CV à Star Service. L’entreprise, qui développe à l’époque ses activités auprès d’Amazon, lui propose un contrat en CDI. Il accepte «dans l’optique de créer un jour [sa] propre société de transport»: «J’arrive à la journée d’intégration, et là, je me dis que je vais me lever et partir. Il y avait beaucoup de jeunes de banlieue. Personne comme moi. Puis je me suis dit: “Je suis là pour apprendre, je reste.”» Le livreur débute dès le lendemain et rencontre trois collègues embauchés presque en même temps que lui: Ahmed (1), Fred (1) et Moussa (1).
Tous vivent en banlieue parisienne, au sud de Paris, et tous enchaînent les horaires déments. Les conditions de travail deviennent très dures après quelques mois. Certains livreurs se font agresser dans des quartiers difficiles et quittent leur job. D’autres sont épuisés par les interminables journées. Les chauffeurs se plaignent surtout d’un retard dans le paiement des heures supplémentaires. «On apprend notre planning et nos horaires la veille au soir par téléphone. Si tu ne comptes pas tes heures toi-même, t’es foutu», décrit Ahmed, 45 ans, qui a été au chômage pendant deux ans. «Ils profitent de ces personnes qui n’ont pas d’autre choix que de travailler, abonde Jean-François. A certains, il manque quatre-vingts heures impayées, voire beaucoup plus. Mais ils nous répètent: “Si tu n’es pas content, tu peux rentrer chez toi.” Ils savent bien qu’ils ne peuvent pas se le permettre.» Ce qui pousse certains livreurs à abandonner leur véhicule en plein service. Ils craquent. «Un matin, j’ai appris qu’un collègue avait laissé la veille son camion plein de colis au milieu des rames de tramway. Il a jeté la clé dans le véhicule et il est parti», se souvient l’ancien livreur.
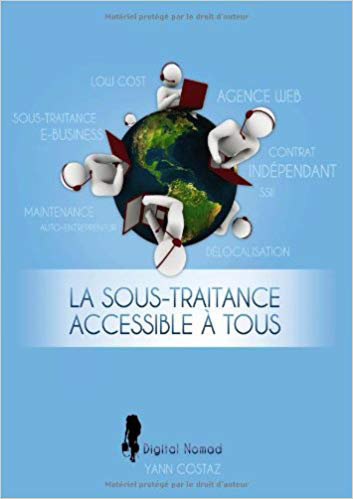 Les chauffeurs répètent souvent la même phrase pour décrire leurs conditions de travail: «Ici, si tu te plains, t’es viré.» Le constat est particulièrement vrai pour les plus anciens salariés. «Ils essaient de les liquider pour pouvoir manipuler les nouveaux plus facilement. Parce que les anciens comprennent le système, alors que les nouveaux, tu peux leur dire de faire ce que tu veux», analyse Jérôme. Depuis qu’il a débuté au sein de l’entreprise, Jean-François comble implicitement l’absence de délégué du personnel dans l’entreprise: il est un des seuls à avoir fait des études et à connaître le code du travail. Ses collègues lui demandent des conseils dans leurs démarches. Au point qu’au bout d’un an lorsqu’il songe à quitter l’entreprise, il est pris à part par un jeune à la fin de la journée. «Il m’a dit: “Reste s’il te plaît, on a besoin de toi.” Ils avaient vu que je m’y connaissais en juridique. Je me suis dit que j’allais rester, pour les aider», raconte le livreur. Il décide alors de tout conserver: audio, photo et vidéo. Libération a pu consulter le tout. Après plusieurs mois de salaires impayés, Jean-François, Ahmed, Fred et Moussa décident d’entreprendre des démarches pour obtenir le versement des heures supplémentaires. Jean-François aide notamment ses collègues à rédiger une lettre, que certains envoient à la direction de l’entreprise par courrier recommandé. Ahmed en poste deux: «Je ne connaissais rien, je demandais à Jean-François: “Je rentre à 1 heure du matin, c’est légal ou pas?” Et là, j’envoie deux courriers et ils m’indiquent que le décompte de mes heures est confidentiel.»
Les chauffeurs répètent souvent la même phrase pour décrire leurs conditions de travail: «Ici, si tu te plains, t’es viré.» Le constat est particulièrement vrai pour les plus anciens salariés. «Ils essaient de les liquider pour pouvoir manipuler les nouveaux plus facilement. Parce que les anciens comprennent le système, alors que les nouveaux, tu peux leur dire de faire ce que tu veux», analyse Jérôme. Depuis qu’il a débuté au sein de l’entreprise, Jean-François comble implicitement l’absence de délégué du personnel dans l’entreprise: il est un des seuls à avoir fait des études et à connaître le code du travail. Ses collègues lui demandent des conseils dans leurs démarches. Au point qu’au bout d’un an lorsqu’il songe à quitter l’entreprise, il est pris à part par un jeune à la fin de la journée. «Il m’a dit: “Reste s’il te plaît, on a besoin de toi.” Ils avaient vu que je m’y connaissais en juridique. Je me suis dit que j’allais rester, pour les aider», raconte le livreur. Il décide alors de tout conserver: audio, photo et vidéo. Libération a pu consulter le tout. Après plusieurs mois de salaires impayés, Jean-François, Ahmed, Fred et Moussa décident d’entreprendre des démarches pour obtenir le versement des heures supplémentaires. Jean-François aide notamment ses collègues à rédiger une lettre, que certains envoient à la direction de l’entreprise par courrier recommandé. Ahmed en poste deux: «Je ne connaissais rien, je demandais à Jean-François: “Je rentre à 1 heure du matin, c’est légal ou pas?” Et là, j’envoie deux courriers et ils m’indiquent que le décompte de mes heures est confidentiel.»
Rôle pivot
Quelques semaines après cet épisode, Ahmed apprend qu’il est mis à pied: «Ils m’ont dit que j’avais des jours d’absence, alors que ce sont eux qui m’ont dit de rentrer chez moi parce qu’il n’y avait pas assez de travail. Ils m’ont aussi reproché un accident qui avait eu lieu en juillet et pour lequel j’avais fait un constat contre X.» Son récit ressemble à celui de Moussa, également quadragénaire et ancien chômeur. «J’ai accumulé dix-sept jours en heures supplémentaires non payées! J’étais payé 1100 euros alors que je travaillais de 8 heures à parfois 23 heures. J’ai commencé à me plaindre et à demander le paiement. Et j’ai dit au brief du matin que je voulais faire grève», relate le livreur. Il reçoit alors une notification de mise à pied de trois jours dans sa boîte aux lettres, mais parvient à sauver sa tête. «Ils m’ont reproché de ne pas avoir été là une journée en décembre et d’avoir pris le camion pour aller me balader. Sauf que je travaillais bien ce jour-là, et que je leur ai apporté la preuve. J’ai donc reçu une lettre qui annulait ma mise à pied. Mais je sais qu’ils trouveront un autre motif pour me licencier bientôt», s’amuse le livreur.
Arrivé du Togo il y a quelques années, Fred n’est pas non plus parvenu à obtenir le décompte ou le paiement de ses heures supplémentaires malgré ses demandes répétées. Et a été licencié peu de temps après pour avoir perdu tous les points sur son permis. «Je leur ai demandé de me donner un autre poste pour que je puisse continuer à nourrir ma famille. Au lieu de ça, ils n’ont plus répondu à mes appels et m’ont envoyé un courrier de licenciement», regrette l’ancien livreur.
Comme ses trois collègues, Jean-François a finalement été mis à pied en mars. Puis licencié pour faute grave. Sur la lettre que Libération a consultée, il est inscrit: «Propos dénigrants l’entreprise» et «vous avez pris des photos des chariots contenant des colis destinés à des particuliers». «A partir du moment où tu te plains, ils cherchent tous les prétextes pour te virer», commente de son côté un ancien livreur du dépôt.
Etant donné la situation et son rôle pivot dans l’entreprise, Jean-François a décidé de montrer l’exemple. C’est pour cela qu’il a saisi le conseil des prud’hommes. D’autres collègues, dont Ahmed, Moussa et Fred sont tentés de l’imiter car ni Amazon ni Star Service n’ont pour le moment été inquiétés par d’anciens livreurs. «Ceux qui se font licencier ne connaissent pas le droit, ils abandonnent. Mais aujourd’hui beaucoup sont prêts à porter plainte pour divers motifs: harcèlement ou licenciement abusif. On se renseigne car chaque cas est différent. On est déjà allés voir l’inspection du travail qui prend l’affaire au sérieux», assure le plaignant. «Si on s’organise bien, ce sera peut-être des dizaines de livreurs qui contesteront bientôt leur licenciement», promet un autre ancien livreur.
Joints par téléphone, les responsables du dépôt refusent de commenter ces cas d’espèces. Star Service, de son côté, n’a pas souhaité réagir pour l’instant. Quant à la direction d’Amazon, elle se dédouane: «Ce ne sont pas des salariés à nous. Mais nous sommes vigilants auprès de nos partenaires de livraison sur ce qu’on leur demande de respecter, notamment la législation. Ils sont retenus en amont sur cette capacité. Ensuite, c’est le droit qui doit s’appliquer.» (Article paru dans Libération en date du 7 avril 2019)
(1) Les prénoms ont été modifiés.


Soyez le premier à commenter