 Entretien avec China Miéville
Entretien avec China Miéville
réalisé par Benjamin Birnbaum
A l’occasion du centenaire de la révolution russe, China Miéville, romancier de fantasy et science-fiction de renommée internationale, s’est donné la tâche de restituer l’expérience de 1917 à travers un récit. Défiant la leçon de Fredric Jameson selon laquelle une révolution est irreprésentable, China Miéville a tenté de donner toute son épaisseur à la complexité et à la contingence de l’événement révolutionnaire. En anticipant la sortie d’Octobre en français à l’automne 2017 [25 octobre, Editions Amsterdam] la revue Période a réalisé un entretien avec l’auteur. Miéville esquisse les traits marquants de son approche: le fait d’avoir donné toute son ampleur aux dimensions spatiales de la révolution, de décrire l’insurrection à Petrograd comme une révolution urbaine, d’essayer de suggérer une appréhension plus vivante des dirigeants bolcheviks ou sociaux-démocrates. Il s’avère qu’une traversée littéraire de la révolution est à même de donner à penser sur le plan stratégique, car elle nous fait vivre l’éclosion de subjectivités, l’émergence d’un agencement collectif qui lie les masses, la situation politique et sociale, les villes et ses boulevards, et les villages les plus reculés de l’empire russe.
Au-delà de votre travail sur le marxisme et le droit international, vous êtes surtout auteur de romans fantastiques, de «weird fiction». Pour quelles raisons avez-vous décidé d’écrire l’histoire de la Révolution d’Octobre ?
Cette année marque le centenaire de la Révolution russe, ou plutôt des Révolutions russes, car il y en eut deux au cours de cette année extraordinaire. Je, nous – j’inclus ici mon éditeur – pensions qu’il était très important de marquer cette année par un texte qui puisse être apprécié par des non-spécialistes, par tous les lecteurs. Un livre qui soit écrit comme un récit tout en étant rigoureusement fondé sur de la recherche. Le point de départ a donc tout simplement été cet anniversaire. Bien entendu, notre intention n’était pas seulement de donner vie à la Révolution: il s’agissait en outre de s’opposer à certains des mythes les plus pernicieux et les moins convaincants qui lui tournaient autour, et donc d’écrire en sympathie et en solidarité avec elle. J’ai écrit le livre de manière à ce qu’il ne raconte pas une histoire pour militants de gauche, mais une histoire pour tous ceux qui s’y intéressent. Une histoire pour tout le monde, bien qu’elle reste écrite, de toute évidence, par un militant de gauche. J’ai essayé d’être impartial, mais mes propres opinions – bien qu’elles ne soient pas mises en avant – n’en sont pas camouflées pour autant.
 Votre livre va à l’encontre des récits habituels, tels que ceux des universitaires Richard Pipes [La Révolution russe, PUF, 1993] ou Martin Malia [Comprendre la Révolution russe, Seuil, 1980] qui présentent la Révolution d’Octobre comme un simple coup d’Etat. Quels sont les éléments marquants qui font de l’année 1917, je vous cite, «un enchaînement épique d’événements» ?
Votre livre va à l’encontre des récits habituels, tels que ceux des universitaires Richard Pipes [La Révolution russe, PUF, 1993] ou Martin Malia [Comprendre la Révolution russe, Seuil, 1980] qui présentent la Révolution d’Octobre comme un simple coup d’Etat. Quels sont les éléments marquants qui font de l’année 1917, je vous cite, «un enchaînement épique d’événements» ?
Du point de vue de la narration, il est déjà difficile de tomber dans l’exagération, tant cette année a été réellement extraordinaire: elle fut autant le résultat de la contingence et du hasard que du calcul minutieux. De mon point de vue, la simple lecture des événements rend la thèse du coup d’Etat très peu convaincante. Souvenez-vous que Pipes voit des tentatives de coups partout, et pas uniquement lors des journées de juillet: il décèle une tentative de coup bolchevik en avril aussi. Les éléments marquants de cette année sont des combinaisons de particularités et de généralités, de contingences à l’intérieur de tendances. Je me rends bien compte que cela doit sembler très général, mais c’est précisément cet enchevêtrement de déterminations et de surdéterminations qui surprend constamment.
Non sans rappeler L’Histoire de la Révolution russe de Léon Trotsky, votre livre commence par un chapitre sur les particularités du développement de la Russie. Plus tard, C. L. R. James a repris l’idée de la nationalisation de la Révolution. Et pourtant Trotsky et James ont été profondément attachés à l’idée de Révolution mondiale. Pourquoi la compréhension de la Révolution, voire de toute révolution, a-t-elle besoin de cet ancrage spécifique?
Simplement parce que ce n’est pas une coïncidence si la Révolution a eu lieu à un endroit particulier, à un moment particulier – et cela s’applique à toute révolution. Comme je l’ai dit plus haut, cela ne signifie pas que toute révolution soit inévitable, inéluctable et que l’on puisse la prédire, comme si elle était promise par une sorte de Weltgeist («esprit du monde»). Cela signifie néanmoins que dans sa détermination aléatoire, dans ses contingences et dans ses tendances, elle doit être comprise comme étant spécifique et particulière. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de grands mouvements généraux dont nous puissions tirer des conclusions, mais qu’il faut le faire avec prudence, en tenant compte de chaque contexte particulier.
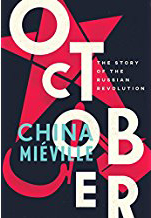 Votre livre décrit d’une manière très vivante les places, les rues, les lieux où des événements révolutionnaires ont eu lieu dans Petrograd, et vous fournissez plusieurs cartes dans les premières pages du livre. Pourquoi l’espace est-il particulièrement important pour raconter la Révolution?
Votre livre décrit d’une manière très vivante les places, les rues, les lieux où des événements révolutionnaires ont eu lieu dans Petrograd, et vous fournissez plusieurs cartes dans les premières pages du livre. Pourquoi l’espace est-il particulièrement important pour raconter la Révolution?
Les spécificités de l’espace, au moins autant que celles du temps, définissent la réalité de la Révolution russe. Le contexte spatial de Petrograd confère aux flux révolutionnaires des formes particulières – traverser la rivière, aller vers le centre de la ville, partir du périmètre des quartiers ouvriers, remonter les boulevards – qui façonnent à leur tour des subjectivités spécifiques, capables de voir le soulèvement grossir le long des grandes avenues, initialement pensées comme un vaste projet bourgeois [Saint Pétesbourg est créée en 1703 par Pierre le Grand]. C’est ce qui donne une conscience de soi propre à la subjectivité de l’époque de la conquête urbaine, et qui confère à la révolution ses spécificités propres à cet endroit. Bien entendu, ailleurs, ces dynamiques auront leurs propres spécificités.
Au cours de l’année 1917, plusieurs conflits ouverts ont éclaté entre les masses et l’autorité politique. Dans ce contexte, il semble particulièrement intéressant de noter que la foule a fait une distinction entre la police et l’armée. Comment les masses se sont-elles comportées face aux forces répressives?
Tout s’est déroulé dans le cadre d’une guerre cataclysmique et désespérément impopulaire. Les soldats ont, en grande majorité, fait partie de la masse du peuple et – même si cet aspect a connu des variations – leur répulsion à l’égard de la guerre qu’ils étaient en train de mener a suscité beaucoup de sympathie à leur égard. Régulièrement, des appels aux forces armées sont lancés, dans la volonté permanente de créer de l’agitation dans leurs rangs afin de les pousser à rejoindre un camp politique. Après février 1917, un certain nombre de forces dans le pays, et pas seulement à gauche, ont considéré ces actions au sein de l’armée comme une priorité. En revanche, la police – les « pharaons » – a été, à juste titre, la cible de la colère populaire, particulièrement en février, et par la suite également. A tel point que K. I. Globachev, un ancien dirigeant de l’Okhrana [«Section de sécurité», police politique de la fin de l’Empire russe, qualifiée par Victor Serge de «modèle de la police politique moderne], a choisi de rester incarcéré dans la prison de Kresty à Petrograd tout au long de cette année, tant il craignait la colère de la rue.
A gauche, l’année révolutionnaire de 1917 est importante car elle montre l’intervention directe des ouvriers, des soldats et des paysans dans le cours de l’histoire; toutefois, la question nationale a également joué un rôle important. Dans cette optique, Etienne Balibar a souligné la conception léniniste des «révolutions impures», qui combinent des mouvements de classe avec des revendications nationales. Selon vous, dans quelle mesure la revendication de l’autodétermination parmi les musulmans, les Polonais, les Ukrainiens et bien d’autres nationalités, capturés dans la prison des peuples tsariste, a contribué à la révolution?
Elle a contribué à la révolution tout en étant «contribuée» par cette dernière – sans vouloir jouer sur les mots. Les interrelations de ces pulsions de liberté variées sont extrêmement imbriquées et difficiles, voire impossibles, à démêler. Bien entendu, toutes les révolutions sont en ce sens «impures».
La volonté de l’auto-détermination nationale s’est évidemment renforcée tout au long de cette année, provocant à des degrés différents la peur ou la solidarité chez les radicaux en Russie, ce qui a contribué à accélérer la tendance à la rupture des structures traditionnelles, tout en étant animée par cette tendance même.
Cela peut paraître une réponse évasive, et j’en suis désolé, mais je pense que ces processus sont inextricables. Les minorités nationales ont toujours été surreprésentées parmi les révolutionnaires; déjà avant 1917, ces groupes étaient le lieu d’une compréhension particulièrement aiguë des réalités des structures oppressives. Liliana Riga [The Bolsheviks and the Russian Empire, Cambridge University Press, 2012, rééd. 2014], parmi d’autres, a réalisé un travail très pertinent qui montre combien les militants issus de ces milieux, donc des personnes marquées par les particularités des oppressions nationales, ont été importants pour le mouvement révolutionnaire. La thèse de l’effondrement du bolchevisme après la révolution dans un bourbier de chauvinisme national russe est une réalité bien déformée.
Votre livre insiste sur le rythme de la révolution. Vous la comparez au mouvement des vagues, en montrant qu’elle s’est développée en suivant un renforcement puis un relâchement de la tension politique, qui s’est matérialisée dans des mots d’ordre, des actions spontanées, des décisions institutionnelles… Dans quelle mesure les leaders politiques ont-ils pu façonner le mouvement de ces vagues?
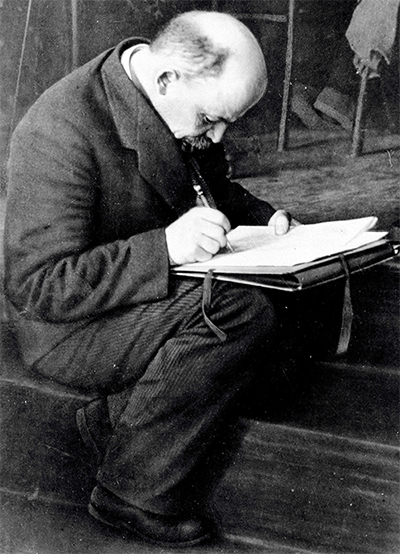 Cela dépend bien entendu du moment et du leader. Je dirais qu’il y a des circonstances exceptionnelles pendant lesquelles un leader exceptionnel peut avoir une véritable efficacité – ce qui ne veut pas nécessairement dire quelqu’un d’exceptionnellement brillant, même si cela a pu être le cas, mais simplement quelqu’un qui, pour des raisons multiples, convient particulièrement à ce moment précis.
Cela dépend bien entendu du moment et du leader. Je dirais qu’il y a des circonstances exceptionnelles pendant lesquelles un leader exceptionnel peut avoir une véritable efficacité – ce qui ne veut pas nécessairement dire quelqu’un d’exceptionnellement brillant, même si cela a pu être le cas, mais simplement quelqu’un qui, pour des raisons multiples, convient particulièrement à ce moment précis.
Comme beaucoup d’autres, je pense par exemple que la thèse selon laquelle Octobre n’aurait probablement pas eu lieu en l’absence de Lénine est très convaincante. Ce sont des moments extraordinaires qui croisent des personnes extraordinaires. Dans la plupart des cas, je pense que ce type de concentration est inhabituel – et inversement, qu’il peut y avoir des personnalités banales qui produisent un effet disproportionné.
L’année 1917, ainsi que les années qui ont précédé et celles qui ont suivi, n’ont pas manqué de héros et de personnalités monumentales. Mais 1917 n’a pas non plus manqué de ratés et certains d’entre eux – Kerensky en est l’exemple le plus amusant – ont pu jouer malgré tout un rôle important. C’est un bouffon ridicule, avec un petit côté «histoire du monde». Ce qui distingue quelqu’un comme lui de quelqu’un comme Lénine, c’est que ce dernier a davantage de couleur locale: avec un sens particulièrement aigu du politique, son impact a été plus direct et, dirais-je, plus mesurable. C’est pour cette raison que les débats interminables tenus dans l’ombre et sur des détails minimes ne sont pas que de la complaisance, et qu’ils ont des effets très concrets dans un moment de soulèvement.
En lien avec ma question précédente, 1917 n’a pas été un moment d’offensive continue qui aurait finalement mené à l’assaut du Palais d’Hiver. En effet, vous montrez la relation étroite entre des objectifs défensifs, comme la protection des acquis de la Révolution de Février, et le renversement offensif du gouvernement provisoire en octobre. Quelles leçons stratégiques peut-on tirer de cette expérience?
Sur ce point, je fais les hypothèses suivantes :
- Les révolutions ne seront pas des moments ponctuels et synchroniques faits d’un «avant» et d’un «après».
- La limite entre «défensif» et «offensif» est fortement perméable.
- De même que celle qui sépare stratégie et tactique.
- Les «leaders» et «l’avant-garde» sont parfois aussi susceptibles de sauter dans le train en cours de route que de mener la bataille sur le front.
- Ils sont tout aussi capables de refréner les masses – avec ou sans succès – que de les pousser à avancer.
- Il sera parfois juste d’agir ainsi.
- Leur rôle (indépendamment de la manière dont on le conçoit) est donc autant d’écouter et d’apprendre que de rejeter et d’expliquer. L’humilité leur a trop manqué.
- Ce n’est que lorsqu’une première lueur est apparue qu’un vrai faisceau devient possible.
Comment expliquez-vous la capacité des révolutionnaires à résister à la propagande de la classe dominante qui, sur la base (réelle) de la hausse importante du taux de criminalité, des meurtres, des lynchages, disait que la Russie était devenue une «maison de fous» ? Toute mesure gardée, cela résonne familièrement à qui est accoutumé à la rhétorique antiterroriste d’aujourd’hui, qui justifie ce faisant la restriction des droits démocratiques.
En effet, rester critique vis-à-vis de cette rhétorique de la «maison de fous» ne signifie pas nier l’existence d’une crise sociale, cette dernière incluant la hausse du taux de criminalité et des meurtres épouvantables. Et ce n’était pas uniquement la droite ou la classe dominante qui concevait les choses ainsi. L’astuce consistait (et consiste toujours, dans les circonstances appropriées) à ne pas nier la catastrophe sociale mais 1° : à l’expliquer, afin de pouvoir, 2° : offrir une réponse politique qui permettrait de la surmonter au mieux.
Les sociaux-démocrates – et en particulier les bolcheviks – ont tout d’abord reconnu la crise. Mais leur analyse a été très différente de celle des libéraux ou des sociaux-démocrates «modérés». Il y a un risque à mettre en parallèle de manière simpliste la situation d’alors avec celle d’aujourd’hui. Dans le contexte actuel du terrorisme et de l’islamophobie, l’une des batailles idéologiques les plus importantes n’est pas tant d’expliquer l’émergence d’un type particulièrement toxique de djihadisme apocalyptique – sans dire pour autant que ce n’est pas un travail qui doit être fait, ni que nous n’avons pas essayé de le faire par exemple dans Salvage, parce qu’il s’agit d’une vraie force sociale – mais de marteler l’idée que les musulmans, dont la vaste majorité n’a, bien entendu, rien à voir avec cette politique, sont surtout les victimes de la violence d’État et de l’oppression dans «l’occident civilisé».
Ce qui est semblable, en revanche, dans ces deux situations, c’est un sentiment de panique morale et sociale, et l’impression qu’on agite un épouvantail – que l’on peut toujours traquer et découvrir. Toutefois, je pense que les valeurs particulières de ces deux cas sont plus différentes que semblables.
Vous soulignez qu’Octobre est la révolution de la Russie, mais qu’elle appartient aussi à d’autres. A qui appartient Octobre ?
Cela dépend évidemment de nous. Je voudrais qu’Octobre nous appartienne et je pense que c’est le cas. Je veux que le sentiment qu’il s’agit de notre histoire, de l’histoire des forces grandissantes qui menèrent au renversement de la pulsion de mort, du sadisme social empoisonné, de la barbarie capitaliste, nous apparaisse de plus en plus clairement. Il ne faut pas tomber dans l’hagiographie ou le sentimentalisme.
Les histoires attentives d’observateurs critiques et les réflexions de ceux qui se sentent solidaires avec les révolutionnaires sont très importantes de ce point de vue. Cela prouve que nous pouvons et devons aller au-delà de la posture, viscérale, de l’avocat de la défense de la révolution. Cependant, nous devons, avec une solidarité et une fidélité critiques, réclamer cette histoire comme étant la nôtre et considérer nos propres luttes autant comme un retour que comme des pas vers l’avant. (Traduction par Benjamin Birnbaum revue par Juliane Lachaut pour la revue Période; édition A l’Encontre)

Soyez le premier à commenter