
Entretien avec Jean-Pierre Filiu
conduit par Pierre Puchot
«Aujourd’hui, Obama solde les comptes.» Paru début 2013 chez Fayard, le dernier livre de Jean-Pierre Filiu (Le Nouveau Moyen-Orient, 402 p., 22 €) n’est pas simplement le récit événementiel d’une révolution en cours s’attachant d’abord à décrire la spécificité du système Assad «pour ensuite décliner les “saisons” de la révolution». C’est aussi une projection pour tenter de voir, derrière ce Moyen-Orient désinvesti par les puissances internationales, le nouvel élan d’une région clé qui renouvelle ses acteurs et forge son processus auto-émancipateur. «Cette révolution syrienne est politique, elle vaincra par le politique», nous explique le professeur de Sciences-po (Paris), familier de la Syrie depuis plus de trente ans, qui décrit la révolution arabe comme un «processus qui durera une génération». Entretien.
Mediapart. Pourquoi avoir écrit ce livre aujourd’hui, qui propose une analyse sur le devenir à long terme du Moyen-Orient, alors que le conflit syrien paraît plus embrouillé que jamais?
Jean-Pierre Filiu. Je suis historien, et par conséquent je me livre à un exercice pour le moins périlleux d’un point de vue intellectuel. Je m’y étais déjà livré dans mon précédent livre, La Révolution arabe, rédigé en anglais dès le printemps 2011. Mon but était, très simplement et humblement, de présenter des outils, qui sont ceux de la méthode historique, pour arriver à y voir plus clair dans la confusion ambiante. Car c’était déjà le cas au printemps 2011, où en Tunisie planait une sorte d’état de grâce. J’étais déjà convaincu que cet état de grâce serait fugace et que le printemps deviendrait très vite un automne, voire un hiver, et que l’on finirait par rejeter la révolution en tant que telle, avant même d’avoir commencé à la comprendre.
Cette démarche que j’ai suivie pour ce que j’appelle «la révolution arabe», je l’ai appliquée cette fois à la révolution syrienne, avec une valeur ajoutée qui est ma connaissance de la Syrie depuis trois décennies, et donc la volonté de placer dans une perspective historique ce qui se passe aujourd’hui, de redonner du sens.
Au-delà du fait que nous sommes accablés par les horreurs qui se passent, la confusion profite aussi au dictateur et à la contre-révolution, au régime et à ceux qui veulent détourner la révolution pour lui faire perdre le fil. Je ne pense donc absolument pas détenir LA grille d’interprétation. Mais, en tant qu’historien, j’en propose une. Et je joue cartes sur table, en développant des arguments pas à pas, que l’on peut bien sûr contester en conscience.
Votre livre est un peu hybride, puisqu’il réunit un exposé factuel des étapes de la révolution syrienne, auquel succède une série de «leçons», donc d’analyses, sur le Moyen-Orient dans sa globalité. Pourquoi avoir construit l’ouvrage ainsi?
La première partie concerne l’assise historique, dont je me suis rendu compte, au cours des débats récents qu’au fond, très peu d’observateurs, même bien intentionnés, la maîtrisaient. Il fallait donc d’abord reconsidérer le système Assad, pour ensuite décliner les «saisons» de la révolution. Ces saisons, on en perd vite le fil, la manière dont tout s’enchaîne. Il s’agissait donc de redonner cette séquence de la Syrie contemporaine en la plaçant dans la perspective de la construction nationale syrienne. C’est l’essentiel du livre. Vient ensuite le «suivi» de mon livre sur la révolution arabe, qui est un bilan d’étape en quelque sorte, car je pense que nous sommes dans un processus qui durera une génération.
Mais, contrairement à beaucoup de commentateurs, je trouve que cela va très vite, beaucoup plus vite que je ne le pensais, au niveau de la maturation des différents acteurs. À partir de là, j’ai fait deux choses: j’ai repris les «leçons» déjà énoncées dans le livre en 2011, en en faisant des points de repère sur la route, et j’ai considéré le rapport de force entre révolution et contre-révolution. Cette contre-révolution a pris très vite dans le monde arabe, et a fourbi des armes tout à fait dévastatrices pour la dynamique révolutionnaire. Je les énonce à travers la malédiction du pétrole, le gouffre confessionnel et le double tranchant de la force, le fait qu’en Syrie, l’on n’a souvent pas le choix de la militarisation, sachant que cette militarisation change la dynamique révolutionnaire elle-même.
On parle beaucoup de la Syrie aujourd’hui comme une terre de djihad, des Tunisiens, des Égyptiens s’y rendent pour combattre. Dans quelle mesure ce phénomène a-t-il modifié le rapport de force sur le terrain, depuis qu’il a pris sa pleine mesure, à la fin 2012?
Là aussi, j’essaie, en posant une séquence historique, de montrer que ce qui a été créé n’est pas donné pour l’éternité, que ce processus d’attraction djihadiste a un commencement, un développement que nous sommes en train de vivre, mais ce sera aussi un cycle qui peut s’achever. Il faut donc montrer quelles sont les conditions qui l’ont permis: le double jeu des anciens combattants djihadistes d’Irak, qui travaillaient avec Bachar al-Assad et sont passés dans le camp révolutionnaire en créant le front Nusra en janvier 2012; la solidarité profonde, et je dirais presque l’empathie de vétérans libyens, qui voient dans la Syrie l’équivalent de leur propre révolution ; et puis, ce jeu que je lie à la malédiction du pétrole, de la surenchère entre le Qatar et l’Arabie saoudite, qui alimente l’extrémisme salafiste et/ou djihadiste au profit de ces groupes.
En même temps, je suis très frappé de ce qui se passe ces derniers jours entre Nusra et Al Qaïda en Irak. Et c’est là où l’historien a une petite contribution à apporter, dans le rappel, et je pense que cela va s’aggraver très vite, des rapports entre les branches syriennes et irakiennes du Baas. La doctrine du Baas est tout aussi internationaliste que l’est la doctrine djihadiste. En même temps, on voit bien qu’une fois que se sont consolidées des formes nationales de cette doctrine transfrontalière – comme le Baas dans les années 1960 et pour le djihadisme, aujourd’hui, avec le front Nusra – la contradiction devient très forte entre ces deux expressions nationales. Depuis 2006, lorsque j’ai écrit Les Frontières du djihad, je pense qu’il y a une contradiction insurmontable entre un djihad de type national et un djihad de type global, transfrontalier.
À mon avis, dans la confusion de ces derniers jours, l’on est déjà pas très loin de contradictions en Syrie entre les Irakiens, qui très clairement veulent utiliser la Syrie comme base arrière pour leur djihad contre le premier ministre Maliki, pour faire simple, et les Syriens, qui veulent utiliser l’Irak comme base arrière contre Bachar al-Assad, chacun souhaitant utiliser l’autre, avec des priorités qui vont très vite diverger.
Il est évident que l’allégeance prêtée par Nusra à Zawahiri (numéro un d’Al Qaïda – ndlr) est très grave, mais je ne vois pas sa conséquence sur le terrain, car Zawahiri n’a aucun moyen de peser sur le cours des choses en Syrie.
Depuis l’été 2012, et la semaine passée encore, se succèdent à intervalles réguliers les offensives dites «décisives», qui n’amènent finalement jamais la fin du conflit et la défaite du régime syrien. Comment expliquez-vous la récurrence de ces «fausses alertes» et la permanence du conflit?
Depuis le début, je dis une chose: la victoire ne sera pas militaire. Il y a une forme d’illusion militariste, milicienne, dans l’idée que cette révolution va se dénouer par les armes. Je pense que ce que l’on a appelé l’offensive des deux capitales, en juillet 2012, est une erreur stratégique majeure de la révolution syrienne, qui s’est enferrée dans une guérilla urbaine, qui a provoqué des destructions sans précédent, sans pour autant élargir sa base, et c’est même l’inverse, vous l’avez vu vous-même sur le terrain. Toutes ces illusions, qui reviennent régulièrement, sont porteuses de grandes souffrances pour le peuple syrien, mais aussi de grandes tensions dans le camp révolutionnaire.
Je pense donc évidemment qu’il faut un rapport de force militaires, mais que l’idée que ce rapport de force est l’alpha et l’oméga de la révolution est une erreur très grave. Cette révolution est politique, elle vaincra par le politique. Le palais présidentiel ne sera pas pris à coups de canon, ou alors il sera vide. Le but, c’est d’établir un rapport de force militaires, qui permette de changer la donne politique. À titre personnel, je suis pour l’armement qualitatif de la révolution. Non pas pour lui permettre de gagner –c’est possible, mais cela impliquerait des destructions énormes–, mais pour lui permettre d’avoir enfin un endroit en Syrie d’où l’Autorité révolutionnaire émettra son propre pouvoir alternatif.
N’est-il pas déjà trop tard pour amorcer cet armement des rebelles par la France, les États-Unis et les puissances occidentales?
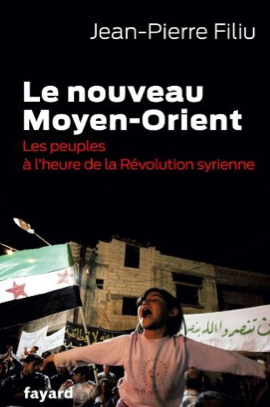 Nous en sommes à deux années de désastre, et nous en sommes à un point où il n’y a plus que des mauvaises solutions. Il faut prendre la moins mauvaise, pour essayer de limiter des dégâts qui vont encore être considérables.
Nous en sommes à deux années de désastre, et nous en sommes à un point où il n’y a plus que des mauvaises solutions. Il faut prendre la moins mauvaise, pour essayer de limiter des dégâts qui vont encore être considérables.
La coïncidence avec les dix ans de l’invasion irakienne est intéressante. L’Irak mettra à partir d’aujourd’hui beaucoup plus de temps à se reconstituer que ne le mettra la Syrie, car en Syrie, le processus endogène est toujours dominant. La révolution gagnera, toute la question est de savoir quelle sera sa nature, et dans quel rapport de force au sein du camp révolutionnaire. Il vaut donc mieux se positionner dans l’après, que de juger au jour le jour.
Néanmoins, dans l’introduction de votre ouvrage, vous écrivez: «Il s’agit de restituer une légitimité populaire à une Syrie née des diktats coloniaux et asservie à une clique rapace», ajoutant même que la Syrie souffre d’une «vulnérabilité structurelle». Comme si la guerre actuelle n’était que le prolongement, ou plutôt le résultat, de la faiblesse de cet État, depuis qu’il s’est constitué en tant que tel. N’y a-t-il pas là une contradiction avec la capacité que vous prêtez à la Syrie de se reconstruire plus rapidement que l’Irak?
Ma thèse, c’est que nous sommes à la conclusion d’un processus d’auto-détermination, alors que très souvent, les grilles d’analyse prennent peu, ou pas du tout en compte cette dimension. Ce n’est pas pour rien qu’on parle d’«Armée syrienne libre». C’est vraiment une lutte de libération contre un régime qui d’ailleurs traite sa population comme une armée d’occupation.
La grande force de la Syrie, c’est qu’elle trouve tous les jours en elle-même cette énergie nationale, patriotique, cet orgueil d’être Syrien, même dans les ruines. Ils sont convaincus qu’ils ont beaucoup à apprendre au monde arabe et au monde entier, et ils iront jusqu’au bout, par eux-mêmes. Et par conséquent, avec toutes ses failles, ce processus de libération nationale va consolider la conscience nationale syrienne, dans les frontières actuelles.
L’Irak, c’est presque le contre-exemple: le processus de construction nationale a été totalement anéanti. En 2003, avec l’invasion américaine, on détruit tout, et on rebat les cartes de la pire façon, en re-tribalisant, en re-communautarisant une société, qui avait quand même réussi malgré tout à dépasser cela. Le risque existe cependant en Syrie aussi, c’est pour cela qu’il vaudrait mieux que cela ne dure pas trop longtemps.
C’est là que je fais un parallèle entre ce que faisaient les Français en 1925-26, avec l’écrasement de la révolte druze, ils bombardaient et en même temps organisaient des élections, et ce qui se passe avec Bachar al-Assad en 2011-13. L’autre parallèle, c’est que les Français jouaient sur les communautés alaouites, druzes, et que le mouvement national syrien s’est construit dans les années 1930-40 contre ces formes de séparatisme, et qu’à la fin, malgré tout, il a obtenu l’indépendance. Cette indépendance était incomplète, elle se réalise aujourd’hui pleinement, évidemment dans une douleur infinie.
Vous opposez en outre le peuple syrien et la Syrie dans son destin national d’un côté, et «l’illusion d’une Syrie-théâtre», où se mèneraient des guerres par procuration.
Vous, comme d’autres journalistes, vous allez sur le terrain. Mais enfin, la plupart des gens qui parlent sur la Syrie, au fond, connaissent assez peu, si ce n’est pas du tout, ce terrain syrien. C’est quelqu’un qui a été diplomate pendant 20 ans qui vous le dit d’expérience, ces gens sont prisonniers de ce ballet diplomatique: «Mais que va faire le Qatar?» ; «Mais où en est le conseil de sécurité?», etc.
Quoi qu’il se passe à l’extérieur, ça ne changera pas cette marche syrienne vers l’autodétermination. Le coût sera exorbitant et les rapports de la Syrie de demain avec les différents États dépendront beaucoup du contexte international. Mais on voit bien aujourd’hui que pour Obama comme pour Poutine, le peuple syrien n’existe pas. L’un comme l’autre ont des priorités, qui sont le nucléaire iranien, Israël, la stabilité régionale, et au fond, ils ne rêvent que d’une chose, c’est que le peuple syrien se laisse massacrer en silence, pour pouvoir «s’occuper des choses sérieuses».
Eh bien, ça ne marchera pas. Et la Syrie demeurera le dossier le plus important dans la région.
Pourquoi estimez-vous que la Syrie imprimera quoi qu’il arrive sa marque à ce que vous désignez comme le nouveau Moyen-Orient, davantage que l’Égypte ou l’Irak?
On voit bien que l’Égypte et l’Irak sont enferrés dans leurs propres contradictions. Je crois, dans la révolution arabe, non pas aux contagions, qui est d’ailleurs un terme atroce, mais au fond à une forme de hiérarchie de type révolutionnaire. Les Tunisiens ont été en tête, et c’est cela qui a poussé les Égyptiens à briser le tabou. Demain, les Syriens seront sur un champ de ruines, mais ils se seront libérés par leur propre énergie, et ils seront allés beaucoup plus loin dans le démantèlement du système dictatorial. Il faut bien voir que l’Orient, avant justement cette construction géopolitique qu’est le Moyen-Orient, c’est Damas, Bagdad, Le Caire. Cela fait quelques millénaires que les configurations de pouvoir fonctionnent sur ce triangle.
Cet équilibre a été perturbé par l’Arabie saoudite qui, pour la première fois depuis la fondation des Omeyyades, s’est imposée dans le jeu comme acteur dans la définition de l’Orient. On voit bien aujourd’hui que le pays qui est le plus intimement lié au champ de la révolution syrienne, c’est l’Arabie. Pour donner le change à l’intérêt que suscite la révolution chez eux, les Saoudiens sont d’ailleurs avec les groupes parmi les plus agressifs. Après la révolution, il faudra être l’ami des Syriens pour exister. Ils seront l’équivalent de ce qu’ont pu être, sans pourtant avoir remporté la moindre victoire, les Palestiniens dans les années soixante-dix, que tout le monde devaient courtiser pour exister dans le monde arabe.
N’y a-t-il pas un paradoxe, qui viendrait perturber cette mutation du Moyen-Orient que vous anticipez, par le fait que le Grand Moyen-Orient de Bush et sa vision binaire et simpliste d’une région séparée entre sunnites et chiites, est en train d’être activé sur le terrain par la contre-révolution et les régimes dictatoriaux, comme c’est le cas à Bahreïn où le régime déplace chiites et sunnites dans des villages distincts et les sépare par des check-points?
Nous sommes dans une série de prophéties auto-réalisatrices, avec des machines contre-révolutionnaires, ce qui est pour eux un contre-feu. Les djihadistes n’existaient pas au début du conflit syrien ; aujourd’hui, ils représentent une force tout à fait substantielle. Et ça arrange beaucoup de puissances extérieures. La confrontation sunnites/chiites sied parfaitement aux deux grands États contre-révolutionnaires que sont l’Arabie saoudite et l’Iran. Effectivement, Bahreïn est le premier exemple de contre-révolution réussie dans ce processus de la révolution arabe. Mais ce ne sont jamais que des palliatifs.
La contradiction sunnites/chiites, alaouites/sunnites, elle se creuse, elle est extrêmement inquiétante. Le plus grand défi de la révolution syrienne est d’arriver à construire non seulement un discours, mais un véritable programme incluant les Alaouites, pour qu’ils aient toute leur place dans la Syrie de demain. Sinon, on les laisse otages du régime de Bachar al-Assad, ce qui est tragique.
Ce nouveau Moyen-Orient que vous décrivez, c’est la fin de l’orientalisme politique, de cette construction d’une région par le regard dominateur et réflexif de l’Occident, tel que l’a théorisé l’intellectuel palestinien Edward Saïd?
Je dirais que c’est la fin de l’Orient rêvé, car la projection de puissances est toujours une projection d’images, que ce soit l’image des révolutions arabes, l’image du choc des civilisations, etc. Aujourd’hui, les États-Unis comme les autres n’ont plus de moyens de gérer cette partie du monde. Alors que pendant un siècle, le Moyen-Orient, tel que conceptualisé par l’amiral Mahan, était le lieu où s’affirmait la puissance planétaire.
La dernière occurrence de ce phénomène, c’est évidemment 1990, Bush père et le nouvel ordre mondial, qui naît sur les ruines de l’armée de Saddam Hussein. Quand, treize ans plus tard, Bush fils envahit l’Irak, cela s’achève dans une catastrophe, d’abord pour les Irakiens, mais aussi pour l’ensemble de la région. Car on peut aussi considérer qu’un mouvementent démocratique en Syrie se serait développé beaucoup plus tôt, s’il n’y avait pas eu l’épouvantail du chaos irakien. J’essaie d’ailleurs de décrire comment Bachar al-Assad a profité de cette descente aux enfers de l’Irak.
Aujourd’hui, Obama solde les comptes. Il se retire d’Irak, il va en Israël et en Palestine pour dire: «Mettez-vous d’accord, et quand vous le serez, voilà mon numéro de téléphone.» C’est un retrait multiforme, c’est vraiment: «Bye-Bye Middle-East.» En tant qu’historien, il me paraît tout à fait normal que ce retrait des puissances s’accompagne d’une reprise en main par les peuples, dans des conditions qu’aucune des puissances et qu’aucun appareil d’État concerné ne peuvent envisager, puisqu’ils n’ont jamais traité avec ce type d’acteurs.
Nous ne sommes cependant pas là à dire: c’en est fini du Grand Moyen-Orient, on passe à l’ère des peuples. Par définition, cela se recoupe. Seulement, cette concomitance profite à la contre-révolution, qui essaie en permanence de parasiter le processus révolutionnaire avec les outils qui ont été forgés dans la période antérieure d’ingérence étrangère. On en est là. C’est d’ailleurs pour cela que je crois que la révolution syrienne est beaucoup plus grande que la Syrie elle-même. Ce n’est pas pour dire que les Syriens vont se répandre dans tout le Moyen-Orient pour prêcher la révolution, mais qu’ils vont prouver par leur victoire, que je souhaite la plus rapide et la moins sanglante possible, que c’est possible. Et d’autres peuples s’engouffreront dans la brèche, je n’en ai aucun doute.
Cela rejoint l’une de vos «dix leçons» revisitées dans votre ouvrage, On peut gagner sans chef. «On» est sorti d’une période politique, et l’«on» n’a plus besoin de guide.
C’est cela… Avec le problème énorme que cela pose tout de même en Syrie. On est dans une telle culture anti-autoritaire que des gens très estimables sont accusés de tous les maux, alors que réellement, ils sont au service de la Nation.
Mais on ne peut pas faire l’économie de cet excès de spontanéisme. Les figures de l’opposition seront souvent injustement critiquées, parce qu’on est dans le cadre de la recomposition.
À mon avis, le gros problème des islamistes et des djihadistes, indépendamment des questions dogmatiques et politiques, c’est qu’ils sont, eux, dans des structures de type léninistes, avec un chef dont la légitimité ne doit pas être contestée. Et il y a une contradiction terrible entre cela et la dynamique révolutionnaire qui, elle, est beaucoup plus éclatée. Cela leur permet d’engranger de grands bénéfices dans un espace où ils présentent la structure la plus cohérente et la plus disciplinée, comme aux élections. Mais très vite, apparaissent les contradictions avec le mouvement révolutionnaire lui-même.
Dans Le peuple veut, paru en février (Actes Sud, coll. Sinbad – L’Actuel), le chercheur Gilbert Achcar met en avant l’importance structurelle de la question sociale dans les grands mouvements actuels, notamment en raison du sous-investissement public chronique dans la région depuis 20 ans. Que pensez-vous de sa démarche?
J’apporte des éléments d’historien, mais un événement d’une telle ampleur nécessiterait la mobilisation de toutes les disciplines, démographie, économie, sciences politiques, anthropologie… J’apprécie donc énormément le travail de Gilbert Achcar [voir l’entretien sur ce site en date du 19 avril 2013], car il mobilise les bases de données économiques qu’il a exploitées pour montrer ce développement non seulement inégal, mais bloqué par l’économie rentière. On voit bien que le passage de l’économie rentière à une économie de production est déterminant – c’est d’ailleurs la grande chance de la Tunisie, c’est pour cela qu’elle a ouvert la voie, car elle n’était pas dans la rente –, comme la question sociale dans son ensemble. De même que je crois qu’Alep sera déterminant demain dans l’avenir de la Syrie, pas uniquement à cause de la bataille, mais parce que c’est à Alep que l’on a les forces vives d’une production qui n’était pas totalement étatique, qui pourront redonner une perspective de progrès au pays. Cela peut même aller assez vite.
D’un autre côté, et c’est pour cela que j’évoque en conclusion la malédiction du pétrole, le baril est à 100/110 dollars. La révolution syrienne et arabe en générale se porterait bien mieux avec un baril à 30/40 dollars. Les jeux de l’Iran et de l’Arabie sont inconcevables sans la possibilité de redistribuer ces mannes pétrolières. On est donc dans la rente, donc dans la clientèle. Et on voit bien que ce qui va peser très lourd dans la révolution syrienne, c’est la différence entre les groupes clientélisés, y compris les djihadistes, branchés sur l’extérieur.
Le futur de la Syrie libre ne sera pas l’addiction de «Qui touche quoi, et de qui?» car la personne qui touchera, même moins, mais sera légitime dans son environnement, elle sera incomparablement plus forte que le djihadiste itinérant.
____
Cet entretien est paru sur le site français Médiapart en date du 20 avril 2013

Soyez le premier à commenter