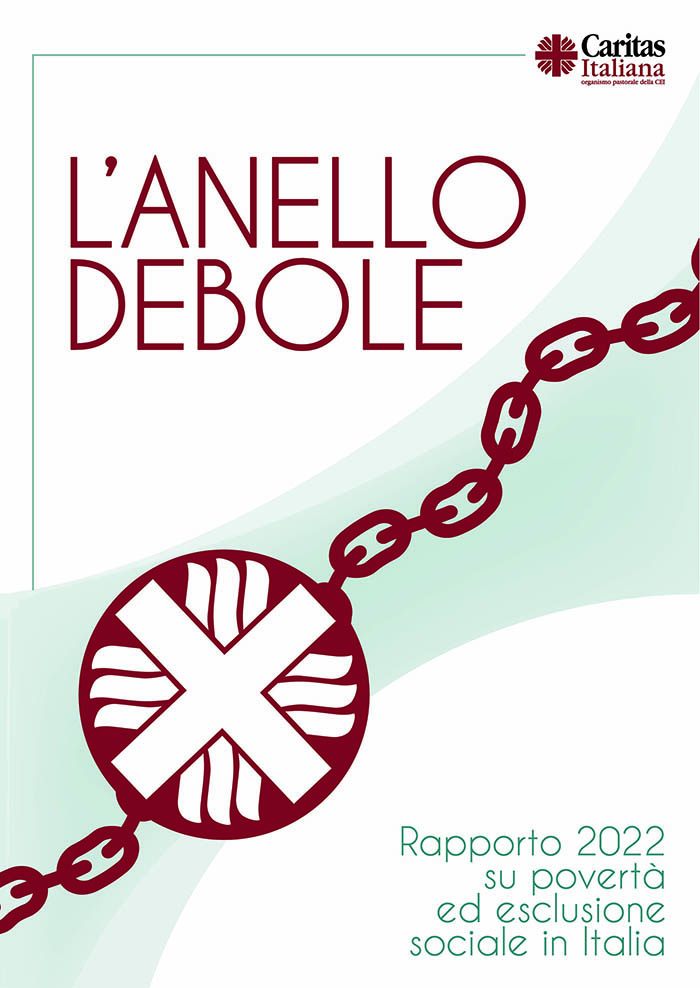 Par Fabrizio Burattini
Par Fabrizio Burattini
Le succès de la droite italienne s’explique par de nombreuses raisons. Dans cette contribution, nous nous concentrons sur la situation sociale, une situation qui trouve ses racines dans l’histoire du pays, mais aussi dans les évolutions économiques et politiques qui ont caractérisé les dernières décennies…
Un système au ralenti
Depuis des décennies, l’économie italienne connaît un ralentissement progressif mais marqué. Le PIB avait progressé en moyenne de 4,52% pour la décennie 1970, de 2,69% pour les années 1980, de 1,73% dans les années 1990, puis de 0,32% dans la première décennie du nouveau millénaire. Durant la décennie antérieure à la pandémie, sous l’effet de la crise des années 2007-2008, la stagnation s’est imposée. En 2020, l’affaissement a été à hauteur de 8,9%, puis la relance en 2021 s’est située à 6,5%. Les prévisions pour l’année en cours (2022) oscillent entre 2,4% et 3,1%. Mais les inconnues sont nombreuses et importantes, notamment en ce qui concerne l’évolution des prix des matières premières et de l’énergie en particulier.
La donnée la plus significative est le différentiel d’évolution du PIB de l’Italie par rapport à celui des autres pays de la zone euro: entre 2003 et 2007, l’augmentation annuelle a été en moyenne de 1,1% en Italie, alors qu’elle a été de 2,2% dans la zone euro. L’Italie a donc fait moins bien que l’Allemagne (+1,6%), que la France (+2%) et surtout que l’Espagne (+3,5%). Durant la récession entre 2008 et 2012, le PIB de l’Italie a baissé davantage que celui des autres pays: soit de 1,4% par an, alors que celui de la zone euro n’a baissé que de 0,3%. Même la petite reprise qui a suivi (2013-2017) s’est caractérisée par une augmentation annuelle moyenne du PIB de l’Italie de 0,4%, nettement inférieure à celle des autres pays, qui dépassait partout 1%. Et lors de la dernière année avant le Covid, en 2019, l’expansion de l’économie italienne a été de 0,4%, soit un quart de celle de la zone euro (1,6%).
Naturellement, la performance du PIB du pays au cours des dernières décennies a été plombée par le paiement d’un important volume d’intérêts sur l’énorme dette publique accumulée dans le passé: 2569 milliards d’euros, soit 150,2% du PIB, le deuxième ratio dette/PIB le plus élevé de l’UE après la Grèce. Un paiement qui, objectivement, soustrait des ressources aux investissements susceptibles de créer des emplois. En tout état de cause, le tournant monétaire drastique imposé au pays dans les années 1990 pour lui permettre d’entrer dans le système de l’euro a fortement influencé la croissance du PIB.
Des facteurs qui plombent le pays
Mais la croissance du PIB a également été ralentie par la faible productivité de nombreuses entreprises, par la baisse des investissements publics, en particulier dans la recherche et l’éducation. A cela s’ajoutent les diverses formes – accentuées – de corruption, le poids important de l’évasion fiscale et de l’économie «au noir», etc.
Dans ce domaine également, l’Italie obtient des résultats peu enviables. La fraude à la TVA est estimée annuellement par plusieurs instituts de recherche à quelque 30 milliards d’euros, soit près de 35% du total. En Allemagne, la fraude à la TVA semble s’élever à un peu plus de 23 milliards, soit 25,8%, en France à 13,9 milliards, soit 7,4%. Les différentes estimations de l’évasion fiscale italienne annuelle totale au détriment des différents impôts oscillent toutefois au-dessus de 100 milliards, avec un écart entre les recettes théoriques et les recettes collectées toujours supérieur à 20% chaque année (sauf en 2018 avec 19,3%).
Au poids de cette importante évasion, il faut ensuite ajouter une économie «souterraine» que l’ISTAT (Institut national de statistique) évalue à 203 milliards d’euros de valeur ajoutée et à plus de 20 milliards d’euros d’«économie totalement illégale».
Enfin, il y a le problème très grave et historique des disparités géographiques abyssales entre le nord et le sud du pays, avec un PIB par habitant allant de 43 188 euros dans le Trentin-Haut-Adige à 17 657 euros en Calabre. Un écart de près de 1 à 3, qui est nettement plus accentué que dans d’autres pays de la zone euro. En bref, deux pays en un. Il fut un temps où le gouvernement central intervenait plus ou moins efficacement pour tenter de combler cet écart. En raison du tournant néolibéral et de la «mise hors la loi» de toute forme d’intervention publique dans l’économie, depuis des décennies les seules ressources pour soutenir le Sud proviennent des fonds européens destinés à la «cohésion». Pour l’Italie, combinés au «cofinancement national», ils s’élèvent pour la période 2014-2020 à 62,8 milliards d’euros, soit moins de 0,5% du PIB par an pour chacune des sept années de référence.
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que le taux d’emploi en Italie (58,2%) soit le deuxième plus bas de l’UE après la Grèce (57%) et 10 points en dessous de la moyenne de l’UE (68,2%).
Bien sûr, le chômage, le sous-emploi, la précarité et la pauvreté accélèrent la désintégration des reliquats de «solidarité sociale» qui ont caractérisé le paysage politique et syndical italien.
Une économie en cours de transformation
Depuis 2000 (date de référence pour le nouveau rôle mondial de la Chine, mais aussi pour l’instauration de l’euro), la croissance cumulée de l’Italie a été de 2,8%, soit un huitième de celle de la zone euro (22,2%). En outre, la productivité totale de l’industrie italienne stagne depuis le milieu des années 1990.
Mais les changements dans la composition de la valeur ajoutée ont été encore plus prononcés: l’industrie manufacturière italienne est toujours la deuxième en Europe, mais elle pesait 20% en 2000 contre 15% aujourd’hui. Le nombre d’entreprises manufacturières, qui s’élevait à plus de 500 000 en 2000, a diminué de près d’un quart pour atteindre 387 000, tandis que le nombre de salarié·e·s du secteur manufacturier a chuté d’environ 700 000 et que la part de l’emploi manufacturier dans l’économie totale est passée de 20% à 15,5%. Un processus qui, par exemple, ne s’est pas produit en Allemagne (première économie manufacturière de l’UE), car le poids de l’industrie manufacturière y est encore supérieur à 23% du PIB.
Le secteur des services a progressé au cours de cette période de 20 ans, passant de 70% à 74% de la valeur ajoutée. Mais les secteurs de services les plus dynamiques n’ont pas été les télécommunications, ni les services financiers, ni le commerce, mais les services domestiques aux ménages – stimulés par une population vieillissante, dans le cadre d’un «Etat providence» très éloigné en termes d’offre moyenne du reste de l’UE – et le boom du tourisme à bas prix. En outre, la chute de la part du PIB attribuable à l’industrie manufacturière qui s’est produite en 2008-9 n’a pas été comblée.
Il s’agit de changements profonds dans le paysage économique mais aussi dans la composition de la classe ouvrière.
Une économie fortement influencée par les micro-entreprises
L’économie italienne, comme la plupart des économies européennes, se caractérise par une présence généralisée de petites ou micro-entreprises. L’Italie compte 3 820 000 PME, soit 99,9% du nombre total d’entreprises actives dans le pays. Ce pourcentage n’est pas différent de la moyenne de l’UE (99,8%), mais d’autres indicateurs relatifs aux PME italiennes sont sensiblement différents. En Italie, elles représentent 70,9% du PIB (contre une moyenne européenne de 57,6%) et, plus important encore, 81,3% de l’emploi total (contre une moyenne européenne de 67,1%). Dans l’UE, seule la Grèce présente des valeurs aussi élevées, tandis que d’autres pays comme la France ou l’Allemagne, qui sont économiquement plus comparables à l’Italie, ont des valeurs beaucoup plus faibles. Il s’agit d’un chiffre historiquement stable dans l’évolution de l’Italie d’après-guerre.
Connaissant les dynamiques sociales et humaines qui règnent au sein des petites et très petites entreprises, les relations de subordination, même psychologique, des salarié·e·s des PME à l’égard de leurs employeurs, les plus de 12 millions de salariés, hommes et femmes, qui travaillent dans ce monde (ainsi que les 3 millions de petits entrepreneurs et les plus de 5 millions d’«indépendants») ont toujours constitué un objet important pour l’action des forces politiques italiennes. Ces dernières savent, grâce à une pratique éprouvée, que gagner le consentement d’un employeur peut également entraîner le consentement de ses salarié·e·s.
A tel point que, après le «tournant de Salerne» que Palmiro Togliatti [1893-1964] a imprimé au PCI en 1944, avant même la défaite finale du fascisme, en initiant la reconstruction du parti en tant que «parti de masse», le Parti communiste italien lui-même a décidé de promouvoir, avec un succès significatif, la construction d’organisations qui rassembleraient les petits entrepreneurs. Le PCI a ainsi encouragé la formation de diverses associations sectorielles (propriétaires de stations-service, commerçants ambulants et petits commerçants, représentatns commerciaux, etc.) Celles-ci, en 1971, ont fusionné pour former les Confesercenti Nazionale, qui ont ensuite étendu leur action à l’ensemble du monde des entreprises commerciales. La CNA (Confederazione Nazionale Dell’Artigianato e Della Piccola e Media Impresa), avait déjà été créée auparavant. Ces organisations ont joué un rôle loin d’être marginal dans le développement de la gauche réformiste italienne et ont également organisé d’importantes mobilisations. Par exemple, la grève des travailleurs des stations-service organisée non par hasard en 1968 est entrée dans l’histoire; elle a permis à la catégorie d’obtenir un rééquilibrage important des marges bénéficiaires entre les petits opérateurs et les grandes compagnies pétrolières.
Il s’agissait d’organisations dominées par le PCI: leur organigramme était défini par le secrétariat du parti et elles étaient gérées selon un système renvoyant à la représentation des différents partis de gauche: le PCI, le PSI et, pendant une certaine période, également le Parti républicain. Ce système était similaire à celui en vigueur à la CGIL.
Ces organisations ont joué un rôle important dans l’enracinement et le développement du PCI, en particulier dans les régions du centre de l’Italie (Toscane, Emilie-Romagne, Marches, Ombrie) où le parti a réussi pendant quelques décennies à devenir une sorte de «parti-Etat», grâce à sa large insertion non seulement dans la classe ouvrière mais aussi dans ce que l’on appelait les «classes moyennes», y compris les entrepreneurs qui possédaient des entreprises de plus de 100 à 150 salariés.
Pour des raisons intrinsèques à leur composition sociale, ces associations ont ensuite, suivi, stimulé et, d’une certaine manière, précédé le virage à droite de ce qui était «le plus grand parti communiste d’Occident». Aujourd’hui, ces organisations – ainsi que la Ligue des coopératives, historiquement puissante, qui organise les «propriétaires» de plus de 15 000 coopératives et a joué un rôle important dans la précarisation du travail salarié dans le pays – ne se distinguent plus de leurs homologues de droite: Confcommercio, Confartigianato, Confcooperative, etc. Elles ont depuis longtemps abandonné tout lien avec la gauche politique et ont adopté une orientation totalement imprégnée par l’idéologie néolibérale.
Aujourd’hui, le monde des petits entrepreneurs italiens se situe dans l’ensemble à droite, souvent sur des positions totalement réactionnaires. Dans le jeu concurrentiel de la représentation des patrons italiens, les organisations de petits entrepreneurs ont même exprimé des critiques «de droite» à l’égard de la Confindustria elle-même, jugée «excessivement ouverte à la consultation des syndicats» et trop subordonnée aux intérêts de la «grande industrie».
La classe ouvrière oubliée par la politique
Parmi les couches sociales qui, depuis longtemps, sont l’objet d’une politique institutionnelle, on trouve, dans l’ordre: les entreprises (grandes et petites), considérées comme «la source de création d’emplois et de richesses», puis les indépendants et, enfin, les «familles» (entendues de manière générique, au-delà de leurs statuts sociaux et de revenus plus que variés). La classe laborieuse, avec ses besoins et ses intérêts, est largement absente des préoccupations politiques, sans parler spécifiquement de la «classe ouvrière», dont tout le monde (y compris à gauche) a dûment débattu de la «disparition», oubliant qu’il y a 18,2 millions de femmes et d’hommes qui sont des salarié·e·s dépendants en Italie (données ISTAT 2022).
Sur ces 18,2 millions, 3 182 000 (soit 17,5%) ont un contrat précaire ou à durée déterminée. Il s’agit d’un pourcentage particulièrement élevé, si l’on considère la moyenne européenne (15,3%) et les principales économies (Allemagne 11,4%, France 15%).
Le travail à temps partiel «involontaire» est tout aussi élevé: en Italie, 62,8% des salarié·e·s à temps partiel déclarent que le travail à temps partiel leur a été imposé par les entreprises, contre une moyenne de 23,3% dans la zone euro, 53,4% en Espagne, 28,3% en France, 7,1% en Allemagne (données Eurostat).
Sur le nombre total d’employés en Italie, à l’exception d’environ 15% de cadres et de dirigeants, le reste (85%, soit 15,5 millions de personnes) est concentré dans des postes à qualifications techniques, exécutives ou manuelles. A cet égard également, la situation est très différente de celle d’autres économies européennes comparables. En Allemagne, les travailleurs et travailleuses exerçant des professions intermédiaires inférieures représentent 76% du total, en France 71%, et même en Espagne 77,5%. La moyenne de la zone euro est de 75%.
Les femmes sur le marché du travail
En 2021, malgré le rebond de l’économie, le nombre de femmes ayant un emploi a continué de diminuer: elles étaient 9 448 000, fin 2020 elles étaient 9 516 000, en 2019 elles étaient 9 869 000. Ainsi, pendant la pandémie, 421 000 femmes ont perdu ou n’ont pas trouvé d’emploi.
Le taux d’activité des femmes (le pourcentage de femmes en âge de travailler qui sont disponibles pour travailler) est de 49,4%, soit environ 2 points de pourcentage de moins qu’avant le Covid et toujours loin derrière celui des hommes qui se situe à 72,9%.
L’Italie se classe donc au dernier rang des pays européens, dépassée également par la Grèce et la Roumanie, qui la devancent de 10 points (59,3%) dans le classement. La pandémie a évidemment eu un impact sur cette situation, mais les femmes en Italie ont toujours été contraintes, avec plus d’imposition que dans d’autres pays européens, de gérer la double charge des enfants et du travail.
La question salariale
L’Italie a toujours souffert d’une situation de forte disparité salariale avec les autres grandes économies européennes. Les données d’Eurostat (2021) nous apprennent que, par rapport à un salaire brut moyen de 37 382 € dans la zone euro, en Italie il s’élève à 29 440 €, ce qui peut être comparé à la situation allemande et française: respectivement 44 468 € et 40 170 €. Le différentiel se maintient également pour ce qui a trait aux salaires nets. Le revenu disponible annuel moyen d’un travailleur italien à plein temps sans charges familiales est de 22 339 euros. En Allemagne, il est de 29 776 euros et en France de 24 908 euros. En outre, au cours des dernières décennies, le différentiel, au lieu de se réduire, s’est creusé, étant donné qu’au cours des trente dernières années, entre 1990 et aujourd’hui, l’Italie est le seul pays de l’OCDE dans lequel les salaires bruts annuels moyens en termes réels ont diminué (-2,9%, contre +33,7% en Allemagne et +31,1% en France).
Ceci est également perçu politiquement par la population. C’est ce que confirme le 55e rapport Censis, selon lequel, pour 30,2% des Italiens et Italiennes, au premier rang des facteurs qui freinent l’emploi des jeunes (et plus généralement des travailleurs) figurent les salaires désincitatifs que les employeurs (y compris l’Etat) «offrent en échange» d’un travail, même pour ceux qui disposent des compétences et des capacités appropriées.
Cette faible attractivité salariale du travail, y compris du travail qualifié mais sous-payé, contribue à l’important phénomène des plus de 3 millions de NEETs – Not in Education, Employment or Training, c’est-à-dire n’étudiant pas, ne travaillant pas, ne recevant pas de formation – dans la tranche d’âge 15-34 ans, soit 25,1% du total.
A ces chiffres, il faut ajouter l’écart salarial entre les sexes, qui atteint environ 20%. Par exemple, un·e titulaire d’une licence (bachelor de trois ans), avec les mêmes tâches et les mêmes heures de travail, gagne en moyenne 1651 € en Italie s’il est un homme et seulement 1374 € s’il est une femme. Mais l’écart atteint 43,7% si l’on tient compte des salaires réels. En d’autres termes, les travailleuses gagnent en moyenne un peu plus de la moitié de ce que gagnent leurs collègues masculins, en raison non seulement de l’écart salarial, mais aussi du travail à temps partiel volontaire ou imposé, de la moindre dynamique de carrière et des interruptions de carrière plus fréquentes dues aux enfants et aux charges familiales en général. Ainsi, en général, le travail des femmes et les salaires perçus par les femmes sont considérés comme des «gains d’appoint» au sein des familles italiennes. Celui qui «ramène l’argent à la maison» reste donc, dans la perception de l’opinion publique, l’homme, qui est donc considéré comme le «soutien de famille» incontesté et indiscutable.
Cette réalité met incontestablement en évidence une très grave responsabilité des trois principaux syndicats (CGIL, CISL, UIL), qui revendiquent un total de 11,3 millions de membres (environ la moitié est constituée par des retraité·e·s) mais qui, au moins depuis les années 1980, ont laissé leur base sociale sans défense.
Les immigré·e·s dans l’économie italienne
Au début de l’année 2021, 5 171 894 ressortissants étrangers étaient officiellement inscrits dans les bureaux d’enregistrement municipaux (51% de femmes), avec un âge moyen de 33 ans pour les femmes et de 31 ans pour les hommes. Ils constituent 8,7% de la population résidente totale, mais représentent plus de 11% des salarié·e·s. A cela s’ajoutent environ 220 000 immigrés réguliers mais non inscrits dans un bureau d’enregistrement et environ 520 000 immigré·e· sans permis de séjour valide.
Ils viennent principalement d’autres pays de l’UE (1,4 million, notamment de Roumanie), d’autres pays européens non membres de l’UE (1,05 million, notamment d’Ukraine et d’Albanie), d’Afrique du Nord, du Bangladesh, d’Inde, du Pakistan, d’Afghanistan, de Chine, etc.
L’Italie est le 14e pays de l’UE en termes de pourcentage d’immigré·e·s résidents par rapport à la population totale. Si l’on ne considère que les immigré·e·s non européens, il s’agit du 9e pays.
Les immigré·e·s participent à la création du PIB à hauteur de 134,4 milliards d’euros par an (chiffres 2020), soit 9% du PIB italien. Leur emploi se concentre avant tout dans l’agriculture, la construction et les hôtels et restaurants, où le pourcentage du PIB produit par les immigrants est supérieur à 17%. Le revenu moyen pro capite des étrangers est d’environ 22 600 euros, ce qui correspond à environ trois quarts du revenu moyen national (29 500 euros).
Globalement, entre les impôts et les contributions versées, les immigré·e·s contribuent pour plus de 28 milliards d’euros au budget de l’Etat.
Effets sociaux globaux: les inégalités
La dynamique historique de l’indice (ou coefficient) de Gini utilisé pour mesurer les inégalités de revenu et de richesse est très significative. En fait, l’indice concernant le revenu a diminué lentement mais de façon presque linéaire jusqu’à la fin des années 1960, où il a atteint 0,37. Puis, sous l’effet des luttes de la décennie suivante, il a atteint en quelques années 0,30 en 1981, un niveau tout à fait inhabituel dans un pays capitaliste. Puis, plus lentement et de façon contradictoire, il est même descendu jusqu’au niveau de 0,29 en 1991. Mais l’année suivante, suite à l’accord d’annulation de l’échelle mobile des salaires, la politique de concertation sociale et d’austérité a été inaugurée. Dès lors, l’indice de Gini a recommencé à augmenter, rapidement, pour atteindre 0,34 en 1993, puis peu à peu jusqu’à 0,43, chiffre enregistré par la Banque d’Italie l’année dernière.
En plus de l’indice portant sur l’inégalité des revenus, la Banque d’Italie établit également un indice d’inégalité ayant trait aux actifs accumulés: pour 2021, son niveau est de 0,68. Le patrimoine net moyen [déclaré] des 5% des ménages les plus riches est de 1,6 million d’euros, tandis que le «patrimoine moyen» des 30% des ménages les plus pauvres est de 8700 euros. 30% des Italiens détiennent moins de 2% de la richesse italienne totale. Et les «classes moyennes» ont également perdu du terrain, tombant à un patrimoine moyen de 206 000 euros, contre 222 000 euros quatre ans plus tôt. Les «50% des ménages les moins riches», écrit Bankitalia, ne possédaient l’an dernier que 8% de la richesse nette totale, tandis que la moitié était détenue par les 7% les plus riches.
Selon le 13e Global Wealth Report du Credit Suisse Research Institute, publié le mois dernier, les choses vont décidément bien pour les riches Italiens: le nombre de ceux que l’on appelle les «ultra high net worth individuals», c’est-à-dire ceux qui, en Italie, peuvent compter sur une fortune supérieure à 100 millions de dollars, a augmenté de 17%: ils étaient 1157 en 2020 et sont au nombre de 1356 en 2021, dont 103 ont des actifs de plus de 500 millions d’euros.
Effets sociaux globaux: l’explosion de la pauvreté
En réalité, la «croissance économique» vantée par le gouvernement de Mario Draghi [13 février 2021-22 octobre 2022] et vantée par les médias a profité aux couches sociales les plus riches, car le revenu disponible moyen des ménages reste inférieur aux niveaux d’avant la crise. Le taux de ménages ayant déclaré que leur situation économique s’était dégradée de 5 points par rapport à l’année précédente a passé de 25,8% en 2019, à 29% en 2020 et 30,6% en 2021.
Les données sur la pauvreté absolue sont également très révélatrices. Elle a connu (données ISTAT) une croissance incontrôlée depuis 2007 jusqu’à aujourd’hui. Elle concernait alors un peu plus de 800 000 ménages, soit 1,8 million de personnes. L’augmentation a connu un arrêt significatif en 2019, coïncidant avec l’adoption par le gouvernement du «revenu de citoyenneté», mais ensuite, à partir de l’année suivante, elle a recommencé à croître jusqu’à atteindre près de 2 millions de ménages, ou 5 600 000 de personnes, en 2021.
La pauvreté absolue, qui concerne donc un résident sur 10 habitants, touche particulièrement les jeunes mineurs (14,2% de pauvres, les ménages pauvres ayant plus d’enfants que la moyenne). De manière très significative, la pauvreté s’accroît également chez les personnes ayant un emploi: parmi ceux qui travaillent, la pauvreté est passée de 3,1% en 2011 à 7% en 2021 et particulièrement chez les ouvriers où elle a plus que doublé, passant de 6,1% en 2011 à 13,3% aujourd’hui. Parmi les résidents étrangers, elle a atteint des niveaux très élevés: 30,6%. Il s’agit d’un phénomène largement prévisible car, dans une situation de crise économique, les premiers à connaître des difficultés sont précisément ceux qui, comme les immigré·e·s, ont un emploi précaire et souvent inférieur à leurs qualifications professionnelles.
L’Italie compte 10,7 millions de travailleurs dont le revenu brut annuel est inférieur à 20 000 euros. La moitié d’entre eux (5,25 millions) n’atteignent pas 10 000 euros (données de l’Agenzia delle Entrate).
Le 17 octobre, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la pauvreté, Caritas Italie a présenté son «21e rapport sur la pauvreté et l’exclusion sociale» avec le titre emblématique «Le maillon le plus faible». Caritas, l’organisme caritatif des évêques catholiques italiens, s’appuyant sur les 2800 «centres d’écoute» qu’il gère dans tout le pays, comme il l’avait fait pour les rapports des années précédentes, élabore son rapport 2021-22 en utilisant les données recueillies dans le maxi échantillon des 227 556 personnes aidées au cours de la seule année 2021.
Ainsi, nous apprenons que, si dans le nord du pays, ceux qui ont demandé de l’aide aux structures de Caritas étaient majoritairement des étrangers (65,7%), dans le sud, c’est l’inverse, avec une prédominance d’Italiens (74,5%). En 2005, près de la moitié des étrangers qui se sont adressés à Caritas (44,5% exactement) provenaient d’Europe de l’Est (dans cet ordre: Roumanie, Ukraine, Moldavie, Albanie et Pologne). Aujourd’hui, au contraire, 48,8% d’entre eux proviennent du continent africain, en particulier des pays du Maghreb et d’Afrique du Nord.
Effets sociaux globaux: la croissance du malaise social
Par ailleurs, il y a quelques semaines, l’ISTAT, l’Institut national de statistique, a publié le «Rapport sur le bien-être équitable et durable» (BES). Le rapport fournit une image globale de l’évolution du «bien-être» au cours des deux années de la pandémie, en examinant les différences entre les différents groupes de population et entre les territoires.
Le nombre de personnes qui n’arrivent pas à boucler leur «fin de mois» avec leur revenu augmente (9%) et le nombre de personnes en situation de «privation grave de logement» passe à 6,1%.
Le rapport de l’ISTAT souligne également la détérioration des «relations sociales», indiquant qu’entre 2019 et 2021, la part de la population qui se déclare «très ou assez satisfaite des relations amicales» diminue de pas moins de 10,2 points de pourcentage (de 82,3% à 72,1%), touchant le taux le plus bas des trente dernières années. La situation des relations sociales est particulièrement grave chez les adolescents (14-19 ans). Ceux qui dénoncent l’impossibilité de «compter sur ses amis» sont de plus en plus nombreux. Parallèlement aux relations sociales, les «relations familiales» se sont également détériorées, un domaine dans lequel l’insatisfaction augmente de 2,6%, avec une insatisfaction particulièrement aiguë chez les jeunes.
On assiste donc, comme on pouvait s’y attendre, à un effondrement de la solidarité sociale. Même l’activité volontaire dans les associations de solidarité, qui avait toujours été élevée dans le pays, tend à se contracter, tant en termes de participation directe que de simples contributions financières, atteignant à nouveau les niveaux les plus bas depuis 1993.
La «confiance dans la politique» reste faible. La note attribuée aux partis est de «très grave insuffisance» (3,3 sur une échelle de 0 à 10), au parlement elle est de 4,6 et au pouvoir judiciaire de 4,8. En revanche, la considération pour les «forces de police» et les pompiers reste élevée (7,5), et celle du «personnel médical et paramédical» l’est encore plus avec une note supérieure à 8.
La surpopulation carcérale se poursuit, le nombre de prisonniers étant toujours supérieur au nombre de places disponibles: on compte aujourd’hui 107 prisonniers pour 100 places disponibles (données du ministère de la Justice).
Il est également nécessaire de souligner que la pandémie de Covid et sa gestion par le gouvernement, comme le souligne le Censis (Centro Studi Investimenti Sociali, l’un des instituts de recherche socio-économique les plus accrédités) dans son 55e rapport sur la situation sociale, ont révélé «un empressement déraisonnable à croire aux superstitions pré-modernes, aux préjugés antiscientifiques, aux théories infondées et aux spéculations de conspiration». Le Censis atteste que 19,9% des Italiens considèrent la 5G comme un «outil très sophistiqué pour contrôler l’esprit des gens»; 5,8 % sont sûrs que «la Terre est plate» et 10% sont «convaincus que l’homme n’a jamais atterri sur la Lune».
Ce type de phénomène facilite la pénétration des idées de «complotistes» largement soutenues par les différentes forces d’extrême droite et portant sur le «grand remplacement». Une théorie qui, selon le Censis, a infecté 39,9% des Italiens qui, certains du danger de remplacement ethnique, accréditent l’idée que «l’identité et la culture nationales disparaîtront en raison de l’arrivée d’immigrants, porteurs d’une démographie dynamique par rapport aux Italiens qui n’ont plus d’enfants, et tout cela se produit par intérêt et volonté d’élites mondialistes prétendument opaques».
Effets sociaux globaux: les inégalités entre les sexes
Il convient de noter que, malgré la «nouveauté» de la première femme première ministre, et bien que depuis les élections de 2013 le système de «double préférence» soit en vigueur (lors du vote, une préférence est donnée à une candidate et une autre à un candidat, sous peine de nullité du vote), l’équilibre entre les sexes dans la politique et les institutions italiennes stagne. Lors des récentes élections générales du 25 septembre, seuls 31% des parlementaires élus étaient des femmes, contre 35% lors de la précédente législature. A l’évidence, la baisse du nombre de personnes éligibles décidée avec la réforme constitutionnelle de 2020 a frappé les femmes en particulier.
Il est très significatif que le parti ayant le moins de femmes élues soit précisément celui – Fratelli d’Italia – de la présidente du Conseil Giorgia Meloni, nouvellement élue: seulement 50 sur 185 députés, soit 27% du total.
Il n’y a que 22,3% de femmes élues aux conseils régionaux, ce qui place l’Italie plus de 12 points de pourcentage en dessous de la moyenne européenne (34,6%) en 2021. Dans les «postes de haut niveau» (Cour constitutionnelle, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les différentes autorités, le corps diplomatique, etc.), les femmes n’atteignent pas 20%.
En termes d’«égalité» entre les sexes, le secteur privé semble fonctionner beaucoup mieux que le secteur public, étant donné la progression de la présence des femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises cotées en bourse (41,2%, soit 10 points de pourcentage de plus que la moyenne des 27 pays de l’UE, 30,6%).
L’inégalité entre les sexes est particulièrement grave dans le domaine de la «sécurité personnelle»: 92,2% des femmes tuées avec violence l’ont été par une personne connue (chiffre en hausse par rapport à 2018 où il s’élevait à 81,2%): environ 6 femmes sur 10 ont été tuées par leur partenaire actuel ou précédent; une sur 4 par un membre de la famille (y compris les enfants et les parents); et une sur 11 par des amis, des collègues, etc. La situation est très différente pour les meurtres d’hommes: seulement 4 sur 10 ont été tués par une personne connue et seulement 3 sur 100 par une partenaire ou une ex-partenaire, tandis que les 60% restants ont été tués par un inconnu ou un tueur non identifié.
Effets sociaux globaux: les services publics
Le Service national de santé, créé par la réforme progressiste de 1978, conçu pour fournir des soins de santé complets à l’ensemble de la collectivité, indépendamment du sexe, du lieu de résidence, de l’âge, des revenus ou du travail, et qui avait permis à l’Italie d’avoir la troisième plus grande espérance de vie au monde (83,6 ans), est aujourd’hui fragmenté en 20 systèmes régionaux. Les dépenses publiques en matière de santé (en 2019, avant l’élévation liée à la pandémie) représentaient 6,8% du PIB, soit moins qu’en France (8%) et en Allemagne (7,3%). Elles avaient connu, suite aux coupes des gouvernements Berlusconi et Renzi, une baisse d’un point de PIB en moins de 10 ans.
Ces coupes ont entraîné une augmentation inévitable des dépenses de santé privées, qui ont atteint 41,8 milliards en 2018 (dernières données disponibles) contre des dépenses publiques de 113 milliards. On constate également une augmentation du renoncement à des soins de santé jugés nécessaires, renoncement dû: à la réduction de la présence des services de santé, notamment dans certaines régions, aux listes d’attente très longues, aux coûts excessifs de l’offre privée, etc. Il convient de rappeler qu’en Italie, sur la période 2009-2019, le nombre de lits d’hôpitaux est passé de 3,7 pour 1000 habitants à 3,2, contre une moyenne de 4,4 pour l’OCDE.
En 2020, en Italie, 1 citoyen sur 10 a déclaré avoir renoncé à une hospitalisation, à des visites de spécialistes ou à des tests de diagnostic alors qu’il en avait besoin. En 2019, ce chiffre était de 6,3%. Le chiffre de 2020, en hausse de 40% par rapport à l’année précédente, a évidemment été affecté par la pandémie de Covid-19. Toutefois, il faut aussi souligner que dans le Nord, où le revenu disponible et l’accessibilité aux services sont supérieurs à la moyenne nationale, on renonce beaucoup moins aux soins.
Pour les quelque 3 millions de citoyens et citoyennes non autonomes qui ont besoin de soins que l’Etat ne fournit pas, on compte plus de 1,3 million de d’intervenants, ce qui coûte 10 milliards par an aux familles qui peuvent se le permettre. Celles qui ne peuvent pas assumer cette dépense essayent de se débrouiller, dans leur grande majorité, bien sûr, sur le dos des femmes.
Les différences territoriales en matière d’approvisionnement en eau persistent également. Par exemple, la part des ménages déclarant l’absence ou une grave irrégularité du service de l’eau est de 9,4% (chiffre de 2021), mais dans le Nord, cette pénurie est signalée par 3,3% des ménages, alors que dans le Sud, elle est de 18,7%. Le pourcentage de pertes totales d’eau dans le réseau national de distribution est très élevé (42,0%): cela signifie que pour 100 litres injectés dans le système, pas moins de 42 ne sont pas livrés aux utilisateurs et que, en raison du mauvais état des infrastructures hydrauliques, 3,4 milliards de mètres cubes d’eau par an sont perdus, soit 156 litres par jour et par habitant. L’entretien et la réhabilitation du réseau d’eau pourraient être un «grand chantier», mais les forces politiques sont occupées à divaguer sur le train à grande vitesse Turin-Lyon et le pont sur le détroit de Messine…
Dans ce contexte, il n’est pas difficile de restituer le succès de la droite et de l’extrême droite jusqu’à présent en marge du système politique italien. Bien sûr, le contexte social et culturel a joué un rôle. Néanmoins, un rôle central a résidé dans la «transformation génétique» de ce qui était autrefois «la gauche la plus forte d’Europe», qui a abandonné toute relation avec les classes les plus pauvres et les plus défavorisées, les laissant à la merci de la désillusion politique ou, pire, de la démagogie réactionnaire. L’orientation de «concertation subalterne et complice» adoptée par les principaux syndicats italiens – qui ont laissé les travailleurs et travailleuses totalement sans défense face à l’offensive néolibérale et patronale – a remis en cause la solidarité de classe, permettant et parfois même facilitant la fragmentation et la différenciation contractuelles sur le lieu de travail, l’extension de la précarité et, finalement, faisant apparaître les politiques patronales comme inéluctables.
Bien entendu, cet article n’a pas pour but d’analyser ces phénomènes politiques et syndicaux, sur lesquels nous reviendrons dans le futur avec d’autres réflexions. (Article reçu le 1er novembre 2022; traduction rédaction A l’Encontre)

Soyez le premier à commenter