
Par François Bonnet
Quel est le chemin pour que le Royaume-Uni quitte la maison européenne? Une négociation de plusieurs années s’annonce pour redéfinir l’intégralité des relations des Britanniques avec l’Union européenne. Explications.
C’est par où la sortie? La décision étant prise, il reste maintenant à trouver le bon chemin pour que le Royaume-Uni quitte la maison européenne. Et ce n’est pas si simple. Il y a ce fameux article 50 du traité de Lisbonne. Il prévoit explicitement qu’un Etat membre quitte l’Union européenne et définit pour cela la procédure à suivre.
Durant la campagne, David Cameron s’était engagé à faire jouer cet article 50, même si le résultat d’un vote par référendum n’est pas juridiquement contraignant. Le fera-t-il dès la semaine prochaine, lors du conseil européen des 28 et 29 juin? Ou laissera-t-il à son successeur (puisqu’il a annoncé sa démission pour octobre prochain) cette responsabilité? «Nous attendons maintenant du Royaume-Uni qu’il concrétise cette décision du peuple britannique aussi vite que possible, aussi douloureux que puisse être ce processus», ont fait savoir dès vendredi matin Jean-Claude Juncker, Donald Tusk et Martin Schulz (commission, conseil et parlement européen) qui ont eux aussi fait référence à cet article 50.
Cette décision de retrait déclenche une longue phase de négociations avec le Conseil européen pour parvenir à un accord sur les nouvelles relations du pays sortant avec l’Union européenne. Cet accord doit être adopté à la majorité qualifiée du Conseil (il regroupe les chefs d’Etat et de gouvernement des 28) et validé par le parlement européen. Le Conseil européen ne peut pas pour autant empêcher un pays de sortir de l’Union en refusant tout accord: une durée de deux ans est fixée pour boucler un accord, durée qui peut être prolongée par le Conseil. Faute d’accord, à l’issue de cette période, les traités de l’UE cessent automatiquement de s’appliquer au pays concerné et le pays sortant tombe sous la réglementation de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en termes d’échanges économiques, ce qui pénaliserait lourdement l’économie britannique.
C’est donc une complexe négociation qui va s’engager entre Londres et Bruxelles et dans un rapport de force – du moins sur le papier – favorable aux instances européennes. «Il n’y a pas de plan B, la Grande-Bretagne restera dans l’Union européenne et sera un membre constructif et actif de l’Union», disait en février le visionnaire Jean-Claude Juncker, avant de comparer quelques semaines plus tard les partisans du Brexit à des «déserteurs». Dans le même temps, la technobulle bruxelloise commençait à travailler sur les termes de la négociation. Puis le même Juncker haussait le ton: en cas de Brexit, expliquait-il dans un entretien au Monde, «Le Royaume-Uni devra accepter d’être considéré comme un État tiers, que l’on ne caressera pas dans le sens du poil.»
Car plusieurs lignes se distinguent entre les Etats membres sur la manière de mener la négociation avec le Royaume Uni. Une ligne dure, de pays excédés de longue date par les demandes dérogatoires permanentes exprimées – et satisfaites – par le Royaume-Uni. «Les négociations sur la sortie doivent être bouclées en deux ans», a ainsi déclaré vendredi le président du groupe du Parti populaire européen (PPE) au parlement, l’Allemand Manfred Weber. «De notre point de vue, il ne peut y avoir aucun traitement de faveur pour le Royaume-Uni. Partir signifie partir. Le temps des exceptions est terminé.» Mais il est aussi une ligne beaucoup plus accommodante, s’inquiétant d’un Royaume-Uni devenant effectivement «un pays tiers» et renvoyé aux seules règles de l’OMC.
Dans tous les cas, il faudra détricoter une multitude d’accords complexes, portant sur la propriété, les questions budgétaires, fiscales, de libre-échange, de régulation bancaire, de domiciliation des sociétés. Il faudra aussi s’accorder sur le statut des personnes et de leur libre circulation, voire même des politiques de visas. Sans oublier les multiples difficultés que provoquera la disparition des Britanniques de toutes les instances politiques européennes (par exemple, les nouveaux équilibres entre groupes politiques au parlement européen)…
Mais s’agit-il de couper tous les ponts? Non, et plusieurs partisans du Brexit n’ont cessé de mettre en avant d’autres modèles. La Suisse, par exemple, qui contribue au budget européen, a adopté de nombreuses lois européennes pour accéder au marché unique et a conclu 120 accords bilatéraux avec les Etats européens. Autre modèle brandi par les tenants du Brexit, celui de la Norvège. Elle fait partie de l’espace Schengen, est membre de l’Espace économique européen, contribue au budget de l’Union, a adopté la quasi-totalité des lois concernant le «marché intérieur» pour pouvoir y accéder. La Norvège n’est pas pour autant membre de l’Union; et si elle envoie des représentants dans les différentes instances européennes, ils n’y ont strictement aucun pouvoir.
Le saut sera-t-il donc si grand à faire pour le Royaume Uni? Pas forcément. Car Londres bénéficie déjà, et de longue date, d’un statut particulier au sein de l’Union ayant multiplié les «opt-out», ces clauses qui lui ont permis de s’exclure de telle ou telle politique commune.
Le double jeu de Boris Johnson?
La négociation conclue en février dernier par David Cameron et le Conseil européen a, de ce point de vue, été éclairante, tant elle a montré le régime d’exception dont bénéficie déjà le Royaume-Uni. Comme le rappelait une de nos précédentes enquêtes, le président du Conseil européen Donald Tusk avait pris un malin plaisir à lister dans une lettre la multitude d’«exceptions» britanniques.
Non seulement la Grande-Bretagne ne fait pas partie de la zone euro, mais le pays bénéficie, tout comme le Danemark, d’un «opt-out» qui précise qu’il n’a pas vocation à rejoindre cet espace monétaire (tandis que les autres États membres hors de l’eurozone, eux, espèrent toujours officiellement rejoindre l’euro à terme). La Grande-Bretagne n’est pas non plus membre de l’espace Schengen. Elle ne participe pas aux négociations pour une taxe sur les transactions financières (TTF). Le «rabais britannique» négocié par Margaret Thatcher en 1984, qui permet à Londres de contribuer un peu moins au budget de l’UE, perdure.
Comme le confirme un graphique élaboré par André Sapir et Guntram Wolff (ci-dessous), les Britanniques («UK» sur l’image) disposent déjà de tous les «opt-out» fondamentaux et sont les plus éloignés du noyau dur des politiques européennes. Outre l’euro, ils n’ont pas davantage signé les textes les plus importants adoptés au plus dur de la crise (le pacte Euro Plus, ou encore le mécanisme de supervision de l’union bancaire).
Ce statut économique aujourd’hui largement dérogatoire de la Grande-Bretagne peut donc faciliter la séparation. Mais au-delà de dispositions très techniques, l’enjeu est d’abord politique. Et cela va être tout l’objet des négociations à venir. Boris Johnson, ancien maire de Londres, leader conservateur des partisans du Brexit et qui se verrait bien prendre la place de David Cameron, a d’ailleurs mis le projecteur sur un tout autre scénario, vendredi, en une seule petite phrase: «Il n’y a aucune raison de se précipiter à invoquer l’article 50 du traité européen.»
Sans article 50, pas de sortie: justement! Certains militants du Brexit ont volontiers expliqué qu’ils avaient une tout autre idée en tête. Il s’agissait par ce vote d’exercer une pression encore plus forte sur les instances européennes et de décrocher de nouvelles concessions, de nouvelles dérogations. Dans six mois, dans un an, des Britanniques satisfaits des victoires obtenues à Bruxelles accepteraient alors de voter en faveur de l’Europe.
Ce scénario est-il totalement à écarter? Oui, ont assuré en chœur les Européens et ils l’ont répété ce vendredi. Mais qui peut exclure que dans plusieurs mois, au terme d’une longue crise politique au Royaume-Uni, de négociations bloquées avec l’Europe, un nouveau compromis ne se construise à Bruxelles? Ce ne serait pas la première fois, tant l’Europe et ses dirigeants nous ont habitués à tordre les résultats de référendums ou à en convoquer de nouveaux pour parvenir à leurs fins. (Article publié par le site Mediapart, le 24 juin 2016)

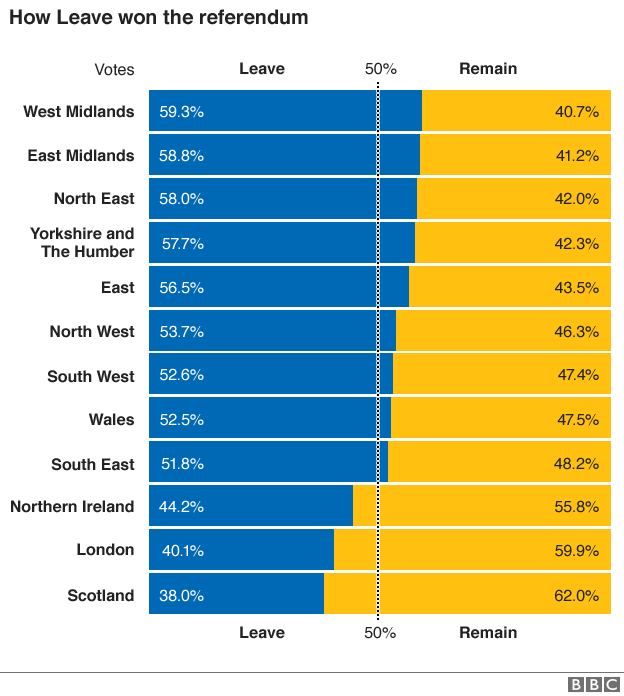

Soyez le premier à commenter