L’arrogance de la confiance a disparu et la nervosité est de retour. La rafale de statistiques inquiétantes, à la fin d’avril 2011, consolide cette situation.
Le 26 avril, les données sur le taux de croissance de l’économie britannique le situaient à 0,5 % pour le premier trimestre 2011. Arrivant dans la foulée d’une contraction du même type au trimestre précédent, un commentateur a été incité à affirmer: « la Grande-Bretagne est prête à retomber dans la récession»; une récession en W [1].
Quarante-huit heures plus tard, le Département du commerce des Etats-Unis indiquait que l’économie étatsunienne connaissait un ralentissement, enregistrant un faible taux de croissance – 1,8% – au premier trimestre 2011, par rapport à un 3% à la fin de 2010. Un jour plus tard, les informations indiquaient que l’économie canadienne avait reculé en février, et que le taux officiel de chômage en Espagne avait passé à 21,3% – alors que le taux de chômage des jeunes avoisinait les 40%.
Et ai-je mentionné la Grèce? Le gouvernement de ce pays ayant imposé des coupes draconiennes dans les dépenses budgétaires constatait que l’économie se ratatinait à un rythme de 5% en 2010. Il découvrait qu’il devait offrir des taux d’intérêt de 23,5% pour des obligations à maturité de deux ans, s’il voulait capter des fonds sur les marchés financiers. De tels niveaux de rendement obligataire ne peuvent que signaler le flair des requins quant à une restructuration à venir de la dette, ce qui semble une conclusion assurée.
Tout cela nous renvoie à une déduction évidente, même si les économistes du courant dominant y résistent: il ne s’agit plus d’une relance économique normale. Au contraire, nous sommes au milieu d’une période plus complexe. Une période faite de récessions profonde, de relance pâlotte, de taux de chômage élevé, de crise des dettes dites souveraines, de nouvelles récessions et d’une période durable d’austérité. Ce que j’ai qualifié de global slump[2].
L’investissement en souffrance
Certes, il n’y avait pas de raison de s’attendre à une relance normale à la lumière des éléments mentionnés. La Grande Récession de 2008-2009, après tout, fut le recul le plus long et le plus profond qu’a connu le capitalisme mondialisé, depuis le marasme de 1929-1932.
Les 30 économies les plus importantes membres de l’OCDE ont connu une contraction de leur Produit intérieur brut de 6%, avec des taux de chômage dépassant de plus de 60% la moyenne précédente. La production industrielle mondiale a chuté de 13%; le commerce international a reculé de 20%; les marchés boursiers se sont tassés à hauteur de 50%. La plus grande vague de faillites bancaires, depuis 80 ans, a frappé de système financier.
Tout cela aurait signalé que, au lieu de faire face à une récession ordinaire, nous avions affaire à une crise systémique, une crise qui annonce la fin de la phase néolibérale de l’expansion capitaliste. Et que récupérer d’un tel processus s’avérerait, en fait, très difficile.
Par exemple, au milieu de 2011, donc au milieu de la «reprise», le taux de croissance annuel aux Etats-Unis et dans les économies les plus robustes de l’Europe se situait dans une fourchette de 2,5% à 3%, à peu près la moitié du taux que l’on aurait pu attendre sur la base des redressements intervenus lors des cycles précédents. Même durant la récupération au milieu de la Grande Récession des années 1929-1930, l’économie des Etats-Unis avait connu une croissance beaucoup plus nette: presque 8% en 1934 et 1935 et un étonnant 14% en 1936.
Actuellement, le taux de croissance est si faible qu’il n’a quasiment pas d’impact sur le chômage. En fait, dans certaines parties de l’Europe – comme l’Irlande, la Grèce, l’Espagne – le chômage grimpe. Aux Etats-Unis, comme l’indique le graphique 1, l’emploi se trouve toujours à un niveau inférieur de plus de 5% à celui antérieur à la récession. Au cours de toute la période, depuis la Grande Récession, il n’y a jamais eu une relance qui a été aussi anémique en termes de création d’emplois, comme nous le constatons aujourd’hui.
Grapique 1

La principale raison pour l’échec du retour au taux d’emploi précédent réside dans le fait que bien que les profits aient retrouvé des seuils antérieurs, il n’y a pas eu d’investissements. Dans les principales économies, les grandes firmes gardent leur cash au lieu de l’investir.
C’est évidemment vrai pour les économies du centre de l’Europe, comme l’Allemagne et la Grande-Bretagne, au même titre que pour les Etats-Unis. Mais c’est aussi le cas pour le Canada, qui a échappé aux pires effets de la crise financière et dont l’économie a été animée par la hausse des prix (et la hausse de la demande) des matières premières. L’investissement dans l’appareil productif au Canada a représenté 5,5% du PIB au début 2011, comparé à 7,7% en 2000; ou juste moins de 7% en 2005 [3]. Pour ce qui est des Etats-Unis, l’investissement fixe en biens de production est resté, fin 2010, quelque 14% inférieur à la période pré-récession, et cela plus d’un an après le début de la «reprise» [4].
Pour le dire simplement: la hausse des profits ne se traduit pas dans une nouvelle vague significative d’accumulation du capital. Par contre, les firmes aux Etats-Unis et ailleurs gardent leur cash, et le conservent dans des dimensions bien plus grandes que jamais depuis la fin des années 1960. Au début 2011, en réalité, les firmes non financières aux Etats-Unis disposaient, en cash et sous formes de dépôts liquides, d’au moins 2 trillions, une hausse extrêmement forte dans la conservation de liquidités, comme le démontre le graphique 2 [5].
Graphique 2
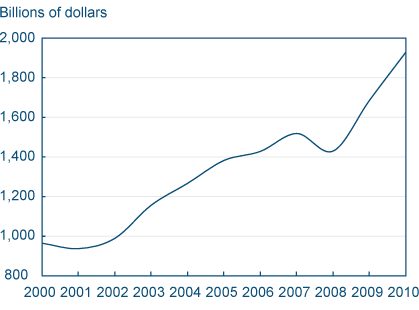
Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une science de pointe pour discerner les raisons pour lesquelles l’investissement reste terne. Tout d’abord, le taux d’utilisation des capacités installées reste en dessous des moyennes historiques. Deuxièmement, les entrepreneurs savent qu’avec des dépenses de consommation déprimées, le recul des stimulations gouvernementales et le tournant vers l’austérité (coupes sombres dans les dépenses publiques), la demande va prendre des coups. Les consommateurs et les gouvernements vont moins dépenser – et non pas le contraire – dans les mois et les années à venir.
Dès lors, au lieu d’investir, les firmes épargnent leurs profits, ou s’engagent dans des activités spéculatives (pétrole, or, contrats à terme sur les biens alimentaires, etc.), car ils sont incapables de voir, dans le contexte économique présent, ce qui justifierait d’importantes dépenses dans de nouvelles fabriques ou de nouveaux équipements.
Même en Chine, où des entrepreneurs construisent de nouvelles usines, le taux de croissance de l’économie ralentit, au moment où le gouvernement essaye de faire se dégonfler des bulles spéculatives et d’infliger un recul à l’inflation.
La logique de l’austérité
Pendant ce temps, les mesures d’austérité – coupes dans les dépenses publiques, licenciements de salarié·e·s du secteur public pour réduire l’endettement gouvernemental, privatisations – conduisent les économies sur la voie de la récession ou, ce qui est en fait identique, sur des sentiers de croissance zéro.
Après avoir effectué des coupes de millions et millions de dollars, par exemple, le Ministère des finances de l’Irlande estime que l’économie va croître d’un minuscule 0,75% en 2011; moins de la moitié du taux prédit il y a quelques mois. Le chômage, qui se situait à 4,4% avant la récession, continue de monter et atteint le taux officiel de 14,7%. L’économie britannique, comme nous l’avons vu, claudique à un rythme pire que l’Irlande.
Puis, il y a la Grèce «en difficulté», où le chômage augmente pour le septième mois consécutif et atteint 15% officiellement, ce qui est un grand bond par rapport à l’année précédente. Les ventes de détail ont reculé de 10% sur un an – et cela durant la phase qualifiée de «reprise». Pendant ce temps, l’Espagne, qui applique de manière déterminée des mesures d’austérité, a connu le recul le plus important des ventes de détail en deux ans, alors que 4 jeunes sur 10 ne trouvent pas d’emploi, selon les données officielles, qui sous-estiment fortement le degré de crise de l’emploi [6]. En résumé, l’austérité coupe la jambe d’une reprise déjà faiblarde.
Cela a poussé un grand nombre de keynésiens à affirmer que l’austérité et la suppression des stimuli sont simplement le produit d’une approche de droitiers ayant une vue hallucinée de la situation. Certes, il y a quelque chose de fou dans cette politique de coupes budgétaires. Mais du point de vue capitaliste ce n’est pas complètement faux.
Devant financer des déficits en ayant recours aux marchés financiers, les gouvernements doivent payer des taux d’intérêt qui sont définis par un calcul de probabilité quant à un possible défaut, à une incapacité de faire face ne serait-ce qu’aux intérêts de la dette. Voilà la raison pour laquelle la Grèce paie 25% pour des émissions obligataires à deux ans. Et cela est quelque chose de très réel, une réalité financière très concrète, pas seulement une folie idéologique de crétins droitiers. Evidemment, la droite cherchera à utiliser une telle conjoncture pour mener un programme politique agressif d’attaque contre les syndicats et les dépenses publiques.
Des pressions effectivement réelles sont exercées par les marchés financiers mondialisés qui poussent les gouvernements à appliquer des politiques d’austérité portant atteinte à l’économie. Nous devons rappeler ici que le principal souci du Capital n’est pas, et n’a jamais été, «l’économie», mais le profit et la stabilité du système. Si ces objectifs sont mieux atteints tout en portant atteinte à l’emploi et aux revenus de la majorité, qu’il en soit ainsi. Voilà pourquoi l’austérité répond à la logique du capital même si cela implique une stagnation économique et un chômage croissant.
De plus, avoir en mémoire que les intérêts du capital n’ont rien à voir avec la croissance, le bien-être, cela permet de mettre en relief que les seules mesures économiques et politiques aptes à résister relèvent d’une orientation anticapitaliste. Seul un processus, sur la durée, d’éducation politique, de mobilisation et de résistance déterminera si cette approche prendra une extension dans un contexte d’austérité et de marasme d’ensemble.
Alors que la nuit tombe sur Athènes ces jours-ci, les bus pleins de polices antiémeute prennent position au centre de la ville. Sachant que l’austérité implique la souffrance pour la majorité, «nos dominants» craignent à juste titre que cette majorité descendent, à tout moment, dans la rue. La question clé actuelle est de savoir si une protestation de masse atteindra l’ampleur nécessaire pour mettre en échec les politiques d’austérité. (Traduction A l’Encontre]
David McNally est professeur à l’Université de York, Toronto (Canada).
______
[1] John Hawqksworth, cité par Philip Aldrick in Telegraph, 27 avril 2011.
[2] Voir mon ouvrage: Global slump. The Economics and Politics of Crisis and Resistance, Oakland, PM Press, 2011.
[3] Karen Howlett, in Globe and Mail, 6 avril 2011.
[4] Federal Reserve Bank of Cleveland, January 10, 2001; article de Robert Sadowski.
[5] Ce chiffre est tiré de R. Sadowski et aussi du Wall Street Journal du 10 décembre 2010.
[6] Sur la Grèce et l’Espagne, voir Guardian, 29 avril 2011, article de Philipp Inman.


Soyez le premier à commenter