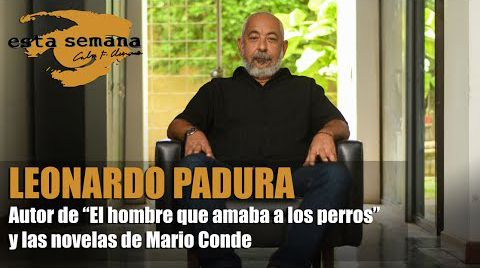 Entretien avec Leonardo Padura
Entretien avec Leonardo Padura
conduit par Carlos F. Chamorro
L’écrivain cubain Leonardo Padura [voir, entre autres, le récit de L. Padura publié sur ce site en date du 19 mai 2017] a annoncé à Managua (Nicaragua) la publication en janvier de l’année prochaine de son nouveau roman La transparence du temps. On y retrouvera son emblématique détective Mario Conde, devenu un policier à la retraite dans le Cuba contemporain de 2014.
Le romancier décrit une société «dans laquelle ont surgi des poches de pauvreté et où certains secteurs ont des possibilités économiques un peu plus importantes». Cette nouvelle réalité, L. Padura la décrit comme la «dilatation d’une société» qui voulait être égalitaire sous le «socialisme» dirigé par Fidel Castro. Son frère Raul cédera la présidence en 2018 sans que l’on puisse y pronostiquer le dénouement des réformes économiques qu’il a entreprises. Comme dans ses romans, la réalité cubaine est pleine d’énigmes, de devinettes et de contradictions.
Le personnage le plus célèbre de la littérature cubaine actuelle a participé pendant une semaine à la cinquième édition de Centroamérica Cuenta (l’Amérique centrale raconte). Il n’a eu de cesse de remercier les organisateurs de l’événement, convoqué par Sergio Ramirez pour lui avoir donné l’occasion de visiter le Nicaragua; même s’il s’est plaint d’avoir été trop englouti par le travail dans de multiples colloques il s’est dit surpris de découvrir qu’il y avait «beaucoup de lecteurs» de son œuvre dans notre pays.
En 2015, vêtu d’une chemise blanche et avec un ballon de base-ball à la main, symbolisant le Cuba de Mantilla, son quartier natal à La Havane, Padura a reçu en Espagne le prix «Princesa de Asturias de las Letras» en signe de reconnaissance pour son œuvre, dont l’éblouissant roman L’homme qui aimait les chiens, qui trouve son inspiration dans l’histoire de Ramon Mercader, l’assassin de Léon Trotsky. Il est également l’auteur d’une série de romans policiers qui ont comme protagoniste Conde, son détective, qui a été incarné par le magnifique acteur cubain Jorge Perugorria dans la série télévisée de Netflix: «Quatre saisons à La Havane».
Padura a également écrit Hérétiques (publié en français en 2016, coll. Points) et La novela de mi vida (2002) qui a servi d’inspiration au scénario du film Retour à Ithaque, dirigé par le Français Laurent Cantet, un film sur la souffrance et l’amour, comme il l’explique dans l’entretien donné lors des deux programmes télévisés Esta Semana et El Confidencial.
Votre roman L’homme qui aimait les chiens est non seulement une enquête historique étonnante, mais également une critique, un portrait du stalinisme en tant que système. Comment s’écrit et se publie à Cuba ce type de roman?

Il s’agit d’un roman qui décrit une expérience collective, mais également personnelle, puisque j’ai vécu à Cuba toute ma vie. J’y suis arrivé un peu par curiosité, car à Cuba le personnage de Trotsky a subi un sort similaire à celui de quelques personnages en Union soviétique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo des leaders bolcheviques sur la Place rouge, sur laquelle Staline a fait effacer certains protagonistes. Et bien, sur le tableau qu’on nous présentait à Cuba, la figure de Trotsky n’apparaissait pas non plus, et c’est ce qui m’a amené à éveiller ma curiosité à l’égard de ce personnage. Plus tard, lorsque j’ai appris que Ramon Mercader avait vécu à Cuba cela a été un bouleversement à plusieurs niveaux, et je me suis rendu rendu compte que ce personnage était mon contemporain et que j’aurais pu le croiser dans la rue.
C’est l’accumulation des faits qui m’a motivé à écrire ce roman. Le moment de l’assassinat de Trotsky y a un caractère plus symbolique, lié au point de non-retour définitif du stalinisme. A un moment donné on a commis ce crime superflu, mais l’idéologie originale bolchevique s’était déjà fortement pervertie tout au long des années 1930. C’était l’époque des procès de Moscou, de la collectivisation de la terre, de la lutte contre les koulaks, de la famine en Ukraine, avec dix millions de personnes mortes. Je crois que c’est là que s’est dénaturé ce beau projet de créer une société des égaux, où l’on vivrait avec un maximum de démocratie. Staline a corrompu à tout jamais ce possible.
Mais comment les lecteurs cubains et le gouvernement ont-ils réagi à vos ouvrages?
C’est là une des deux plus grandes satisfactions que j’ai vécues en tant qu’écrivain dans mes rapports avec les lecteurs. Les lecteurs cubains ont établi avec mon personnage de Mario Conde un rapport particulier, ils l’envisagent comme si c’était une personne réelle. L’autre grande satisfaction a été l’accueil qu’a reçu le livre L’homme qui aimait les chiens. J’ai reçu beaucoup d’appels téléphoniques, de courriers électroniques, d’échanges personnels avec des gens qui me remerciaient d’avoir écrit ce roman car sa lecture leur avait permis de comprendre beaucoup de choses sur leur propre histoire et sur l’histoire de Cuba et du XXe siècle, qu’ils ne connaissaient pas sous cet angle. Cela m’a démontré à quel point la littérature peut être utile à d’autres personnes.
Dans ce roman sur la société soviétique il y a aussi beaucoup d’éléments qui se refléteront plus tard dans le processus cubain. Comment a réagi le gouvernement cubain?
Le livre a été publié à Cuba. La première édition est sortie en Espagne en 2009, puis, en 2010, il a été publié à Cuba et a été présenté à la Foire du Livre de 2011 après quoi il y a eu deux rééditions. Le livre a gagné le prix de la critique. Je crois que cela a joué un rôle très important pour que je reçoive le Prix national de littérature de Cuba, mais il y a eu très peu de commentaires sur le livre. Je sais qu’il y a eu beaucoup de lecteurs bien que les éditions soient limitées, mais il y a eu peu de répercussion dans les médias.
Vos romans policiers, avec ce détective Mario Conde, dont les gens vous parlent comme s’il était en chair et en os, sont-ils plutôt des romans ou des réflexions sur la réalité sociale cubaine
Ce sont des romans sociaux. J’utilise le genre policier, tout comme dans les romans comme L’homme qui aimait les chiens, Le roman de ma vie ou Hérétiques j’utilise l’histoire pour comprendre le présent. Toutes ces histoires se passent dans des époques contemporaines, avec parfois des sauts dans le passé, les premières de la série ont démarré en 1989; ce sont ces quatre qui peuvent maintenant être vues en film sur Netflix. Et ensuite j’ai continué à travailler sur le personnage de Mario Conde et les histoires en rapport avec la société cubaine.
Le personnage figure également dans l’ouvrage intitulé Hérétiques…
En effet, il figure dans Hérétiques en 2008. Dans le roman que je suis en train de terminer maintenant, le personnage apparaît en 2014. Le roman se termine le 17 décembre 2014, lorsque Mario Conde se lève le matin avec la prémonition que quelque chose va arriver: c’était le jour où on a annoncé que Cuba et les Etats-Unis commençaient à discuter en vue de rétablir des relations.
Autrement dit, j’avance dans le temps avec le personnage, et cela est très important pour moi car cela me permet de comprendre le processus d’évolution de la société cubaine, mais également le processus d’évolution humaine et physique de l’individu. En effet, Mario Conde est en train de vieillir avec moi, il a mal aux genoux, comme moi, il commence à avoir des problèmes du genre «quand est-ce que je vais arrêter de fumer» parce que je tousse à cause de mes cigarettes. J’ai ainsi transmis au personnage beaucoup de mes préoccupations sociales et existentielles tout au long de ces années.
Ce personnage que vous avez imaginé et qui a vécu avec vous revêt maintenant pour beaucoup de gens le visage de l’acteur Jorge Perugorria. Comment incarne-t-il Conde?
Depuis l’année 2000 un réalisateur de films à Cuba avait des propositions en vue de produire un film avec un de ces romans et il a pensé à Jorge Perugorria comme acteur pour le personnage de Mario Conde. Il y a eu pas mal de projets qui n’ont pas abouti, mais Perugorria a toujours été retenu comme étant le visage le plus connu du cinéma cubain. Au fil des années je crois que «Pichi», comme nous appelions Perugorria, s’est approché de plus en plus du personnage de Mario Conde. Lorsque l’occasion s’est présentée de réaliser cette série de films et que le producteur Tornasol Films a pu monter le projet (c’est le producteur espagnol qui a négocié la distribution avec Netflix), il a été décidé que ce serait avec Jorge Perugorria. «Pichi» avait intériorisé à fond le caractère de Mario Conde et je ne pense pas que cela lui a été particulièrement difficile étant donné que c’est un homme de sa génération, qui partage ses préoccupations et sa culture, ce qui lui a permis de cerner à fond le personnage, et je trouve qu’il l’interprète admirablement. De toute manière pour moi, en tant qu’écrivain, c’est toujours un processus surprenant de voir Mario Conde physiquement, ce personnage que je ne décris nulle part dans mes romans.
La novela de mi vida traite de la naissance de l’identité cubaine avant l’indépendance, mais également des grands dilemmes actuels. Des personnages qui vivent dans le Cuba de la révolution doivent quitter le pays, et à leur retour ils rencontrent une fois de plus la souffrance.
C’est de là que naît le scénario que vous avez écrit avec votre épouse Lucia et avec le directeur français Laurent Cantet du film «Retour à Ithaque». Un film où les personnages parlent de l’étonnement et de la souffrance dans la vie quotidienne à Cuba.
Il s’agit d’un film sur la souffrance et l’amour. Souffrance due aux pertes, et amour de ce qui est permanent. Ce qui est permanent, c’est Cuba. C’est un film qui a été réalisé avec un budget très modeste, nous avons dû écrire un scénario adapté à nos possibilités économiques. De toute manière, Cantet voulait que cela se passe dans un seul lieu et dans un seul espace temporel.
Il a été filmé sur une terrasse?
Oui. On l’a filmé en 17 jours, ce qui paraît presque incroyable. Il traite d’un groupe d’amis qui parlent de ce qu’a été leur vie dans le Cuba contemporain. J’en suis très satisfait, car je trouve que c’est un portrait plausible de ma génération. Il existe bien sûr d’autres divisions, la réalité ne peut s’expliquer d’une seule manière, mais je crois que ce film est très proche de ce qu’ont été les attentes, les espoirs et les frustrations de ma génération.
L’année prochaine sera la dernière de la présidence de Raul Castro. Les réformes des dernières années ont généré des expectatives sur les résultats qu’elles pourraient produire dans la sphère économique, et, au-delà, dans le domaine politique. Comment vit-on ce processus à Cuba? Y aura-t-il une transition?

On vit ce processus surtout comme un grand signe d’interrogation, nous n’avons pas beaucoup d’informations. Nous savons juste que la période de Raul en tant que président se terminera en 2018. Par contre il restera en tant que premier secrétaire du Parti, et pourra donc continuer à avoir un rôle politique fondamental. Dans la période qui va débuter à Cuba à ce moment-là, plusieurs noms sont envisagés, par exemple celui du vice-président Miguel Diaz-Canel en tant que futur président de Cuba. Mais que va-t-il réellement se passer? Que pourra-t-il se développer? Le gouvernement laisse entendre qu’il y aura une continuité, et je le crois aussi, mais cette continuité devra être combinée avec des changements beaucoup plus profonds que ceux qui se sont produits jusqu’ici.
Ceci est compliqué en rapport avec la réalité cubaine. Par exemple, en 2005 un citoyen cubain ne pouvait pas avoir un téléphone cellulaire parce qu’il ne pouvait obtenir le droit d’avoir une ligne; un des changements introduits par Raul est que les Cubains peuvent avoir des téléphones cellulaires. Ailleurs dans le monde ceci peut paraître négligeable, mais à Cuba c’est un changement important, et il y en a eu d’autres du même genre.
Je pense que le fait qu’on ait libéralisé pour les Cubains la possibilité de voyager, ceci après 50 ans où les déplacements étaient très contrôlés constitue également un changement important. Il y a eu de petites ouvertures économiques, mais je pense que l’ouverture économique doit être beaucoup plus profonde. L’année passée Cuba était en récession, le produit intérieur brut a diminué; cette année il ne croîtra que très peu, la dette économique s’accumule, le vieillissement des infrastructures nécessite une impulsion économique importante pour améliorer la vie des Cubains.
Je me suis rendu à Cuba à la fin de l’année dernière, et les personnes avec lesquelles j’ai discuté dans la rue disaient: «Oui, il y a quelques réformes, mais nous sommes des spectateurs, ce sont d’autres qui prennent les décisions et dirigent le cours du pays.» Et les jeunes, en particulier, disent qu’ils n’ont pas d’avenir dans leur pays.
En effet, cela est dramatique et constitue l’un des défis dont dépend l’avenir de Cuba. Au cours des récentes années beaucoup de jeunes ont émigré. Maintenant cela est devenu un peu compliqué avec le changement des lois états-uniennes: autrefois tout Cubain arrivant sur le sol états-unien avait immédiatement un droit de résidence, ce n’est plus le cas. [Obama a mis fin, en janvier 2017, à cette politique d’accueil presque automatique des Cubains connue sous le nom de “pieds secs, pieds mouillés”].
Trump ne s’est pas prononcé sur le sujet, d’ailleurs il n’a pratiquement pas parlé de Cuba, et je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose étant donné l’imprévisibilité de Trump. Mais il y a eu une saignée importante du jeune «capital humain cubain», beaucoup de ces jeunes qui sont partis étaient les mieux formés: informaticiens, médecins, physiciens. Il faut trouver une solution pour retenir ce «capital humain» qui a été formé dans le pays, c’est essentiel pour l’avenir de Cuba. Car même si notre principal problème est d’ordre économique, ce capital d’intelligence est très important, et il faut lui donner de l’espace pour qu’elle puisse se développer.

Au cours des dernières années sont apparus quelques médias digitaux indépendants comme El Estornudo [l’Eternuement], Periodismo de barrio, Catorce y medio. Mais de quel espace réel bénéficient-ils? Y a-t-il à Cuba un espace pour une société civile autonome qui puisse influer sur l’avenir de ces changements?
Si nous regardons ce qui se passait il y a dix, quinze ans, ces espaces, qui existent fondamentalement grâce aux possibilités d’Internet, auraient été inimaginables à Cuba. Aujourd’hui ils existent. Le problème est que l’on lit beaucoup plus en dehors de Cuba que dans ce pays, justement à cause de cet accès assez limité qu’ont les Cubains à Internet.
De toute façon, je crois qu’il est important qu’il y ait une diversification des opinions. J’ai l’impression que la société cubaine a besoin de beaucoup plus d’espaces pour le débat, pour que puissent surgir quelques lumières qui nous aident à mieux comprendre ce que nous voulons et dans quelle direction nous voulons aller et cela doit être, comme le disait José Marti [1853-1895]: «Avec tous et pour le bien de tous».
Mais jusqu’à maintenant rien ne laisse penser qu’il y aura autre chose que des réformes économiques. Y a-t-il une orientation vers une ouverture politique?
Non, il n’y en a pas, même dans le domaine de la culture j’ai l’impression qu’il y avait des espaces beaucoup plus ouverts il y a cinq ou six ans, et que maintenant c’est beaucoup plus contrôlé, plus fermé. Je ne pense donc pas qu’il y ait une volonté d’ouverture politique dans l’immédiat. (Entretien publié sur Prodavinci, Managua, le 5 juin 2017; traduction A l’Encontre)


Soyez le premier à commenter