Le dimanche 28 octobre, 147 millions de Brésiliens et Brésiliennes étaient appelés à voter, directement, pour la huitième élection présidentielle après la période de la dictature de 1964 à 1985. Le vote s’est fait par système électronique. Ainsi à minuit – heure brésilienne – le Tribunal suprême électoral transmettait les résultats complets ayant trait à l’élection de la présidence et des gouverneurs des 13 Etats, plus le District fédéral (Brasilia), soit 14 au total.
Le Brésil – qui a une structure fédérale – est composé de 26 Etats. La moitié avait déjà élu leur gouverneur au premier tour, le 7 octobre 2018. Autrement dit, les autres candidats au poste de gouverneur – qui disposent d’un rôle important dans la structure du système politique – étaient «installés», ayant obtenu une majorité absolue, le 7 octobre. Ceux ou celles qui devaient être encore désignés le furent ce dimanche 28 octobre. Le choix des gouverneurs concernait des Etats riches et très peuplés, parmi lesquels ceux de São Paulo, du Minais Gerais, de Rio de Janeiro, du Paraná, etc.
Les résultats de la présidentielle sont évidemment importants. Mais négliger la répartition des gouverneurs, dans la conjoncture présente, représente une négligence politique dommageable. Nous y reviendrons.
En arrière-fond des élections
Deux dynamiques socio-économiques doivent être présentes à l’esprit pour comprendre l’arrière-fond d’une telle élection au Brésil et surtout saisir une structure du pouvoir économico-politique dérangée. Selon les tendances propres à l’accumulation du capital et à la distribution de la plus-value produite par la force de travail et accaparée par les dominants, le Brésil est marqué, à la fois, par : 1° des inégalités sociales très profondes, avec des traits largement encore imprimés par la période esclavagiste qui n’a pris fin qu’en 1888. Cette date tardive est le produit des inerties à l’existence d’une formation sociale esclavagiste durant plus de deux siècles, comme l’ont remarquablement mise en relief les travaux de Jacob Gorender; 2°des inégalités régionales exacerbées dans un pays aux allures de continent.
Cette inégalité spatiale et sociale s’accentue encore sous les effets d’une réforme agraire qui est stagnante (depuis 2003, premier gouvernement de Lula). Elle stimule donc un exil de la population rurale, par étapes, vers les grandes villes. Cela s’effectue sous les coups de boutoir de l’extension des cultures rentières (soja transgénique, orange, canne à sucre, en partie pour le biocarburant, etc.), d’un élevage extensif (pour la viande de bœuf) et intensif (gigantesque usine à produire des poulets en batterie, par exemple), de politiques extractivistes impliquant le pillage des divers minerais, des hydrocarbures et le déboisement de surfaces gigantesques de terre, entre autres en Amazonie. Ce colossal territoire sert aussi de réservoir dans lequel puisent les transnationales à la recherche de molécules (plantes, arbres, insectes divers, champignons…) aptes, potentiellement, en bout de chaîne, à la production de médicaments ou de matériaux nouveaux. En un mot, il s’agit d’une énorme privatisation du vivant.
Toute cette conquête territoriale s’effectue au moyen d’une «véritable chasse criminelle» contre les pauvres, les indigènes (Indiens de l’Amazonie, entre autres), les Noirs des quilombos, les territoires «autonomes» formés par des Noirs ayant échappé aux esclavagistes ou/et ayant cherché un refuge à la fin du XIXe siècle. Des bandes criminelles, financées par les grands propriétaires terriens et des spéculateurs immobiliers, pourchassent les paysans sans terre et les «immigrés urbains» n’ayant pas de toit.
Ces derniers ont été chassés (et le sont) sous les effets des projets immobiliers ou suite à la mégalomanie des constructions «sportives» nécessaire à la construction de l’empire des Jeux olympiques (en 2016 à Rio de Janeiro) – placés sous le leadership du CIO, dont le siège est à Lausanne – ou de la Coupe du monde de football (en 2014), placée sous les ordres de la FIFA, organisation philanthrope sise à Zurich. Et alors dirigée par Sepp Blatter, le «ballon d’or» de l’escroquerie… invité (privé) à Moscou pour le dernier mondial, afin d’éviter toute arrestation.
Ne pas comprendre ces éléments socio-économiques et historiques élémentaires conduit des commentateurs «cultivés» – en fait des cavernicoles – à bredouiller des chiffres sur le nombre d’homicides et la «violence» – toute «naturelle», quasi «culturelle» – régnant au Brésil. Ils reprennent, de la sorte, un discours bolsonariste dont ils n’ont pas même conscience, tant leur «cerveau» est obstrué par les communiqués, très résumés, des agences de presse.
Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro
Les résultats complets – y compris avec les votes des 500’727 électrices et électeurs brésiliens votant dans 99 pays – furent disponibles quelques minutes après minuit. Le vote électronique permettait, en pressant sur le numéro 13, de choisir le candidat du «Front démocratique», en réalité du Parti des travailleurs, et sur le 17, le capitaine à la retraite et député fédéral depuis 27 ans: le néo-fasciste Jair Bolsonaro.
Le résultat du vote présidentiel au second tour: 55,13% pour Jair Messias Bolsonaro, avec 57’977’423 suffrages; Fernando Haddad: 44,87%, soit 47’040’574 voix; donc un avantage de 10 millions de voix en faveur de l’admirateur de la dictature, de celui qui promet et va mettre en œuvre une accélération des contre-réformes sociales et économiques déjà initiées par le sordide Michel Temer. Un Temer qui, sans crainte, remplaça Dilma Rousseff, suite à sa destitution en août 2016. Michel Temer avait été candidat à la vice-présidence sur le ticket de Dilma Rousseff, ce qui explique non seulement sa succession, mais l’acharnement à la débouter. Il termine son mandat avec 4% «d’opinions favorables» et des procès qui l’attendent, peut-être…
Dilma Rousseff, elle, a été battue au premier tour des élections (le 7 octobre) pour le poste de sénatrice dans l’important Etat du Minais Gerais, avec 15,21% des voix, malgré un investissement financier de plus de 5 millions de reais. Eliminée par un réactionnaire lié à Bolsonaro, Rodrigo Pacheco (Democratas: un oxymore). En fait, elle est arrivée en quatrième position. Son «sort», comme celui de Temer, quoique certes différent, illustre la farce politico-électorale mise en œuvre par le PT lors des élections présidentielles d’octobre 2014. Son dénouement s’est concrétisé ce 28 octobre 2018.
Des résultats qui parlent d’eux-mêmes
Jair Messiah Bolsonaro est le huitième président élu directement après la période de la dictature militaire de 1964-1985. Il est le troisième militaire à gagner la présidence par vote direct. En 1910, Hermes Fonseca, ancien ministre de la Défense, admirateur de l’armée prussienne de Guillaume II et catholique conservateur, obtint ce poste. Il imposa le «service militaire obligatoire». Il vécut six ans en Suisse dans les années 1920.
En 1945, Euricio Gaspar Dutra (1883-1974) fut élu président et occupa son mandat de janvier 1946 à janvier 1951. Il avait aussi occupé, antérieurement, le poste de ministre de la Guerre du 5 décembre 1936 au 3 août 1945. Il joua un rôle dans la conspiration pour établir «l’Estado Novo» en 1937, avec Getulio Vargas. Un projet qui combinait une affirmation nationaliste face au déclin des anciens impérialismes, un pouvoir autoritaire, une certaine politique de développement (par début d’une politique de substitution des importations) et un anticommunisme farouche. Conjointement à cette option, face à une Argentine en plein essor, le Brésil conclut un début d’alliance avec les Etats-Unis, ce qui se concrétisa, durant la seconde guerre mondiale, dans un sens politiquement opposé à celui de l’Argentine.
Le troisième militaire post-1945, élu au suffrage universel direct, n’est que capitaine ayant échoué sa carrière et recyclé depuis 27 ans comme député fédéral de São Paulo: Jair Messiah Bolsonaro.
L’examen des résultats obtenus dans les divers Etats permet de mieux circonscrire la victoire de ce candidat néo-fasciste. (En lettres rouges les quelques Etats où Fernando Haddad arrive en tête, avec pour tous les pourcentages de votes et le nombre de suffrages.)
- São Paulo: Jair Bolsonaro (JB) réunit 67,97% des voix, soit 15’305’786 électeurs/électrices; Fernando Haddad (FH), 32,03% avec 7’212’092.
- Rio Grande Do Sul : 63,24% (JB), soit 3’893’737 suffrages; 36,76% (FH), 2’263’171.
- Rio de Janeiro : 67,95% (J.B), 5’668’950 ; 32,05% (FH), 2’673’278.
- Minais Gerais : 58,19% (JB), 6’100’107 ; 41,81 (FH), 4’382’952.
- Santa Caterina : 75,92% (JB) ; 24,08% (FH), 949’724.
- Paranå: 68,43% (JB) 4’224’416; 31,57% (FH), 1’948’790.
- Pernambuco: 66,5% (FH), 3’297’944; 33,5% (JB). 1’661’163.
- Mato Grosso: 66,42% (JB), Sul 1’085’824; 33,58% (FH) 549’001.
- Matto Grosso do Sul: 65,22% (JB), 872’049; 34,78 (FH),465’025.
- Maranhão: 73,26% (FH) 2’428’790; 26,74% (JB), 886’547.
- Espírito Santo : 63,06% (JB) ; 36,94% (FH), 747’768.
- Distrito Federal: 69,99% (JB), 1’080’411; 30,01% (FH),463’340.
- Acre: 77,16% (JB)290’632; 22,84% (FH), 86’009
- Alagoas: 59,92% (FH), 912’034; 40,08% (JB). 610’093.
- Amapá: 50,2% (JB), 185’096, 49,8% (FH), 183’606.
- Amazonas: 50,27% (JB), 885’391; 49,73%, 875’805.
- Bahia: 72,69% (FH), 5’484’901; 27,31% (JB), 2’060’092.
- Cearã, 71,11% (FH),3’407’454; 28,89% (JB), 1’384’586.
- Goais: 65,52% (JB), 2’124’739); 34,48% FH), 1’118’060.
- Para: 54,82% (FH) 2’112’577; 45,19% (JB), 1742’092.
- Rio Grande do Norte: 63,41% (FH), 1’131’027; 36,59% (JB), 652’562.
- Paraíba: 64,97% (FH)1’450’709; 35,03% (JB), 782’034.
- Roraima: 71,57% (JB), 183’233; 28,43% (FH), 72’791.
- Rondônia : 72.18% (JB), 594’968 ; 27,82% (FH), 229’343.
- Piauí : 77,05% (FH), 1’417’113 ; 22,95% (JB), 442’095.
- Sergipe: 67,54% (FH), 758’797; 32, 46% (JB), 364’621.
- Tocantins: 51,01 (FH), 371’376; 48,99 (JB), 356’681.
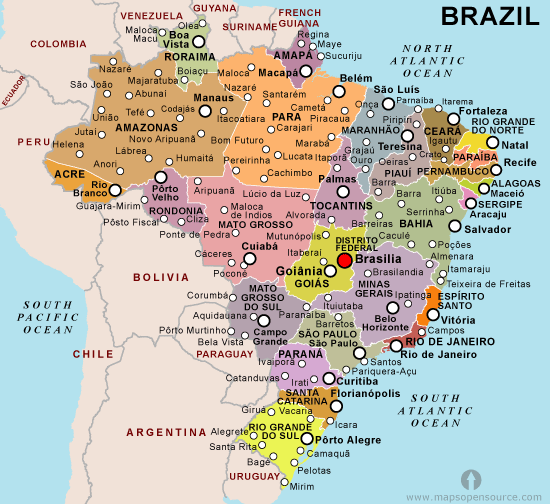
Les derniers sondages de Ibope ou de Datafolha étaient très proches des résultats effectifs. «La surprise» électorale n’est donc pas grande.
Il faut remonter à 2013 pour saisir le début du tournant. Il s’opère lorsque le mouvement de juin a démontré la couardise du PT pour y répondre par l’action (mouvement pour le transport gratuit, entre autres) et par une contre-attaque décidée à la présence de groupes de droite radicaux dans ce mouvement. Ces derniers mirent sur la défensive, sur ce terrain, y compris des formations de la gauche radicale qui se divisaient sur l’analyse de la «nature du mouvement» – avec des sociologues sondant les âmes et les cœurs, de loin évidemment – et ne répondant pas, dans la mobilisation plurielle, aux provocations de l’extrême droite. Cette situation a donné le signal qu’un vide s’était installé entre, d’une part, un secteur de la population, y compris paupérisée ainsi que d’une fraction de la jeunesse, et, d’autre part, ladite «classe politique».
Dans ce contexte a commencé la mobilisation, bien organisée, contre le gouvernement de Dilma Rousseff qui non seulement n’appliquait pas ses «promesses» électorales, mais multipliait les concessions aux ruralistes.

Par exemple, elle plaçait à la direction du ministère de l’Agriculture Kátia Abreu, de janvier 2015 à mai 2016. Or, cette dernière avait été – en tant que propriétaire d’une grande ferme dans le Tocantins – la présidente durant des années (1995 à 2005) de l’association des propriétaires ruraux de cet Etat. Puis en gagnant des galons, elle devint la présidente de la CNA (la Confédération de l’agriculture et de l’élevage au Brésil) entre 2008 à 2011. Elle y a rempli avec fermeté son rôle de défenseur des ruralistes. Elle exprimait les vœux et les intérêts de ces derniers. Ceux de la «fraction B» (Bœuf), du complexe réactionnaire: BBB, c’est-à-dire Bœuf, Balles (armes) et Bible. Cela ne posait pas de problème à «son amie» Dilma Rousseff.
Dans la foulée d’une telle débandade gouvernementale s’est donc organisée la mobilisation de la droite contre le gouvernement du PT et, symboliquement pour personnaliser la campagne, contre Dilma Rousseff. L’envol de cette mobilisation se fit au moment où la crise économique frappait durement le Brésil, en fait dès 2014 mais avec un pic en 2015-2016. Elle se prolongeait en 2017.
Il s’en est suivi une paupérisation d’une couche sociale qui avait pensé grimper «l’échelle sociale» – quelques échelons, pas plus! – et manifestait sa déception en cherchant un «bouc émissaire». Il était tout constitué et prêt à servir. En effet, il surgissait, désarmé de la tête aux pieds, des «scandales de corruption» qui frappaient tous les partis, mais en particulier le PT parce que son image historique était censée contraster avec le dogme de corruption opérant depuis fort longtemps dans la politique brésilienne; un peu à l’image de l’étonnement que certains expriment face aux «vœux» du clergé catholique et aux pratiques pédophiles.
L’occasion faisant le larron. l’opération «mains propres» brésilienne (Lava Jato) déstabilisa tous les formations politiques. L’autonomie partielle du judiciaire, la judiciarisation de ladite vie politique et, enfin, les méthodes utilisées – selon le modèle italien admiré par le juge Sergio Moro – consistant à se déclarer témoin à charge pour voir sa peine d’incarcération diminuée en dénonçant «les siens» grossirent un flot continu et croissant «d’affaires». Elles étaient difficiles à endiguer. Il en ressortit une intrication de la crise économique, de celle du régime politique, du rapport entre les institutions et le «contrôle de la population», jusqu’à des mesures de militarisation d’un Etat par le pouvoir central, comme c’est le cas à Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro, pendant ce temps, avec ses supporters, préparait le terrain.
Les deux partis qui dominaient le champ politique dès la fin de la dictature étaient très secoués et le sont encore: 1° le PSDB (Parti de la social-démocratie brésilienne), au sein duquel la figure emblématique était et est Fernando Henrique Cardoso, qui a connu l’exil à Paris durant une partie de la période dictatoriale et 2° le PT luliste; Lula fut un membre clé du noyau qui lança le PT au tout début des années 1980, puis il devint l’homme du «lulisme», après avoir été le leader du PT.
Que ces deux partis n’aient cessé de passer des alliances les plus «pourries» politiquement et financièrement, afin de contrôler un législatif (Assemblée des députés et Sénat), ne fait que discréditer des formations complices comme le PMDB (aujourd’hui le MDB de Temer) ou le Parti démocratique travailliste (PDT) dont le leader est Ciro Gomes. Il fut candidat aux élections présidentielles de 2018. Il obtint la troisième place avec 12,47% des voix; alors que Géraldo Alckmin du PSDB atteignait péniblement le 4,76% des suffrages.

Dans cette brèche ouverte par cette multiplication de chocs s’engouffrèrent des petites formations. Parmi elles, le PSL (Parti social-libéral) de Jair Bolsonaro qui trouva un appui, dans un premier temps, parmi des fractions de l’armée dont des membres furent d’ailleurs très actifs dans la campagne électorale. Puis dans un réseau communicationnel contrôlé par les Eglises évangéliques et pentecôtistes qui dament le pion, depuis des années, à l’Eglise catholique. Ces Eglises organisent leurs bases (actives durant la campagne) avec un système de solidarité – qui consiste à redistribuer une fraction des sommes piquées à «leurs» fidèles à un petit pourcentage d’élus, reconnaissants – et une machinerie de socialisation, surtout pour les désaffilié·e·s vivant dans les grandes villes et issus de l’exil rural.
A cela s’est ajouté ce que The Economist (27 octobre-2 novembre 2018) qualifie d’une adhésion hésitante d’une fraction du grand capital dans le but suivant: «Sous la présidence de Bolsonaro, le Brésil [de qui?] peut espérer une réforme [du secteur public], une économie en croissance rapide [qui serait impulsée par les privatisations dont le champion est le conseiller de J. Bolsonaro: Paulo Guedes] et avec un président qui contrôle ses pulsions autoritaires.» Un vrai programme pour le capital brésilien.
Mais entre ces projets, ces visions prospectivistes technocratiques, et les forces sociales et politiques mises en marche la collision est presque certaine.
Nous reviendrons demain sur la situation au Brésil, entre autres en examinant les élections des gouverneurs, les réactions populaires «instantanées» et à l’annonce faite par la Folha de São Paulo selon laquelle «Bolsonaro déménage son bunker à Brasilia», soit le début de la formation d’un nouveau gouvernement qui ouvre une nouvelle période au Brésil. Ce d’autant plus que cette élection prolonge celles de Colombie, du Chili, de l’Argentine de Macri, des pouvoirs autoritaires – d’origines diverses en Amérique centrale – et du désastre complet du gouvernement Maduro au Venezuela, qui devient, sur la base de ce que vit concrètement la population (quand elle ne s’exile pas en masse), un épouvantail aisément agitable. (29 octobre 2018)


Soyez le premier à commenter