Les économistes dominants pensent que leur «science» a réalisé des progrès fulgurants depuis sa naissance. L’un deux a ainsi pu affirmer que les connaissances économiques de Marx et Malthus «étaient par rapport à ce que nous savons aujourd’hui ce que l’automobile de Cugnot [1725-1804] était par rapport à nos formules 1» [1]. Et, de manière cohérente, ils cherchent à exclure l’histoire de la pensée économique des programmes universitaires.
On peut très bien défendre la thèse inverse: la discipline économique est au contraire caractérisée par la récurrence de débats dont les termes ne changent pas vraiment, en dépit des habillages modernes. Ce n’est après tout pas étonnant, dans la mesure où les rapports sociaux capitalistes sont fondamentalement invariants. Le débat sur le partage du travail est une bonne illustration de cette proposition.
Ce débat a récemment rebondi en France et l’argument classique des détracteurs de la réduction du temps de travail a de nouveau été mobilisé. Il consiste à dénoncer le raisonnement statique et «malthusien» selon lequel il y aurait une quantité prédéterminée de travail à partager. Il faudrait au contraire réfléchir aux politiques habiles qui permettraient, moyennant les réformes structurelles appropriées, de dynamiser l’activité et l’emploi. Dans son dernier livre, le «prix Nobel d’économie» (français) Jean Tirole (2014) est allé encore plus loin avec cet amalgame: «paradoxalement, l’hypothèse sous-jacente à la fixité de l’emploi et donc à la politique de réduction du temps de travail afin de permettre un partage de l’emploi est la même que celle qui sous-tend le discours des partis d’extrême droite quand ils soutiennent que les immigrants “prendraient» le travail des résidents nationaux au motif que cet emploi serait en quantité fixe.» [2]
Un argument récurrent…
Passons sur l’erreur qui consiste à confondre «fixité» de l’emploi et «fixité» du nombre total d’heures travaillées [3] pour en venir à la généalogie de cet argument récurrent. La dénonciation de cette supposée erreur est en effet un classique de l’économie dominante. Dans ses Perspectives de l’emploi de 2004, l’OCDE note une «corrélation négative entre le ratio emploi-population et le nombre moyen d’heures annuelles par travailleur». Autrement dit, la part des personnes en emploi est plus élevée dans les pays où la durée du travail est moins élevée. Mais c’est évidemment une illusion d’optique et «il est peu probable», décrète l’OCDE, qu’il s’agisse d’une «situation où un volume de travail plus ou moins fixe doit être réparti au sein de la population adulte.» [4] Ce serait verser dans la «lump of labour fallacy», l’illusion de la quantité fixe de travail.
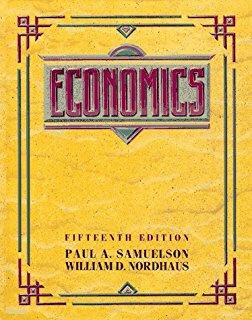 Dans l’édition de 1998 du manuel classique de Samuelson [5], cette illusion était balayée en quelques paragraphes: «Face à un chômage élevé, les gens pensent souvent que la solution réside dans une meilleure répartition du travail existant (…) Cette vue selon laquelle le volume de travail est donné est une illusion qui s’appelle lump of labour fallacy. Le travail n’est pas une quantité qui devrait être partagée entre les travailleurs potentiels. Les ajustements du marché du travail aux déplacements de l’offre et de la demande de main-d’œuvre passent par des variations du salaire réel et part la mobilité de la main-d’œuvre et du capital.» Dans l’édition de 2009 de leur manuel, Samuelson et Nordhaus, feront disparaître ce passage (ainsi que ceux consacrés à l’histoire des syndicats ou à l’économie marxiste) pour «laisser de la place à la théorie financière moderne.» [6]
Dans l’édition de 1998 du manuel classique de Samuelson [5], cette illusion était balayée en quelques paragraphes: «Face à un chômage élevé, les gens pensent souvent que la solution réside dans une meilleure répartition du travail existant (…) Cette vue selon laquelle le volume de travail est donné est une illusion qui s’appelle lump of labour fallacy. Le travail n’est pas une quantité qui devrait être partagée entre les travailleurs potentiels. Les ajustements du marché du travail aux déplacements de l’offre et de la demande de main-d’œuvre passent par des variations du salaire réel et part la mobilité de la main-d’œuvre et du capital.» Dans l’édition de 2009 de leur manuel, Samuelson et Nordhaus, feront disparaître ce passage (ainsi que ceux consacrés à l’histoire des syndicats ou à l’économie marxiste) pour «laisser de la place à la théorie financière moderne.» [6]
L’appréciation portée par Alfred Sauvy sur l’expérience des 40 heures en 1936 repose sur le même postulat. Son jugement est très sévère: Sauvy dénonce le «contresens économique la semaine de 40 heures bloquant une économie en pleine reprise». C’est pour lui «l’acte le plus dommageable commis depuis la révocation de l’édit de Nantes.» [7] En fin de compte, cet échec renvoie au «malthusianisme du temps» et en particulier aux illusions colportées par le Bureau international du travail (BIT) auprès des syndicalistes qui considèrent «le montant total des heures de travail comme une donnée de fait.» [8]
Cette déclaration grandiloquente passe allègrement sur cette réalité: si une réduction significative de la durée du travail ne s’accompagne pas d’embauches, il est alors évident que la production recule. Or, le patronat a pratiqué à l’époque une véritable grève de l’embauche, ce que d’ailleurs Sauvy reconnaît lui-même: «si le patronat français, si profondément malthusien pendant la crise, critique la semaine de 40 heures, c’est à cause de la majoration du salaire horaire qui l’accompagne. Mais il ne voit pas d’un mauvais oeil la réduction de la production qui en résultait.» [9] Et même pendant la reprise de 1938-39, «les industriels ont souvent hésité à s’engager dans les heures supplémentaires, malgré la simplification de la procédure, soit par crainte de résistance des ouvriers, soit parce qu’ils préfèrent allonger les carnets de commande et disposer d’une certaine sécurité.» [10]
La dénonciation de cette lump of labour fallacy date de 1891. Elle figure dans un article de David F. Schloss [11]. Pour cet économiste qui travaille sur les modes de rémunération des salarié·e·s, la base de cette erreur est une «croyance répandue dans nos classes ouvrières»: travailler au maximum de ses possibilités irait à l’encontre «de ses propres intérêts et de sa fidélité à la cause du travail. La base de cette croyance, qui est en grande partie responsable de l’impopularité du travail aux pièces, est cette erreur notable sur laquelle nous voulons attirer l’attention sous le nom de “théorie de la quantité de travail” (theory of the Lump of Labour).»
Schloss cite même (défavorablement) un syndicat qui prescrivait formellement à ses membres de «ne pas faire le double du travail qui vous est imparti, en forçant ainsi les autres à faire de même, tout cela pour obtenir un sourire du contremaître. Ces comportements inconséquents et déloyaux privent d’emploi de nombreux bons camarades.»
Suit la description de cette croyance erronée, tout à fait semblable à l’argumentaire des contempteurs contemporains de la réduction du termps de travail: «Selon cette théorie, il existe un volume de travail fixé et les travailleurs ont donc intérêt à ne pas prendre une trop grande charge de travail, pour que ce volume soit correctement réparti. On attend de cette pratique une restriction de l’offre de main-d’œuvre disponible et comme on suppose que la demande reste inchangée, il devrait en résulter l’intégration des sans-emploi. Dans le même temps, il y aurait deux employeurs en concurrence pour embaucher un même homme; les ouvriers, ayant réussi à introduire ce “coin”, pourront, l’espèrent-ils, obtenir un salaire beaucoup plus élevé pour le prix de leur travail.» [12] On voit que la question n’est pas seulement théorique: il s’agit de désamorcer une revendication ouvrière centrale.
Une autre voie était possible
Souvent l’économie dominante a bifurqué, de manière à éliminer les approches alternatives. Il existait en effet une autre ligne d’analyse qui a été progressivement évincée. Elle a été formulée en 1909 dans un article sobrement intitulé «Les heures de travail.» [13] Son auteur est un économiste anglais, Sidney Chapman, qui n’a rien d’un hétérodoxe, puisqu’il sera le conseiller économique du gouvernement britannique. Cet article a été exhumé par Tom Walker, un chercheur et syndicaliste canadien, qui s’interroge sur la disparition de sa théorie et en montre toute l’actualité. [14]
L’idée essentielle de Chapman peut être résumée ainsi: toute réduction du temps de travail s’accompagne d’une amélioration de la productivité du travail. Il y a donc une durée optimale qui maximise le produit et est en général inférieure à la durée effective. Chapman propose un modèle quantifié qui reste d’ailleurs conforme au paradigme néo-classique. Mais on sent bien qu’il ne se plie à l’exercice que pour satisfaire aux canons de la «science» et son modèle est reporté dans une note de bas de page ! [15]

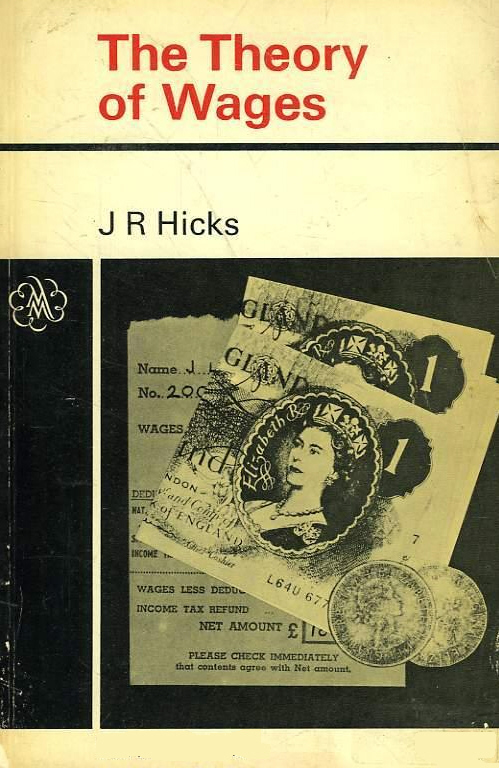 Tom Walker montre comment l’analyse de Chapman a été pendant longtemps acceptée. Arthur Pigou y fait explicitement référence dans The Economics of Welfare et reprend à son compte le «théorème» de Chapman: «Le point essentiel, cependant, est que, dans chaque industrie, pour chaque classe de travailleurs, il y a une certaine durée de travail dont le dépassement sera désavantageux pour le revenu national.» [16] En 1929, Lionel Robbins évoque l’article de Chapman qui a traité d’un des «principaux problèmes de l’analyse de l’équilibre économique.» [17] Enfin, dans sa Theory of Wages, John Hicks cite favorablement Chapman: «L’exposé classique de la théorie des “heures” dans un marché libre se trouve dans l’article de Sir Sydney Chapman» auquel «il y a très peu de choses à ajouter.» [18]
Tom Walker montre comment l’analyse de Chapman a été pendant longtemps acceptée. Arthur Pigou y fait explicitement référence dans The Economics of Welfare et reprend à son compte le «théorème» de Chapman: «Le point essentiel, cependant, est que, dans chaque industrie, pour chaque classe de travailleurs, il y a une certaine durée de travail dont le dépassement sera désavantageux pour le revenu national.» [16] En 1929, Lionel Robbins évoque l’article de Chapman qui a traité d’un des «principaux problèmes de l’analyse de l’équilibre économique.» [17] Enfin, dans sa Theory of Wages, John Hicks cite favorablement Chapman: «L’exposé classique de la théorie des “heures” dans un marché libre se trouve dans l’article de Sir Sydney Chapman» auquel «il y a très peu de choses à ajouter.» [18]
Pigou, Hicks ou Robbins n’étaient pas, loin de là, des hétérodoxes. Autrement dit, la théorie de Chapman faisait partie de l’économie dominante de l’époque. Et, sans qu’il y soit explicitement fait référence, elle a inspiré des travaux statistiques plus proches de nous. La méthodologie de Chapman a été reprise dans les travaux menés aux États-unis à la fin des années 1960. L’objectif était de mesurer les sources de la croissance et d’en tirer des enseignements pour définir les meilleures politiques. On peut citer les riches contributions de James Knowles et de John Kendrick [19] mais la plus célèbre est celle de Edward Denison [20] qui s’appuie d’ailleurs sur les travaux de ses prédécesseurs. Dans le chapitre consacré aux heures de travail, Denison développe un raisonnement analogue à celui de Chapman, qui repose sur deux hypothèses. La première est qu’une légère réduction du temps de travail pouvait en 1929 être pleinement compensée par une augmentation de la production horaire, alors que la durée annuelle du travail était de 2529 heures (soit 48,6 heures par semaine sur la base de 52 semaines). La seconde hypothèse est qu’en 1957, avec une durée annuelle du travail de 2069 heures (39,8 par semaine), la compensation ne serait plus que de 40%. Autrement dit, une réduction de 1 % de la durée du travail réduit la production par heure-homme de 0,6%.
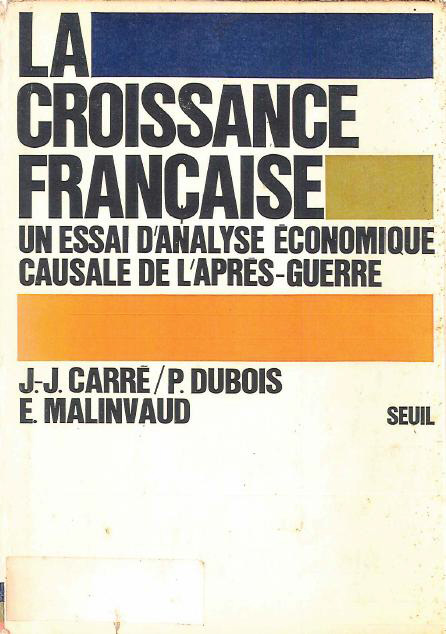 Dans leur ouvrage sur la croissance française, qui reprend la méthodologie de Denison, Jean-Jacques Carré, Paul Dubois et Edmond Malinvaud citent le correctif de Denison mais signalent qu’il n’a pas d’importance pratique puisque la durée du travail est restée en France pratiquement constante sur la période étudiée 1951-1969, ce qui est exact. En revanche, la question de la durée du travail est curieusement reportée à une annexe où les auteurs soumettent un questionnaire à leurs collègues sociologues, en leur demandant notamment si «le maintien à un haut niveau de la durée hebdomadaire du travail a été désiré par les travailleurs.» [21] Cette dichotomie entre économie et sociologie est particulièrement symptomatique d’une terrible régression par rapport aux fondateurs de l’économie politique.
Dans leur ouvrage sur la croissance française, qui reprend la méthodologie de Denison, Jean-Jacques Carré, Paul Dubois et Edmond Malinvaud citent le correctif de Denison mais signalent qu’il n’a pas d’importance pratique puisque la durée du travail est restée en France pratiquement constante sur la période étudiée 1951-1969, ce qui est exact. En revanche, la question de la durée du travail est curieusement reportée à une annexe où les auteurs soumettent un questionnaire à leurs collègues sociologues, en leur demandant notamment si «le maintien à un haut niveau de la durée hebdomadaire du travail a été désiré par les travailleurs.» [21] Cette dichotomie entre économie et sociologie est particulièrement symptomatique d’une terrible régression par rapport aux fondateurs de l’économie politique.
Des implications subversives
L’analyse de Chapman est toujours d’actualité: lors du passage aux 35 heures en France, la productivité horaire a nettement augmenté, réduisant de moitié l’impact de la réduction de travail sur l’emploi. Cela permet cependant de contextualiser l’argument de Chapman. Pour lui, il existe un compromis possible où la baisse du temps de travail serait compensée par des gains de productivité. A l’époque de Chapman (qui était aussi un observateur des conditions concrètes de travail) la démonstration était destinée à réduire la pénibilité du travail liée à une très longue journée de travail. Dans le cas des 35 heures la question se pose aujourd’hui en des termes différents puisque les gains de productivité ont été obtenus par une intensification et donc par une dégradation des conditions de travail. C’est pourquoi l’exigence d’embauches compensatoires est apparue comme une condition essentielle d’une réduction du temps de travail vertueuse.
Ces considérations ne suffisent pas à expliquer l’abandon de la théorie de Chapman et le repli sur la dénonciation de la lump of labor fallacy, autrement dit de l’illusion selon laquelle on pourrait répartir différemment le volume de travail. C’est Tom Walker [22] qui en donne la clé en remarquant que Chapman posait une autre question: la durée optimale du travail peut-elle être atteinte par le libre jeu du marché? Chapman montre que ce ne serait le cas que s’il existait un accord concerté entre les employeurs, peu probable dans un régime de concurrence. Dans ces conditions, un employeur qui déciderait d’applique unilatéralement la journée de neuf heures s’exposerait à la concurrence d’un autre qui «allongerait les heures de travail en échange d’un salaire hebdomadaire légèrement plus élevé». C’est pour Chapman la preuve que la durée du travail optimale ne pourrait s’établir spontanément «en supposant l’absence de toute pression des travailleurs.» [23]
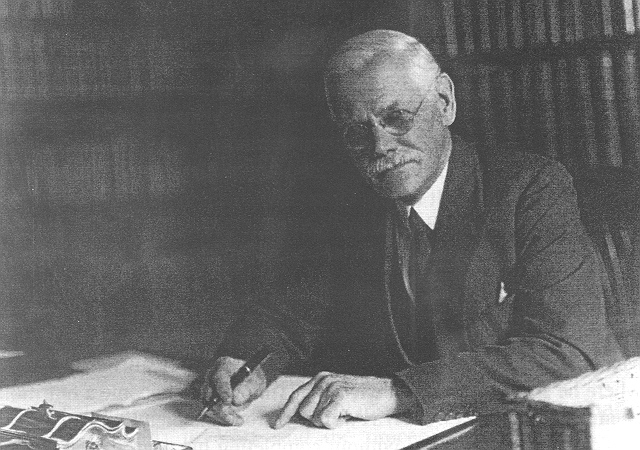
Même si Chapman utilise un outillage néo-classique, il met le doigt sur les effets de la concurrence qui empêche d’atteindre ce qu’il définit comme un optimum et laisse ouverte une brèche béante, à savoir la nécessité de l’intervention de l’État pour remédier à cette «défaillance» du marché. Un peu plus tard, Benjamin Seebohm Rowntree s’engouffrera dans cette brèche. Rowntree était un industriel anglais et réformateur social (il fut surnommé l’«Einstein du Welfare State») et l’auteur d’une magistrale enquête sociologique sur la pauvreté en milieu urbain [24]. En 1914, il décrit les effets de la concurrence dans les mêmes termes que Chapman: «L’employeur n’est pas principalement intéressé à maintenir sa main-d’œuvre en bonne santé. Ce qu’il veut, c’est disposer d’un volant de main-d’œuvre qualifiée qui lui permette de répondre immédiatement à la demande (…) Dans le système actuel de concurrence, il ne peut pas se permettre d’avoir une vision à long terme. Il ne doit pas être trop en avance sur ses concurrents. Dans la mesure où il représente des intérêts immédiats et limités, ses perspectives économiques sont forcément très éloignées de celles de l’ensemble de la nation.»
Rowntree en tire toutes les conséquences et met les pieds dans le plat. Il appelle de ses vœux une intervention de l’État pour encadrer la liberté d’entreprendre et récuse l’argument de la fuite des capitaux: «La question se ramène alors à celle-ci: dans quelle mesure est-il souhaitable et possible de dépasser les intérêts immédiats de l’employeur en lui imposant des obligations avantageuses pour la nation plutôt que pour lui? Cette intervention contraignante ne risque-t-elle pas de faire fuir le capital et condamner les travailleurs au chômage? Certains ne manqueront pas de faire valoir que toute ingérence dans la liberté des employeurs fera fuir le capital du pays. Et pourtant, l’histoire d’un siècle de mise en place de législations garantissant un minimum de sécurité et de santé au travail et encadrant la durée du travail, prouve que ces contraintes, loin de faire fuir le capital des branches concernées, ont presque toujours conduit à une plus grande productivité, grâce à un meilleur état de santé et une meilleure efficacité des travailleurs.» [25]

Cette brève histoire du dogme de la «quantité fixe de travail» montre que les controverses actuelles ne font que reprendre les termes d’un débat fort ancien. L’économie dominante a réussi à expulser de la «science» les analyses fondées sur l’observation des conditions concrètes de travail et qui, même si elles s’inscrivaient dans un cadre néo-classique, dérapaient rapidement sur des considérations subversives.
Ces analyses montraient le conflit permanent entre la logique de concurrence et les aspirations des travailleurs à des conditions d’emploi décentes. A la recherche d’un compromis social – la «paix industrielle» de Rowntree – les réformateurs en concluaient logiquement à la nécessité d’une législation sociale. Il est inutile de souligner que les réformes dites structurelles visant aujourd’hui à flexibiliser le marché du travail ne sont pas une marche (comme dirait Macron) vers la modernité mais un retour en arrière par rapport à des évidences qui allaient de soi pour des économistes aussi peu sulfureux que Pigou ou Hicks.
Cette expulsion n’a été possible qu’au prix d’une autonomisation de l’économie dominante par rapport aux sciences sociales, sous prétexte d’une quantification gage de scientificité.
C’est pourquoi la clé ultime du débat se trouve sans doute dans cette phrase du livre de Carré-Dubois-Malinvaud où les auteurs reconnaissent que «la notion d’intensité du travail échappe sans doute à la quantification» (p. 255). On ne peut mieux dire: ce n’est pas à partir de la comptabilité des heures de travail (et encore moins des mécanismes de marché) que l’on peut définir l’organisation optimale du travail. Seule l’auto-organisation des travailleurs eux-mêmes peut y parvenir. (Article envoyé à A l’Encontre en le 22 juin 2017)
Notes
[1] Charles Wyplosz, «Inculture française», Libération, 26 mars 1998.
[2] Jean Tirole, Économie du bien commun, PUF, 2016.
[3] Michel Husson, «Les anti-RTT : arrogance et gros sabots», Alternatives économiques, 25 mai 2016.
[4] OCDE, Perspectives de l’emploi, 2004, p. 29.
[5] Paul A. Samuelson et William D. Nordhaus, Economics, 16th edition, Irwin McGraw-Hill, 1998, p. 239.
[6] Paul A. Samuelson et William D. Nordhaus, Economics, 19th edition, Irwin McGraw-Hill, 2009, p. XIX.
[7] Alfred Sauvy, Histoire économique de la France entre les deux guerres, Economica, 1984, vol.1, p. 331-332.
[8] idem, p.329.
[9] idem, p. 330.
[10] idem, p.364.
[11] David F. Schloss, «Why Working-Men Dislike Piece-Work», The Economic Review, Vol. I, No.3, April 1891, p. 311-326.
[12] David F. Schloss, Methods of Industrial Remuneration, Williams and Norgate, London, 3th Edition, 1898 [1892], p. 80-83. Le chapitre cité reprend l’essentiel de l’article de 1891. Traduction française: Les modes de rémunération du travail, V. Giard & E. Brière, 1902.
[13] Sidney J. Chapman, «Hours of Labour», The Economic Journal, September 1909.
[14] Cette contribution doit beaucoup aux articles de Tom Walker, notamment: «Missing: the strange disappearance of S. J. Chapman’s theory of the hours of labour», Review of Social Economy, vol. LXV, N° 3, September 2008.
[15] Il est disponible ici dans une version plus lisible: «Le “modèle” de Chapman».
[16] Arthur C. Pigou, The Economics of Welfare, 1920, p. 414.
[17] Lionel Robbins, «The Economic Effects of Variations of Hours of Labour», The Economic Journal, Vol. 39, No.153, March 1929, p. 25.
[18] John R. Hicks, The Theory of Wages, 1932, 2ème édition, Palgrave Macmillan, 1963, p. 104.
[19] John W. Kendrick, Productivity Trends in the United State, NBER, 1961 ; James W. Knowles, The Potential Economic Growth in The United States, Joint Economic Committee Congress of The United States, January 1960.
[20] Edward F. Denison, The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us, Committee for Economic Development, January 1962, chapter 5.
[21] Jean-Jacques Carré, Paul Dubois, Edmond Malinvaud, La croissance française, Le Seuil, 1972, p. 668.
[22] Tom Walker «The “Lump-of-Labor” Case Against Work-Sharing: Populist Fallacy or Marginalist Throwback?», dans: Lonnie Golden and Deborah Figart (eds), Working Time: International trends, theory and policy perspectives, Routledge, 2000.
[23] Chapman, déjà cité, p. 361.
[24] B. Seebohm Rowntree, Poverty, A Study of Town Life, Mac Millan, London, 1901.
[25] B. Seebohm Rowntree, The Way to Industrial Peace and the Problem of Unemployment, T. Fisher Unwin, London, 1914, p. 66-67.


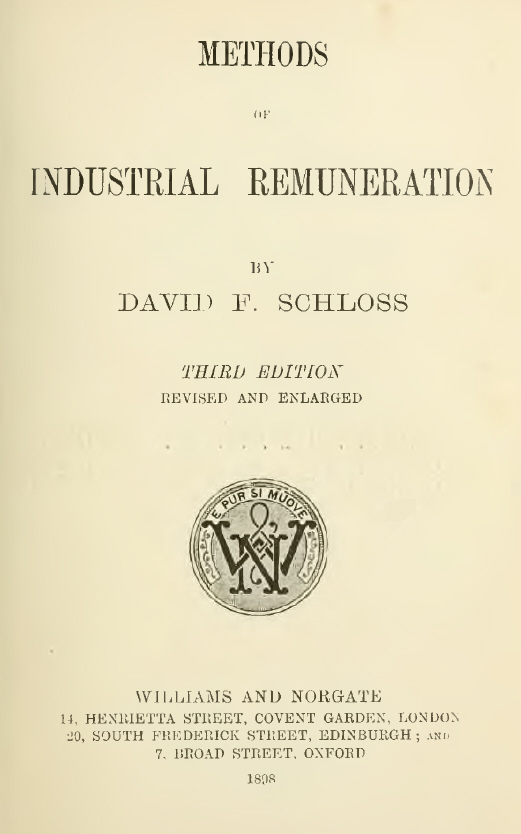
Soyez le premier à commenter