Jean Tirole a reçu en 2014 le prix de la Banque de Suède en sciences économiques (baptisé «prix Nobel» d’économie[1]). C’est le troisième français à obtenir cette récompense après Gérard Debreu en 1983 et Maurice Allais en 1988. On peut en déduire que ces trois prix récompensent une certaine tradition de la science économique française. Ils ont en tout cas un point commun, à savoir un usage intensif de la mathématisation qui permet de prétendre à l’objectivité scientifique. Mais, pour chacun d’eux, cette consécration s’accompagne d’une sorte de coming out où ils dévoilent les biais idéologiques qui se trouvent au fondement de leurs savants modèles.
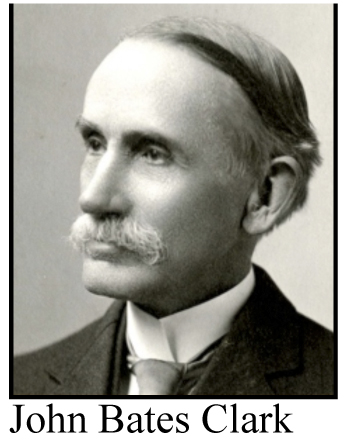 Il n’est pas inutile de revenir sur une citation tout à fait éclairante de John Bates Clark, l’un des fondateurs de la théorie néo-classique de la répartition. En 1889, il écrivait ceci: «Les travailleurs, nous dit-on, sont en permanence dépossédés de ce qu’ils produisent. Cela se passe dans le respect du droit et par le fonctionnement normal de la concurrence. Si cette accusation était fondée, tout homme doué de raison devrait devenir un socialiste, et sa volonté de transformer le système économique ne ferait que mesurer et exprimer son sens de la justice». Pour répondre à cette accusation – qui fait clairement référence à la théorie marxiste de l’exploitation – il faut, explique Clark «entrer dans le royaume de la production. Nous devons décomposer le produit de l’activité économique en ses éléments constitutifs, afin de voir si le jeu naturel de la concurrence conduit ou non à attribuer à chaque producteur la part exacte de richesses qu’il contribue à créer[2]».
Il n’est pas inutile de revenir sur une citation tout à fait éclairante de John Bates Clark, l’un des fondateurs de la théorie néo-classique de la répartition. En 1889, il écrivait ceci: «Les travailleurs, nous dit-on, sont en permanence dépossédés de ce qu’ils produisent. Cela se passe dans le respect du droit et par le fonctionnement normal de la concurrence. Si cette accusation était fondée, tout homme doué de raison devrait devenir un socialiste, et sa volonté de transformer le système économique ne ferait que mesurer et exprimer son sens de la justice». Pour répondre à cette accusation – qui fait clairement référence à la théorie marxiste de l’exploitation – il faut, explique Clark «entrer dans le royaume de la production. Nous devons décomposer le produit de l’activité économique en ses éléments constitutifs, afin de voir si le jeu naturel de la concurrence conduit ou non à attribuer à chaque producteur la part exacte de richesses qu’il contribue à créer[2]».
Depuis lors, la science économique officielle a bifurqué, rompant avec la tradition de l’économie politique classique et adoptant un paradigme emprunté à la science physique du XIXe siècle[3]. Elle se réclame d’une méthodologie objective et pousse les hauts cris chaque fois que sa neutralité est remise en cause. C’est le grand écart qui existe entre cette prétention et les croyances profondes que l’on va chercher à illustrer à partir de «nos» «prix Nobel» français.
Gérard Debreu
Le premier français à obtenir le «prix Nobel», en 1983, est Gérard Debreu (1921-2004) même s’il travaillait aux Etats-Unis et y avait été naturalisé. Ses travaux ont principalement porté sur la théorie de l’équilibre général et ont abouti à deux résultats essentiels: 1) l’équilibre existe et: 2) c’est un optimum. Si on laisse de côté les sophistications mathématiques, on pourrait résumer cette théorie de la manière suivante. La société est composée d’individus qui consomment et d’entreprises qui produisent. Les consommateurs dépensent leurs revenus de manière à obtenir le plus grand bien-être possible, tandis que les entreprises organisent la production de telle sorte qu’elle coûte le moins cher possible. Si rien n’y fait obstacle, leur confrontation sur le marché conduit à un équilibre qui concilie leurs comportements. Et c’est un optimum, dès lors que les consommateurs prennent garde à ne pas acheter des biens qui ne leur plaisent pas, tandis que les entreprises évitent les dépenses inutiles. Tout cela se passe dans un monde imaginaire qui ne saurait être le capitalisme, puisqu’il n’y a pas d’accumulation du capital, pas de croissance (pas de chômage évidemment), mais un échange instantané entre producteurs et consommateurs.
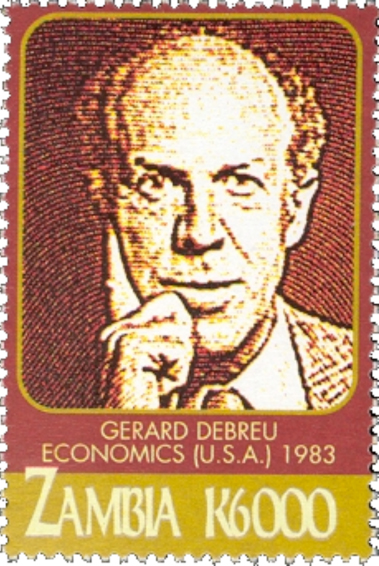 Que cette théorie soit censée fournir les fondements microéconomiques de la science économique est en soi un mystère. On pourrait tout à fait entretenir une catégorie de chercheurs évoluant dans ce monde virtuel, s’ils n’imprégnaient pas tout l’enseignement officiel de l’économie. Mais ils ont une autre fonction sociale, celle de fournir des soubassements supposés scientifiques à l’apologie du capitalisme réellement existant. C’est le meilleur des mondes, à condition bien sûr de ne pas perturber son fonctionnement par toute une série de rigidités néfastes. Si le monde réel était organisé comme la théorie, le chômage ne pourrait pas exister, et il est au fond la mesure de nos imperfections, de la distance qui nous sépare du capitalisme pur et parfait.
Que cette théorie soit censée fournir les fondements microéconomiques de la science économique est en soi un mystère. On pourrait tout à fait entretenir une catégorie de chercheurs évoluant dans ce monde virtuel, s’ils n’imprégnaient pas tout l’enseignement officiel de l’économie. Mais ils ont une autre fonction sociale, celle de fournir des soubassements supposés scientifiques à l’apologie du capitalisme réellement existant. C’est le meilleur des mondes, à condition bien sûr de ne pas perturber son fonctionnement par toute une série de rigidités néfastes. Si le monde réel était organisé comme la théorie, le chômage ne pourrait pas exister, et il est au fond la mesure de nos imperfections, de la distance qui nous sépare du capitalisme pur et parfait.
Peu de temps après avoir obtenu son prix, Debreu a accordé un entretien à Guy Sorman, pour le Figaro Magazine[4]. Il rappelle d’emblée que «l’économie n’est pas un objet de préférence personnelle ou d’opinion politique» et encore que «les fondements de l’économie sont scientifiques et les problèmes économiques sont universels, quel que soit le régime». Voilà pour la neutralité. Mais Debreu se lâche et assume fièrement le titre de l’article: «la supériorité du libéralisme est mathématiquement démontrée».
Il peut le faire! et c’est de la science: «La supériorité de l’économie libérale est incontestable et mathématiquement démontrable, en utilisant des modèles informatiques, qui sont parfaitement maîtrisés». Ou encore: «c’est l’économie de marché, c’est-à-dire la liberté de produire et de commercer qui, dans tous les cas, aboutit aux meilleurs résultats mathématiques. A l’inverse, je peux prouver de manière tout aussi scientifique, comment les interventions de l’État perturbent le marché ou nuisent à la croissance».
Maurice Allais
Maurice Allais (1911-2010) a dû attendre un âge plus avancé que Debreu – qui avait d’ailleurs été son étudiant – pour obtenir son «prix Nobel» en 1988. Il en a, semble-t-il, conçu une certaine amertume puisque Wikipedia lui prête cette pique (dont on n’a cependant pas retrouvé la source): «la construction de Debreu n’a aucune valeur scientifique, tant elle est totalement étrangère au monde de l’expérience». Maurice Allais est donc un personnage fascinant, qui a formé toute une série d’économistes-ingénieurs, de ministres et de PDG à l’École nationale supérieure des Mines de Paris: Marcel Boiteux, Gérard Debreu, Jacques Lesourne, Lionel Stoléru, André Giraud, Thierry de Montbrial, Georges Besse, Jean-Louis Beffa, Raymond Lévy, etc.
 Dans la conférence qu’il a donnée lors de la remise de son prix[5], Allais expose une position de principe essentielle: «Le prérequis de toute science est l’existence de régularités qui peuvent être l’objet d’analyses et de prévisions. C’est le cas par exemple de la mécanique céleste. Mais c’est vrai également pour de nombreux phénomènes économiques. Leur analyse approfondie révèle en effet l’existence de régularités tout aussi frappantes que celles que l’on trouve dans les sciences physiques. Voilà pourquoi l’Économie est une science et voilà pourquoi cette science repose sur les mêmes principes généraux et sur les mêmes méthodes que les sciences»
Dans la conférence qu’il a donnée lors de la remise de son prix[5], Allais expose une position de principe essentielle: «Le prérequis de toute science est l’existence de régularités qui peuvent être l’objet d’analyses et de prévisions. C’est le cas par exemple de la mécanique céleste. Mais c’est vrai également pour de nombreux phénomènes économiques. Leur analyse approfondie révèle en effet l’existence de régularités tout aussi frappantes que celles que l’on trouve dans les sciences physiques. Voilà pourquoi l’Économie est une science et voilà pourquoi cette science repose sur les mêmes principes généraux et sur les mêmes méthodes que les sciences»
Dans son principal ouvrage, le Traité d’économie pure[6], écrit en 1943, Allais adoptait d’emblée une approche typique des théoriciens de l’équilibre général: «Notre modèle schématique ne constitue qu’une économie irréelle, très éloignée de la réalité, mais, par le fait même que cette économie reproduira d’une manière extrêmement simplifiée les caractères fondamentaux de l’économie réelle, elle permettra de définir, de manière précise, des concepts, dont la transposition à cette économie se fera ensuite d’elle-même». Mais Allais y ajoute une méthodologie très particulière, qu’il baptise «analyse psycho-géométrique» et qu’il résume ainsi: «Tandis que dans les sciences physiques la confrontation des théories avec la réalité se réduit à la comparaison des résultats prévus par le calcul avec ceux donnés par l’observation, dans les sciences morales, et en Économie en particulier, une telle confrontation résultera tout autant de la comparaison directe des hypothèses de départ avec les données immédiates de notre intuition». Son intuition le conduit à cette conclusion générale: «ce sont les psychologies individuelles qui constituent la base même de l’évolution du marché» et Allais anticipe sur certains errements contemporains: «Il n’est pas impossible que l’on réalise dans l’avenir en psychologie économique des expériences analogues à celles de la psychologie physiologique».
 Le «prix Nobel» récompense donc les raffinements psychologiques (et «intuitifs) apportés par Allais à la théorie de l’équilibre général, dans la tradition de Walras et surtout de Pareto. Mais le jury n’a sans doute pas pris en compte d’autres de ses travaux qui sombrent dans un pur délire. Ainsi, dans un article résumant ses apports à la science, Allais[7] explicite son hypothèse du «Facteur X» selon laquelle «les fluctuations des séries temporelles que nous observons dans les phénomènes qui relèvent des sciences de la nature, des sciences de la vie et des sciences de l’homme, résultent pour une large part de l’influence, par des effets de résonance, des innombrables vibrations qui sillonnent l’espace dans lequel nous vivons et dont l’existence est aujourd’hui une certitude. Ainsi peut s’expliquer la structure des fluctuations, à première vue incompréhensible, que l’on constate dans un très grand nombre de séries temporelles comme par exemple celles des taches du soleil ou des cours de bourse. En fait ces fluctuations présentent toutes les apparences d’une structure presque périodique».
Le «prix Nobel» récompense donc les raffinements psychologiques (et «intuitifs) apportés par Allais à la théorie de l’équilibre général, dans la tradition de Walras et surtout de Pareto. Mais le jury n’a sans doute pas pris en compte d’autres de ses travaux qui sombrent dans un pur délire. Ainsi, dans un article résumant ses apports à la science, Allais[7] explicite son hypothèse du «Facteur X» selon laquelle «les fluctuations des séries temporelles que nous observons dans les phénomènes qui relèvent des sciences de la nature, des sciences de la vie et des sciences de l’homme, résultent pour une large part de l’influence, par des effets de résonance, des innombrables vibrations qui sillonnent l’espace dans lequel nous vivons et dont l’existence est aujourd’hui une certitude. Ainsi peut s’expliquer la structure des fluctuations, à première vue incompréhensible, que l’on constate dans un très grand nombre de séries temporelles comme par exemple celles des taches du soleil ou des cours de bourse. En fait ces fluctuations présentent toutes les apparences d’une structure presque périodique».
Allais n’est pas avare en prises de position tonitruantes. En 1946, dans Économie et Intérêt, il déclare qu’«en tant que construction économique, la Théorie Générale est inconsistante» et que «les attaques de Keynes contre l’épargne et l’inégalité des revenus séduisent les esprits démagogiques ou aigris pour lesquels toute inégalité dont ils ne bénéficient pas est insupportable[8]». Dans d’autres textes, Allais prétend prouver l’anisotropie (la propriété d’être dépendant de la direction) de l’univers et décrète «l’effondrement radical et définitif de la théorie de la relativité». Dans un article publié en 2003 par la prestigieuse revue des anciens élèves de Polytechnique[9], Allais arrive à cette conclusion: «La théorie de la relativité restreinte qui implique l’invariance de la vitesse de la lumière est ainsi totalement invalidée par les données de l’observation. Il en est de même de la théorie de la relativité générale dont la théorie de la relativité restreinte n’est qu’un cas particulier». Et il ajoute que «l’intolérance aveugle et fanatique de certains partisans de la théorie de la relativité ont fait perdre un siècle à la pensée physique».
Grâce à la notoriété conférée par le «prix Nobel», Maurice Allais intervient dans le débat public en soutenant des thèses protectionnistes et souverainistes. Il devient même à ce titre une référence de certains altermondialistes, en raison de sa critique violente du libre-échangisme, notamment pendant la campagne pour le non au traité constitutionnel européen[10].
Il y a là un exemple des confusions actuelles, dans la mesure où Allais est aussi une référence pour l’extrême-droite, de Bruno Mégret au Front national. Qu’une partie de la gauche ait pu se réclamer d’Allais est absolument scandaleux, ou en tout cas le résultat d’une ignorance coupable. Il suffit de quelques citations pour s’en rendre compte[11]. En 1987, Allais déclare que «le chômage chronique ne pourrait être pallié que par la réduction de la rémunération du travail et par la détermination des salaires par le marché, tous les contrats de travail, et tout particulièrement ceux des travailleurs étrangers ne restant valables que pour une durée déterminée» [mes italiques]. Dans la foulée, Allais propose de lutter contre l’immigration par «la suppression pour les étrangers des allocations familiales» et la «révision des modalités d’acquisition de la nationalité française par le sol».
Sur la reproduction sociale, Allais a une vision très arrêtée (et très inspirée de Pareto): «En moyenne, les enfants des plus capables sont les plus capables; il est de l’intérêt de tous que les plus capables disposent d’un pouvoir économique plus grand que ceux qui le sont moins». Et la démocratisation de l’enseignement n’y pourra rien changer: «Une structure de classe est inévitable et l’idée que la répartition des étudiants dans l’enseignement supérieur doive fidèlement refléter, quant à leur origine sociale, la répartition de la population relève ou d’une analyse insuffisante des faits, ou d’une démagogie hypocrite».
Jean Tirole
Une bonne partie de l’œuvre de Tirole porte sur les défaillances du marché et les politiques publiques (c’est d’ailleurs le titre de sa conférence «Nobel»). Et son projet essentiel est de définir des modalités d’intervention publique qui corrige les imperfections du marché, mais de manière parcimonieuse, afin de conserver les vertus intrinsèques du marché tout en réduisant au maximum l’intervention publique.

On pourrait même dire que la préoccupation essentielle de Tirole est que les interventions du régulateur public n’enfreignent pas la péréquation des taux de profit, même s’il n’a évidemment rien à faire d’une théorie de la valeur. On peut trouver un exemple de ce positionnement dans un article[12] où Tirole traite du brevetage des médicaments contre le Sida. L’une des conditions à respecter de la part du régulateur est de «garantir à l’entreprise un taux de rendement équitable sur son investissement» (To provide the firm with a fair rate of return on investment). La nationalisation de l’industrie pharmaceutique est évidemment exclue par principe, puisqu’une telle mesure détruirait tout effort d’innovation. Reste une procédure de rachat de l’activité de l’industrie pharmaceutique par une fondation, une organisation multilatérale, le pays concerné lui-même, ou une combinaison des trois. Le médicament serait alors distribué quasi gratuitement. L’un des avantages de ce dispositif serait que «la firme pharmaceutique serait de facto autorisée à conserver son profit», à condition que le régulateur prenne en compte le risque.
De manière générale, le projet de Tirole est de trouver quelles sont les incitations à mettre en œuvre par l’Etat afin d’étendre la logique des marchés à l’ensemble des domaines de la vie sociale. C’est pourquoi ses travaux portent sur des thèmes très variés que l’on va rapidement balayer.
L’emploi et le chômage
L’emploi ne représente qu’«un pour cent» des travaux de Tirole, comme il a pu le dire sur France Inter, mais cela ne l’empêche pas d’avoir des idées sur la question, qui s’inscrivent tout naturellement dans la vulgate dominante, assez bien résumée par la tribune qu’il a récemment cosignée avec la fine fleur néo-libérale[13]. La spécificité de Tirole est de proposer, comme il l’avait fait il y a une dizaine d’années[14], un système «pollueur-payeur»: une taxe serait due par l’entreprise sur chaque licenciement «en échange d’une diminution du rôle des instances judiciaires dans le processus de licenciement». Et, cerise sur le gâteau, un contrat de travail unique avec «augmentation progressive des droits des salariés». Là encore, on retrouve une obsession constante chez Tirole, qui est de rétablir le fonctionnement optimal des marchés, en l’occurrence celui du travail. Mais ce «marché» est parfaitement asymétrique et l’objectif est ici d’instituer une «taxe libératoire» avec laquelle l’employeur acquiert un droit illimité sur la gestion de l’emploi. Le projet de réforme du Code du travail promu par le gouvernement français se situe parfaitement dans cette logique.
La finance
En 2010, Jean Tirole a cosigné un livre où il tire les leçons de la crise financière[15]. La position commune des auteurs est résumée dans leur introduction. S’ils reconnaissent clairement que la crise financière justifie un «renforcement de la réglementation», ils assortissent cette déclaration de réserves et de mises en garde.
La première difficulté qu’ils rencontrent sur le chemin vers «une réglementation efficace» est qu’il faut «éviter les réactions excessives». On retrouve ici un thème récurrent chez Tirole[16]: la réglementation des banques devrait se borner à «transposer la gouvernance d’entreprise des entreprises non financières» plutôt que de vouloir les «punir dans le seul but de les rendre responsables de la crise». Certes il faut quand même réglementer ce qui ne l’est pas, augmenter les ratios prudentiels, mais «il est beaucoup moins clair que l’on doive, par exemple, imposer des modèles d’affaires au secteur bancaire».
Le second écueil possible est assez extraordinaire: les responsables politiques doivent «résister à la tentation de se montrer particulièrement sévères à l’égard des banques qui ont bénéficié d’un plan de sauvetage, par exemple en limitant leur capacité de payer leurs dirigeants au même tarif que leurs concurrents. Une telle mesure peut être contre-productive parce qu’elle implique un désavantage concurrentiel par rapport aux autres banques». L’idée ne vient évidemment pas à l’esprit de Tirole qu’il serait possible d’encadrer les rémunérations des dirigeants de toutes les banques, et il faut admirer comment la référence à la concurrence devient du coup un argument en faveur du statu quo.
Le troisième danger serait un effondrement des «services bancaires transnationaux». En effet, le sauvetage des banques a été financé par les budgets nationaux, et on leur demande ensuite de favoriser le crédit domestique. Pour les auteurs, cette tendance «pourrait conduire à la disparition du marché bancaire unique de l’Union européenne, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour le marché unique, en général, et donc pour la croissance économique et l’efficacité».
Le livre propose un récit assez affligeant de la crise financière, mais le message est clair: attention de ne pas trop réglementer la finance, sous peine de nous voir privés de ses bienfaits! Il se situe dans la lignée des travaux précédents de Tirole, et il faut ici citer le communiqué d’Attac[17] au lendemain de la remise du «prix Nobel»: «Dans le domaine de la finance, Tirole s’est illustré par une approche – fondée sur la théorie des jeux et de l’information – selon laquelle la stabilité des marchés peut être obtenue par la transparence de l’information et la concurrence sur les marchés. Ignorant le caractère fondamentalement instable des marchés, Jean Tirole a cautionné les politiques de dérégulation financière et encouragé les autorités de régulation à négliger la nécessité d’une régulation globale de la finance. Le caractère global et systémique de la crise a montré qu’il s’agissait là d’une erreur tragique, démontrant par là le caractère inadapté et dangereux des analyses de Jean Tirole et du courant de pensée qu’il représente: un néolibéralisme dogmatique pour lequel la fonction économique essentielle de l’État est d’étendre la logique des marchés à l’ensemble des domaines de la vie sociale».
Le prix du carbone
Tirole, en association avec Christian Gollier (lui aussi membre de la «Toulouse School of Economics»), a saisi l’occasion d’intervenir dans le débat préliminaire à la COP21, avec toujours le même principe: des incitations publiques correctement calibrées peuvent corriger toute imperfection du marché, et le rétablir dans sa majesté. La solution idéale serait alors, dans le cas du réchauffement climatique, une taxe carbone mondiale uniforme. Mais, comme «elle reste difficile à faire accepter», il faudrait se rabattre sur «la mise en place d’un marché d’émissions» qui serait «la solution la plus pertinente»[18].
Cette position simpliste oublie les controverses et les expériences, et ne tient aucun compte de l’applicabilité de ces mesures. Un spécialiste de l’économie de l’énergie, comme Dominique Finon qui travaille depuis de longues années sur ces questions, se demande si ces apprentis vivent «dans le monde réel» et leur rappelle qu’il existe «une branche de notre discipline qui s’appelle l’économie politique»[19].
Dans une tribune, Finon oppose cet argument simple à la proposition de Tirole: «on ne peut rêver d’un prix unique pour la simple raison que les pays ont des niveaux de développement très différents et que l’utilité économique d’un $ supplémentaire est très différente entre l’Américain ou l’Européen moyen et un ouvrier indien»[20]. Bref, «nos grands économistes oublient ce type de problème théorique où il faut marier efficience et équité» et ils devraient donc s’abstenir «de lancer leurs grandes idées pour se faire plaisir».
Olivier Godard[21], un autre spécialiste du domaine, développe la même critique: «La condition pour qu’un prix mondial unique du carbone maximise le bien-être mondial est l’effacement complet des inégalités économiques de développement». Mais «ce n’est pas à l’ordre du jour de la COP 21» et, dans ces conditions, «imposer une tarification unique à l’émission de gaz à effet de serre provoquerait alors des inefficacités et des injustices majeures».
Tirole se situe dans la lignée de Gary Becker (1930-2014), qui a lui aussi reçu le «prix Nobel» en 1992. Gary Becker est un des créateurs de la théorie du «capital humain» dans sa version la plus réactionnaire[22]. Elle explique par exemple les différences de salaires par des différences de productivité qui résultent elles-mêmes des différences d’investissement en capital humain: l’individu qui n’a pas investi en années d’études pâtit donc d’un «rendement» inférieur.
Plus généralement, la démarche de Gary Becker consiste à appliquer l’analyse économique à tous les aspects de la vie sociale, et notamment le crime et la famille. Pour lui, les comportements des individus s’expliquent toujours par un calcul. Ainsi l’amour des parents pour leurs enfants s’explique parce que ces derniers représentent une sorte d’assurance vieillesse pour leurs vieux jours. Et si l’amour ne suffit pas, reste la culpabilisation. C’est pourquoi la sécurité sociale menace la famille en supprimant cette raison d’aimer ses enfants ou, en tout cas, d’agir de façon altruiste à leur égard.
Dans une chronique pour Business Week, Becker combat l’idée d’une augmentation du salaire minimum et conclut ainsi: «Même un magicien aurait de grosses difficultés à repousser la loi économique selon laquelle un salaire minimum plus élevé réduit l’emploi». Tout ceci est bien connu, mais Gary Becker va plus loin et, ans une autre tribune, pousse le raisonnement jusqu’au bout: «Nous pourrions exempter les jeunes gens des lois sur le salaire minimum. Ces lois éliminent les jeunes non qualifiés du marché du travail et augmentent leur taux de chômage. A son tour, ce chômage incite les jeunes à s’engager sur la voie du crime, et particulièrement des crimes contre la propriété»[23].
La moralité et l’éthique
La filiation avec Gary Becker est particulièrement nette à propos d’une question essentielle: la vente d’organes. Dans un article publié en 2007[24], Gary Becker et Julio Jorge Elías évaluaient le prix d’un rein à 15 200 dollars, et celui d’un foie à 37 600 dollars. Ces estimations «peuvent sembler faibles», admettaient les auteurs. Mais leurs résultats étaient fondés sur quatre facteurs: «la valeur de la vie évaluée à 5 millions de dollars par la recherche économique sur la propension des individus à prendre des risques; le faible risque de mortalité associé au don d’un rein ou d’un foie; l’amélioration attendue de la qualité de la vie; la courte période de récupération».
L’argument de Becker est alors de dire que l’interdiction de vendre son rein aurait condamné chaque année «des milliers de personnes aux États-Unis à mourir faute de donneurs». On ne peut donc «se targuer de moralité quand on est contre le commerce des organes» puisque cet idéal de moralité est «coupable de la mort des malades en demande d’organes».
Tirole a pris une position très claire sur cette question qui semble le préoccuper particulièrement, lors d’un débat après une communication à l’Académie des Sciences morales et politiques, le 21 novembre 2011[25]. A la question lui demandant ce que «pense l’économiste de la rémunération du don d’organes», Tirole a répondu ceci: «Bien entendu, on désapprouve le commerce clandestin qui peut avoir des conséquences économiques ou sociales très néfastes. Dans l’hypothèse d’école où l’on pourrait instituer un commerce bien contrôlé des organes en offrant une somme d’argent importante à des gens du tiers-monde, il est certain que des réticences se manifesteraient toujours, alors qu’il s’agirait somme toute d’un accord commercial passé à la satisfaction des deux parties».
 L’idée dérangeante, pour Tirole, c’est que l’on puisse introduire des notions d’éthique dans ses petits calculs. Et il a une tête de turc: Michael Sandel, dont le livre, Ce que l’argent ne saurait acheter[26], obtient un succès international extraordinaire, même s’il n’a pas eu un grand impact en France. Sandel soulève deux objections majeures au marché: l’équité et la corruption, qu’il résume ainsi: «l’objection de l’équité revient à s’interroger sur l’inégalité que les choix marchands peuvent refléter; quant à l’objection de corruption, elle est centrée sur les attitudes et les normes que les relations marchandes sont susceptibles d’endommager ou de dissoudre».
L’idée dérangeante, pour Tirole, c’est que l’on puisse introduire des notions d’éthique dans ses petits calculs. Et il a une tête de turc: Michael Sandel, dont le livre, Ce que l’argent ne saurait acheter[26], obtient un succès international extraordinaire, même s’il n’a pas eu un grand impact en France. Sandel soulève deux objections majeures au marché: l’équité et la corruption, qu’il résume ainsi: «l’objection de l’équité revient à s’interroger sur l’inégalité que les choix marchands peuvent refléter; quant à l’objection de corruption, elle est centrée sur les attitudes et les normes que les relations marchandes sont susceptibles d’endommager ou de dissoudre».
Ce sont ces deux objections, et le sous-titre du livre de Sandel («Les limites morales du marché»), qui ont provoqué l’agacement de Tirole à tel point qu’il a consacré sa dernière conférence à l’Académie des Sciences morales et politiques à une critique de Sandel, nommément cité[27]. Le titre de la dissertation de Tirole est donc «La Moralité et le marché» et elle est très médiocre.
Tirole commence par reprocher à Sandel de méconnaître le «travail récent, voire plus ancien, des économistes (…): travaux sur l’économie de l’information et des externalités, qui couvrent des sujets aussi divers que la morale, l’éthique, les phénomènes d’éviction». Puis il revient sur la question des dons d’organe et s’interroge: «pourquoi sommes-nous gênés vis-à-vis du marché du don d’organes ou de la brevetabilité du vivant?». La réponse à cette question morale se trouve dans la théorie des incitations: cela revient à calculer le prix du rein qui va maximiser le nombre de donneurs, sans doute «en offrant une somme d’argent importante à des gens du tiers-monde» comme Tirole le disait plus clairement en 2011.
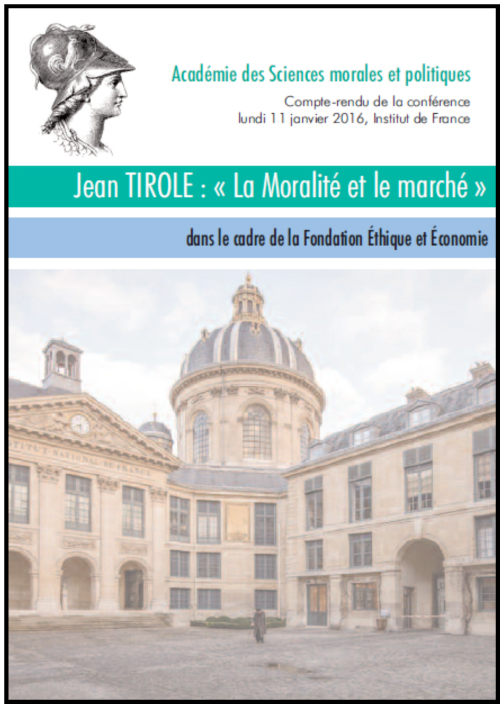 Suivent des affirmations baroques et pitoyables. Par exemple: «le marché est supposé libérer les acteurs du pouvoir de marché d’autres acteurs, et empêcher les entreprises puissantes d’imposer leur prix élevé et leurs qualités médiocres à des consommateurs captifs»; ou encore (citant Daron Acemoglu): «en soi, la cupidité n’est ni bonne ni mauvaise; lorsqu’elle est canalisée au service d’un comportement novateur, concurrentiel, et axé sur la maximisation des profits dans le cadre de lois et réglementations bien conçus, la cupidité peut servir de moteur à l’innovation et à la croissance économique». Et enfin: «une personne qui serait scandalisée par l’idée même de la prostitution ou de rémunération d’une compagnie peut néanmoins rester avec un époux ou une épouse qu’il ou elle n’aime plus par désir de sécurité financière ou par peur de la solitude».
Suivent des affirmations baroques et pitoyables. Par exemple: «le marché est supposé libérer les acteurs du pouvoir de marché d’autres acteurs, et empêcher les entreprises puissantes d’imposer leur prix élevé et leurs qualités médiocres à des consommateurs captifs»; ou encore (citant Daron Acemoglu): «en soi, la cupidité n’est ni bonne ni mauvaise; lorsqu’elle est canalisée au service d’un comportement novateur, concurrentiel, et axé sur la maximisation des profits dans le cadre de lois et réglementations bien conçus, la cupidité peut servir de moteur à l’innovation et à la croissance économique». Et enfin: «une personne qui serait scandalisée par l’idée même de la prostitution ou de rémunération d’une compagnie peut néanmoins rester avec un époux ou une épouse qu’il ou elle n’aime plus par désir de sécurité financière ou par peur de la solitude».
De manière générale, les exemples concrets donnés par Sandel n’apprennent rien à Tirole, ce ne sont que «des phénomènes de défaillances de marché, déjà mis en évidence par les économistes». Il faut trouver ses solutions, mais celle qui consiste à les sortir du marché n’est peut-être pas la meilleure. Et c’est au fond le fil directeur de Tirole: les valeurs éthiques peuvent être trompeuses et superficielles et doivent être confrontées aux mécanismes du marché plutôt qu’à la délibération démocratique.
Une petite entreprise qui ne connaît pas la crise
De manière très cohérente, Jean Tirole met en application ses principes théoriques dans le cadre de sa petite entreprise, Tirole Economie, qui a versé 319’000 euros de dividendes sur la période 2005-2010 à ses deux actionnaires: Jean Tirole (75 %) et Madame (25 %)[28]. Tirole n’est donc pas un pur esprit, qui n’hésite pas non plus à intervenir dans la lutte idéologique. Il sait défendre, bec et ongles, les prérogatives de son courant, comme l’a montré sa lettre à la secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Geneviève Fioraso[29]. Elle avait pour objet de la dissuader de créer une deuxième section d’économie dans les universités françaises. Pour Tirole, «ce serait une catastrophe pour la visibilité et l’avenir de la recherche en sciences économiques dans notre pays». Les arguments employés étaient très méprisants: en gros, ils suggéraient que les «autoproclamés “hétérodoxes”» sont des nuls, voire des «ratés» ou des «frustrés»[30], qui voudraient se soustraire au «jugement» de leurs «pairs», ce qui reviendrait, selon Tirole, à promouvoir, «le relativisme des connaissances, antichambre de l’obscurantisme». Et le projet sera finalement retiré, alors que la décision semblait avoir été prise.
De l’abstrait au concret
Ce passage en revue des «prix Nobel” français montre que la prétention des économistes dominants à faire de la science indépendamment de tout présupposé idéologique, est un leurre. Cette prétention explose lors de la remise du prix, comme si celle-ci libérait une parole longtemps contenue.
Le coming out des lauréats révèle ainsi les liens inextricables qui unissent la «science économique» officielle et l’apologie du système réellement existant. Ces travaux nous infligent une forme symbolique de torture, en nous plongeant «dans les eaux glacées du calcul égoïste». Et, pour continuer à citer Marx et Engels, la science économique bourgeoise «fait de la dignité personnelle une simple valeur d’échange».
____
[1] Il n’existe pas de «prix Nobel» d’économie, d’où les guillemets.
Voir: Gilles Dostaler, «Le “prix Nobel d’économie” : une habile mystification », Alternatives Economiques n° 238, juillet 2005.
[2] “Workmen it is said, are regularly robbed of what they produce. This is done within the forms of law, and by the natural working of competition. If this charge were proved, every right-minded man should become a socialist ; and his zeal in transforming the industrial system would then measure and express his sense of justice. If we are to test the charge, however, we must enter the realm of production. We must resolve the product of social industry into its component elements, in order to see whether the natural effect of competition is or is not to give to each producer the amount of wealth that he specifically brings into existence”.
The Distribution of Wealth. A Theory of Wages, Interest and Profit, p.7.
[3] voir le livre remarquable de Philip Mirowski, More heat than light, Cambridge University Press, 1989 ; traduction française: Plus de chaleur que de lumière, Economica, 2002.
[4] Gérard Debreu, «La supériorité du libéralisme est mathématiquement démontrée », Le Figaro Magazine, 10 mars 1984.
[5] Maurice Allais, «Les lignes directrices de mon oeuvre », Conférence Nobel, 9 décembre 1988.
[6] les citations sont tirées de Jean-Sébastien Lenfant, «Psychologie individuelle et stabilité d’un équilibre général concurrentiel dans le Traité d’économie pure de Maurice Allais », Revue économique, vol.56, n°4, juillet 2005.
[7] Maurice Allais, «La philosophie de ma vie », Revue d’économie politique, vol.99, n°1, 1989.
[8] cité par Henri Sterdyniak, «Itinéraire d’un économiste français », Revue d’économie politique, vol.121, n°2, 2011.
[9] Maurice Allais, «Des régularités extraordinaires et irréfragables dans les observations interférométriques de Dayton C. Miller, 1925-1926. L’effondrement radical et définitif de la Théorie de la relativité », La Jaune et la Rouge, n°588, octobre 2003.
[10] Emmanuel Buisson, «Que faire de Maurice Allais ? », 2005.
[11] source: Sterdyniak, article cité.
[12] Jean Tirole, «Intellectual Property and Health in Developing Countries », in A. Banerjee, R. Benabou and D. Mookherjee, eds., Understanding Poverty, Oxford University Press, 2006.
[13] Pierre Cahuc, Jean Tirole et alli, «Pour un Jobs Act à la française », Les Echos, 30 mars 2015.
[14] Olivier Blanchard et Jean Tirole, Protection de l’emploi et procédures de licenciement, rapport du Conseil d’analyse économique, 2003.
[15] Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole, Balancing The Banks. Global Lessons from the Financial Crisis, Princeton University Press, 2010
[16] Cette idée selon laquelle il n’y a pas de spécificité bancaire a été vigoureusement critiquée par l’ancien président de la Commission des marchés. Voir: Jean-Michel Naulot: «Jean Tirole et la finance: la théorie à l’épreuve de l’expérience », L’Economie politique n° 65.
[17] Attac, «”Prix nobel” d’économie : des cocoricos déplacés », 13 octobre 2014.
[18] Christian Gollier et Jean Tirole, «Pour un accord efficace sur le climat », Le Monde, 4 juin 2015.
[19] cité par Sylvestre Huet, «Les scientifiques chauffent la salle avant la COP 21 », Libération, 6 juillet 2015.
[20] Dominique Finon, «A quoi peuvent servir les économistes pour préparer l’accord climat de Paris ? », 7 juillet 2015.
[21] Olivier Godard, «Un prix mondial unique pour le carbone ? Une fausse bonne idée », Cepii, 8 octobre 2015.
[22] Gary Becker, Human Capital. A theoretical and empirical analysis, 3ème édition, 1993 [1964]
[23] Gary Becker, Deux articles sur le salaire minimum et le crime, Business Week, 1995
[24] Gary Becker & Julio Jorge Elías, «Introducing incentives in the market for live and cadaveric organ donations », Journal of Economic Perspectives, vol.21, n°3, summer 2007
[25] Jean Tirole, Questions-réponses, Académie des Sciences morales et politiques, 21 novembre 2011
[26] Michael Sandel, What Money Can’t Buy. The Moral Limits of Markets, 2012 ; traduction française: Ce que l’argent ne saurait acheter. Les limites morales du marché, Le Seuil, 2014
[27] Jean Tirole, «La Moralité et le marché», Académie des Sciences morales et politiques, 11 janvier 2016.
[28] Frédéric Dessort, «Les bonnes affaires du prix Nobel d’économie», Marianne, 3 juillet 2015.
[29] Jean Tirole, Lettre à Geneviève Fioraso, décembre 2014.
[30] Ce sont les termes employés par d’autres opposants (anonymes) au projet, et rapportés par Marie-Estelle Pech, «Universités: guerre ouverte chez les profs d’économie», Le Figaro, 4 janvier 2015.


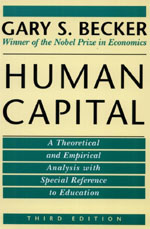
J’ai du respect pour l’auteur de cette contribution, en revanche je ne comprends pas son enthousiasme pour l’ouvrage de Mirowski. En effet, ce dernier avale les critiques spécieuses du sraffien Steedman à la théorie de la valeur, que l’auteur lui-même a brillamment réfutées sous un pseudonyme il y a plus de 30 ans.
De plus, Mirowski se révèle un admirateur de Georgescu-Roegen, auteur réactionnaire qui professait qu’il y aura toujours des dominateurs et des dominés dans toute société humaine.
Mirowski est en revanche intéressant, à première vue, pour l’histoire des sciences. Mais un autre aspect est les conclusions de son analyse descriptive, remarquable, de l’histoire du néolibéralisme qu’il faut certes comprendre pour le comprendre. Mais sa dite hégémonie – qui est contestée aujourd’hui au plan théorique et pratique (socio-politique) avec plus de force que dans les années 1990 – renvoie à autre chose que son histoire «théorique» et intellectuelle et des liens intriqués avec la science et l’économie néoclassique qui fait prendre la réalité des rapports sociaux effectifs comme étant en quelque sorte dictée par cette théorie; avec les implications politiques qui en découlent: une sorte de monstre imbattable, sur le fond, depuis la «défaite du keynésianisme». Le cours effectif du capitalisme auquel on assiste consiste à remettre au point cela et à poser des questions portant sur «un mouvement ouvrier» quasi détruit (et dont les sommets sont cooptés par les grandes transnationales et leurs relais institutionnels et non pas seulement par la bureaucratie d’appareil et de pouvoir institutionnel).
Post-scriptum. On pourrait citer, pour faire exemple, ces passages de Georgescu-Roegen, admiré sous un certain angle par Mirowski. Et ce commentaire: «… like Marx, I believe that the social conflict is not a mere creation of man without any root in material human conditions. But unlike Marx, I consider that, precisely because the conflict has such a basis, it can be eliminated neither by man’s decision to do so nor by the social evolution of mankind…»
When man (some men) attempts to radically change the distribution of access to material resources in society, this may result in wars or revolutions, Georgescu admits. But even though wars and revolutions may bring about the intended redistributions, man’s economic struggle and the social conflict will remain. There will be rulers and ruled in any social order, and the ruling is largely a continuation of the biological struggle of sustaining life and survive, Georgescu claims.
Under these material conditions, the ruling classes of past and present have always resorted to force, ideology and manipulation to defend their privileges and maintain the acquiescence of the ruled. This historical fact does not end with communism, Georgescu points out; quite the contrary, it goes on during communism, and beyond it as well. It would be against man’s biological nature to organise himself otherwise.» Voir Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process (Harvard University Press, 450 pages, 1971, 1ère édition)