David Mandel met au centre de son travail nourri de très nombreux extraits de souvenirs de militants, de résolutions de soviets et de comités d’usine la question vitale de l’indépendance de classe posée avec une insistance croissante par les ouvriers et les ouvrières de la capitale. Son livre met en évidence le conflit de plus en plus vif qui dresse les ouvriers de Petrograd, le cœur ouvrier de la Russie, à cette époque, contre la bourgeoisie industrielle et financière et le pouvoir qu’elle exerce à travers le gouvernement provisoire présidé par le prince Lvov, grand propriétaire terrien, d’abord puis par l’avocat socialiste Alexandre Kerenski.
Les ouvriers de Petrograd, comme le souligne David Mandel, avaient gardé en mémoire le lock-out massif déclenché par les grands patrons à la fin de 1905 pour briser la révolution montante et sauver le régime tsariste menacé. L’antagonisme brutal entre les deux classes s’était manifesté à nouveau à dater de l’écrasement des grévistes de la Lena Goldfield en avril 1912. David Mandel cite un épisode qui en souligne l’ampleur autant ou plus encore que les grèves qui secouent la capitale en juillet 1914 et les barricades qui s’élèvent dans les rues de la ville: «un arrêt de travail de 102 jours à l’usine de construction mécanique Lessner, une grève déclenchée suite au suicide d’un ouvrier juif, amené au désespoir par les railleries d’un contremaître» (p. 37).
La confiance s’effrite
Cet antagonisme réapparaît brutalement dès que la grève des ouvrières du textile de Vyborg le 23 février (8 mars) 1917 déclenche le mouvement de protestation qui balaie le régime autocratique englué dans la guerre. David Mandel étudie minutieusement les diverses couches de la classe ouvrière de Petrograd et leur évolution rapide au cours des mois. Alors que les ouvriers et les ouvrières détestent les bourgeois et leurs représentants politiques, les dirigeants du soviet de Petrograd (mencheviks et socialistes-révolutionnaires), auxquels ces ouvriers et ouvrières manifestent au début leur confiance, s’acharnent d’abord à remettre le pouvoir aux hommes politiques de cette bourgeoise puis à collaborer avec eux dans un gouvernement qui poursuit une guerre de plus en plus rejetée par eux et par une masse croissante de soldats. C’est la «politique conciliatrice» qui tente de concilier des intérêts de classe profondément antagonistes au nom de la volonté de confier le pouvoir à la bourgeoisie jugée seule légitime pour l’exercer.
La confiance initiale de la masse des ouvriers dans les dirigeants mencheviks et socialistes-révolutionnaires s’effrite au fil des semaines et cet effritement se traduit par l’influence croissante des bolcheviks. Il est aisé d’en mesurer l’ampleur. David Mandel le rappelle en effet: «Les ouvriers révoquaient souvent leurs délégués aux soviets et aux comités d’usine.» (p. 17) Il en donne de nombreux exemples. Ainsi souligne-t-il plus loin: «Dans certaines usines les ouvriers élisaient leurs comités d’usine à répétition dans le vain espoir de voir leurs revendications satisfaites» (p. 515) en affirmant leur volonté tenace.
La multiplicité de ces exemples suffit à réfuter l’affirmation de certains [1] selon laquelle à la «bureaucratisation par en haut» se serait ajoutée dès avril 1917 une bureaucratisation par en bas due à l’élection de délégués plus ou moins inamovibles… en réalité soumis plusieurs fois à réélection entre mars et octobre 1917. Or toute bureaucratie suppose à la fois la permanence des fonctions et un lot plus ou moins grand de privilèges. Les délégués révocables élus aux soviets, aux comités d’usines et même dans les syndicats ne bénéficiaient ni des uns ni des autres.
L’abîme se creuse entre le prolétariat et ses représentants au soviet
David Mandel éclaire le mécanisme qui mène de la révolution de février à celle d’octobre. Jusqu’en juillet 1917 la majorité des ouvriers et des ouvrières de Petrograd, animés, je le répète, par une profonde hostilité à l’égard des classes possédantes, accordent toute leur confiance aux dirigeants du soviet qui s’acharnent à maintenir l’alliance avec les représentants de ces classes et donc, dans la réalité, la subordination à ces dernières. Le rejet croissant de la politique impulsée par les dites classes pousse le prolétariat de la capitale à se prononcer pour que les dirigeants du soviet, qui ne le veulent pas, assument le pouvoir à eux seuls. D’où les manifestations monstres des 3 et 4 juillet 1917 à Petrograd, pour le transfert du pouvoir aux soviets, qui n’aboutissent pas.
Plus se creuse l’abîme entre ce que réclament ouvriers, ouvrières et soldats et ce que font ceux en qui ils ont depuis février vu leurs représentants et plus la solution paraît inéluctablement relever de la violence. Elle peut être verbale. Ainsi le 12 juillet 1917 les Izvestia, organe du Comité exécutif central des soviets qui soutient le gouvernement provisoire, écrit: «Les bolcheviks sont les amis de Nicolas[II] et de Guillaume», à la fois donc du tsar déchu et du kaiser en place, doublement traîtres donc parce qu’ils réclament la paix et le transfert de tout le pouvoir aux soviets, c’est-à-dire aux organes représentant les seules couches populaires (les ouvriers, les paysans et les soldats). On ne saurait mieux dire que l’affrontement est inéluctable. David Mandel rappelle que lors des manifestations de juillet, dénoncées par les dirigeants mencheviks et socialistes-révolutionnaires comme une insurrection bolchevique, le commandement de la petite ville ouvrière de Sestroretsk où le Soviet fait la loi a reçu une mission pacificatrice très virile: «Une véritable opération militaire a été montée incluant quelques centaines de cosaques, des junkers et six camions blindés. Le commandant a eu l’autorisation de faire feu contre toute résistance et, si nécessaire, de raser la ville (…). Les troupes ont fouillé sans distinction toutes les maisons ouvrières et mis à sac les locaux des organisations ouvrières et du Parti bolchevique. Elles sont reparties avec tous les membres du comité de l’usine locale placés aux arrêts.» (p. 242)
L’affrontement est inéluctable
La violence peut prendre d’autres formes comme le lock-out des usines par les patrons ou la mise en place d’un plan de transfert d’usines de Petrograd (et seulement d’une partie de leurs ouvriers) loin de la capitale. «Vers la fin du mois d’août, rappelle David Mandel, on a rendu publique une liste de 47 usines à évacuer en priorité. S’y trouvaient toutes les usines de l’Etat, la plupart des grandes entreprises métallurgiques privées et un certain nombre d’usines chimiques. Pour ajouter l’insulte à l’injure, seule une petite partie des ouvriers employés dans ces usines devaient les suivre vers leur nouvel emplacement. Les autres devaient être licenciés avec deux semaines de salaire d’indemnité. Par contre l’Etat allait prendre en charge tous les coûts des transferts des usines privées.» (p. 261) Cette véritable déclaration de guerre contre les ouvriers et les ouvrières de la capitale avait l’accord des socialistes dits modérés, dont le ministre du travail Skobelev, qui avait déclaré en juillet: «Mitrailleuses et baïonnettes sont souvent le meilleur argument.»
L’aspiration à un gouvernement responsable devant les soviets
Au lendemain de 2e congrès des soviets et de l’insurrection d’octobre, contre le Conseil des commissaires du peuple, les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires proposent un«gouvernement socialiste homogène». Les deux partis conciliateurs non seulement veulent que les bolcheviks soient minoritaires dans ce gouvernement socialiste homogène qu’ils proposent, mais ils se refusent absolument qu’il soit responsable devant le Comité exécutif central des soviets. Or souligne David Mandel: «Les bolcheviks, y compris Lénine et Trotsky, qui étaient les dirigeants de l’aile gauche du parti, n’insistaient pas sur un gouvernement exclusivement bolchevik (…). D’un autre côté le Parti bolchevique ne voulait rien concéder quant au principe même du pouvoir des soviets, à savoir un gouvernement formé par les soviets et responsables devant eux.» (p. 403) David Mandel signale un éditorial du quotidien menchevique de gauche, Novaia Jizn, dirigé par l’écrivain Maxime Gorki et hostile au gouvernement bolchevik. Selon cet éditorial: «Dans certaines usines les assemblées ouvrières adoptaient des résolutions appelant à une coalition de tous les partis socialistes tout en insistant pour que cette coalition soit responsable devant le nouveau Tsik [2], élu par le deuxième congrès des soviets.» Or si les partis dits conciliateurs, c’est-à-dire favorables à une alliance étroite avec la bourgeoisie industrielle et financière bourgeoise dont ils jugent le pouvoir indispensable et légitime, utilisaient l’aspiration profonde à l’unité des partis soviétiques forte dans le prolétariat, David Mandel précise que «les ouvriers qui se prononçaient en faveur d’une coalition socialiste voyaient celle-ci comme un gouvernement de coalition responsable devant les soviets» (p. 404).
Forte adhésion des ouvrières au gouvernement bolchevique
C’est parce qu’ils s’appuient sur cette volonté quasi unanime du prolétariat de la capitale que les bolcheviks se maintiennent au pouvoir malgré le sabotage organisé par leurs adversaires qui réduit les premiers décrets du nouveau pouvoir à des déclarations d’intention sans effet réel. Pour le moment. Détail significatif, souligne David Mandel: «Il est particulièrement frappant de voir que le nouveau gouvernement suscitait une forte adhésion chez les ouvrières, alors qu’en général elles avaient été les dernières en 1917 à adopter la revendication du pouvoir aux soviets.» Ainsi: «A la fin octobre 1917, les délégués des ouvriers du textile sont même entrés en conflit avec l’exécutif de leur syndicat, suite au refus de celui-ci d’accorder son soutien complet au nouveau gouvernement.» (p. 415) Et la direction du syndicat s’inclinera devant la volonté de la base. Ainsi s’explique que le nouveau gouvernement ait pu, les années suivantes, surmonter le sabotage, la famine, la contre-révolution armée et l’intervention des détachements de la bourgeoisie européenne, américaine et japonaise. (Article publié dans La Tribune des travailleurs)
____
[1] Avancée par Marc Ferro dans son Histoire de la révolution russe publié en 1976, affirmation aujourd’hui très à la mode. et reprise en particulier par Olivier Besancenot dans son essai Que faire de 1917?.
[2] Tsik: Comité exécutif central des soviets.

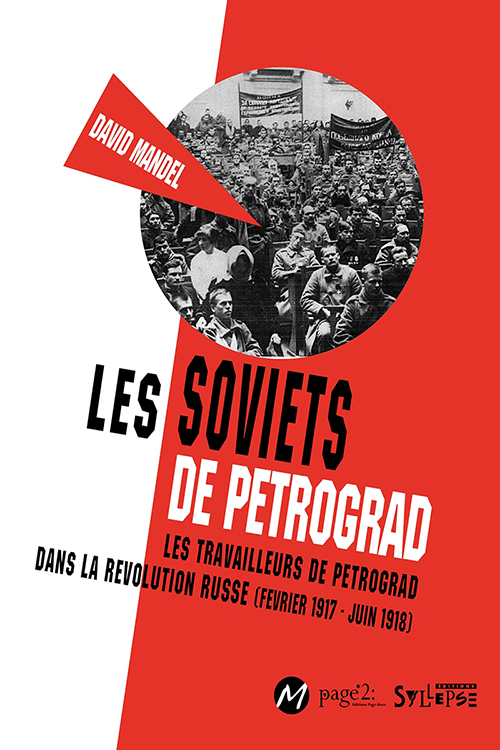
Soyez le premier à commenter