
Entretien avec Ziad Majed
Alors que le scrutin présidentiel prévu pour le 3 juin en Syrie s’apparente à une mascarade démocratique dans un pays en proie à des violences extrêmes, que sait-on vraiment de la société syrienne? Chercheur et politologue libanais, Ziad Majed a publié un essai offrant un éclairage sur cette Syrie de l’intérieur: Syrie, la révolution orpheline, Actes Sud, 2014. L’entretien ci-dessous a été conduit pour Amnesty International par Aurélie Carton.
Jusqu’à la révolution de mars 2011, vous écrivez que la société syrienne était «invisible», comment l’expliquez-vous?
Cet «effacement» de la société syrienne remonte aux années 1970. Le président Hafez al Assad a construit ce qu’il a lui-même appelé la «Syrie d’Assad» en occultant la société. Toute la relation au monde extérieur était centrée sur le rôle de Damas dans la région, les enjeux stratégiques, les alliances, la géopolitique, en faisant oublier les visages des Syriens et Syriennes. Dans les années 1950 et 1960, il existait une créativité artistique et intellectuelle riche dans le pays, mais sous Assad, nombre de ces figures de proue sont parties en exil, en prison ou ont opté pour le silence par crainte des représailles.
Puis l’état d’urgence, imposé dès 1963 par le parti Baas et renforcé à partir de 1976, a interdit toute création d’associations ou de partis politiques. La société a été complètement encadrée. On devait adhérer aux scouts du Baas, à la ligue étudiante du Baas, pour trouver un emploi dans le secteur public, il fallait être membre du Baas… Cet écrasement de la société civile a eu des conséquences terribles, dont cette opacité de la société.
Le soulèvement populaire a-t-il permis de rompre avec cette opacité et d’ouvrir cette «boîte noire» selon l’expression de l’ancien prisonnier politique Yassin al-Haj?
Oui, les Syriens et Syriennes eux-mêmes ont été surpris de découvrir leur propre société, la détermination de leurs concitoyens, leur créativité. C’était une découverte également pour les observateurs extérieurs. La dictature avait imposé aux gens une certaine solitude. L’absence d’espaces publics conjuguée avec le sentiment d’être tout le temps observé par un agent du pouvoir et à la méfiance entre communautés confessionnelles, tout cela a créé une société où les individus avaient peur les uns des autres et se retrouvaient isolés.
Avant même le début de la Révolution, avec l’arrivée d’Internet, la censure du régime était devenue plus difficile. Le soulèvement populaire, en mars 2011, a détruit le mur de la peur. La reprise de la parole s’est traduite alors par une profusion de slogans, de dessins, de chansons politiques, créant une sorte d’émulation, voire de compétition sur le terrain et dans l’espace virtuel. L’humour est devenu une arme de résistance et un outil de déconstruction de l’image du dictateur. Un travail clandestin de recensement des exactions s’est mis en place dans lequel les femmes ont joué un rôle de premier plan, même si aujourd’hui, avec la militarisation de la Révolution, elles se retrouvent davantage dans un rôle humanitaire de soutien.
On ne parle pas suffisamment de cet aspect-là. Une avocate comme Razan Zaitouneh [1], par exemple, a dirigé un centre de documentation des violations des droits de l’Homme, devenu une référence et disposant d’une base avec une dizaine de milliers de noms de victimes tuées par le régime ou détenus dans ses geôles.
Au sein de l’opposition armée, on a assisté à une montée en puissance des forces islamistes. Ont-elles une base sociale?
Oui, on ne peut le nier. La destruction du champ politique syrien a favorisé les mosquées comme lieux de rencontres. Après avoir éradiqué les Frères musulmans dans les années 1980, Assad père, soucieux de montrer qu’il avait des alliés dans le champ religieux, a encouragé un salafisme quiétiste. On a pu observer la montée d’un conservatisme social. Au début de la Révolution, plusieurs manifestations partaient des mosquées où les gens trouvaient refuge, se connaissaient, pouvaient se faire confiance. Avant de sortir et de risquer d’être arrêté, torturé, tué, on crie «Allah Akbar» pour se donner du courage.
Avec la militarisation de la Révolution, à partir de l’automne 2011, c’est devenu une force psychologique pour combattre les chars et les avions du régime. Aujourd’hui, alors que l’on compte environ 150’000 morts, un slogan résonne dans les funérailles: «On n’a que toi ô Dieu!». L’islam est donc de plus en plus présent dans la terminologie comme dans les mentalités. Il faut noter que parmi les premiers groupes constitués qui ont pris les armes contre le régime, certains n’étaient pas nécessairement islamistes. Mais les brigades affirmant haut et fort leur affiliation avec l’islam recevaient une manne du Qatar, d’Arabie saoudite et des réseaux non gouvernementaux salafistes.
Alors qu’en revanche, les combattants de l’Armée syrienne libre (ASL) ou des brigades indépendantes se heurtaient aux valses hésitations de l’Occident.
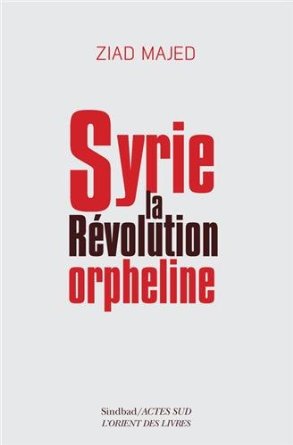 Comment sont arrivés les djihadistes?
Comment sont arrivés les djihadistes?
Il faut différencier les islamistes syriens et les djihadistes. Les premiers combattent d’abord le régime d’Assad et font partie de la Révolution même s’ils ont leur propre agenda pour le futur du pays. Certains sont radicaux d’un point de vue idéologique, mais ils ne peuvent se distinguer complètement du tissu social national. En revanche, les djihadistes, arrivés en Syrie à la fin 2012, n’ont rien à voir avec le combat révolutionnaire. Ils poursuivent leur expérience irakienne et leur combat ne s’inscrit ni dans la territorialité ni dans la temporalité syrienne.
Un groupe comme l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL) regarde bien au-delà de la Syrie et lutte prioritairement contre les autres groupes de l’opposition qu’ils soient de l’Armée libre ou islamistes. La cause du «djihad» qu’il porte existait avant la révolution en Syrie et continuera après, là où les conditions le permettent. Ce djihadisme est donc transnational. Beaucoup de ses adeptes viennent d’Irak, du Maghreb, des pays du Golfe et d’Europe… Aujourd’hui encore le régime d’Assad épargne les positions de ces djihadistes dans le gouvernorat de Raqqa (Nord-Est) qu’ils contrôlent, alors qu’il bombarde les habitations et les infrastructures civiles dans la région.
On est passé d’une sous-exposition de la réalité syrienne à une multiplication d’images atroces sur YouTube. Que vous inspire cette évolution?
Au début de la Révolution, les médias extérieurs étant absents, certains révolutionnaires se sont transformés en citoyens-journalistes et ont filmé par leurs propres moyens les manifestations et les évènements autour d’eux. Après la militarisation, on trouvait des smartphones de soldats morts sur lesquels étaient récupérés des photos et des films. Il y a également la récente exfiltration de 54’000 photos de 11’000 personnes tuées sous la torture dans les prisons d’Assad. Ces photos, selon des juges et des experts, sont authentiques et constituent un élément important pour la justice internationale. Dans la guerre syrienne, on voit souvent les visages des tueurs. Certes, tout cela permet l’archivage et la préservation d’une mémoire, mais risque aussi de rendre plus difficile la guérison voire la réconciliation de demain. (3 juin 2014)
[1] Razan Zaitouneh, née en 1977, est une avocate syrienne qui a participé à la création du «Centre de documentation des violations des droits de l’homme». Elle a mené cette action dès 2001. Dès 2002, elle ne peut plus sortir du pays. Dès 2011 elle est contrainte à la clandestinité. Elle a reçu en 2011 le Prix Anna Politkovskaya pour la défense des Droits de l’Homme. Le 9 décembre 2013, elle a été enlevée avec ses collègues Samira Al-Khalil, Waël Hamadé et Nazim Hamadi, à Douma, une ville sous contrôle rebelle proche de Damas. (Rédaction A l’Encontre)

Soyez le premier à commenter