Bien que les événements d’Egypte puissent ne plus figurer en page de couverture des journaux, la discussion de l’après-Moubarak continue de figurer en bonne place dans les nouvelles financières [en fin mai 2011].
Ces dernières semaines, la direction que prend en matière économique le gouvernement intérimaire égyptien a fait l’objet d’un intense débat à la Banque mondiale (BM), au Fonds monétaire international (FMI) et à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Le président Obama a consacré une grande partie de son discours du 19 mai 2011 sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la question du futur économique de l’Egypte – en fait la seule politique concrète proposée dans son discours avait trait aux relations économiques des Etats-Unis avec l’Egypte.
La réunion du G8 en France qui s’est tenue à fin mai 2011 [26-27 mai à Deauville] a continué dans la même voie en annonçant que jusqu’à 20 milliards dollars seraient offerts à l’Egypte et la Tunisie. Si on inclut dans ces chiffres ce que vont apporter les Etats du Golfe, l’Egypte à elle seule apparaît comme étant sur le point de recevoir environ 15 milliards de dollars en prêts, investissements, et aide de la part des gouvernements et des principales institutions financières (IFI/Institutions financières internationales).
Les communiqués de presse qui ont accompagné l’annonce de ces paquets financiers ont évoqué de manière prétentieuse «la transition vers la démocratie et la liberté» ce qui escamote commodément, comme plusieurs analystes l’ont fait remarquer, le soutien passé des gouvernements occidentaux aux dictateurs déposés de Tunisie et d’Egypte.
Le présent article se donne pour objectif d’expliquer néanmoins qu’une critique de ces paquets financiers doit être envisagée comme beaucoup plus que seulement une illustration supplémentaire de l’hypocrisie occidentale. La pléthore d’initiatives d’aide et d’investissement avancée récemment par les puissances dominantes représente une tentative consciente de consolider et renforcer le pouvoir de la classe dominante de l’Egypte face aux mobilisations populaires qui continuent. En d’autres termes, elles représentent un effort soutenu pour contenir la révolution dans les limites d’une «transition ordonnée» – pour emprunter l’expression perspicace que le gouvernement de Washington a employée de façon répétée à la suite du renversement de Moubarak.
Au cœur de cette intervention financière en Egypte, il y a une tentative d’accélérer le programme néolibéral poursuivi par le régime Moubarak. Les paquets financiers des IFI promeuvent ostensiblement des mesures comme «la création d’emplois», «l’expansion des infrastructures» et d’autres objectifs qui paraissent louables. Mais en réalité, elles sont basées sur les politiques néolibérales classiques de privatisation, de dérégulation et d’ouverture aux investissements étrangers (IDE). Malgré la prétention d’une transition démocratique, les institutions de l’Etat égyptien sont refaçonnées selon cette démarche néolibérale comme un mécanisme de fonctionnement du marché. Sous plusieurs rapports, l’Egypte prend la forme du parfait laboratoire du soi-disant Consensus de Washington qui voit une rhétorique aux allures de gauche et « favorable aux pauvres » – liée principalement au discours de la démocratisation – exploitée pour approfondir la trajectoire néolibérale de l’ère Moubarak. Si ça réussit, le résultat probable – particulièrement au vu de la mobilisation politique accrue et des attentes insatisfaites du peuple égyptien – en sera une société qui à un niveau superficiel prendra quelques apparences limitées d’une démocratie libérale mais, dans les faits, restera un Etat néolibéral fortement autoritaire dominé par une alliance des élites militaires et des affaires.
«Accélérer les réformes économiques structurelles»
Le point le plus important à remarquer à propos des paquets d’aide promis à l’Egypte est qu’ils ne représentent en aucune manière une rupture par rapport à la logique sur laquelle reposent les stratégies économiques antérieures pour la région. Dans un rapport pour le Sommet du G8, le FMI a résumé clairement cette logique quand il écrivait:
« Surmonter le fort chômage va nécessiter une augmentation substantielle du rythme de la croissance économique… Atteindre une telle croissance va nécessiter à la fois des investissements additionnels et une productivité améliorée. Si quelques augmentations de l’investissement public peuvent être nécessaires, par exemple pour améliorer la qualité de l’infrastructure et des services dans les régions rurales moins développées, le rôle clé va devoir être joué par le secteur privé, y compris en attirant de l’investissement étranger direct. C’est pourquoi les politiques gouvernementales devraient favoriser un environnement facilitant la prospérité du secteur privé.»
L’idée centrale exprimée dans cette déclaration est essentiellement le même message que le FMI et la Banque mondiale ont propagé durant des décennies de rapports sur les économies de l’Egypte et du Moyen-Orient: les problèmes de l’Egypte proviennent de la faiblesse du secteur privé et de la «recherche d’une rente» par les fonctionnaires de l’Etat. La solution consiste : à ouvrir au monde extérieur les marchés de l’Egypte; à lever les restrictions à l’investissement dans des secteurs clés de l’économie; à libéraliser les lois sur la propriété; à abolir les subventions aux pauvres pour la nourriture et d’autres biens de première nécessité; et à accroître la concurrence sur le marché. En permettant à des marchés sans entraves d’opérer librement, le secteur privé sera le moteur-clé de la croissance. Grâce à cette mobilisation de l’initiative entrepreneuriale, cela conduira à la création d’emplois et à la prospérité.
Bien sûr, ces idées sont simplement une répétition des principes de base du néolibéralisme, mais il est impératif de reconnaître la continuité avec les plans antérieurs: l’aide promise à l’Egypte vise consciemment à atteindre un résultat spécifique dans la même ligne que la stratégie néolibérale antérieure. Les implications politiques concrètes de cela ont été formulées le plus clairement dans un rapport étendard de la Banque mondiale publié en 2009, Du privilège à la concurrence: Libérer la croissance impulsée par le privé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Le rapport prescrit des mesures que doivent appliquer tous les gouvernements au Moyen-Orient, dont:
«1° Ouvrir des secteurs protégés tels que le commerce de détail et l’immobilier, qui ont des barrières contre les investisseurs étrangers…; 2° réduire les taxes à l’importation et les barrières non tarifaires [limitations autres que les droits de douane : contingentements formalités administratives, etc.]; 3° lever la protection des entreprises étatiques en imposant des contraintes budgétaires sévères et en les exposant à la concurrence ouverte; 4° éliminer le biais anti-exportation.» Dans le but d’encourager les investissements étrangers, les gouvernements devraient éliminer «les exigences élevées de capital minimum et les restrictions à la propriété des étrangers» et, dans les pays où existent des banques propriété d’Etat «engager une privatisation ouverte et transparente».
Voilà les types de politiques que nous pouvons nous attendre à voir appliquer en Egypte avec l’arrivée de cette aide. En fait, ce sont les conditions préalables fondamentales pour la concession de cet appui financier. Les mécanismes de cette conditionnalité sont discutés plus loin; pour le moment, limitons-nous à remarquer qu’il y a un lien inattaquable qui a été établi entre l’aide et la réalisation de réformes néo-libérales. Comme l’Institut de la Finance Internationale (IIF en anglais), une organisation d’élaboration et de lobbying qui réunit les plus grandes institutions financières du monde, l’a remarqué début mai 2011:
«Aussi considérables que puissent être les actuels défis de restructuration sécuritaire et politique, il est absolument critique que les autorités de transition… accordent une haute priorité à l’approfondissement et à l’accélération des réformes économiques structurelles… les gouvernements de transition et leurs successeurs doivent formuler un cadre crédible de réforme à moyen terme et de stabilisation… (et) ont besoin de se concentrer sur la création de l’environnement légal et institutionnel pour promouvoir l’esprit d’entreprise, l’investissement, et la croissance mue par le marché.»
Et l’IIF de qualifier carrément cette accélération de l’ajustement structurel comme le «contexte» nécessaire à ce que l’aide à l’Egypte soit fournie.
Réglementations «bureaucratiques» et réforme institutionnelle
En plus de ces prescriptions néo-libérales habituelles, les autres éléments de la logique politique qui guide le soutien financier des IFI concernent la réforme institutionnelle. Cela reflète un déplacement plus général dans la stratégie de développement des IFI depuis les années 1990. Une plus grande importance est donnée à la relation entre la fonction du marché et sa gouvernance institutionnelle. Dans ce contexte, la BM et d’autres institutions ont souligné des notions telles que «l’application de la loi», la «bonne gouvernance», la «séparation du législatif et de l’exécutif», et ainsi de suite, toutes choses qui sont supposées réduire la recherche d’une rente par les fonctionnaires de l’Etat et garantir une plus grande transparence dans les questions économiques [1].
Cette importance donnée à la réforme institutionnelle reflète un problème de perception que rencontrent les IFI. Englober des questions de «gouvernance» et de «démocratie» est conçu explicitement pour assurer une plus grande légitimité au néo-libéralisme, particulièrement à la suite de la décennie désastreuse des années 1980 et 1990 quand la promotion franche de l’ajustement structurel a fait des ravages dans une grande partie du Sud.
Cependant, cette inflexion de la politique ne représente pas une prise de distance face à la logique du néolibéralisme. Elle sert bien plutôt à renforcer cette logique en ajustant les institutions aux besoins du secteur privé et en enlevant à l’Etat la capacité d’intervenir dans le marché. Au Moyen-Orient, où des régimes autoritaires ont été la norme, ces appels à des réformes institutionnelles peuvent facilement être présentés comme démocratiques (et effectivement, ils sont explicitement insérés dans un discours de démocratisation). En réalité, ils sont profondément anti-démocratiques. En limitant la démocratie à la sphère «politique» et en élargissant la notion de liberté pour inclure «les marchés», ils escamotent les nécessaires relations de pouvoir au sein du marché et bloquent explicitement la capacité des Etats à décider de l’usage, de la propriété et de la distribution de leurs ressources économiques. Un contrôle démocratique de l’économie est ainsi exclu comme une violation de la «bonne gouvernance».
Dans le cas de l’Egypte, le discours de la réforme institutionnelle a permis de présenter l’ajustement structurel non pas seulement comme une nécessité technocratique, mais comme la véritable satisfaction des revendications qui irriguaient le soulèvement. Dans ce sens, l’idéologie néolibérale essaie de réabsorber et façonner la dissidence à sa propre image, en formulant le soulèvement égyptien dans un discours pro-marché. Ce message de fond a été souligné de manière répétée ces dernières semaines par les porte-parole des Etats-Unis et de l’Europe : ceci n’était pas une révolte contre plusieurs décennies de néo-libéralisme, mais bien plutôt un mouvement contre un Etat intrusif qui avait mis des obstacles à la poursuite de l’intérêt individuel grâce au marché.
L’exemple le plus cru de cette inflexion du discours a peut-être été la déclaration du président de la BM, Robert Zoellick, lors de l’ouverture d’une réunion de cette institution consacrée, mi-avril, au Moyen-Orient. Faisant allusion à Mohammed Bouazizi, le jeune vendeur d’un marché tunisien qui s’est immolé par le feu [le 17 décembre 2010, il en est mort le 4 janvier 2011] et était devenu le catalyseur du soulèvement en Tunisie, Zoellick déclarait:
«La question clé que j’avais aussi soulignée et que je souligne encore dans ma présente allocution, c’est qu’il ne s’agit pas juste d’une question d’argent. C’est une question de politique… Gardez à l’esprit que feu Monsieur Bouazizi a au fond été poussé à se brûler parce qu’il était harcelé par des réglementations bureaucratiques … un point de départ est donc de cesser de harceler ces gens et de leur laisser une chance de monter des petits commerces.»
Dans cette reformulation discursive des soulèvements, les protestations massives qui ont renversé Moubarak et Ben Ali ont eu lieu à cause d’un manque de capitalisme plutôt qu’à cause de son fonctionnement normal. Dans un sens idéologique, cette reformulation s’oppose directement aux aspirations populaires qui sont apparues dans le cours de la lutte en Egypte.
Les revendications politiques entendues dans les rues d’Egypte aujourd’hui – reprendre la richesse qui a été volée au peuple, offrir un soutien de l’Etat et des services aux pauvres, nationaliser les industries qui ont été privatisées et instituer des restrictions aux investissements étrangers – peuvent être soit écartées soit présentées comme «anti-démocratiques». Justement parce que le soulèvement égyptien a vu les revendications politiques et économiques être combinées de manière inséparable et entremêlées, cet effort pour reformuler la lutte comme «pro-marché» vise, dans un sens très réel, à dévaluer et affaiblir les mobilisations en cours dans le pays.
Les mécanismes de l’ajustement structurel
Cette compréhension de la logique fondamentale présupposée dans les paquets financiers des IFI nous permet de passer aux mécanismes précis par lesquels l’ajustement structurel se déploie. Il y a deux éléments communs à toutes les aides financières offertes à l’Egypte jusqu’à aujourd’hui : une extension des prêts (donc une augmentation de la dette extérieure de l’Egypte) et des investissements promis dans les soi-disant Partenariats Public-Privé (PPPs). Ces deux éléments sont conditionnés à la mise en œuvre par l’Egypte de l’ajustement structurel. Stratégiquement, il apparaît que la première cible de cet ajustement structurel sera la privatisation de l’infrastructure de l’Egypte et l’ouverture de son économie à l’investissement étranger et au commerce extérieur au travers de PPPs (discutés plus bas). En plus du gouvernement de Washington, de la BM et du FMI, l’autre principal acteur institutionnel dans ce processus est la BERD.
La dette
Actuellement, la dette extérieure de l’Egypte s’élève à environ 35 milliards de dollars. Durant la décennie écoulée le pays a payé environ 3 milliards de dollars par année pour le service de sa dette. Entre 2000 et 2009, le niveau de la dette égyptienne s’est accru d’environ 15%, bien que le pays ait payé durant cette période un total de 24,6 milliards pour service de la dette. Les transferts nets de l’Egypte sur sa dette à long terme, soit la différence totale entre les prêts reçus et les montants remboursés, se sont élevés à 3,4 milliards de dollars durant la même période. En d’autres termes, et contrairement à la croyance populaire, plus d’argent coule de l’Egypte vers les prêteurs occidentaux que vice et versa. Ces chiffres démontrent la réalité frappante des rapports financiers de l’Egypte à l’économie mondiale. Les prêts occidentaux extraient de la richesse des pauvres de l’Egypte et les redistribuent aux banques les plus riches d’Amérique du Nord et d’Europe.
Bien sûr, ce ne sont pas les pauvres de l’Egypte qui ont pris la décision d’emprunter cet argent et d’entrer ainsi dans ce «piège de la dette». La grande majorité de cette dette (environ 85%) est publique ou garantie par l’Etat, c’est-à-dire que l’emprunt a été contracté par le gouvernement Moubarak avec l’encouragement officiel des IFI. L’élite dominante égyptienne – centrée autour de Moubarak et sa coterie la plus proche – a largement profité de ces transactions (estimées à plusieurs milliards). Cela indique qu’une grande partie de la dette de l’Egypte est ce que les économistes du développement appellent une «dette illégitime», c’est-à-dire une dette qui a été amassée par un régime dictatorial sans égard aux besoins de la population. Moubarak n’est pas seul responsable de ce processus. La Banque mondiale, le FMI et de nombreux autres prêteurs ont continué d’encourager ces emprunts (et de louer la direction économique de l’Egypte sous Moubarak) justement parce qu’il s’agissait d’une entreprise si rentable.
Voilà l’arrière-fond essentiel des discussions autour de la dette extérieure de l’Egypte. Dans son discours du 19 mai, Barak Obama a mis en valeur la promesse de soulager l’Egypte de jusqu’à un milliard de dollars de ses obligations de remboursement. Obama a décrit cela comme un effort du gouvernement des Etats-Unis pour appuyer «le changement positif dans la région… au moyen de nos efforts pour faciliter le développement économique des nations engagées dans la transition vers la démocratie». Outre cet appui en argent, Obama a aussi promis d’exhorter la BM, le FMI et les autres pays à aider à «stabiliser et moderniser» l’Egypte et à «satisfaire ses besoins financiers aux échéances».
Si on laisse de côté la grandiloquence de ce discours, l’offre d’Obama doit être comprise de manière précise. Contrairement à ce qui a été largement rapporté par les médias, il ne s’agit pas d’une annulation de la dette égyptienne. C’est en fait un échange de dette – une promesse de réduire le service de la dette par l’Egypte à hauteur de un milliard, à condition que l’Egypte utilise cet argent d’une manière que le gouvernement des Etats-Unis approuve. Cet échange de dette confirme la relation de pouvoir inhérente à la finance moderne. Les Etats-Unis sont en mesure d’exploiter le fait que l’Egypte est endettée comme un moyen de l’obliger à adopter les types de politique économique décrits plus haut.
Obama a été très explicite à ce propos en déclarant: «L’objectif doit être un modèle dans lequel le protectionnisme cède le pas à l’ouverture, les rênes du commerce passent du petit nombre au grand nombre et l’économie crée des emplois pour les jeunes. L’appui de l’Amérique à la démocratie sera par conséquent basé sur la garantie de la stabilité financière, la promotion des réformes et l’intégration dans des marchés en concurrence les uns avec les autres et avec l’économie mondiale.»
Ce même langage politique a été clairement formulé à propos des prêts promis à l’Egypte par la BM et le FMI. Le 12 mai 2011, Caroline Atkinson, directrice du Département des Relations extérieures du FMI, a annoncé que ce dernier étudiait une demande du gouvernement égyptien pour un prêt de 3-4 milliards de dollars et qu’elle «visiterait prochainement le Caire pour entamer des conversations avec les autorités égyptiennes à propos de ce contrat.» Signalant que ce prêt serait lié à des conditions, Atkinson a fait remarquer que «la taille et l’ampleur de l’appui du Fonds seraient définis au fur et à mesure du progrès des conversations.» Un conseiller du ministre égyptien des finances Samir Radwan a confirmé cela, déclarant: «Comment l’argent sera dépensé va être soumis à un processus de négociation.» Le 24 mai, cette conditionnalité fut exposée à la suite d’une annonce par la BM et le FMI qu’ils fourniraient 4,5 milliards de dollars à l’Egypte sur deux ans. Faisant remarquer que «les réformes sont aussi importantes que l’argent», Robert Zoellick a explicitement lié le premier milliard de dollars «aux réformes de la gouvernance et de la transparence avec un second milliard de dollars mis à disposition l’année suivante en fonction du progrès réalisé».[2] Le solde de 2,5 milliards de dollars serait investi dans des projets de développement et des prêts au secteur privé (voir plus bas).
A moins de refuser ces prêts et de répudier la dette existante, l’Egypte va se retrouver dans une impasse d’où elle a peu de chances de sortir. L’aide étrangère n’est pas une forme neutre «d’aide» mais une relation sociale d’exploitation établie entre des institutions financières du Nord et des pays du Sud. Piégés dans cette relation, les pays deviennent dépendants d’un flux continu de nouveaux prêts afin de servir la dette à long terme accumulée auparavant. C’est un moyen pour approfondir l’extraction de richesse de l’Egypte et – précisément à cause de cette dépendance prolongée envers des influx financiers – cela sert à enchaîner l’Egypte à des mesures d’ajustement structurel supplémentaires. Le peuple égyptien est ainsi puni pour une dette qu’il n’a pas contractée et cette punition consiste à être enchaîné par un endettement de plus en plus grand par les institutions qui l’ont mis dans cette situation.
L’investissement étranger et les Partenariats Public-Privé (PPPs)
Dans son discours du 19 mai, Obama a également engagé un milliard de dollars d’investissements au travers d’une institution connue sous le nom de Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Le mandat de l’OPIC consiste à soutenir les investissements des entreprises des Etats-Unis dans lesdits marchés émergents. Elle procure des garanties pour des prêts (particulièrement pour des grands projets) ou des prêts directs pour des projets qui ont une part significative d’implication des entreprises des Etats-Unis et qui peuvent être exposés à des risques politiques.
L’emblème des activités de l’OPIC pourrait être le premier investissement en Afghanistan juste après l’invasion de ce pays par les forces dirigées par l’Otan en 2001: un nouvel Hôtel Hyatt à Kaboul destiné à servir «de plateforme pour des hommes d’affaires» qui visitent le pays. L’OPIC a aussi été un partenaire clé pour encourager l’idéologie du libre marché qui a sous-tendu la politique économique de la Coalition Provisional Authority (CPA) en Irak après l’invasion dirigée par les Etats-Unis en 2003 [3].
Comme l’investissement de l’OPIC dépend d’une réduction des barrières mises à l’entrée du capital étranger et d’une accélération de la privatisation des entreprises étatiques, ses activités sont soumises à un préalable: l’extension du programme néo-libéral décrit plus haut. Et il participe à le renforcer. Dans le cas de l’Egypte, cela va probablement se faire principalement au travers de l’emploi de fonds du gouvernement étatsunien pour établir des PPPs. Un PPP est une manière d’encourager la sous-traitance à des entreprises privées de services publics pris en charge auparavant par l’Etat. Une entreprise privée assure un service au travers d’un contrat avec le gouvernement. Cela peut typiquement inclure des activités telles que gérer des hôpitaux ou des écoles, ou construire des infrastructures comme des autoroutes ou des centrales électriques. Pour cela elles sont payées par le gouvernement ou par les usagers du service (par exemple des péages routiers). Les PPPs sont donc une forme de privatisation, qui, dans les termes de Emanuel Savas, qui est l’un des plus éminents promoteurs des PPPs, sont «une expression utile parce qu’elle évite l’effet inflammatoire du mot privatisation sur ses adversaires idéologiques». [4]
L’intervention de l’OPIC en Egypte a été officiellement liée à la promotion des PPPs. Un communiqué de presse de l’OPIC, par exemple, paru peu de temps après le discours d’Obama, a signalé que le milliard de dollars promis par le gouvernement de Washington serait employé «à identifier les entreprises étatiques égyptiennes investissant dans des partenariats public-privé afin de promouvoir la croissance dans des secteurs de l’économie égyptienne faisant l’objet d’un accord mutuel.»
La focalisation sur les PPPs, cependant, est illustrée encore plus nettement par l’investissement promis par une autre institution financière internationale, la BERD. La BERD a été fondée à l’époque de la chute de l’URSS dans le but de faciliter la transition de l’Europe de l’Est à l’économie capitaliste. Comme le président de la BERD, Thomas Mirow, l’a dit à l’ouverture des discussions de la banque sur l’Egypte: «La BERD a été fondée en 1991 pour promouvoir la démocratie et l’économie de marché, et les événements historiques en Egypte ont une forte résonance dans notre banque.»
La BERD se prépare à être un acteur dirigeant du projet néo-libéral en Egypte. Le 21 mai, les actionnaires de la BERD ont accepté de prêter jusqu’à 3,5 milliards au Moyen-Orient, avec l’Egypte comme premier pays recevant des prêts durant la première moitié de 2012. Ce sera la première fois depuis sa fondation que la BERD aura prêté de l’argent au Moyen-Orient. Catherine Ashton, la responsable de la politique étrangère de l’Union européenne, a fait remarquer que la BERD pourrait fournir à l’Egypte un milliard de dollars par année, ce qui donnerait à l’institution un poids énorme dans l’économie égyptienne. Comme comparaison, la valeur totale investie dans toutes les PPPs en Egypte entre 1990 et 2008 a été de 16,6 milliards de dollars.
Si quelqu’un a des illusions concernant les objectifs de l’investissement de la BERD en Egypte, il ferait bien de lire attentivement le Rapport 2010 de Transition de la BERD. Le rapport présente une évaluation détaillée des Républiques est-européennes et ex-soviétiques, en mesurant leurs progrès selon un jeu détaillé d’indicateurs.
Ces indicateurs sont hautement révélateurs: 1° part du secteur privé au PIB ; 2° privatisations de grandes dimensions; 3° petites privatisations; 4° gouvernance et restructuration des entreprises; 5° libéralisation des prix; 6° commerce et système des échanges extérieurs; 7° politique de la concurrence; 8° réforme bancaire et libéralisation des taux d’intérêts; 9° marché des titres et institutions financières non bancaires; 10° réforme d’ensemble des infrastructures[5]. Seuls les pays qui ont un bon score sur ces indicateurs peuvent prétendre à des prêts de la BERD. Un institut de recherche qui suit l’activité de la BERD, Bank Watch, remarquait en 2008 qu’un pays ne peut pas obtenir des bonnes notes dans une évaluation par la BERD s’il ne met pas en œuvre des PPPs dans les secteurs des routes et des eaux.
L’intervention de la BERD augure donc probablement une accélération massive du processus de privatisation en Egypte, le plus probablement par le moyen des PPPs. L’actuel gouvernement égyptien a donné son accord officiel à cette démarche. En fait, lors de l’Assemblée générale annuelle de la BERD qui a eu lieu fin mai, et qui a promis des fonds à l’Egypte, un porte-parole du gouvernement égyptien a déclaré: «Le présent gouvernement de transition reste attaché à l’approche par le libre marché, que l’Egypte va poursuivre à un rythme accéléré après les prochaines élections.» La déclaration poursuivait: «Les partenariats public-privé ont un grand potentiel comme modalité efficace pour concevoir et réaliser des projets d développement, particulièrement dans les secteurs des infrastructures et des services (transport, santé, etc.). C’est pourquoi nous encouragerons les initiatives de PPPs.» Qui plus est, le gouvernement égyptien reprend pleinement le discours idéologique pro-marché en promettant de relâcher les contrôles sur les investissements étrangers. Il s’engage «à surmonter les défauts antérieurs d’une centralisation gouvernementale excessive. En plus, nous allons construire sur les initiatives existantes afin d’atteindre un meilleur niveau de décentralisation, particulièrement en termes de planification locale et de gestion financière.»
Conclusion
Les projets et les investissements mentionnés plus haut ne sont pas le seul aspect du projet néo-libéral façon IFI en Egypte[6]. Mais à un niveau fondamental, cette aide financière confirme une intervention consciente des gouvernements occidentaux dans le processus révolutionnaire égyptien. A très court terme, des grands projets d’infrastructure et d’autres projets économiques peuvent créer des emplois, des logements, de la formation, dans une certaine mesure, et peut-être l’apparence d’un retour à la stabilité étant donné le sentiment dominant de «crise». Néanmoins, cet investissement est soumis à une condition préliminaire: une profonde libéralisation de l’économie égyptienne. Ces projets ne se concrétiseront qu’en parallèle avec des mesures telles qu’une profonde privatisation (sans doute sous la forme de PPPs), une dérégulation (initialement probablement liée à l’ouverture de plus de domaines à l’investissement étranger), la réduction des barrières commerciales (liée à l’accès aux marchés des Etats-Unis et à ceux de l’Europe) et l’expansion du secteur informel (sous le slogan de moins de «bureaucratie»). En outre, cela entraînera nécessairement un accroissement rapide de l’endettement total de l’Egypte, ligotant le pays toujours plus solidement à des paquets d’ajustement structurels futurs.
Si ce processus ne rencontre pas de résistance, il menace d’annuler les gains du soulèvement égyptien. Comme les décennies de l’expérience qu’a l’Egypte du néolibéralisme ne le montrent que trop clairement, ces mesures vont encore plus approfondir la pauvreté, l’insécurité économique et l’érosion du niveau de vie de la vaste majorité. Simultanément, les afflux financiers vont contribuer à renforcer et consolider les étroites élites des affaires et de l’armée comme la seule couche de la société égyptienne qui peut tirer bénéfice de la libéralisation plus poussée de l’économie. L’expansion des PPPs, par exemple, va offrir aux plus grands groupes patronaux du pays des énormes occasions de prendre des parts en propriété dans les principaux projets d’infrastructure et autres services publics privatisés. Aux côtés des investisseurs étrangers, ces groupes patronaux égyptiens vont profiter de la dérégulation du marché du travail, de la libéralisation de la terre et du commerce de détail, et de l’accès potentiel aux marchés à l’exportation vers les Etats-Unis et l’Europe.
Ces mesures ont un impact régional. Leurs autres principaux bénéficiaires seront les Etats du Conseil de coopération du Golfe (GCC), soit l’Arabie saoudite, Koweït, Emirats arabes unis, Bahreïn, Qatar et Oman, qui jouent un rôle bien visible et complémentaire aux côtés des IFI. L’Arabie saoudite a promis 4 milliards de dollars à l’Egypte, plus que les montants promis par les Etats-Unis et la BERD. La Kuwait Investment Authority a annoncé en avril qu’elle créait un fonds d’investissement souverain de un milliard de dollars pour investir dans des entreprises égyptiennes. Le groupe koweitien Kharafi, qui avait obtenu en 2010 des contrats de PPP dans le secteur électrique égyptien et dont on estime qu’il a déjà 7 milliards investis en Egypte, a annoncé qu’il empruntait 80 millions de dollars pour investir en Egypte. On rapporte que Qatar aussi envisagerait d’investir jusqu’à 10 milliards de dollars, selon son ambassadeur en Egypte.
Comme pour les investissements occidentaux, ces flux financiers de la part du GCC sont dépendants d’une libéralisation plus accentuée de l’économie égyptienne, probablement par des PPPs. D’ailleurs, Essam Sharaf, le premier ministre par intérim égyptien depuis mars 2011 [ancien ministre des transports de 2004 à 2005] et Samir Radwan, le ministre des finances, ont tous les deux voyagé fréquemment dans les pays du GCC ces derniers mois dans le but de conclure des PPPs, particulièrement dans les secteurs de l’eau et des eaux usées, des routes, de l’éducation, de la santé, et de l’énergie. Une indication de la direction de ces efforts fut l’annonce par la bourse de Dubaï et celle de l’Egypte qu’elles permettaient la cotation conjointe d’actions sur leurs bourses. Cela va permettre aux entreprises privatisées et autres véhicules d’investissement d’être cotées conjointement dans les deux Bourses, ce qui va faciliter l’afflux de capitaux du GCC vers l’Egypte.
Essentiellement, ces initiatives financières annoncées ces dernières semaines représentent une tentative de lier des couches sociales telles que les élites militaire et patronale égyptiennes, les familles régnantes et les grands conglomérats du Golfe, toujours plus étroitement aux Etats occidentaux.
Le processus révolutionnaire en Egypte a représenté dans le monde arabe une attaque contre ces couches sociales. Le soulèvement ne peut pas être réduit à une question de «transition démocratique». Justement parce que la forme de l’Etat égyptien sous Moubarak était un reflet direct de la nature du capitalisme dans le pays, le soulèvement remettait en question implicitement la position de ces élites. Les mobilisations exemplaires qui se poursuivent dans les rues égyptiennes confirment que ces aspirations sont profondément ressenties. L’aide financière occidentale doit être comprise comme une intervention dans cette lutte en cours, une tentative d’exploiter le sentiment de «crise économique» pour refaçonner la société égyptienne contre les intérêts de la majorité des Egyptiens et détourner la révolution des objectifs qui restent à atteindre. (Traduction A l’Encontre)
* Adam Hanieh enseigne au Département d’études du développement de la School of Oriental and African Studies (SOAS), de l’Université de Londres. Il est l’auteur de Capitalism and Class in the Gulf Arab States (Palgrave Macmillan, juin 2011). Cet article a paru d’abord sur Jadaliyya (www.jadaliyya.com), le 29 mai 2011, une revue électronique indépendante produite par l’ASI (Arab Studies Institute), un réseau d’auteurs associés au Arab Studies Journal
______
[1] Pour une critique détaillée de ces notions, voir Jomo, K.S. et Ben Fine, éd., The New Development Economics: After the Washington Consensus, Zed Books, Londres, 2006.
[2] Ce clair message de conditionnalité ridiculise la prétention du ministre égyptien des finances, Samir Radwan, qui déclarait: «Nous avons un programme égyptien… Je n’accepterai aucune conditionnalité aucune d’aucune sorte.»
[3] Un aspect fondamental de ce processus, qui va probablement se reproduire dans le cas de l’Egypte, était une priorité donnée à l’encouragement des entreprises irakiennes à devenir de plus en plus dépendantes du capital financier des Etats-Unis, au travers de prêts par les banques et la finance des Etats-Unis à des petites et moyennes entreprises du pays.
[4] Emanuel Savas, Privatization in the City, CQ Press, Washington D.C., 2005, p.16.
[5] La Biélorussie, par exemple, a été récompensée par son élévation de 3 à 3+ de l’indicateur de la libéralisation des prix «pour avoir levé les restrictions de prix et de commerce de plusieurs biens et la réduction de la liste des prix minimum à l’exportation». De manière analogue, le Monténégro a bénéficié de la même élévation pour avoir privatisé des parties de ses secteurs portuaires et électriques.
[6] Par exemple, un autre véhicule important est la Arab Financing Facility for Infrastructure (AFFI), constituée au début de cette année conjointement par la Banque mondiale, la International Finance Corporation et la Banque islamique de développement, afin de promouvoir l’investissement dans la région du Moyen-Orient. La AFFI projette de réunir un milliard de dollars et va se concentrer sur les infrastructures, explicitement par des PPPs. La AFFI se fixe pour objectif central des projets d’intégration régionale. Elle est donc utilisée pour promouvoir la réduction des barrières douanières au sein de la région. Il n’est pas encore clair pour le moment quelle implication la AFFI aura en Egypte, mais la Banque mondiale l’a mise en avant comme une composante majeure de ses activités futures dans le pays.

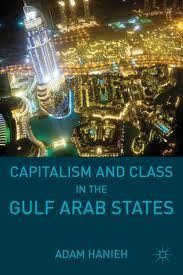
Soyez le premier à commenter