 Entretien avec Myriam Benraad conduit par Hélène Sallon et Marc Semo
Entretien avec Myriam Benraad conduit par Hélène Sallon et Marc Semo
Les «printemps arabes» de 2011 paraissaient enlisés dans d’interminables conflits (Libye, Syrie, Yémen) ou étouffés par la contre-révolution (Egypte). En 2019, a émergé une nouvelle vague contestataire, portée par une jeunesse qui se dit apolitique, en Egypte, en Irak et en Algérie. Politologue et spécialiste du monde arabe, Myriam Benraad, auteure notamment de Jihad : des origines religieuses à l’idéologie (Le Cavalier bleu, 2018), décrypte cette nouvelle donne.
Quel est le moteur de ces nouvelles contestations?
Il y a d’abord la colère de populations laissées à l’abandon par des Etats qui n’ont aucune intention de se réformer. Les acteurs de ces contestations – pas si nouvelles quand on les replace dans le temps long – sont en majorité des citoyens qui ne supportent plus leurs conditions de vie, ainsi qu’une jeunesse, démographiquement toujours plus nombreuse, qui ne se satisfait plus de ce statu quo. Les griefs formulés par ces foules sont une remise en cause profonde des systèmes politiques qui ont échoué à les entendre et à répondre à leurs attentes par une action institutionnelle tangible. Il est impossible de dissocier les revendications socio-économiques du volet politique.
Ensuite, il y a la dignité, karama en arabe, une notion centrale et décisive, renvoyant à une pluralité de sens qui ont constitué, depuis 2011, autant d’expressions protestataires que d’enjeux pour des transitions toujours en cours. En descendant dans les rues, les populations arabes exigent avant tout du respect et de la reconnaissance. Elles entendent donner corps à cette citoyenneté à laquelle toutes aspirent. Pour certains protestataires, cette revendication correspond également à une quête d’identité, de morale, de justice, de valeurs, après de longues années d’autoritarisme politique et de violations de leurs droits les plus fondamentaux.
La dignité était déjà centrale dans les soulèvements de 2011. S’agit-il des mêmes ressorts?
Au-delà des spécificités nationales, tous les soulèvements de 2011 visaient des castes de dignitaires établis dont le monopole des ressources économiques et financières leur était garanti par l’exercice du pouvoir. Aux yeux de ceux-là, la dignité est «aristocratique» et se confond avec une conscience aiguë de leurs privilèges. Il n’est pas non plus possible de s’en prévaloir si l’on considère la situation de certains groupes ethniques ou religieux. Enfin les femmes, humiliées parmi les humiliés, subissent une double oppression.
A l’opposé, les protestataires de 2011 comme en 2019 expriment une conception «égalitariste» de cette dignité longtemps bafouée, évacuée de la grammaire politique officielle, niée sur le plan socio-économique pendant toute la période postcoloniale, d’un régime à l’autre. Considérés a posteriori, les «printemps arabe», comme on les nomme encore aujourd’hui, s’assimilent à une remise en cause sans précédent des hiérarchies sociales instituées de longue date, cristallisée autour d’une demande de reconnaissance et de dignité de la rue arabe dans son ensemble.
Les mobilisations en Algérie et en Irak, où les contestations de 2011 avaient eu des répercussions assez faibles, expriment-elles cette quête égalitaire?
Les répercussions sont restées limitées dans ces deux pays, mais cela ne signifie pas pour autant que la colère n’était pas présente, ou latente. Replacées dans le continuum contestataire de la dernière décennie, les mobilisations algérienne et irakienne prennent ainsi un tout autre sens. A Alger, derrière la protestation amorcée en février contre la candidature d’Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel, le mouvement Hirak revendiquait des réformes socio-économiques de fond, l’instauration d’un nouveau régime politique et plus encore la destitution des dignitaires au pouvoir. Face à la persistance de l’Etat profond et aux obstructions multiples et diverses de l’armée, véritable «Etat dans l’Etat», la contestation se poursuit sans grande surprise.
Il en va de même en Irak, où les manifestants ciblent une élite prédatrice et corrompue qui verrouille l’ensemble du champ sociopolitique depuis la mise à bas du régime de Saddam Hussein au printemps 2003. De façon symptomatique, cette colère a pris une forme plus nette à partir de 2011 et du premier désengagement militaire américain, au moment où l’establishment irakien, sous la tutelle de l’ancien premier ministre Nouri Al-Maliki, a amorcé un virage autoritaire.
En Egypte, le président Abdel Fattah Al-Sissi, au pouvoir depuis 2013, se targue de redonner au pays sa grandeur, mais les manifestations réprimées en septembre traduisent un mécontentement très profond. Qu’en est-il?
L’Egypte est un cas exemplaire. Sa situation intérieure illustre parfaitement ce combat entre les deux définitions antagoniques de la dignité: aristocratique d’une part, dont se targue le régime d’Al-Sissi au nom de la défense du peuple, du «relèvement national», de la lutte contre le terrorisme et pour le maintien de l’ordre, et égalitariste d’autre part, héritée de la révolution contre la dictature de [Hosni] Moubarak [président du 14 octobre 1981 au 11 février 2011] et ses manifestations contre une extrême personnalisation du pouvoir, la répression militaire féroce et le délabrement des conditions de vie.
L’Egypte n’est cependant pas une exception. Ailleurs dans le monde arabe, d’autres Etats en situation de régression autoritaire et s’adonnant à une répression tous azimuts contre leur peuple, se prévalent aussi d’une approche patricienne de la dignité pour délégitimer ou tout simplement annihiler les demandes de ceux qu’ils qualifient de «plèbe».
Ce conflit de représentations est-il aussi un conflit générationnel, identitaire?
Oui, il s’agit en effet d’un conflit d’ancrage à la fois générationnel, et dans une moindre mesure identitaire. Générationnel, tout d’abord. La vision que la jeunesse arabe entretient d’elle-même et de son destin a changé avec le refus des inégalités et des injustices – une vision diamétralement opposée à celle des élites.
Pour beaucoup de jeunes, il n’est plus question de transiger sur des revendications élémentaires au bénéfice d’idéologies ou de modèles non seulement dépassés, mais qu’ils dénoncent comme autant d’outils ayant servi à manipuler les opinions publiques pour les faire renoncer à l’essentiel : le bien-être que chaque citoyen devrait être en droit d’escompter de la part d’un gouvernement qui prétend le représenter. Identitaire ensuite, car ces jeunes conçoivent que leurs revendications sont universelles, portées par d’autres peuples à travers le monde, au-delà du prisme culturel communément appliqué aux sociétés arabes.
La victoire en Tunisie du juriste conservateur et hors système Kaïs Saïed est analysée comme un retour du «refoulé» de la révolution de 2011. Qu’en pensez-vous?
Alors que personne ne l’attendait, et avec plus de 70 % des suffrages [au second tour des élections, le 13 octobre], Kaïs Saïed s’est imposé comme le sauveur potentiel de la révolution tunisienne. Il incarne l’espoir d’une vertu politique que beaucoup de révolutionnaires désiraient voir émerger dans l’après-Ben Ali [Zine El-Abidine Ben Ali a fui la Tunisie le 14 janvier 2011 après plus de vingt ans passés à la présidence], qui avait, depuis, largement été déçu. Du fait de sa maîtrise de la langue arabe, de sa connaissance intime des institutions, de sa dénonciation de la corruption et du clientélisme d’Etat, Saïed a séduit une bonne partie des électeurs.
Parviendra-t-il néanmoins à répondre à cette demande de dignité, qui perdure face au creusement des inégalités et des injustices depuis 2011 et à mettre en œuvre les réformes qui s’imposent? Son conservatisme, son opposition à l’égalité de succession pour les femmes ou à la dépénalisation de l’homosexualité interrogent sur son positionnement, qui n’est pas si éloigné, en définitive, de celui des dignitaires traditionnels…
En Egypte ou en Algérie, les contestataires ne se revendiquent pas de la mouvance de l’islam politique. En Irak, les contestataires expriment un fort rejet des partis islamistes au pouvoir. L’islam politique est-il décrédibilisé?
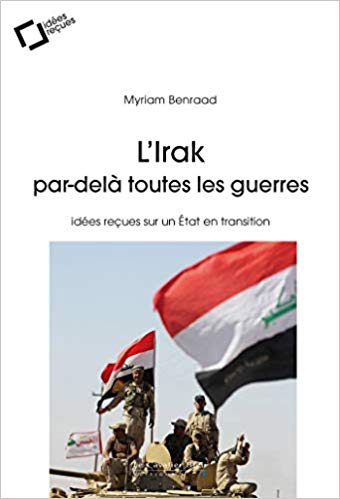 A partir de 2011, les Frères musulmans et les mouvements islamistes pris au sens large se sont, pour la première fois de leur histoire contemporaine, confrontés à l’exercice effectif du pouvoir. Or, dans la majorité écrasante des cas – de l’expérience du parti Ennahda en Tunisie à celle des partisans de l’ancien président Mohamed Morsi en Egypte –, l’islam politique, tout entier construit autour d’une promesse millénariste de justice et de liberté pour le monde musulman, a lamentablement échoué à améliorer le quotidien des populations et à leur rendre leur dignité.
A partir de 2011, les Frères musulmans et les mouvements islamistes pris au sens large se sont, pour la première fois de leur histoire contemporaine, confrontés à l’exercice effectif du pouvoir. Or, dans la majorité écrasante des cas – de l’expérience du parti Ennahda en Tunisie à celle des partisans de l’ancien président Mohamed Morsi en Egypte –, l’islam politique, tout entier construit autour d’une promesse millénariste de justice et de liberté pour le monde musulman, a lamentablement échoué à améliorer le quotidien des populations et à leur rendre leur dignité.
La situation est identique en Libye, en Syrie et au Yémen: trois pays où s’ajoutent les dissensions délétères entre factions islamistes. Dans le cas de l’Irak, ce sont tout autant le primat des mouvances politiques et armées de l’islamisme chiite que l’influence des fondamentalistes sunnites, qui sont rejetés par la population.
L’organisation Etat islamique, qui avait pris pied dans les régions sunnites d’Irak et de Syrie en promettant de redonner aux sunnites leur dignité, a-t-elle encore une capacité de mobilisation après la chute du califat?
Indignité, indignation et dignité sont les trois mots-clés pour analyser l’ensemble des mouvements de contestation qui parcourent le monde arabe, en Irak tout particulièrement. En 2012-2013, alors que peu y prêtaient attention, les provinces sunnites irakiennes ont été touchées par de violentes manifestations réclamant égalité et dignité.
Face à l’inaction et à la répression de Bagdad, ces mêmes régions se sont littéralement offertes, en 2014, aux djihadistes de l’Etat islamique qui promettait un honneur retrouvé. Evidemment, cette promesse a été trahie par les horreurs perpétrées par ce groupe. Cependant, avec le vide politique qui perdure sur le terrain, l’organisation a d’ores et déjà repris son « travail social » et ses efforts de recrutement, sur fond de relance de la violence insurrectionnelle. (Article mis en ligne sur le site du quotidien Le Monde le 18 octobre 2019)


Soyez le premier à commenter