A l’école secondaire, à la fin des années 1990, mes amis et moi avons fait l’école buissonnière et nous sommes allés en voiture à Flint, dans le Michigan, où nous avions appris qu’il y aurait une grève à l’usine Delphi, un fournisseur de pièces automobiles pour General Motors. Nous sommes arrivés juste à temps pour voir les hommes sortir, marcher lentement en rangs, en se tenant par les bras. Certains d’entre eux chantaient. Des personnes se tenaient devant les portes de l’usine, regardant silencieusement et pendant un moment, puis tout s’est arrêté. Plus tard, j’ai appris que 5800 hommes et femmes avaient fait la grève à l’usine de Flint East. Ils furent rejoints la semaine suivante par 2700 grévistes de l’usine voisine de Flint Metal. Les deux grèves ont entraîné la fermeture des 32 (à l’époque) usines d’assemblage et de sous-traitance de GM aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Ce moment vécu aux portes de cette usine a changé la trajectoire de ma vie: mon premier emploi post-universitaire a été celui de journaliste spécialisée sur le mouvement syndical.
Une grande grève traditionnelle comme celle dont j’ai été témoin est maintenant assez rare. La grève était le principal instrument d’un syndicat. Mais dans l’atmosphère actuelle favorable aux employeurs, où sévissent des lois antisyndicales comme la récente vague de lois sur le droit du travail, les grèves sont utilisées comme une occasion pour les employeurs de briser le syndicat, de licencier des dirigeants et, grâce au lock-out, d’embaucher des travailleurs intérimaires (pour remplacer ceux qui subissent le lock-out) qui seront engagés plus tard de manière permanente. De 2010 à 2017, par année, il y a eu moins de 13 grèves impliquant 1000 travailleurs dans le secteur privé. Il s’agit d’un revirement majeur par rapport au nombre annuel moyen de grèves importantes dans les années 1980 (83) et au cours des années 1970 (288).
Compte tenu de ces chiffres, il est presque étrange d’écrire sur les syndicats aux Etats-Unis en ce moment même. Les syndicats ne représentent que 6,4% des travailleurs et travailleuses du secteur privé et 10,5% de l’ensemble des travailleurs/travailleuses, soit les pourcentages les plus bas depuis 100 ans, selon le Bureau of Labor Statistics. Pourquoi se concentrer sur la minuscule minorité de travailleurs et travailleuses syndiqués alors qu’il y a tant de cols-bleus, de cols roses [pink-collar qui renvoie à une main-d’œuvre féminine dans des emplois considérés comme «réservés aux femmes» au XXe siècle] et même de cols blancs qui ne peuvent obtenir de leurs patrons un accord dit équitable?
La question primordiale: se mobiliser
C’est l’une des principales questions que Steven Greenhouse – qui a couvert les questions relatives au travail et au lieu de travail pour le New York Times pendant 19 ans – pose et à laquelle il répond dans son nouveau livre, intitulé Beaten Down, Worked Up: The Past, Present, and Future of American Labor [Ed. Knopf, août 2019]. Greenhouse croit au mouvement ouvrier – c’est un fait, écrit-il, que les emplois syndiqués donnent encore plus de pouvoir aux travailleurs et ont des rémunérations supérieures – mais il est aussi réaliste. Il dit clairement que les travailleurs non syndiqués peuvent bénéficier de gains obtenus, en partie, grâce aux dépenses et au temps investis par le mouvement syndical. Et c’est correct. Comme les chroniques de Greenhouse présentent des façons alternatives et non traditionnelles de s’organiser, la leçon générale du livre est que pratiquement tout le monde s’en sort mieux en se mobilisant – même s’ils n’ajoutent pas leur nom dans les rangs des organisations syndicales.
Alors que Greenhouse nous donne quelques leçons historiques – les mêmes que celles que nous avons lues dans beaucoup d’autres livres (la grève générale de Flint de 1936 à 1937, la grève désastreuse de 1981 de PATCO-Professional Air Traffic Controllers Organization, défaite par Reagan) –, les parties les plus intéressantes du livre racontent ces luttes non traditionnelles, que Greenhouse appelle «les actions actuelles exceptionnelles et victorieuses des travailleurs des temps modernes qui indiquent une voie pleine d’espoir».
Certains de ces travailleurs, comme un groupe déterminé de travailleurs de la restauration rapide, ne peuvent pas être reconnus comme un syndicat par leur employeur et pourtant ils se sont battus d’une façon différente. Les travailleurs agricoles – comme la Coalition of Immokalee Workers qui cueille des tomates pour des firmes telles que Taco Bell, McDonald’s, Whole Foods et Wal-Mart, appartiennent à une catégorie qui ne tombe pas sous le National Labor Relations Act, ce qui implique qu’ils n’ont pas le droit de se syndiquer. Les enseignants de Virginie-Occidentale – le secteur qui a lancé la vague de grèves des enseignants en 2018 – bien que gravement affaiblis en tant que syndicat, car ils n’avaient pas le pouvoir de négocier collectivement ou de faire grève, ont quand même engagé un mouvement de grèves.
Dans le plus réussi de ces mouvements, le pouvoir change vraiment, ou du moins est en jeu. The Fight for $15 [le combat pour les 15 dollars de l’heure], par exemple – un mouvement qui a commencé par les travailleurs de la restauration rapide de la ville de New York et qui s’est rapidement étendu à l’échelle nationale en 2012 (Greenhouse a été le premier journaliste à le couvrir quand il travaillait au New York Times) – a montré que vous n’avez pas besoin d’un syndicat pour obtenir un meilleur salaire. En fait, vous n’avez même pas besoin de votre employeur pour «négocier» avec vous. Pour commencer, les travailleurs de McDonald’s ont essayé la voie traditionnelle. Ils ont rencontré les organisateurs du Service Employees International Union (SEIU) et ont décidé qu’ils voulaient un syndicat. A une époque où de nombreux salariés gagnaient 7,25 dollars de l’heure, l’un de leurs principaux objectifs était d’obtenir un salaire de 15 dollars, parmi d’autres améliorations – la plupart non liées à la rémunération – qu’une convention collective pouvait offrir. Ils étaient aussi assez en colère pour faire grève, organisant une journée de grève d’une journée à New York avec 200 personnes. En décembre 2012, des grèves ont eu lieu dans 100 villes.
Pourtant, McDonald’s a refusé de parler avec les travailleurs ou de reconnaître un syndicat. Mais il allait se passer autre chose. En 2014, Seattle venait d’adopter un salaire minimum de 15 dollars dans le cadre d’une bataille plus vaste pour le salaire minimum vital. En conséquence, le groupe Fight for $15 a envisagé une nouvelle voie. Ils n’avaient plus à faire pression sur McDonald’s; ils pouvaient déplacer la lutte et faire pression sur les municipalités, ville par ville, en organisant une coalition de syndicats, de membres des communautés, d’immigrant·e·s et autres groupes progressistes. Et, comme le souligne Greenhouse, ils ne se battaient plus seuls.
Le conseil municipal de Chicago s’est prononcé pour un salaire minimum de 13 dollars, suivi de Los Angeles avec 15 dollars. La liste des villes et des Etats ayant un salaire minimum de 15 dollars incluait finalement: San Francisco, Minneapolis, une grande partie de l’Etat de New York, la Californie, le Massachusetts et le New Jersey. A New York, le gouverneur Andrew Cuomo a adopté le salaire de subsistance de 15 dollars en utilisant ce qu’on appelle le wage board, un outil de l’époque de la dépression qui déterminait ce que devrait être le salaire minimal de subsistance pour certaines industries, en l’occurrence ici les travailleurs de la restauration rapide. Greenhouse est favorable au potentiel du wage board: «En théorie, dit-il, ce type de négociation à l’échelle d’une branche pourrait également être fait pour les hôtels, les maisons de retraite, les salons de manucure et d’autres secteurs.»
Bien que les travailleurs de la restauration rapide n’aient pas obtenu leur syndicat, en fin de compte, ils ont gagné quelque chose de différent, d’important mais aussi de plus diffus. Greenhouse cite la présidente du SEIU, Mary Kay Henry, qui a déclaré que, grâce à la participation à la lutte pour les 15 dollars de l’heure à l’échelle nationale, le salaire de 22 millions de travailleurs a augmenté, directement ou indirectement.
La capacité de s’organiser
Les cueilleurs de tomates d’Immokalee, comté de Collier en Floride, ont montré que, pour les travailleurs mobilisés du XXIe siècle, la capacité d’organisation est la vraie clé, surtout pour ceux qui ne peuvent disposer d’un syndicat traditionnel pour une raison quelconque. A Immokalee, les migrant·e·s cueillent des tomates, qui sont vendues à une poignée de gros producteurs, qui sont ensuite vendues à de grandes entreprises comme Taco Bell. Jusqu’à récemment, les conditions pour les cueilleurs étaient proches de l’esclavage moderne. Il y a une douzaine d’années, c’était un travail infernal: des abus à tous les niveaux, y compris sexuel, les travailleurs/travailleuses ne recevant régulièrement pas un salaire correspondant à tout ce qu’ils/elles cueillaient.
 En 1993, des militants travailleurs agricoles ont fondé la Coalition of Immokalee Workers, une coalition qui s’occupait de sensibilisation et d’éducation. Ils ont fait grève par deux fois contre différents producteurs, mais les gains ont été très limités. Dès lors, au lieu de s’engager dans un jeu d’attrape-nigaud avec les producteurs, la Coalition a décidé d’exercer des pressions sur les acheteurs les plus en vue, d’amorcer un boycott national contre Taco Bell et de demander à l’entreprise d’adopter un code de conduite, notamment en matière de salaire minimum et d’avantages sociaux, d’horaires de travail et de sécurité des salarié·e·s. Elle a également demandé à Taco Bell de payer un cent de plus la livre pour ses tomates de type Florida. Après quatre ans, en 2005, Taco Bell a accepté. Ensuite, la Coalition s’en est prise à McDonald’s, avec les mêmes exigences, plus une troisième: que McDonald’s aide à créer un système de surveillance pour s’assurer que les producteurs de tomates respectent le code de conduite.
En 1993, des militants travailleurs agricoles ont fondé la Coalition of Immokalee Workers, une coalition qui s’occupait de sensibilisation et d’éducation. Ils ont fait grève par deux fois contre différents producteurs, mais les gains ont été très limités. Dès lors, au lieu de s’engager dans un jeu d’attrape-nigaud avec les producteurs, la Coalition a décidé d’exercer des pressions sur les acheteurs les plus en vue, d’amorcer un boycott national contre Taco Bell et de demander à l’entreprise d’adopter un code de conduite, notamment en matière de salaire minimum et d’avantages sociaux, d’horaires de travail et de sécurité des salarié·e·s. Elle a également demandé à Taco Bell de payer un cent de plus la livre pour ses tomates de type Florida. Après quatre ans, en 2005, Taco Bell a accepté. Ensuite, la Coalition s’en est prise à McDonald’s, avec les mêmes exigences, plus une troisième: que McDonald’s aide à créer un système de surveillance pour s’assurer que les producteurs de tomates respectent le code de conduite.
McDonald’s a accepté, et bientôt d’autres grandes chaînes de restauration rapide et supermarchés ont acquiescé à leurs demandes. Maintenant, les cueilleurs de tomates d’Immokalee travaillent selon un code de conduite qui interdit les abus verbaux et sexuels, qui fournit de l’eau propre, qui n’oblige pas les cueilleurs à travailler sous une chaleur dangereuse. Ils sont payés pour toutes les heures travaillées et sont protégés contre les représailles des superviseurs. Il y a une ligne d’assistance anonyme 24 heures sur 24 pour les plaintes. Il ne s’agit pas d’une convention collective ou d’un syndicat, mais la Coalition of Immokalee Workers a obtenu plusieurs des droits qu’elle aurait obtenus avec un syndicat. En fait, il s’agit plutôt d’un système de surveillance de qualité des conditions de de travail.
Un autre thème développé par Greenhouse est que le mouvement organisé des travailleurs étant donné son état de faiblesse n’a plus le luxe de faire les choses seulement par lui-même. Depuis le début des années 1990, la Los Angeles Alliance for a New Economy (LAANE) a été fondée avec 60’000 dollars en fonds d’aide syndicale. Depuis lors, l’organisation a accumulé des réalisations pour les travailleurs à faible salaire avec le but exprès de ne pas faire cavalier seul.
LAANE a obtenu des promoteurs immobiliers qu’ils versent un salaire de subsistance aux travailleurs et qu’ils acceptent de ne pas s’opposer à la syndicalisation. L’alliance a remporté une loi de grande portée sur le salaire minimum et un salaire minimum de 15,37 dollars pour les employé·e·s des hôtels de Los Angeles. Ces victoires ont été remportées grâce à des partenariats avec d’autres organisations. Au cours d’une lutte pour un salaire de subsistance, décrit M. Greenhouse, le LAANE a envoyé «un contingent de membres du clergé, de dirigeants communautaires et de travailleurs de base» pour parler avec les membres du conseil municipal. Les salarié·e·s de la restauration et les concierges s’y sont joints, soulignant qu’ils pouvaient à peine payer leurs factures. Au moment où ils l’ont fait, il semblait que les organisateurs avaient amené toute la communauté au conseil municipal pour discuter de la question, y compris les écoliers et les personnes vivant dans des maisons de retraite. La coalition visait à gagner les 15 membres du conseil, surtout dans les régions conservatrices. A cette fin, un organisateur a dit à Greenhouse: «Les membres du clergé de toutes les confessions religieuses ont commencé à faxer chaque jour leur appui aux membres du conseil.» Finalement, LAANE a obtenu le salaire de subsistance.
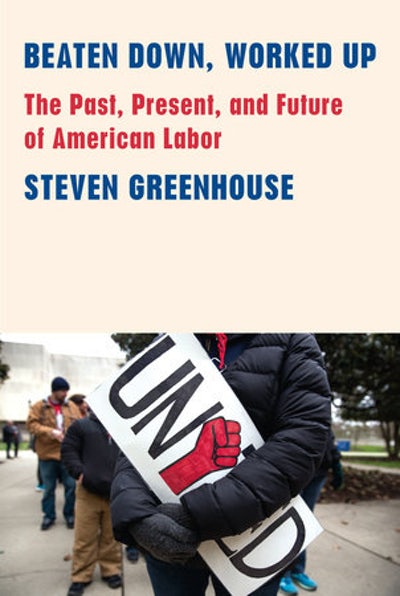 Le livre de Greenhouse note également que l’une des plus grandes surprises en 2018 a été la vague de grèves des enseignants. Tout a commencé en Virginie-Occidentale, où les enseignant·e·s étaient furieux des augmentations constantes des primes pour les soins de santé qui dévoraient leurs petits salaires (certains avoisinant les 32’000 dollars par année). Bien que les enseignants fussent représentés par deux syndicats différents, l’Etat n’a pas permis aux enseignant·e·s de négocier collectivement ou de faire la grève. Ils/elles se sont donc mobilisés via les médias sociaux et ont décidé de faire grève illégalement, revendiquant une augmentation de 5%. Après neuf jours, ils ont gagné et inspiré d’autres enseignants de tout le pays, en Oklahoma, Arizona, Kentucky, Colorado, et Caroline du Nord. En Virginie-Occidentale, les enseignant·e·s ont prouvé que l’on peut gagner même quand les circonstances sont très difficiles.
Le livre de Greenhouse note également que l’une des plus grandes surprises en 2018 a été la vague de grèves des enseignants. Tout a commencé en Virginie-Occidentale, où les enseignant·e·s étaient furieux des augmentations constantes des primes pour les soins de santé qui dévoraient leurs petits salaires (certains avoisinant les 32’000 dollars par année). Bien que les enseignants fussent représentés par deux syndicats différents, l’Etat n’a pas permis aux enseignant·e·s de négocier collectivement ou de faire la grève. Ils/elles se sont donc mobilisés via les médias sociaux et ont décidé de faire grève illégalement, revendiquant une augmentation de 5%. Après neuf jours, ils ont gagné et inspiré d’autres enseignants de tout le pays, en Oklahoma, Arizona, Kentucky, Colorado, et Caroline du Nord. En Virginie-Occidentale, les enseignant·e·s ont prouvé que l’on peut gagner même quand les circonstances sont très difficiles.
L’avenir de la syndicalisation ne repose peut-être pas principalement sur les syndicats que nous associons aux syndicats du XXe siècle. Mais, comme Greenhouse le démontre, les tactiques syndicales n’ont guère perdu de leur pertinence et peuvent être appliquées par de nouveaux secteurs de travailleurs et travailleuses, même ceux qui n’ont peut-être pas le droit de s’organiser, ou qui ont peu de chances d’obtenir le droit de s’organiser en syndicat, ou qui sont peut-être déjà organisés mais ne peuvent peut-être pas négocier ou faire grève.
«Des centres pour les travailleurs et travailleuses»
L’avenir, selon Greenhouse, pourrait impliquer que d’autres secteurs créent leur propre structure de régulation, comme l’a fait la Coalition of Immokalee Workers, ou créent un «centre pour les travailleurs», une sorte de groupe de travail alternatif, qui ne s’engage pas dans la négociation collective, mais soutient les salarié·e·s d’autres manières. Les «centres de travailleurs» sont des organisations à but non lucratif, ayant une insertion sociale, qui soutiennent les travailleurs à bas salaires par le biais de services tels que le soutien juridique pour les questions relevant du salaire et du temps de travail, la mobilisation locale et l’organisation pour de meilleurs salaires et conditions de travail. Greenhouse plaide en faveur d’une loi exigeant que tous les «centres de travailleurs» reçoivent des cotisations volontaires de la part des travailleurs qu’ils soutiennent. Il suggère également que les milliardaires fassent des dons aux centres de travailleurs. (Ce dernier point est une suggestion loufoque, car jusqu’à présent, les milliardaires comme les frères Koch n’ont guère plus de plaisir que de faire un don à la législation antisyndicale.)
Greenhouse offre une foule de suggestions sur la façon d’améliorer les conditions de travail, dont certaines ont été faites plusieurs fois auparavant. Il s’agit notamment d’une réforme du financement des campagnes électorales (Greenhouse est un partisan des attaques de Bernie Sanders contre les grosses fortunes) pour juguler l’argent noir, comme celui des frères antisyndicaux Koch [dont l’un vient de décéder], et pour accroître le financement public dans les campagnes politiques. Il suggère la création d’un groupe de pression national des travailleurs, tout comme l’American Association of Retired People fait pression en faveur des personnes âgées. Il propose une nouvelle loi sur la vérification des cartes [actuellement les salarié·e·s doivent signer une «autorisation» d’être représentés par les syndicats et si plus de 50% des salarié·e·s signent, l’employeur doit reconnaître le syndicat] qui faciliterait la syndicalisation et propose à juste titre une règle exigeant que les syndicats qui stagnent augmentent le nombre d’adhérents, et bien d’autres choses encore.
En fin de compte, Greenhouse assimile des syndicats forts, ou du moins le pouvoir des travailleurs, à la démocratie elle-même. Il voit très peu de limites à ce qu’un mouvement ouvrier sain et actif pourrait réaliser. Le mouvement syndical pourrait aussi, selon lui, «se faire le champion d’une couverture universelle en matière de santé, de collèges de quartier gratuits, d’universités publiques gratuites, d’apprentissages plus nombreux et de meilleure qualité, de congés paternels payés, d’un système fiscal plus équitable… de logements abordables, d’écoles publiques de qualité, de transports publics excellents et un air et une eau non pollués», écrit-il dans Beaten Down, Worked Up. C’est une liste incroyablement audacieuse, mais c’est un but. Greenhouse veut voir les travailleurs/travailleuses participer à tous les aspects de la vie états-unienne construire un filet de sécurité sociale plus solide et se battre pour tout le monde. (Article publié dans The New Republic en date du 20 août 2019; traduction rédaction A l’Encontre)
Sheila McClear est écrivaine, vivant à New York.


Soyez le premier à commenter