
Par Layla Martínez
Cette histoire débute par une fuite. Des militants de la CNT [Confédération nationale du travail, le plus grand syndicat espagnol avant la guerre civile, anarcho-syndicaliste] ont brûlé jusqu’aux fondations l’Instituto Católico de Artes y Oficios de Madrid. Le directeur de l’Institut, le jésuite José Agustín Pérez del Pulgar, a décidé de partir pour la Belgique. L’attaque contre cet édifice n’était en rien un hasard. Pérez del Pulgar est un militant actif de la droite la plus réactionnaire; il met à profit sa fonction pour diffuser de la propagande, il est convaincu de la nécessité de freiner l’expansion des idées marxistes parmi les jeunes. Quelques mois après avoir quitté le pays, la guerre civile éclate. Il décide de rentrer, se placer au service du soulèvement, participer à la croisade qui sauvera l’Espagne.
Pérez del Pulgar passe les mois suivants au nord de la péninsule. Il sait bien que sa place n’est pas au front, mais à l’arrière-garde le travail ne manque pas pour des hommes tels que lui. Il ne perd pas son temps. Il se met en relation avec Máximo Cuervo Radigales [1893-1982], un général très proche des sommets ecclésiastiques en raison de son activité à la direction du CEU [Centro de Estudios Universitarios, fondé en 1933 par l’Association catholique de propagandistes]. Cuervo Radigales est sur le point de devenir l’un des personnages les plus dangereux et obscurs du régime franquiste, il a toutefois besoin de l’aide du jésuite. Les deux vont commencer à construire l’appareil idéologique qui soutiendra le système pénitentiaire de la dictature.
La récompense est immédiate. En 1938, Cuervo Radigales est nommé Directeur général des prisons; il réorganise les prisons sous contrôle franquiste. Avec l’aide de Pérez del Pulgar, il crée un système de travail forcé pour les prisonniers qui sera maintenu pendant toute la durée de la dictature. Celui-ci est placé sous le contrôle d’un nouvel organisme, le Patronato de Redención de Penas por trabajo [Fondation/patronage de rédemption des peines par le travail]. Cuervo Radigales place le jésuite à la tête du Patronato, ce dernier est placé sous sa responsabilité directe. L’une des machines répressives parmi les plus cruelles du régime vient de naître. Ce Patronato ne sera, toutefois, pas le seul organisme qui fera appel à du travail esclave. Il faut en effet ajouter au système pénitentiaire le système de camps de concentration créé dans l’ensemble de la péninsule au sein desquels ont également été constitués des bataillons de travail. Leurs prisonniers ne devaient pas même accomplir des peines, car ils n’avaient pas été jugés. Ils dépendaient directement de l’Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP) puis de la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios.
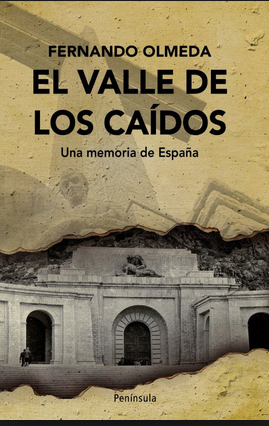 Bien que le travail forcé des prisonniers fût chose courante depuis le coup d’Etat [en juillet 1936], la construction du Valle de los Caídos [Vallée des tombés, basilique creusée dans la roche située à quelques kilomètres de Madrid et où sont enterrés le fondateur de la Phalange, José Antonio Primo de Rivera, et Franco] sera l’un des premiers chantiers à faire massivement usage de main-d’œuvre esclave. Franco voulait un grand mausolée, un monument digne de la croisade qu’il venait de terminer. Il attendit peu avant de lancer les travaux. Le 1er avril 1940, date du premier anniversaire de la victoire, il publie un décret ordonnant le début des travaux. Le document ne laisse aucun doute quant au but poursuivi: Franco souhaitait rendre hommage à ceux qui étaient tombés en se battant à ses côtés. «Destination éternelle de pèlerinage, où le grandiose de la nature offre un cadre digne au terrain dans lequel reposent les héros et martyres de la Croisade.»
Bien que le travail forcé des prisonniers fût chose courante depuis le coup d’Etat [en juillet 1936], la construction du Valle de los Caídos [Vallée des tombés, basilique creusée dans la roche située à quelques kilomètres de Madrid et où sont enterrés le fondateur de la Phalange, José Antonio Primo de Rivera, et Franco] sera l’un des premiers chantiers à faire massivement usage de main-d’œuvre esclave. Franco voulait un grand mausolée, un monument digne de la croisade qu’il venait de terminer. Il attendit peu avant de lancer les travaux. Le 1er avril 1940, date du premier anniversaire de la victoire, il publie un décret ordonnant le début des travaux. Le document ne laisse aucun doute quant au but poursuivi: Franco souhaitait rendre hommage à ceux qui étaient tombés en se battant à ses côtés. «Destination éternelle de pèlerinage, où le grandiose de la nature offre un cadre digne au terrain dans lequel reposent les héros et martyres de la Croisade.»
C’est là que Pérez del Pulgar revient dans notre histoire. Dans un pamphlet publié fin 1939, sous le titre La solution de l’Espagne au problème des prisonniers politiques, le jésuite jettent les bases de ce qui sera sa tâche à la tête du Patronato de Redención de Penas por Trabajo: «il est bien juste que les prisonniers contribuent par leur travail à la réparation des dommages auxquels ils ont contribué en collaborant avec la rébellion marxiste.» Del Pulgar va faire en sorte qu’ils paient.
Le fonctionnement du Patronato était simple: les entreprises et les entités publiques sollicitaient des prisonniers comme travailleurs et les responsables décidaient du nombre qui leur serait attribué ainsi que la prison où ils seraient sélectionnés. Les Archives générales de l’administration conservent les registres élaborés par le Patronato entre 1940 et 1960. Ceux-ci détaillent les prisonniers attribués, le lieu de destination et le travail qu’ils devront réaliser. Ces données n’ont toutefois pas pu être consultées de manière systématique, raison pour laquelle les chercheurs qui travaillent sur ce thème ont dû recourir aux Memorias de la Dirección General de Prisiones. Les recherches indiquent qu’il y avait des entreprises de tout type, y compris des petits commerces et des particuliers qui sollicitaient une domestique. Alors qu’ils travaillaient, ils étaient enfermés dans des colonies pénitentiaires, en détachement pénal, ou même dans des prisons. Pour avoir une image générale du système d’enfermement, il faudrait ajouter à ces colonies pénitentiaires les camps de concentration dont la fonction était d’interner et de classer les prisonniers de guerre.
Les chiffres et l’étendue de cette pratique à tous les secteurs de l’économie montrent que le système de travail esclave n’avait rien de provisoire, mais qu’il s’agissait bien d’un pilier central de l’économie franquiste. D’après les historiens qui ont traité de cette question, le nombre le plus élevé de prisonniers a été destiné aux infrastructures et travaux publics: construction de chemins de fer, routes, canaux, prisons et mines. Un exemple est celui de la construction de la prison de Carabanchel, à Madrid, où l’on sait qu’en 1946 956 prisonniers travaillaient, bien que l’on ne possède pas de données sur d’autres années.
Dans son ouvrage intitulé El Valle de los Caídos: Una memoria de España, l’une des recherches les plus détaillées sur la construction du monument, l’historien Fernando Olmeda ne s’aventure pas à donner des chiffres sur le nombre de prisonniers qui ont œuvré au Valle en raison des difficultés à trouver ces données. D’après les Memorias de la Dirección General de Prisiones, il y aurait eu environ 500 prisonniers par année entre 1943 et 1950, bien qu’il n’y ait aucun chiffre pour certaines années.
Les travaux furent confiés à trois entreprises de la construction – Banús, Molán et San Román – dont les dirigeants eux-mêmes faisaient le tour des prisons pour sélectionner les détenus. Teodoro García Cañas, prisonnier à Ocaña, rappelle dans le libre Esclavos por la patria comment Juan Banús examinait personnellement les dents et les muscles des prisonniers pour choisir ceux qui seraient les plus à même à tenir le coup. Nombreux sont ceux qui ne le firent pas. Aux morts causés par les mauvaises conditions de travail et par l’épuisement, il faut ajouter ceux qui moururent de silicose à la suite du travail dans les cryptes.
Pérez del Pulgar observait la progression du Valle de los Caídos et souriait. Les prisonniers se rachetaient non seulement vis-à-vis de la patrie, mais aussi face à Dieu. En échange de leur travail, le Patronato avait établi un système de réduction des condamnations et un salaire dont l’objectif était de montrer qu’il était possible de revenir sur le droit chemin et d’obtenir le pardon. Ce qui est sûr, c’est que ces mesures furent peu mises en place. Le système pénitentiaire de Cuervo Radigales était fondé sur l’arbitraire et la torture systématique des détenus, qui souffraient de mesures telles que la politique de dispersion permanente baptisée de «tourisme pénitentiaire» par Radigales. Pour ce qui est du salaire, il était fixé à 2 pesetas par jour, desquels l’Etat déduisait 1,5 pour les frais d’entretien.
La plus grande fosse commune de la péninsule
Franco choisi un autre anniversaire pour l’inauguration du Valle de los Caídos, celui de 1959 [20 ans après la fin de la guerre civile]. Alors que dans un premier temps il avait été décidé que seuls les héros franquistes y seraient enterrés, en 1958 le régime changea d’idée: une lettre du ministre de Gobernación [de l’intérieur] spécifiait que les inhumations se feraient «sans distinction du camp dans lequel ils combattirent». L’endroit ne cessa jamais d’être un monument à la victoire franquiste, mais on décida d’y transférer les cadavres provenant de fosses communes de pratiquement toute la péninsule, sans tenir compte d’où ils venaient et sans aviser les familles.
L’énorme transfert, 33’833 corps, qui se prolongea jusqu’en 1983, transforma le Valle de los Caídos en la plus grande fosse commune d’Espagne. 12’410 cadavres n’ont toujours pas été identifiés. Bien que les fosses aient été déclarées de propriété de l’Etat en 2007, leur accès dépend de l’Eglise en vertu des accords de 1979 avec le Vatican. L’Eglise a fait usage de ce pouvoir pour refuser les identifications, y compris contre des décisions judiciaires comme dans le cas, en 2017, de Manuel et Ramiro Lapeña.
Ces accords, qui ont rang de traité international et sont par conséquent au-dessus des lois nationales, constituent l’obstacle principal auquel fait face le gouvernement [Sánchez] pour transférer les restes de Franco. L’avenir du mouvement soulève toutefois d’autres questions. L’une d’elles est celle de sa transformation possible en un mémorial des victimes des deux camps, ainsi que l’avait recommandé le Comité d’experts nommé par Zapatero en 2011. Cette transformation semble compliquée pour un monument dont la finalité était claire dès le début et qui est resté, jusqu’à aujourd’hui, un lieu d’hommage au franquisme. Il s’agit aussi de répondre à des questions telles que celle du financement de sa restauration, dont le coût est estimé à 13 millions d’euros en raison de l’importante détérioration du monument.
 En 2011, Joan Tardá [député membre d’ERC] proposa au Congrès que ces coûts soient portés par les entreprises qui s’étaient enrichies grâce à l’usage de main-d’œuvre esclave. Pour appuyer son propos, il utilisa une photographie des travaux où l’on pouvait voir une affiche de l’entreprise Huarte, ancêtre de l’actuelle OHL [Obrascón Huarte Lain, S.A., l’une des six plus grandes entreprises espagnoles de la construction]. Au dos de la photo, une note indiquait qu’il fallait effacer l’affiche pour éviter toute association avec l’entreprise. En réalité, la participation de Huarte aux chantiers fut plus tardive, en 1950, alors que, selon les données de la Dirección General de Prisiones, il n’y avait plus de travail esclave. Toutefois, ainsi que l’ont signalé les collectifs de mémoire historique de Navarre lorsque Félix Huarte a reçu la médaille d’or de Navarre, la complicité de ce dernier avec la dictature était très forte. Il est probable qu’il ait eu recours à du travail esclave sur d’autres chantiers, tels que la construction de l’aérodrome d’Ablitas.
En 2011, Joan Tardá [député membre d’ERC] proposa au Congrès que ces coûts soient portés par les entreprises qui s’étaient enrichies grâce à l’usage de main-d’œuvre esclave. Pour appuyer son propos, il utilisa une photographie des travaux où l’on pouvait voir une affiche de l’entreprise Huarte, ancêtre de l’actuelle OHL [Obrascón Huarte Lain, S.A., l’une des six plus grandes entreprises espagnoles de la construction]. Au dos de la photo, une note indiquait qu’il fallait effacer l’affiche pour éviter toute association avec l’entreprise. En réalité, la participation de Huarte aux chantiers fut plus tardive, en 1950, alors que, selon les données de la Dirección General de Prisiones, il n’y avait plus de travail esclave. Toutefois, ainsi que l’ont signalé les collectifs de mémoire historique de Navarre lorsque Félix Huarte a reçu la médaille d’or de Navarre, la complicité de ce dernier avec la dictature était très forte. Il est probable qu’il ait eu recours à du travail esclave sur d’autres chantiers, tels que la construction de l’aérodrome d’Ablitas.
Huarte n’était pas seul. Les grandes fortunes de l’IBEX 35 [l’indice boursier espagnol], édifiés sur le travail esclave, ne souhaitaient pas laisser de traces de leur passé. Ainsi que l’ont découvert des recherches du Financial Times, publiées en 2003, et de La Marea, en 2014, aux côtés d’OHL se trouvent de nombreuses autres entreprises dont la fortune repose sur le travail forcé, des compagnies minières Norte ou Duro à des entreprises de la construction comme Acciona et ACS en passant par Iberdrola ou Gas Natural Fenosa.
Toutes ces entreprises ont refusé de donner toute explication et à fournir des informations sur cette affaire. Le système créé par Pérez del Pulgar et Cuervo Rodigales produit toujours, bien des années plus tard, des bénéfices. (Article publié le 27 juin sur le site Elsaltodiario.com. L’auteure remercie l’historien Fernán Mendiola pour la révision et l’amélioration du texte. Traduction A l’Encontre)

Soyez le premier à commenter