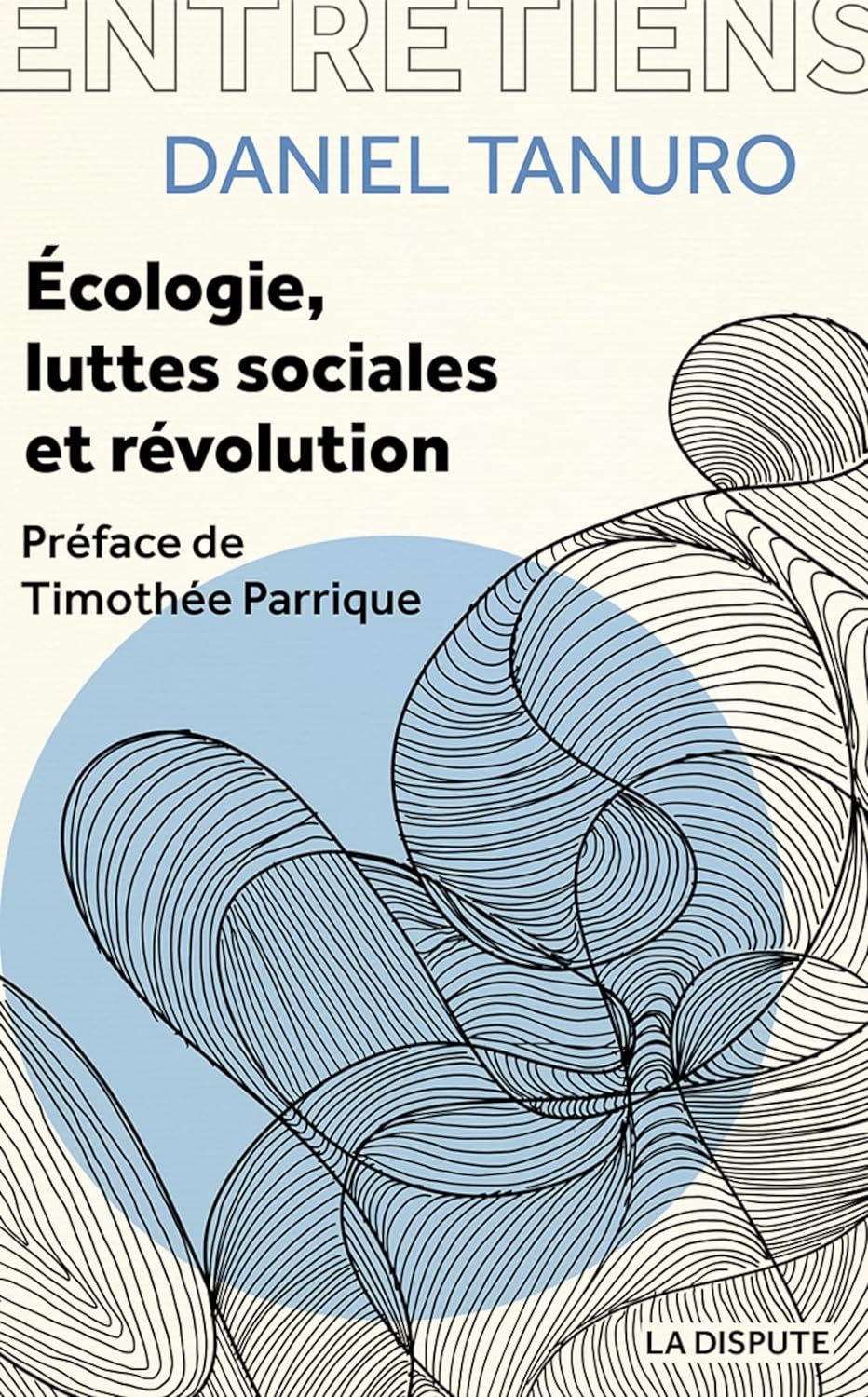
[En mars 2024, les éditions La Dispute publiaient cet ouvrage. Dans l’avant-propos, Alexis Cukier et Marina Garrisi indiquaient: «Dès le lancement de la collection «Entretiens» nous souhaitions publier un ouvrage pour déplier les enjeux et les problèmes que les catastrophes écologiques en cours posent à la théorie et à l’action politiques.» Dans ce but, ils se sont adressés à Daniel Tanuro, dont les compétences professionnelles, l’activité militante et les élaborations théoriques se sont déjà explicitées dans divers ouvrages tels que L’Impossible capitalisme vert (La Découverte, 2010), Trop tard pour être pessimiste (Textuel, 2020) et Luttes sociales et écologiques dans le monde, avec Michael Löwy (Textuel, 2021). Ces entretiens ont été préfacés par Timothée Parrique; le titre de sa contribution désigne une question d’importance: «La décroissance comme transition, l’écosocialisme comme destination». La lecture de cet ouvrage, dont la rigueur ne fait pas obstacle à l’accessibilité, constitue un instrument pour une activité écosocialiste informée. Les deux grands entretiens qui structurent l’ouvrage – «Ce que l’on sait», «Ce que l’on peut faire» – l’illustrent. Un ouvrage à lire (et pour cela à acquérir…). Le choix des extraits, publiés ci-dessous, a été proposé par Robert Mertzig. – Réd.]
***
«Du point de vue de l’état des connaissances scientifiques, je le répète, il n’y a pas de doute ni sur la gravité de la crise, ni sur ses causes «anthropiques». Comment qualifier cette crise? En grec ancien, katastrophè signifie retournement, changement complet, révolution. Cette définition implique un moment brusque de basculement. À première vue, on n’est pas vraiment dans ce scénario. Plutôt dans celui d’une catastrophe qui dure. Elle a débuté assez lentement dans l’après-guerre, puis a grossi de plus en plus vite. Aujourd’hui, elle se manifeste dans des accidents spectaculaires: les mégafeux en Australie en 2020 et au Canada en 2023, les inondations au Pakistan en 2022, les sécheresses graves dans l’isthme centraméricain ou en Afrique de l’Est, les records de chaleur un peu partout, etc. Quand on regarde ces phénomènes avec quelques décennies de recul, aucun doute n’est permis: primo, leur nombre et leur intensité augmentent; secundo, les politiques censées les enrayer sont inopérantes. On songe alors à la citation de Walter Benjamin: «La catastrophe, c’est que tout continue comme avant.» Nous sommes effectivement déjà dans la catastrophe, nous nous y enfonçons, elle monte autour de nous, des points de bascule partiels sont franchis. Mais sa temporalité longue ne doit pas faire perdre de vue la menace d’un «grand basculement». Les processus ne sont pas linéaires. La quantité se transforme toujours, à un moment ou l’autre, en qualité.»
***
«On parle d’un changement d’ère géologique (ou au moins d’un événement géologique), il faut donc appliquer les critères des géologues. Un changement d’ère se caractérise par la présence globale dans la croûte terrestre de marqueurs objectifs, stratigraphiques. Les principaux marqueurs possibles d’un Anthropocène pourraient être: la trace laissée par la hausse du niveau des océans au XXe siècle, les témoignages fossiles du déclin brutal de la biodiversité, la présence dans les roches de nouvelles entités chimiques telles que des microplastiques et des nucléides radioactifs. Ces critères fournissent une base solide pour situer le début de l’Anthropocène après la Seconde Guerre mondiale. Le phénomène est donc directement lié à cette période que les spécialistes du changement global appellent la grande accélération, les historiens les Trente Glorieuses et que les marxistes désignent comme l’onde longue de croissance du capitalisme dans l’après-guerre. … Selon moi, les écosocialistes ont doublement intérêt à s’en tenir aux marqueurs géologiques car ils sont les plus solides scientifiquement, et conduisent tout droit à la conclusion simple que le changement intervient dans les années 1950, comme résultat d’un siècle et demi d’accumulation capitaliste. Par rapport à cet enjeu, le débat sémantique me semble très secondaire. Pour moi, les propositions de Capitalocène, de Plantationocène, d’Androcène (pour ne pas parler du Chthulucène de Donna Haraway) sont à côté du sujet.
Les anticapitalistes préfèrent parler de Capitalocène plutôt que d’Anthropocène pour souligner que c’est le capitalisme qui est responsable, et pas l’espèce Homo sapiens. Dans le même ordre d’idées, je peux comprendre que des personnes investies dans les luttes d’émancipation anticoloniales préfèrent parler de Plantationocène, et que des féministes proposent le terme Androcène. Ces volontés de mettre en accusation le capitalisme, le colonialisme et la domination patriarcale sont mille fois justifiées. Il faut en effet s’opposer aux tentatives d’utiliser «l’Anthropocène contre l’histoire», comme dit fort bien Andreas Malm. Ces tentatives escamotent les déterminants sociaux, les dissolvent dans les lois de la nature. On efface ainsi l’histoire, en particulier le capitalisme, le colonialisme et le patriarcat. C’est du scientisme et le scientisme est une arme idéologique aux mains de la classe dominante.»
***
«Un troisième problème surgit quand on se rappelle que la catastrophe écologique n’est pas due uniquement au capitalisme. L’URSS stalinienne, les pays du glacis soviétique et la Chine maoïste portent une responsabilité non négligeable. Une manière simple de parer l’objection consiste à prétendre que ces pays connaissaient un capitalisme d’État, mais ce simplisme ne s’accorde pas avec la définition scientifique du capitalisme proposée par Marx: une société de (sur)production généralisée de marchandises, basée sur la propriété privée des moyens de production, constamment bouleversée par la concurrence pour le profit. L’ex-URSS ne cochait aucune de ces cases. Il me semble beaucoup plus convaincant de dire qu’il s’agissait d’une société en transition vers un socialisme qui ne pouvait exister qu’au niveau mondial, que son évolution non capitaliste a été bloquée par une contre-révolution nationale-bureaucratique, et qu’il en est résulté une forme sociale sclérosée, non viable. J’admets que cette explication est plus complexe, mais elle a l’avantage de faire surgir les questions stratégiques que la théorie du capitalisme d’État laisse dans l’ombre: comment éviter qu’un productivisme spécifique, qui n’est pas exactement le même que le productivisme capitaliste, puisse se développer dans le cadre d’une économie collectivisée? Comment éradiquer l’idéologie bourgeoise de domination de la nature dans le cadre d’un processus révolutionnaire? Et les réponses à ces questions sont nécessaires à nos luttes.»
***
«On a d’un côté les économistes mainstream, selon qui la croissance capitaliste est nécessaire pour produire les technologies nécessaires à la transition. Et de l’autre ces économistes critiques qui répondent que c’est impossible parce que cette production demande plus d’énergies fossiles, donc plus d’émissions, qu’il faut donc décroître en satisfaisant les besoins de base, dans la justice sociale. Les implications politiques de cette controverse sont évidentes. Le développement de ce courant de la décroissance juste me réjouit tout particulièrement, j’y retrouve des arguments que je développais il y a treize ans dans mon livre L’Impossible capitalisme vert: on ne peut pas à la fois passer aux renouvelables, augmenter radicalement l’efficience énergétique, poursuivre la croissance du PIB et sauver le climat en réduisant les émissions. Pour une raison évidente: les renouvelables et l’efficience demandent d’énormes investissements, donc beaucoup d’énergie… fossile à 80%, donc source d’émissions. Je pense que cette controverse va s’approfondir…»
***
«Le savoir écologique traditionnel, avec sa part de croyances et de magie, serait-il plus efficace que le savoir scientifique moderne? … Une réponse est suggérée par les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur «l’ingénierie écologique». Ils et elles soulignent que les techniques découlant des savoirs écologiques traditionnels sont d’une grande importance pour relever les défis de la catastrophe actuelle. Les écosystèmes ont été façonnés par l’activité humaine pendant des générations, on ne peut les restaurer technocratiquement, en faisant fi de ce qui a guidé cette activité. Appréhender les techniques implique la reconnaissance des modes de production de l’existence où les techniques se sont développées. Ici, l’intérêt se porte surtout sur les communautés où les savoirs traditionnels sont les mieux préservés – c’est-à-dire les communautés indigènes. Le paradoxe du savoir s’explique alors par les différences entre modes de production. Il n’exprime pas la supériorité des croyances et de la magie sur la raison scientifique, il exprime la supériorité, notamment face aux catastrophes, d’un mode de production sans classes, où les humains puisent directement dans l’environnement de quoi produire les valeurs d’usage nécessaires à l’existence sociale.»
***
«Du point de vue des savoirs, le capitalisme présente… deux mouvements contradictoires. D’une part, les connaissances scientifiques basées sur la raison progressent spectaculairement et percolent plus ou moins dans toute la société par le biais du système éducatif. D’autre part, la dépossession du travail social, sa soumission croissante au capital et l’appropriation capitaliste de la science engendrent un abêtissement de masse qui favorise la déraison, sur laquelle surfent les climatosceptiques, les négationnistes du Covid-19, etc. Nous sommes des animaux sociaux qui produisent leur existence collective par le biais d’une activité consciente (le travail) que notre intelligence développe au fil des générations. En s’appropriant le travail, en l’émiettant et en le soumettant à sa logique absurde, le capitalisme déconnecte cette intelligence de son objet principal. Il fait de nous des créatures mutilées qui errent sans but dans un univers absurde. Je pense que cela contribue à expliquer le sentiment d’impuissance qui obscurcit considérablement la prise de conscience.»
***
«D’un côté, on voit à quel point l’impasse du capitalisme est profonde: le «capitalisme vert» est vraiment impossible, il ne nous sortira pas de la catastrophe et est même incapable de la freiner. De l’autre côté, il faut être aveugle pour ne pas voir les difficultés immenses de l’alternative. Un bouleversement complet, révolutionnaire, est nécessaire. Comment le rendre désirable aux yeux d’une majorité sociale? Comment répondre aux inquiétudes des exploité·es et des dominé·es sur l’emploi, les revenus, les droits démocratiques, l’avenir en général? Tel est le défi que nous avons à relever. En tant que tel, le plaidoyer philosophique contre le dualisme entre nature et culture n’est d’aucune aide dans cette entreprise. Même quand il est prononcé au nom du marxisme et de la lutte contre le Capitalocène, à la manière de Jason Moore. C’est sur l’élaboration d’un programme à la fois social et environnemental, sur l’invention d’une stratégie et sur la mise au point de tactiques de lutte qu’il faut se concentrer et se rassembler.»
***
«On observe partout une répression croissante de ce que nous avons appelé avec Michael Löwy les luttes écosociales. Ce phénomène est à appréhender dans le cadre de la crise très profonde du capitalisme. Confrontés à une baisse régulière des gains de productivité, les capitaux sont attirés par les investissements dans les richesses naturelles, parce qu’elles sont gratuites. Le secteur minier, les groupes énergétiques, l’agrobusiness rivalisent pour s’approprier toujours plus de ressources, au détriment des communautés locales. C’est ce que le géographe marxiste David Harvey nomme l’accumulation par dépossession. Dans les pays du Sud principalement, les multinationales lorgnent vers des territoires, y compris des réserves naturelles, abritant des gisements de pétrole ou de minéraux, des aquifères ou des ressources hydroélectriques inexploitées. Cette tendance est porteuse d’une brutalité croissante. En effet, la raréfaction des ressources exacerbe la concurrence et la violence. Un·e activiste investi·e dans la lutte écosociale a été tué·e tous les deux jours dans le monde en 2022.»
***
«Pour ma part, je n’emploie l ‘expression «capitalisme vert» que pour désigner les secteurs du capital qui prétendent investir dans la transition écologique et leurs représentants politiques. Mais il faut bien comprendre que, d’une manière générale, c’est un oxymore. Il n’y a aucune compatibilité entre la dynamique intrinsèque d’accumulation du capital et la gestion rationnelle des échanges de matières, à la fois au sein de la société humaine et entre celle-ci et le reste de la nature. En tant que système, le capitalisme est par définition insoutenable, à la fois du point de vue écologique et du point de vue social. Ce qui se passe, c’est que les menaces que la catastrophe climatique fait peser sur la stabilité de ce système sont tellement inquiétantes que les plus lucides des responsables veulent croire à l’impossible: guérir par le capitalisme le mal congénital du capitalisme. L’Union européenne est en pointe de ces tentatives. Les États-Unis et la Chine sont pour le moment sur leurs talons. Mais la réalité est aux antipodes des belles promesses.»
***
«L’ère de la domination absolue du monde par les États-Unis est en effet révolue. Nous sommes entrés dans une configuration nouvelle, où plusieurs impérialismes se disputent l’hégémonie. La Chine est devenue une superpuissance en reproduisant à très grande échelle la recette des «tigres asiatiques», soit le développement rapide d’un capitalisme sous contrôle étatique. Les «nouvelles routes de la soie» matérialisent le projet impérialiste de Pékin. Celui-ci s’accompagne logiquement de la constitution d’une force armée capable de se projeter sur les théâtres extérieurs. Moscou s’allie avec Pékin contre l’Occident tout en poursuivant son propre objectif de reconstitution de l’empire russe, notamment en Asie centrale, une zone également convoitée par la Chine. Des puissances intermédiaires profitent de cette situation complexe pour développer leur autonomie et offrir leur soutien à la plus offrande des puissances – tantôt l’une, tantôt l’autre. Dans les pays dominés, ces différents éléments se traduisent par une intensification de la destruction écologique et de ses conséquences sociales, notamment l’appropriation des terres (land grabbing). Nous n’assistons pas à un retour de la guerre froide entre blocs bien délimités, les rapports de force sont plus mouvants et les guerres se multiplient. C’est une banalité de dire qu’elles sont à l’opposé d’une politique écologiquement responsable. … Sous le capitalisme, le progrès technologique met constamment de nouveaux moyens à disposition des militaires.»
***
«L’analyse aide au moins à prendre la mesure du problème. Il est gigantesque. Matt Huber a entièrement raison de dire que les dépossédé·es restent le sujet par excellence d’une révolution nécessaire, mais l’ampleur et la profondeur de leur dépossession – leur «dépendance absolue du capital» – entraînent une énorme difficulté à penser une autre société non pas seulement comme utopie abstraite, mais comme projet concret impliquant des luttes, des revendications, des formes d’organisation, une vision sur l’unification entre couches différentes au sein de la classe, une tactique vis-à-vis des bureaucraties cogestionnaires, des alliances avec d’autres mouvements sociaux, des étapes transitoires, bref, une stratégie. C’est vraiment compliqué. D’autant plus compliqué qu’il y a en toile de fond la faillite au XXe siècle du projet socialiste dont les deux versions dominantes – la social-démocratie et le stalinisme – sont des repoussoirs.»
***
«La seconde remarque concerne «le parti». Je ne suis pas spontanéiste: une organisation politique est nécessaire pour assimiler les leçons de l’histoire, tracer des perspectives et organiser des membres sur un programme, par-delà les hauts et les bas des luttes. Par ailleurs, faire converger ces luttes est une tâche complexe. Cela requiert la présence, dans le plus grand nombre de secteurs et de mouvements, de militant·es partageant une même vision stratégique, et qui échangent les informations, les analyses. Pour être utile à un projet émancipateur, cette organisation politique ne peut être ni un parti au sens institutionnel du terme, ni le genre de regroupement autour d’un leader charismatique que proposent les populistes de gauche. Ces deux types de formation ont en effet un point commun: le verticalisme qui écrase la spontanéité au profit de la priorité donnée à l’occupation du pouvoir par la voie électorale. Les partis d’avant-garde autoproclamés ne sont pas davantage appropriés à la tâche. Comment faire émerger une formation anticapitaliste composée de militantes et militants qui mettent en pratique une stratégie authentiquement révolutionnaire d’auto-organisation démocratique des mouvements, en solidarité internationaliste avec tou·tes les exploité·es et tou·tes les opprimé·es? Après un demi-siècle engagement, j’avoue avoir plus d’interrogations que de réponses à ce sujet.»
***
«Je participe à un travail collectif … [écologisation du programme de transition] au sein du mouvement dont je suis membre, la Quatrième Internationale. Il est clair que la méthode dite «transitoire» est d’une actualité brûlante. On peut moins que jamais se contenter d’agiter des revendications immédiates, d’une part, et de propager l’idée d’une société socialiste ou écosocialiste, d’autre part. Il faut jeter un pont entre les deux. Cette préoccupation était déjà présente chez Marx et Engels. Jaurès a tenté de la développer avant 1914. Trotsky, dans les années 1930, lui a donné sa formulation la plus achevée. Il proposait de présenter un ensemble de revendications fournissant une réponse globale, cohérente, aux contradictions de la société en crise. Prises isolément, expliquait-il, certaines de ces revendications sont compatibles avec le capitalisme, mais elles sont reliées entre elles, de sorte que le programme dans son ensemble est en contradiction avec le fonctionnement normal du système. C’est pourquoi il débouche sur une conclusion centrale: la nécessité de s’emparer du pouvoir politique, d’instaurer par la mobilisation un gouvernement aussi fidèle aux exploité·es et aux opprimé·es que tous les gouvernements actuels sont fidèles aux capitalistes.»
***
«Il n’est pas encore minuit dans le siècle mais on risque de s’en approcher. De Buenos Aires à Mar-a-Lago, de Moscou à Tel Aviv, de Rome à Paris, le déni climatique et la «liberté» du renard dans le poulailler dessinent le nouveau visage du nihilisme fasciste au service du capitalisme fossile. Le péril est immense, mais le néofascisme est une carte dangereuse à jouer pour la classe dominante. Plus d’une fois il a amené des retours de flamme. Je ne céderai pas à la facilité de ressortir la citation fameuse de Gramsci, tout le monde la connaît. J’ajouterai seulement ceci: face à la menace d’une nouvelle plongée dans la barbarie, nous n’avons tout simplement pas d’autre choix que l’espérance. Nous n’avons pas d’autre choix que de lutter pour un programme rouge et vert, un programme qui réponde aux besoins fondamentaux des classes populaires en jetant un pont vers la transformation révolutionnaire de la société. La difficulté est énorme, mais il n’y a pas d’autre voie. Il n’y a pas de fatalité à voir la catastrophe devenir cataclysme. Homo sapiens produit sa propre existence sociale, j’ai rappelé cette vérité élémentaire plusieurs fois au cours de l’entretien. «Produire» signifie «faire apparaître», « faire naître». Les exploité·es, les opprimé·es uni·es peuvent «produire», «faire apparaître», «faire naître» une alternative lumineuse aux ténèbres. À chaque étape de la catastrophe grandissante, leurs luttes pour l’émancipation du travail peuvent ouvrir la voie vers un autre possible, digne de la nature humaine. On ne peut prévoir que la lutte. On ne peut que s’accrocher à l’espérance pour y puiser l’énergie nécessaire à la lutte.»

Soyez le premier à commenter