
Par Alain Bihr
Au printemps 1566 éclatent dans l’ensemble des Anciens Pays-Bas, alors possession espagnole (castillane), des troubles dont personne ne peut alors imaginer qu’ils se solderont quelque quatre-vingts ans plus tard par la victoire des insurgés, certes repliés sur sept seulement des dix-sept provinces dont se composaient ces Pays-Bas, tant la disproportion du rapport de force est énorme.
La guerre de Quatre-vingts Ans
C’est que les geuzen révoltés [10] se trouvent face au plus puissant Etat européen de l’époque, l’Espagne habsbourgeoise, qui vient à peine dix ans auparavant de faire céder la France au terme du cycle des guerres dites d’Italie (1494-1557). Leur victoire s’explique précisément par le fait qu’eux ont su réunir la plupart des conditions de cette stratégie optimale que je viens de définir [voir la première partie de l’article publié le 21 avril 2023]; ce dont l’Espagne (la Castille) va s’avérer incapable.
1. En premier lieu, la suprématie maritime. Au cours des deux siècles précédents, les provinces septentrionales des Anciens Pays-Bas (Hollande et Zélande en tête) étaient devenues une puissance maritime de tout premier ordre, tant dans le domaine de la pêche (notamment aux harengs) que dans celui du commerce et du fret maritimes (en direction tant de la Méditerranée que des îles Britanniques et de la Baltique). Elles avaient accumulé ainsi moyens matériels (navires de tous types, chantiers navals, accès aux fournitures navales) et savoir-faire (matelots et capitaines expérimentés, traditions maritimes).
De ce fait, sur ce terrain, le rapport de force sera d’emblée favorable aux insurgés, comme le montreront les succès des zeegeuzen (les gueux de la mer) dès le début des années 1570. C’est ce qui leur vaudra de contrôler rapidement les côtes frisonnes, hollandaises et zélandaises, en élargissant leur tête de pont. Et ce rapport de force ne cessera de se déséquilibrer en leur faveur par la suite: en témoigneront les défaites cuisantes des Espagnols à Gibraltar (25 avril 1607) et aux Downs (21 octobre 1639) ainsi que les pertes infligées plus généralement à la marine espagnole tout le long du conflit. De ce fait, cette supériorité maritime soumettra à une menace constante les côtes des possessions espagnoles, tant aux Amériques qu’en Europe, ainsi que les voies maritimes les reliant entre elles.
La suprématie maritime néerlandaise va ainsi contraindre les Espagnols à chercher à vaincre les insurgés par voie de terre, en tentant de jouer de leur supériorité écrasante sur ce terrain. Mais cette même suprématie maritime va aussi les entraver sur ce terrain même. Elle va les contraindre à acheminer troupes et ravitaillement par voie de terre, depuis l’Italie (Gênes) jusqu’aux provinces méridionales des Anciens Pays-Bas via le Milanais, la Valteline, l’Allemagne méridionale et la vallée rhénane. Voie longue et pénible, rendue plus difficile encore par l’hostilité des populations de certaines régions traversées ou des puissances voisines, puis par la belligérance durant la guerre de Trente Ans tout le long de la vallée du Rhin.
2. La capacité hégémonique néerlandaise. Le deuxième atout des Provinces-Unies aura bien été leur capacité à constituer, consolider et conduire un système d’alliances tourné contre leur ennemi. Il réunira tous les Etats qui auront à redouter le tropisme impérial espagnol et qui, à un titre ou un autre, auront un intérêt direct à la tenir en échec.
Dans un premier temps, en gros jusqu’à la trêve signée en 1609, cette capacité hégémonique est le fruit de la résistance opiniâtre et victorieuse que les Provinces-Unies opposent à l’Espagne. Elle se limite à attirer à elles l’Angleterre d’Élisabeth Ière (c’est avec elle que les Néerlandais déferont en 1588 la si mal surnommée Invincible Armada) et, dans une moindre mesure, la France de Henri IV.
Mais, lorsque les hostilités reprendront en 1621, les Provinces-Unies parviendront à constituer une alliance bien plus large et plus puissante, réunissant outre les princes allemands protestants révoltés contre l’empereur, successivement le Danemark, la Suède et surtout la France, singulièrement renforcée entre-temps. Ce qui leur permettra d’ailleurs de minimiser le coût de la poursuite de la guerre contre l’Espagne et ses alliés impériaux sur terre, en le reportant pour l’essentiel sur ses principaux alliés, la Suède puis la France, tout en les soutenant financièrement.
3. La puissance financière néerlandaise versus la gabegie financière castillane. La victoire néerlandaise a tenu, en troisième et dernier lieu, à la facilité dont disposaient les autorités néerlandaises (la Généralité, les amirautés, les différentes provinces et les principales villes, Amsterdam en tête) d’emprunter auprès de leurs propres sujets ou auprès d’étrangers, pour se procurer rapidement les ressources monétaires nécessaires à la poursuite de la guerre, en dépit de la dramatique augmentation de son coût après la reprise des hostilités en 1621. C’est qu’elles pouvaient gager le remboursement de leurs emprunts :
- sur une fiscalité dont les impôts indirects constituaient la part majeure, leur rentrée étant assurée par la large monétarisation de l’économie, adossée à la prospérité continue du commerce intérieur et extérieur néerlandais en dépit des hostilités, du fait qu’il était essentiellement un commerce maritime;
- sur le fait que les finances publiques néerlandaises, aux différents échelons du pouvoir, sont sous la surveillance ou même la direction d’assemblées représentatives (les Etats généraux, les Etats provinciaux, les municipalités), au sein desquels l’élément bourgeois est le plus souvent prépondérant; ce qui en garantit la saine gestion et la bonne tenue.
Inversement, faute d’un appareil fiscal aussi efficace, faute surtout d’une saine gestion de ses finances publiques, l’Etat espagnol (en fait castillan) va rapidement devoir compter exclusivement sur l’arrivée des métaux précieux américains et les disponibilités du crédit «international» (par l’intermédiaire des banquiers génois) pour faire face au coût grandissant de la guerre. Avec pour conséquences de se retrouver dans une situation de détresse financière à chaque fois que l’or et l’argent américains n’arriveront pas (notamment du fait de l’action des pirates et corsaires néerlandais et de leurs alliés), arriveront en retard ou arriveront en trop faible quantité, en devant prononcer une banqueroute au lendemain de laquelle le recours au crédit sera encore plus difficile… et plus onéreux.
Le tout ne pouvant que perturber la poursuite des opérations militaires, voire la rendre tout simplement impossible. C’est la banqueroute de 1575 qui provoque, neuf mois plus tard, la mutinerie générale des troupes mercenaires engagées contre les insurgés néerlandais n’ayant plus touché de soldes, conduisant à l’effondrement du pouvoir habsbourgeois à Bruxelles. Celle de 1607 contraint Philippe III à concéder une trêve aux insurgés début 1609. Celle de 1627 permet aux Néerlandais de s’emparer de Bois-le-Duc, de Wesel et d’autres localités, les troupes mercenaires espagnoles ayant cessé de combattre. Celle de 1647 précipite la signature de la paix.
Entre-temps, la tentative menée par le comte-duc d’Olivares, «Premier ministre» de Philippe IV, de soulager la Castille du fardeau fiscal de la guerre, en en reportant en partie la charge sur les autres composantes européennes de l’Empire des Habsbourg d’Espagne aura abouti à la révolte de la Catalogne et à la sécession du Portugal en 1640, en engageant les forces castillanes sur deux fronts supplémentaires. Les fiers souverains espagnols éprouveront ainsi à leurs dépens que, dans le monde protocapitaliste, la puissance militaire est devenue essentiellement une affaire de richesse marchande, commerciale et financière.
Résumons. Suprématie maritime, d’où prospérité marchande, d’où rendement assuré de la fiscalité indirecte, d’où larges possibilités d’emprunts, qui permettent de financer sans problème majeur l’effort de guerre sur mer ainsi que des coalitions garantes de l’établissement et du maintien d’alliances à direction hégémonique capables de contenir et même de vaincre l’ennemi sur terre, en permettant en retour de conserver et même de renforcer la suprématie maritime: voilà une base solide pour gagner une guerre prolongée dans les conditions de l’époque protocapitaliste.
La seconde guerre de Cent Ans
Ce sont en gros les mêmes facteurs qui vont assurer la victoire de la Grande-Bretagne sur la France durant cette seconde guerre de Cent Ans qui débute par la guerre de la Ligue d’Augsbourg et s’achèvera dans la «morne plaine» de Waterloo.
1. En premier lieu donc, la suprématie maritime. Paradoxalement, la recherche de cette suprématie est la conséquence directe de la lourde défaite que la France inflige à l’Angleterre à la fin de la première guerre de Cent Ans (1453). Car cette défaite prive la monarchie anglaise et l’élite de sa noblesse de leurs riches possessions sur le sol français et les confine dans les îles Britanniques. Encore affaiblies par la guerre des Deux Roses entre 1455 et 1485, elles n’auront plus d’autre choix que de se lancer, d’une part, dans une meilleure mise en valeur de leurs terres en Angleterre même (ce qui vaudra à cette dernière de s’engager tôt dans une «révolution agraire» protocapitaliste), d’autre part, dans la recherche de toutes les ressources que l’on peut tirer de la mer: la pêche, la piraterie et l’expansion commerciale et coloniale.
- La piraterie va ainsi devenir, au cours du XVIe siècle, la grande cause nationale anglaise, en s’exerçant non seulement dans la Manche et la mer du Nord au détriment du commerce français et néerlandais mais encore dans l’Atlantique, au détriment des flotas espagnoles rapportant l’or et l’argent extrait des mines de Zacatecas et de Potosi.
- L’expansion commerciale se fera tout d’abord sous la forme d’un intense cabotage au sein des îles Britanniques elles-mêmes, avant de se déployer dans la mer du Nord et la Baltique où elle viendra concurrencer le commerce néerlandais mais aussi en Méditerranée où elle se déploiera au détriment du commerce français. Et avec la constitution le 31 décembre 1600 de l’East India Company (la Compagnie anglaise des Indes orientales), les Anglais afficheront clairement leur ambition de venir contester les positions portugaises dans le commerce asiatique, même s’ils seront moins heureux que leurs rivaux néerlandais de la Vereenigde Oost-Indische Compagnie (la Compagnie néerlandaise des Indes orientales).
- Quant à l’expansion coloniale, elle se fera d’abord au détriment de l’Irlande au cours du XVIe siècle avant, dans la première moitié du siècle suivant, de s’emparer de positions espagnoles dans les Antilles (en y acquérant du même coup des points d’appui pour leur piraterie et leur contrebande) et d’occuper progressivement toute la façade atlantique de l’Amérique du Nord, entre le Saint-Laurent et la Floride.
Cette intense activité maritime, rien moins que pacifique par bon nombre de ses aspects, va tôt s’accompagner, dès Henri VII (1485-1509) et Henri VIII (1509-1547) de la formation d’une marine de guerre au sens propre, la première en Europe, la Navy, composée de navires hauturiers et non pas seulement de galères, produits par des arsenaux royaux. Cette marine va croître en puissance tout au long du XVIe siècle; ce sont par exemple les Anglais qui vont les premiers placer leur artillerie embarquée sur les ponts inférieurs, en faisant tirer les canons par des sabords, et qui vont mettre au point la tactique de la bataille en ligne.
La montée en puissance mais aussi les ambitions grandissantes de l’Angleterre sur mer se manifesteront clairement à partir du milieu du XVIIe siècle, lorsque le Parlement anglais adoptera les deux Navigation Acts (1652 et 1660), destinés à contester le quasi-monopole néerlandais dans le commerce et le fret maritimes dans la Baltique, en mer du Nord et même dans les Antilles. En effet, ils réservent aux seuls navires anglais la possibilité d’introduire en Angleterre et dans ses colonies des marchandises en provenance d’Asie, d’Afrique ou des Amériques; tandis que les marchandises en provenance d’Europe ne pourront y être introduites qu’en étant transportées par des navires anglais ou des navires des pays à partir desquels elles ont été exportées. Il va en résulter trois guerres anglo-néerlandaises (1652-1654, 1664-1667 et 1672-1674) au cours desquelles la Navy sera en mesure de faire mieux que bonne figure face aux redoutables marins néerlandais.
Et, dès lors que s’amorcera la seconde Guerre de Cent Ans, la suprématie de la Navy ne fera que se confirmer et se renforcer. L’Amirauté britannique, parfaitement soutenue par le Parlement, veillera tout au long du XVIIIe siècle à ce que son effectif soit en gros le double de celui de la Royale (la marine de guerre française) et dépasse même celui des deux marines française et espagnole réunies (alliées), en y consacrant l’essentiel du budget militaire. Et elle y parviendra d’autant mieux que, face à elle, la France aura tôt fait le choix inverse, celui de privilégier la guerre terrestre.
Inverse de celui des Anglais, le choix français est d’abord un choix contraint. Si l’Angleterre peut et même doit d’abord compter sur sa marine pour se défendre face à tout risque d’invasion, il ne peut en aller de même pour la France. Car, si la France possède une des plus longues façades maritimes en Europe, elle possède presque autant de frontières terrestres, dont certaines ne sont entravées par aucun obstacle naturel. Ainsi en va-t-il notamment de ses frontières du Nord-est, s’étendant du nord de l’Alsace à la Manche, une trouée par laquelle s’engouffreront toutes les invasions que le territoire français subira au cours des siècles. Il lui faut donc défendre ses frontières, notamment cette section particulièrement vulnérable, par des lignes de fortifications (Vauban s’y emploiera en particulier) et en entretenant de puissantes forces armées terrestres. Or on sait qu’aucun Etat européen n’a à l’époque les moyens d’être le plus puissant à la fois sur terre et sur mer.
Mais ce choix de la lutte sur terre répond aussi, dans le cas de la France, à d’autres facteurs, moins directement contraignants. Durant toute l’époque protocapitaliste, la Russie mise à part, la France est la formation sociale européenne la plus peuplée: elle comptera en moyenne sur la période une petite vingtaine de millions d’habitants, soit plus que deux fois la population de l’Espagne, plus que trois fois celle de l’Angleterre, entre huit et dix fois celle des Provinces-Unies, pour s’en tenir à ses voisines et rivales immédiates. Elle le doit essentiellement à sa richesse agricole, héritage du Moyen Age et même de l’Antiquité, qui en fait aussi un pays essentiellement rural, où les intérêts fonciers sont prédominants, en assurant une solide assise à la noblesse et au clergé. Ce qui ne peut que conforter l’idée qu’il n’est de richesse et de puissance que celles qui procèdent de la terre (les physiocrates ne diront pas autre chose jusque tard dans le XVIIIe siècle) et que le meilleur moyen de les accroître est d’étendre la surface des terres que l’on possède. D’où la tendance naturelle à préférer la guerre sur terre que celle sur mer.
D’autant plus que ces mêmes facteurs démographique et économique auront longtemps incité les marchands et manufacturiers français à se tourner d’abord vers le marché intérieur plutôt que vers les marchés extérieurs. Ce qui explique le retard avec lequel la France se lancera dans l’expansion commerciale et coloniale outre-mer (elle sera la dernière des grandes puissances d’Europe occidentale à entrer dans cette voie) et la longue médiocrité des résultats qu’elle y enregistrera, en dépit des efforts déployés sous les ministères de Richelieu (1624-1642) et de Colbert (1661-1683) dans une perspective toute mercantiliste. A la notable exception des armateurs et marchands des villes de la façade atlantique (de Bayonne à Saint-Malo) et des manufacturiers de leurs arrière-pays immédiats. Ce qui ne pouvait que redoubler le peu d’intérêt qu’il y avait à développer l’arme navale.
Les mêmes Richelieu et Colbert seront du coup les seuls ministres à prendre au sérieux la nécessité d’un tel développement. C’est sous les ministères de Colbert et de son fils et successeur Seignelay (1683-1690) que la France se hissera au premier rang de la puissance navale, juste avant que les déboires des débuts de la guerre de la Ligue d’Augsbourg ne décident Louis XIV et ses principaux ministres de renoncer à la guerre d’escadre pour se contenter de cette guérilla navale qu’est la guerre de course. La puissance navale française déclinera alors rapidement. En dépit des efforts de réarmement entrepris dans les années 1740 et surtout, sous l’impulsion de Choiseul et de Sartine, dans les années 1760 et 1770, jamais plus la Royale ne sera en mesure de faire jeu égal avec la Navy. Cela vaudra à la France de perdre la quasi-totalité de ses possessions coloniales et de ses comptoirs commerciaux au Québec et surtout aux Indes (dans le Carnatic et au Bengale), pourtant très prometteurs s’agissant des seconds.
2. Deuxième atout britannique: la capacité hégémonique. Le choix britannique de privilégier la guerre maritime impliquait que la Grande-Bretagne soit en mesure d’édifier et de conduire une alliance avec d’autres Etats sur le continent, capable de tenir tête aux armées françaises. C’est ce que je nomme sa capacité hégémonique.
Dans un premier temps, elle va l’acquérir de manière inattendue et, là encore, proprement paradoxale. En fait, elle va littéralement hériter de la capacité hégémonique néerlandaise. En effet, au printemps 1672, lorsque les Provinces-Unies se trouvent brutalement agressées et en partie envahies par la France, alliée pour la circonstance à l’Angleterre, elles ne devront leur salut, outre l’inondation artificielle d’une grande partie de la Zélande et de la Hollande, à la constitution autour d’elles d’une vaste alliance. Celle-ci réunira, en à peine plus d’un an, le Saint Empire, le Grand Electorat de Brandebourg (la future Prusse), le Danemark, le duché de Lorraine et même l’Espagne, pourtant ancien ennemi héréditaire. Elle devra tout aux talents diplomatiques du stadhouder Guillaume III d’Orange; mais aussi aux subsides que les Etats généraux des Provinces-Unies alloueront à leurs alliés; enfin à la crainte que l’appétit territorial de l’ogre français inspire à toutes les Cours d’Europe. C’est notamment cette crainte qui conduira l’Angleterre à sortir de l’alliance française en février 1674; puis, après l’opportun mariage en novembre 1677 de Guillaume III avec sa cousine Marie Stuart, fille aînée du frère cadet du roi Charles II, le futur Jacques II, l’Angleterre elle-même rejoindra l’alliance anti-française en janvier 1678, précipitant la fin de la guerre.
C’est cette même alliance, encore étendue et renforcée (par la Saxe, la Bavière et la Savoie), que le même Guillaume III d’Orange remet sur les pieds à partir du milieu de la décennie suivante, face à un Louis XIV toujours aussi menaçant du fait de sa politique de «réunions» (des annexions ou des prétentions territoriales tout le long de la frontière nord-est, jouant des ambiguïtés des clauses des traités de Westphalie et de Nimègue) et dont l’impopularité dans les Etats protestants est à son comble à la suite de la révocation de l’édit de Nantes qui va chasser quelque deux cent mille huguenots. Ce sera la Ligue d’Augsbourg. Et, quand la guerre éclate, Guillaume III exécute un audacieux coup de force: pour prévenir toute reconstitution de l’alliance franco-anglaise, il débarque en Angleterre à la tête de vingt mille mercenaires, marche sur Londres, en chasse Jacques II (son propre beau-père) et se fait élire, lui et son épouse, roi et reine d’Angleterre et d’Ecosse par les Parlements de Londres et d’Edimbourg, en enrôlant du coup ces deux royaumes dans l’alliance anti-française. Celle-ci va dès lors être dirigée par un condominium anglo-néerlandais.
Dans ce condominium, l’élément britannique semble a priori subordonné à l’élément néerlandais: somme toute, ce sont les Provinces-Unies qui ont envahi l’Angleterre, en y imposant un changement de régime; et c’est un Orange qui est monté sur les deux trônes anglais et écossais. En fait, le premier élément va rapidement devenir prépondérant. Si le rapport entre les deux est encore globalement équilibré pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg, le déséquilibre devient manifeste à la faveur du conflit suivant, la guerre de Succession d’Espagne. C’est que, en ce début de XVIIIe siècle, la puissance économique et financière néerlandaise commence à décliner (pour la première fois, les Provinces-Unies auront du mal à financer la guerre) tandis que celle de la Grande-Bretagne est en pleine ascension. Le passage de l’hégémonie des Provinces-Unies à la Grande-Bretagne tient aussi à la division du travail qui s’est imposée dans leur coopération militaire: aux Britanniques, le soin de régner sur les mers, aux Néerlandais le soin de fournir l’essentiel de l’effort conjoint sur la terre, en liaison avec le restant des alliés. C’est que, contrairement aux premiers, les seconds seront constamment sous la menace des forces terrestres françaises, capables d’envahir les Pays-Bas espagnols pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg et installées à demeure dès lors que ces derniers seront devenus possessions des Bourbon d’Espagne. Or, pas plus qu’aucune autre puissance européenne de l’époque protocapitaliste, fût-elle aussi riche qu’elles le sont alors, les Provinces-Unies n’ont les moyens d’entretenir de larges forces militaires à la fois sur terre et sur mer.
Et, par la suite, lors du second round de cette seconde Guerre de Cent Ans, soit pendant la guerre de Succession d’Autriche puis pendant la guerre de Sept Ans, la capacité hégémonique britannique n’a pas failli, selon une formule désormais rodée: garantir à leurs alliés une suprématie incontestée sur mer; les soutenir militairement et surtout financièrement sur terre, en les chargeant d’y fournir l’effort principal. A deux différences près cependant. Sur mer, ils pourront de moins en moins compter sur l’appui des Néerlandais, qui leur fera même totalement défaut pendant la guerre de Sept Ans; ce qui prouvera qu’ils pouvaient désormais s’en passer. Sur terre, d’une guerre à l’autre, il leur faudra changer d’allié principal, en passant de l’Autriche à la Prusse.
3. Troisième atout britannique: la puissance financière. Entendons une capacité à s’endetter régulièrement, massivement et à bon compte; en tout cas, à de meilleures conditions que son ennemi. C’est que la Grande-Bretagne aura su s’assurer au cours des XVIIe et XVIIIesiècles quelques-unes des conditions que l’on sait essentielles à l’établissement et au maintien d’un crédit solide. Ce dont la France va s’avérer incapable. A savoir:
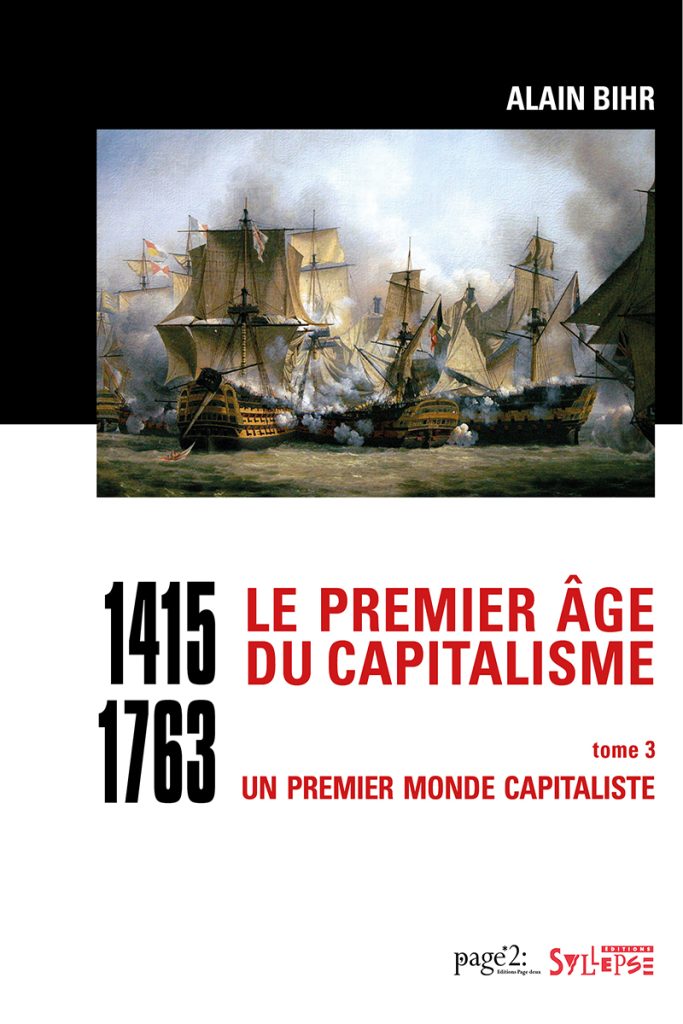 Une fiscalité solide. Il y a trois différences notables entre la fiscalité britannique et son homologue française. D’une part, la part (majoritaire dans les deux cas) des impôts indirects (droits de douane et accises) est plus importante en Grande-Bretagne qu’en France; ce qui permet à la fiscalité britannique de bénéficier pleinement de la croissance économique et démographique. D’autre part, contrairement à ce qu’on a longtemps dit et cru, la fiscalité britannique est globalement plus lourde que la fiscalité française: la taxe foncière frappe toutes les propriétés, y compris nobles; les accises sont plus nombreuses et leur taux plus élevé. Enfin, contrairement à la France, les impôts ne sont pas affermés en Grande-Bretagne: les impôts directs sont de longue date prélevés par des fonctionnaires locaux, généralement des membres de la gentry; tandis que les douanes ont cessé d’être affermées en 1672 et les accises en 1683.
Une fiscalité solide. Il y a trois différences notables entre la fiscalité britannique et son homologue française. D’une part, la part (majoritaire dans les deux cas) des impôts indirects (droits de douane et accises) est plus importante en Grande-Bretagne qu’en France; ce qui permet à la fiscalité britannique de bénéficier pleinement de la croissance économique et démographique. D’autre part, contrairement à ce qu’on a longtemps dit et cru, la fiscalité britannique est globalement plus lourde que la fiscalité française: la taxe foncière frappe toutes les propriétés, y compris nobles; les accises sont plus nombreuses et leur taux plus élevé. Enfin, contrairement à la France, les impôts ne sont pas affermés en Grande-Bretagne: les impôts directs sont de longue date prélevés par des fonctionnaires locaux, généralement des membres de la gentry; tandis que les douanes ont cessé d’être affermées en 1672 et les accises en 1683.
Une monnaie stable. Il faut relever la remarquable stabilité de la livre sterling, étonnante dans un régime monétaire métallique structurellement instable. Sa valeur est fixée sous Elisabeth Ire en 1560-1561 à l’équivalent de quatre onces d’argent fin, une valeur qu’elle conservera par la suite jusqu’en… 1931, en n’enregistrant qu’une faible dévaluation de 3,2% en 1601. Alors qu’il faudra attendre 1726 pour que la livre tournois soit de même stabilisée. Cela s’explique par plusieurs raisons.
- Le solde positif constant de son commerce extérieur a valu à l’Angleterre de bénéficier d’un afflux régulier de métaux précieux, condition indispensable à la qualité de l’émission monétaire en régime de monnaie métallique.
- Contrairement à la France, l’Angleterre n’a été engagée dans aucune guerre d’importance entre 1485 et 1652, soit pendant plus d’un siècle et demi, évitant ainsi aux finances publiques anglaises de connaître ces situations de stress qui incitent ordinairement les gouvernements à des manipulations monétaires pour gonfler artificiellement leurs moyens de paiement et dévaluer leurs dettes, comme ce sera le cas en France.
- Enfin, auraient-ils été tentés de recourir à de tels moyens que les souverains anglais en auraient été empêchés par le contrôle constant exercé sur les finances publiques par le Parlement.
Une gestion des finances publiques saine. Ce contrôle parlementaire assure plus largement une saine gestion de ces finances, alors qu’il est quasi inexistant en France. Dès sa création en 1215 par la Magna Carta (la Grande Charte), c’est le Parlement anglais qui seul autorise (ou non) le roi (ou la reine) à lever des impôts et à entrer en guerre. Par la suite, alors que sa composition s’élargit aux représentants des communes (villes et gros bourgs), son pouvoir ne cessera de se renforcer. Sous les Tudor, il obtient que le remboursement de tout emprunt soit gagé sur une recette fiscale spécialement affectée à cette fin. Pour avoir défié ses prérogatives, Charles Ier Stuart (1625-1649) y perdra sa couronne et finalement sa tête. Et, à la faveur de la Glorious Revolution orangiste (1688-1689), est institué un régime de monarchie constitutionnelle dans lequel, selon la formule consacrée, le roi ou la reine continue certes de régner mais ne gouverne plus: le budget de l’Etat est décidé par le Parlement et son exécution est contrôlée par lui, les ministres devenant responsables devant lui, tandis que le souverain doit se contenter du montant de la liste civile qui lui est attribuée, en plus des revenus qu’il peut tirer de ses domaines propres.
En France, rien de tel. Les Etats généraux, avec lesquels le roi doit en principe négocier le principe et le montant des impôts, ne seront plus convoqués entre 1614 et… 1789. Dans ces conditions, la monarchie absolue française a pu s’abandonner à son insouciance quant aux dépenses de l’Etat, y compris celles de la Maison royale et de la Cour et celles des guerres à répétition, jusqu’à se trouver finalement complètement ruinée. Lorsque Louis XVI se décide à rappeler Jacques Necker fin août 1788, le service de la dette absorbe les deux tiers du budget de l’État et il manque 300 millions de livres pour assurer l’équilibre de ce dernier [11]. On ne peut alors différer la convocation des Etats généraux. La suite est connue…
L’institution d’une dette publique consolidée. Enfin, dernière condition favorable à l’instauration et au maintien d’un crédit solide en Grande-Bretagne, qui aura fait défaut en France: la transformation de la dette flottante en une dette consolidée adossée à une Banque d’Etat. Je ne peux pas reprendre ici l’analyse de ce processus qui aura couvert toute la première moitié du XVIIIe siècle et aura vu la Banque d’Angleterre, créée en 1694, devenir progressivement le pivot de la gestion d’une dette publique contractée sous forme de l’émission de titres négociables [12].
Là encore, rien de tel en France où le crédit public continuera à reposer sur la formation de rentes constituées et des emprunts contractés auprès de consortiums de «financiers», regroupant receveurs des impôts directs, fermiers des impôts indirects (notamment ceux de la Ferme générale) ainsi que banquiers (lyonnais, génois et genevois), opérant pour le compte de membres des couches supérieures des deux premiers ordres, clergé et noblesse. Différents projets de constitution d’une banque d’Etat analogue à la banque d’Angleterre verront cependant le jour dans les années 1700 et 1710. La tentative la plus sérieuse en ce sens a été menée par John Law (1671-1729). En décembre 1718, il parvient à convaincre le régent Philippe d’Orléans de transformer sa banque privée en Banque royale, disposant du monopole de l’émission de monnaie fiduciaire. L’année suivante, il propose de racheter l’ensemble des rentes constituées, des titres de la dette flottante, bon nombre d’offices et les fermes fiscales, en les échangeant contre des titres de sa Compagnie des Indes, réunion de la Compagnie d’Occident exploitant la Louisiane, de la Compagnie du Sénégal maîtresse de la traite négrière vers les Antilles françaises, de la Compagnie des Indes orientales et de la Compagnie de Chine que Law avait réalisée parallèlement, avec laquelle sa Banque fusionnera en définitive en février 1720. De la sorte, Law espère réaliser d’une pierre trois coups: consolider définitivement la dette publique française, préalable à son amortissement éventuel; mobiliser les capitaux ainsi libérés pour les mettre au service de l’expansion commerciale et coloniale de la France; permettre à la circulation marchande de se libérer des contraintes de la monnaie métallique en lui substituant une monnaie fiduciaire, gagée en définitive sur le crédit de l’Etat et, à travers lui, sur la dynamique économique générale. Mais ce montage monétaro-financier ne résistera pas à la spéculation sur les titres qu’il a lui-même lancée par la témérité de ses entreprises et que ses différents adversaires, ministres, fermiers fiscaux et banquiers privés, dont il menaçait directement les intérêts, se sont ingéniés à déchaîner contre lui.
4. Résumé. En somme, dans leur affrontement contre les Français, les Britanniques auront su bénéficier des mêmes atouts que ceux qui avaient permis aux Néerlandais de vaincre les Espagnols un siècle auparavant: la suprématie maritime, la prospérité marchande, le rendement assuré d’une fiscalité indirecte dont les échanges intérieurs et extérieurs constituent l’assiette, de larges possibilités d’emprunts, la capacité de financer leur propre effort de guerre (menée principalement sur mer) ainsi que l’établissement et le maintien de larges coalitions sur le continent dont ils s’assuraient la direction par le biais de leurs subsides. Dans les deux cas, un petit Etat dont la prospérité est fondée essentiellement sur le commerce maritime et une fiscalité indirecte, dont l’usage des recettes fait l’objet d’un contrôle par les classes dominantes via des assemblées représentatives, est venu à bout d’un grand Etat territorial, dont la fiscalité foncière est grevée d’exemptions d’ordre et d’un pillage par les intermédiaires financiers, en dehors de tout contrôle y compris par un pouvoir qui se voulait pourtant absolu.
Je pense qu’il est désormais inutile de revenir sur le titre de cet article, d’apparence énigmatique à première vue, mais qui a trouvé à s’expliciter dans le fil des développements précédents. Retenons que, tout au long de la période protocapitaliste, par-delà des Etats qui en sont les protagonistes immédiats, les guerres confrontent en fait des formations sociales, prises dans toutes leurs dimensions, démographiques, économiques, sociales, institutionnelles, notamment les rapports de force entre ordres et classes sociales qui les constituent, sans omettre la profondeur de leur héritage historique. Elles opèrent en fait comme de véritables radiographies de ces sociétés en mettant en jeu et en donnant du coup à voir l’ensemble de leurs éléments constitutifs. (Voir la première partie de cet article publiée sur ce site le 21 avril 2023)
___________
[10] Geuzen est l’autodénomination ironique des sujets révoltés contre la Couronne castillane. Elle procède du détournement de ce terme, employé à titre d’injure et de stigmate, par un conseiller de la gouvernante Marguerite de Parme à la vue de la troupe de nobles venus présenter à cette dernière un ensemble de remontrances en son palais de Bruxelles le 5 avril 1566. Le mauvais accueil fait à cette troupe par la gouvernante marque le début des troubles.
[11] Michel Morineau, « Budgets de l’État et gestion des finances royales en France au XVIIIe siècle », Revue historique, tome DXXXVI, 1980, pages 301-316.
[12] Cf. à ce sujet Peter George Dickson, The Financial Revolution in England. A Study in the Development of Public Credit, 1688-1756, Londres, Macmillan, 1967 Je l’ai largement utilisé dans le tome 3 de mon ouvrage, pages 755-767.


Soyez le premier à commenter