L’idée d’un complot judiciaire international de la droite la plus réactionnaire contre les anciens présidents progressistes sud-américains jouit d’une certaine aura de plausibilité dans l’opinion de gauche régionale et mondiale. À y regarder de plus près, ce grand récit ne tient guère la route. Décryptage en règle par le directeur de l’édition Cône Sud du Monde diplomatique.
La notion de lawfare, qui décrit l’instrumentalisation et le détournement du système judiciaire aux fins de persécution des adversaires politiques, est à la mode. Certains secteurs de la gauche latino-américaine y voient l’outil principal d’un complot contre les anciens dirigeants et les partis progressistes du continent. D’aucuns, en France, essaient même de se convaincre qu’un phénomène identique serait en train de se reproduire dans notre pays. Rafael Correa en Équateur, Cristina Kirchner en Argentine, tous deux en difficulté avec la justice de leur pays, s’efforcent d’accrocher leur wagon à la locomotive du «martyr» Lula, dont la popularité et la légitimité internationales sont beaucoup plus grandes que la leur et dont la condamnation a indigné bien au-delà des rangs de la gauche.
Les choses sont toutefois passablement plus compliquées qu’il n’y paraît. On peut avoir de bonnes raisons de considérer que la destitution de la présidente brésilienne Dilma Rousseff en 2016 avait bien un caractère de coup d’État parlementaire et que les sanctions contre Lula ont un biais à la fois sélectif et très excessif (douze ans de prison pour l’usufruit potentiel supposé d’un appartement dont il n’est pas nominalement propriétaire et où il n’a jamais mis les pieds) et visaient essentiellement à l’expulser de l’arène politique. Reste que l’implication de nombre de hiérarques du Parti des Travailleurs (PT) brésilien dans des schémas de corruption liés entre autres au géant de la construction Odebrecht et à la compagnie pétrolière nationale Petrobras est indéniable, même si le niveau de corruption des forces de centre et de droite est vraisemblablement beaucoup plus massif.

Quant aux charges qui pèsent sur Rafael Correa [président de janvier 2017 à mai 2017 de la République d’Equateur] et sur les principales figures de son entourage politique immédiat, ainsi que les révélations récentes sur le vaste système de pots-de-vin versés aux gouvernements des époux Kirchner [Nestor Kirchner président de mai 2003 à décembre 2007 – décédé en octobre 2010 – et Cristina Fernández de Kirchner, présidente de l’Argentine de décembre 2007 à décembre 2015] en échange de marchés publics, elles sont amplement documentées et extrêmement graves.
Cette situation confuse tend à alimenter les fantasmes des idéologues au petit pied des deux camps, avec une droite ultra-réactionnaire qui vocifère que «la gauche, toujours crypto-totalitaire, est corrompue par essence», et une gauche cavernicole qui gémit qu’elle est victime d’un complot diabolique coordonné au niveau mondial – et se dédouane ainsi à bon compte de ses erreurs, voire des crimes de certains de ses représentants. Pour mieux dénouer cet imbroglio, rien de mieux qu’offrir aux lecteurs français la très intéressante analyse sur le lawfare du journaliste et politiste argentin José Natanson, directeur de l’édition Cône Sud du Monde diplomatique [article publié le 16 octobre dans le quotidien argentin Pagina 12, sous la rubrique Opinión, le 16 octobre 2018].
Où il est notamment démontré: que l’hyperactivisme judiciaire mérite certainement d’être interrogé du point de vue démocratique, aussi bien en soi qu’a fortiori lorsque sa dynamique converge avec les intérêts de centres de pouvoir publics ou privés ; que ces convergences, quand elles existent, n’excluent pas les contradictions, les angles morts, les conséquences inattendues et les logiques d’autonomisation des acteurs et des procédures judiciaires; que le lawfare est loin d’être une arme exclusive de la droite contre la gauche; que la lutte contre la corruption «n’est pas une lubie des libéraux qui veulent détruire l’État, un piège tendu par les médias hégémoniques ou une arme de l’Empire»; qu’il serait à la fois politiquement dangereux et éthiquement douteux d’abandonner à la droite la bannière de la transparence sous prétexte qu’elle peut couvrir des manipulations réactionnaires; et que s’il est un pays en Amérique latine où la justice fonctionne comme un instrument du gouvernement au service de la répression systématique des opposants, c’est en premier lieu le Venezuela de Nicolás Maduro. On vous l’avait dit, c’est compliqué…
***
Sur la notion de «lawfare»
Par José Natanson
L’expression a commencé à devenir populaire il y a quelques années: on s’est mis à parler de «coup d’État soft», de «putsch institutionnel» ou de «putsch parlementaire». C’est ainsi qu’on décrivait l’éviction irrégulière d’un président lorsqu’elle ne passait pas par l’intervention de l’armée, comme dans un coup d’État traditionnel, ni même par un recours quelconque à des méthodes violentes. Le caractère manifestement contradictoire du concept – jusqu’à quel point un «putsch» peut-il être «institutionnel», et si un coup est «soft», doux, ne s’agit-il pas alors d’une caresse? – exprimait la perplexité engendrée par un phénomène inédit. Face à l’inconnu, le langage politique tâtonnait et se heurtait à de nouveaux oxymores, dont le dernier en date est la notion de «lawfare», curieux mélange de droit et de guerre, de loi et de conflit.
Apparu pour la première fois dans un article publié en 2001 par le militaire américain Charles Dunlap à propos de la manipulation du droit international dans des contextes de guerre, le concept de lawfare a commencé à être utilisé pour définir un détournement de l’usage domestique de la justice dans une série de pays. Dans la mesure où il s’agit d’une idée nouvelle, et plus souvent d’un argument de lutte politique que d’une véritable catégorie scientifique, sa définition est floue. D’après Geraldo Carreiro de Barros Filho (pour des raisons évidentes, les développements les plus élaborés sur la question sont dus à des auteurs brésiliens), le lawfare fait référence à l’utilisation des juges comme instruments de persécution politique à travers la promotion de «maxi-procès» qui impliquent un haut niveau de spectacularisation, par exemple par le biais de la transmission en direct des arrestations, et exigent donc une relation fluide entre le pouvoir judiciaire et les médias.

Ces procédures utilisent généralement des catégories pénales ouvertes («association illicite en Argentine», «organisation criminelle» au Brésil) qui permettent d’inclure dans la même affaire des accusés ayant des comportements criminels et des niveaux de responsabilité distincts. Comme il est fréquent que ces accusations soient fondées sur des crimes contre l’administration publique difficiles à prouver, où le «corps du délit» est souvent impossible à identifier, le pouvoir judiciaire fait généralement appel à des méthodes procédurales controversées telles que la «prime à la délation» (la figure de l’«accusé collaborateur» en Argentine). Ces figures flexibilisent les garanties des accusés et, combinés à l’utilisation abusive de la détention provisoire, offrant aux juges une ample marge d’action discrétionnaire, laquelle débouche sur une sorte de «justice pénale négociée». Dans de nombreux cas, les aveux sont manifestement obtenus sous contrainte.
«La judiciarisation de la politique»
L’effet de ces procès est politique plutôt que judiciaire. Plus que leur issue finale, qui peut fort bien se terminer par l’acquittement de l’accusé, ce qui compte, c’est l’impact qu’il produit à mesure qu’il progresse. D’une certaine manière, le lawfare est une version consolidée d’une tendance bien connue, la judiciarisation de la politique, laquelle a commencé en Amérique latine à partir du cycle de restauration démocratique des années 1980. Le pouvoir judiciaire a alors commencé à élargir son champ d’intervention à des aspects de plus en plus nombreux de la vie publique: si, au départ le phénomène était perçu comme un moyen d’éviter un retour aux autoritarismes du passé, il fonctionne aujourd’hui comme une «voie rapide» pour prévenir la restauration populiste, avec la corruption comme argument majeur de légitimation.
Avec des différences et des nuances évidentes, on soutient souvent que le lawfare explique les récentes accusations portées contre d’anciens présidents latino-américains. Citons en particulier: Rafael Correa, sujet à un mandat d’arrêt international dans un cas assez insolite d’enlèvement d’un opposant politique en Colombie; Cristina Kirchner, pour les affaires sur lesquelles le juge fédéral Claudio Bonadio mène l’enquête, et bien entendu Lula, détenu sur ordre du juge Sergio Moro qui, malgré le manque de preuves, l’a condamné à douze ans de prison pour l’achat supposé du fameux appartement de la station balnéaire de Guarujá.
La notion de lawfare mérite d’être interrogée: non pas pour la réfuter, car il s’agit d’une tentative de décrire quelque chose qui se passe effectivement, mais pour mieux calibrer son utilisation et éviter son application indiscriminée dans n’importe quel contexte.
Quand le «lavage express» déborde…
Le premier aspect qui mérite d’être discuté est le niveau de coordination. Même quand il existe une coïncidence d’objectifs entre les trois acteurs qui jouent un rôle de premier plan dans le domaine du droit, à savoir le pouvoir politique et économique, les juges et les médias, on est assez loin de l’harmonie parfaite décrite par ceux qui la dénoncent et qui présentent souvent les choses comme si tout était négocié au sein d’un groupe Whatsapp. Chaque acteur a ses propres objectifs, qui peuvent converger de manière plus ou moins permanente mais aussi engendrer des contradictions et avoir des angles morts ou des conséquences inattendues.
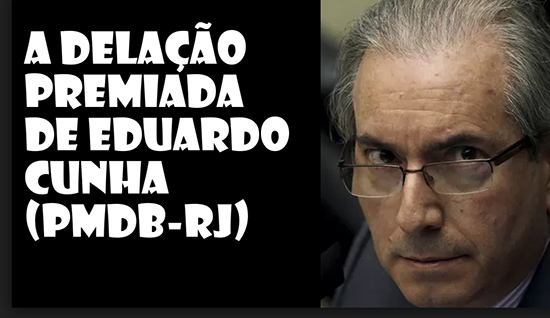 Dans le cas du Brésil, par exemple, l’opération Lava Jato («karcher», «lavage express») a d’abord ciblé les fonctionnaires du Parti des Travailleurs (PT), dans le contexte du processus accéléré de perte de popularité du gouvernement de Dilma Rousseff [en 2015-206] et en s’appuyant, bien entendu, sur la réalité d’un système de corruption qui existait vraiment. Apparue initialement comme un moyen d’accélérer l’usure de la gestion du PT et d’éviter sa possible relance à travers la figure de Lula, Lava Jato a fini par affecter une bonne partie de la classe politique et du milieu des affaires brésiliens. Aujourd’hui, ce sont 123 hommes politiques et hommes d’affaires qui ont été condamnés, dont Eduardo Cunha [membre du PMDB, qui se nomme MDB depuis 201, président de la chambre des députés de février 2015 à juillet 2016, condamné pour corruption en mars 2017], architecte de la destitution de Dilma Rousseff, avec 24 ans de prison, et l’entrepreneur le plus important du pays, Marcelo Odebrecht, qui a déjà été détenu pendant deux ans avant son jugement.
Dans le cas du Brésil, par exemple, l’opération Lava Jato («karcher», «lavage express») a d’abord ciblé les fonctionnaires du Parti des Travailleurs (PT), dans le contexte du processus accéléré de perte de popularité du gouvernement de Dilma Rousseff [en 2015-206] et en s’appuyant, bien entendu, sur la réalité d’un système de corruption qui existait vraiment. Apparue initialement comme un moyen d’accélérer l’usure de la gestion du PT et d’éviter sa possible relance à travers la figure de Lula, Lava Jato a fini par affecter une bonne partie de la classe politique et du milieu des affaires brésiliens. Aujourd’hui, ce sont 123 hommes politiques et hommes d’affaires qui ont été condamnés, dont Eduardo Cunha [membre du PMDB, qui se nomme MDB depuis 201, président de la chambre des députés de février 2015 à juillet 2016, condamné pour corruption en mars 2017], architecte de la destitution de Dilma Rousseff, avec 24 ans de prison, et l’entrepreneur le plus important du pays, Marcelo Odebrecht, qui a déjà été détenu pendant deux ans avant son jugement.
En outre, dans une affaire parallèle, le président Michel Temer, ancien vice-président et bénéficiaire de la destitution de Dilma Rousseff, a été secrètement enregistré par le propriétaire de la société JBS, qui lui demandait de payer un pot-de-vin et de résoudre un problème avec un de ses conseillers, lequel fut ensuite filmé recevant une mallette pleine de billets. Si Temer n’est pas aujourd’hui en prison, c’est grâce à sa capacité à préserver la coalition législative qui le soutient plutôt qu’à une protection judiciaire spéciale: c’est la Chambre des députés, pas la justice, qui l’a sauvé. Enfin, et pour compliquer encore les choses, rappelons que l’enregistrement a été diffusé par le quotidien O Globo, principale expression médiatique de l’establishment, qui a également demandé la démission du président.
Il est exact qu’en raison de la rapidité avec laquelle la procédure contre lui a avancé et de la faiblesse des preuves l’incriminant, la cible principale du Lava Jato a toujours été Lula qui, en tant que dernière chance de retour du «populisme» au pouvoir concentre la haine d’une bonne partie des élites brésiliennes. Néanmoins, on a nettement l’impression qu’au moins à certains moments, le système judiciaire s’est autonomisé des acteurs qui l’avaient encouragé et a produit des résultats qui vont beaucoup plus loin que ce qu’ils avaient prévu. Dans le cas argentin, un fonctionnaire argentin de Mauricio Macri [président depuis 2015] a résumé la situation en ces termes: «Il y a deux alliés qui sont des alliés mais que nous ne contrôlons pas: les juges fédéraux et la députée Elisa Carrió.» [1]
Les cibles et les acteurs: du Pérou au Venezuela
Le deuxième aspect qu’il convient de discuter est le parti pris idéologique. Ceux qui dénoncent le lawfare tiennent pour acquis qu’il s’agit d’un instrument des élites pour attaquer les partis et les dirigeants du camp populaire, une arme exclusive de la droite contre la gauche. Il est pourtant facile de constater que des politiciens conservateurs ont également été victimes d’opérations de ce genre: au Pérou, Pedro Pablo Kuczynski [président de juillet 2016 à mars 2018] a dû démissionner de son poste de président pour éviter la procédure d’impeachment impulsée par le fujimorisme [Keiko Fugimori, dont le père a été emprisonné pour corruption et crimes contre l’humanité; la firme brésilienne Odebrecht a financé la campagne présidentielle de Keiko Fugimori, accusation similaire à celle qui pesait contre Kuczynski] après que le bureau du procureur général ait ouvert une enquête contre lui pour des versements présumés d’Odebrecht à deux sociétés de conseil auxquelles il était associé lorsqu’il était ministre (Kuczynski affirme qu’à ce moment-là, il travaillait en fait dans le secteur privé). La distribution d’une vidéo opportunément «éditée» dans laquelle des députés favorables à Kuczynski négociaient avec un représentant de l’opposition son vote de rejet du procès politique en échange de contrats publics fut la cerise sur le gâteau: il s’agissait d’un accord ténébreux mais pas vraiment illégal, mais de toute façon Kuczynski fut obligé de démissionner.
Un autre exemple est celui d’Otto Pérez Molina, ancien général putschiste, élu président du Guatemala [de février 2012 à septembre 2015], qui a dû démissionner après avoir été accusé d’avoir mis en place dans les douanes un système de corruption connu sous le nom de «La Línea». À cette occasion, on a également assisté à une multiplication des écoutes téléphoniques et des arrestations transmises en direct, tandis qu’un rôle de premier plan était joué par la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala, un organisme indépendant de soutien au travail du Bureau du Procureur général créé en vertu d’un accord entre les Nations Unies et l’État guatémaltèque. Pérez Molina a dénoncé une application sélective de la justice pénale de la part de… la gauche.

Mais s’il est un pays en Amérique latine où la justice fonctionne comme un instrument du gouvernement, c’est bien le Venezuela. Tout comme Lula, le leader de l’opposition Henrique Capriles est interdit de candidature à toutes les charges électives pour une durée de quinze ans en raison d’irrégularités présumées lors de son mandat de gouverneur de Miranda. Le général Raúl Isaías Baduel, ancien ministre de la Défense d’Hugo Chávez, a été condamné à huit ans de prison pour corruption présumée après être passé à l’opposition. Pas besoin d’être un libéral comme Mario Vargas Llosa pour admettre que la persécution judiciaire des opposants est plus fréquente au Venezuela que dans tout autre pays de la région.
Sans tout mettre sur un pied d’égalité, dans la mesure où chaque cas exige une analyse spécifique, il convient de se demander dans quelle mesure le lawfare est une invention de la droite pour combattre la gauche ou s’il s’agit d’un outil qui peut également être utilisé contre des gouvernements conservateurs faibles (comme celui de Kuczynski) ou par des gouvernements «populaires» de tendance autoritaire (comme celui du Venezuela). Autrement dit, la prétendue partialité anti-gauche se vérifie-t-elle dans la pratique ou bien s’agit-il d’un outil qui ne distingue pas les idéologies?
Les Etats-Unis derrière toutes ces procédures?
Le troisième aspect à considérer est l’influence des États-Unis, auxquels d’aucuns attribuent la manipulation de la télécommande des procédures concernées. Jusqu’où cela va-t-il vraiment? En premier lieu, il est vrai que certains changements dans les codes pénaux et certaines innovations procédurales ont une origine nord-américaine évidente, comme la négociation de règlements extrajudiciaires entre procureurs et accusés en échange d’une réduction des peines ou l’utilisation du «piège judiciaire», qui permet de soumettre un fonctionnaire à la tentation de commettre un crime afin de vérifier son honnêteté, comme dans l’affaire Temer.

Il est également vrai que, comme le souligne le sociologue Sebastián Pereyra, la construction de la corruption en tant que problème social est en grande partie le résultat du travail d’un certain nombre d’organisations basées aux États-Unis, telles que Transparency International, qui ont développé des recommandations et des pratiques qu’elles exportent vers le reste du monde. Enfin, il est également vrai que différents organismes du gouvernement américain invitent à l’occasion des juges et des procureurs latino-américains à des cours et à des séminaires de formations. La question est de savoir si ces indices sont suffisants, s’il faut dès lors voir derrière chaque procédure la main invisible de l’Empire, ou bien s’il s’agit d’une inspiration plus générale.
En réalité, l’expérience à partir de laquelle se sont construites les procédures judiciaires latino-américaines est le Mani Pulite italien, ce méga-procès dirigé par le procureur Antonio Di Pietro qui a pulvérisé le système politique italien et créé les conditions pour l’ascension de Silvio Berlusconi, et sur lequel le juge Sergio Moro [qui a engagé, entre autres, la procédure contre Lula] avait écrit un article universitaire élogieux avant de commencer l’opération Lava Jato.
Pourquoi la gauche devrait-elle céder à la droite le «drapeau de la transparence»?
Récapitulons. Le lawfare n’est pas une pure invention sortie de l’imagination fébrile d’intellectuels populistes, mais une tentative de décrire ce qui se passe réellement. C’est une notion qu’il est toutefois nécessaire d’affiner afin d’éviter que sa généralisation ne finisse par être condamnée à l’oubli. Les mots sont comme les politiciens: ils ont besoin d’un minimum de crédibilité pour continuer à fonctionner; s’ils perdent cette crédibilité, ils se banalisent, voient leur force décroître et finissent par s’éteindre. Parce qu’il est un autre risque sur lequel il convient d’attirer l’attention: celui que la dénonciation du lawfare finisse par déboucher sur une sous-estimation politique – voire un déni manifeste – des délits commis pendant le cycle des gouvernements progressistes en Amérique latine.
Pourquoi la gauche devrait-elle faire à la droite la faveur de lui céder le drapeau de la transparence? Quelles erreurs les gouvernements progressistes ont-ils commises pour qu’un ex-militaire représentant l’extrême droite brésilienne [Bolsonaro], un banquier équatorien [Guillermo Lasso qui se présentait contre Lenn Moreno et qui est lié à un grand nombre de firmes ayant leur siège dans des «paradis fiscaux»] ou un héritier de la «patrie des contrats publics» en Argentine [Macri] puissent brandir le discours anti-corruption de manière convaincante?
La lutte contre la corruption n’est pas une lubie des libéraux qui veulent détruire l’État, un piège tendu par les médias hégémoniques ou une arme de l’Empire. Ses conséquences ne le sont pas non plus: lorsqu’on nous dit que ces procès produisent des résultats indésirables, que l’effet de Lava Jato est l’ascension de Jair Bolsonaro ou que Mani Pulite a engendré Berlusconi, il s’agit d’un argument moralement douteux et politiquement stérile. Il se trouve que, comme le souligne Pablo Stefanoni [directeur de la revue Nueva Sociedad], la transparence est aujourd’hui une exigence de presque tous les secteurs sociaux, une réponse au «républicanisme d’en bas» qui a pris racine en Amérique latine et qui peut tout aussi bien être capitalisé par la gauche, comme le démontre le succès de la campagne «honestiste» [2] d’Andrés Manuel López Obrador [AMLO] au Mexique.
Pour résumer, la construction d’une nouvelle éthique publique est tout à la fois un impératif moral et une exigence sociale : quelque chose qu’il faut faire parce que c’est notre devoir et parce que la société l’exige. (Article traduit et publié sur son blog par Marc Saint-Upéry); intertitres de la rédaction de alencontre.org)
Source: José Natanson, «Sobre el lawfare», Página 12, 16-10-2018.
_____
[1] Ayant émergé dans les années 2000 comme une des figures les plus notables de la lutte contre la corruption endémique du système politique argentin, la juriste et députée Elisa Carrió est aujourd’hui membre de la coalition libéral-conservatrice du président Mauricio Macri. Elle est aussi connue pour ses positions assez idiosyncrasiques et ses propos parfois extravagants.
[2] Forgé initialement par le journaliste argentin Martín Caparrós, le terme espagnol «honestismo» est parfois utilisé sarcastiquement en Argentine par certains secteurs de la gauche et du péronisme pour décrire la façon dont l’obsession moraliste du combat contre la corruption servirait à détourner les énergies progressistes de la lutte contre les inégalités structurelles et/ou les rapports sociaux capitalistes.



Soyez le premier à commenter