La guerre civile en Syrie entre dans sa quatrième année et son bilan ne cesse de s’alourdir. Dans son ouvrage consacré au régime autoritaire de Bashar al-Asad, La Syrie de Bashar al-Asad, Anatomie d’un régime autoritaire (Belin, 2013, 464 p.), Souhaïl Belhadj montre que ce conflit n’est pas d’ordre communautaire, mais qu’il naît d’un conflit social profond.
En ce début de 2014, la Syrie semble s’enfoncer dans une crise dont l’issue semble bien incertaine, et lointaine. De mois en mois, depuis le déclenchement de l’insurrection syrienne il y a trois ans, en mars 2011, les bilans font de la surenchère macabre : près de 150’000 morts, plus d’un tiers de la population déplacée à l’intérieur du pays, plus de deux millions de réfugiés à l’extérieur (sur une population totale de 21 millions d’habitants en 2011), des villes et des quartiers ravagés par les bombardements aériens et l’utilisation massive par l’armée du régime de missiles et d’armes interdites – armes chimiques, on le sait désormais, mais aussi, de façon beaucoup plus banale et quotidienne, d’autres armes prohibées, comme les bombes à fragmentation. Le soulèvement populaire et les groupes de l’opposition au régime se trouvent pris au piège entre la stratégie opportuniste de groupes jihadistes cherchant à investir le terrain syrien depuis début 2013 et un régime dont la stratégie de répression tous azimuts est soutenue par de puissants alliés extérieurs (Iran, Russie, Hezbollah, certaines milices irakiennes).
Dans ce contexte dramatique, après trois ans l’ouvrage du politologue Souhaïl Belhadj, La Syrie de Bashar al-Asad [1], paru en 2013, représente une contribution importante à la fois à la littérature scientifique consacrée à la Syrie et à l’analyse des régimes autoritaires. Ce texte très bien écrit, accessible et clair, issu d’un travail de recherche scientifique approfondi effectué dans les années 2000, offre des clefs de lecture du conflit actuel d’une grande richesse.
Souhaïl Belhadj fait en effet œuvre à la fois de politologue et d’historien du contemporain. En politologue, il procède à une véritable anatomie d’un régime autoritaire, pour reprendre le sous-titre qu’il a choisi, et en particulier à une anatomie des institutions et des systèmes de pouvoir qui lui ont permis de se maintenir depuis 40 ans. De ce point de vue, La Syrie de Bashar al-Asad offre une analyse du pouvoir syrien d’autant plus précieuse qu’elle ne se limite pas à celle du président et de son entourage, défaut de la plupart des ouvrages qui ont été consacrés au nouveau raïs, et qu’elle permet de montrer que les ressorts du système de pouvoir ne sont pas à trouver dans une identité « minoritaire » (« alaouite », la secte de l’islam à laquelle appartient le président al-Asad) qui s’imposerait aux autres, mais dans une alliance plus large avec la communauté sunnite, qui a pour effet d’attiser les antagonismes internes de la société syrienne.
Il fait également œuvre d’historien en offrant au lecteur une synthèse de plus soixante ans de vie politique syrienne, analysée à partir du fil rouge qui, selon lui, est à l’origine du régime autoritaire syrien et de la formule si singulière de « leadership » qu’il a créé. Ce fil rouge est l’existence d’un conflit social qui oppose différents groupes en compétition pour l’exercice et la participation à l’ordre politique dans la Syrie de l’indépendance.
Le conflit social, aporie du système autoritaire syrien
La proclamation de l’indépendance en 1946 engage la Syrie sur le chemin de la construction d’une république parlementaire. La période qui s’ouvre est celle d’une très grande instabilité politique, qui voit se succéder les gouvernements, les coups d’État, et les aventures politiques (cf l’éphémère République Arabe Unie avec l’Égypte, de 1958 à 1961). Elle n’en reste pas moins un moment d’expérimentation politique et institutionnelle alors unique au Moyen-Orient, et qui enracine en Syrie la culture parlementaire et celle du pluralisme politique [2].
Pour Souhaïl Belhadj, il faut attribuer cette forte instabilité politique à « l’incapacité des élites de l’époque à réguler le conflit social » qui traverse la Syrie de l’indépendance. Par conflit social, il entend, classiquement, la compétition, « les luttes qui opposent des groupes sociaux antagonistes ». Dans le contexte syrien, ce conflit social reflète la transformation de l’ordre social et politique qui prévalait dans les provinces syriennes de l’empire ottoman jusqu’au Mandat français (1920-1946), transformation que l’indépendance et la construction républicaine rendent enfin visible.
En effet, les années de l’indépendance voient s’opposer des élites urbaines composées de « la notabilité traditionnelle sunnite, latifundiaire, et des entrepreneurs chrétiens », à des groupes minoritaires qui étaient jusqu’alors dominés (minorités ethnico-religieuses et sunnites pauvres des campagnes). Ces antagonismes, dont les racines remontent à l’époque ottomane, sont donc à la fois de classe et ethnico-religieux. Avec l’indépendance, les groupes minoritaires, qui ont commencé à s’émanciper à la faveur des politiques mandataires et des politiques d’éducation dont bénéficient les jeunes générations, contestent l’ordre politique et social de la nouvelle Syrie. Ils contestent la domination des élites urbaines sunnito-chrétiennes, l’incapacité de celles-ci à intégrer la nouvelle donne sociale à leur projet de modernisation de la Syrie, leur refus du partage du pouvoir. Ce qui change à cette époque est que ces groupes, bien que fortement divisés sur ce que doit être la Syrie de demain, s’entendent pour mettre à bas ce qui est alors désigné comme la « République des notables ». L’autre fait nouveau est que la contestation émane également de l’armée, dont le personnel a été largement renouvelé depuis la période mandataire sous l’effet de l’intégration dans ses rangs de beaucoup de membres de ces groupes minoritaires (alaouites et druzes notamment).
Le rapport de force est tranché en faveur de l’un de ces groupes – le parti Ba’th – lors du coup d’État de 1963. Ce coup renverse l’ordre social de la République et installe au pouvoir « une contre-élite [3] provinciale de modeste extraction », composées d’alaouites, de paysans sunnites, de ba’thistes. Cette contre-élite est dominée par les militaires, qui prennent durablement l’ascendant sur la structure civile du parti. Ils établissent une dictature militaire – qui n’est pas exempte de coups de force internes – à la tête de laquelle se hissera Hafez al-Asad (père de Bashar al-Asad) en 1970. Le « mouvement de rectification » que celui-ci engage s’incarne dans la proclamation de la « république ba’athiste » en 1973. Cependant, comme le montre Souhaïl Belhadj, la domination du Ba’th, loin de résoudre le conflit social syrien, vient alors le « geler ».
Anatomie de la « formule autoritaire » syrienne
À la tête de la Syrie, Souhaïl Belhadj rend bien compte de la façon dont Hafez al-Asad met progressivement en place une « formule autoritaire » tout en exerçant une violente répression (qui culmine avec l’écrasement de la contestation des Frères musulmans dans le sang à Hama en 1982), et en utilisant le contexte régional tendu, notamment au Liban, pour construire sa légitimité interne en se présentant comme le champion du panarabisme. La grande force de l’ouvrage de Souhaïl Belhadj est de proposer une analyse très argumentée de cette « formule autoritaire » en se fondant sur un travail documentaire qualitatif accumulé au cours d’un travail de recherche de plusieurs années qui lui permet d’apporter des éléments d’analyse tout à fait inédits et précieux sur le système politique syrien contemporain : travail sur les archives officielles, notamment du Ba’th ; sources orales (entretiens avec des responsables et des fonctionnaires syriens, notamment du Ba’th) ; observations de terrain (par exemple à l’Assemblée du Peuple, le parlement syrien).
La « formule autoritaire » syrienne repose sur une direction politique articulée à plusieurs institutions, qu’avait décrite notamment Michel Seurat dans les années 1980 [4]. D’une part, l’armée, qui a pris l’ascendant sur la direction civile du Ba’th depuis le coup d’État de 1963. Cette domination est renforcée par la prise de pouvoir d’Hafez al-Asad, qui a fait sa carrière dans le corps des officiers. Ce qui explique que la préparation à la succession de son père ait impliqué, pour Bashar al-Asad, un parcours d’ascension très rapide dans la hiérarchie militaire. La seconde institution, ce sont les services de renseignement, dont le rôle est central et structurant du point de vue sécuritaire, à l’évidence, mais également du point de vue politique dans la mesure où ils sont présents, pour les surveiller, dans l’ensemble des administrations de l’appareil d’État et des institutions de la vie sociale. Enfin, la troisième institution est le parti Ba’th, dont la domination sur la vie politique syrienne est inscrite dans la Constitution de 1973. Du fait de ses fonctions exécutives, les structures du parti sont très intimement enchevêtrées dans celles de l’État, ce qui de fait marginalise le rôle du gouvernement. Par ailleurs, au Ba’th reviennent les 2/3 des sièges à l’Assemblée du Peuple, et le parti domine la coalition du Front National Progressiste composé des partis autorisés, ce qui réduit automatiquement l’espace du pluralisme et de la libre compétition. Enfin, le Ba’th encadre la vie sociale au travers de ses multiples organisations partisanes, populaires, et professionnelles. Il est de ce point de vue en charge de la construction d’un nouveau « consensus national » autour des nouveaux mots d’ordre du régime : socialisme et panarabisme dans les années 1970, ouverture économique et redistribution dans les années 2000. La recherche d’un consensus national est destiné à subsumer les antagonismes de la société syrienne, à neutraliser en somme le conflit social que la domination autoritaire ba’athiste ne manque pas de réactiver.
Le leadership syrien sous Bashar al-Asad
Dans cette formule autoritaire, le leadership syrien contrôle bien, in fine, tous les leviers du pouvoir : le président domine le gouvernement, il est le secrétaire général du parti Ba’th, il est général en chef des forces armées, et il est le seul auquel rendent compte les services de renseignements et les gardes prétoriennes – une prééminence essentielle, compte tenu du fait que les services, appartenant à l’administration d’État, devraient normalement être sous l’autorité du Ba’th. Mais il serait inexact d’en déduire, comme une lecture un peu rapide des régimes du Moyen-Orient peut le faire penser, que l’État syrien – ou l’État arabe – fonctionnerait comme un faux-semblant, un écran de fumée, tandis que le pouvoir réel serait ailleurs, autour du raïs et de son entourage proche. Les exemples égyptiens et tunisiens ont ainsi montré que le chef perd son pouvoir lorsque l’armée l’abandonne, et a contrario la crise syrienne actuelle indique bien que tant que les institutions structurantes restent fidèles, le régime résiste. En effet, c’est dans l’« agencement » entre le leadership et le système de pouvoir syrien qu’il faut trouver les raisons de la perpétuation du régime autoritaire.
À partir de l’analyse de la présidence de Bashar al-Asad et des choix que celui-ci opère par rapport à l’héritage qu’il reçoit, Souhaïl Belhadj indique ainsi que le leadership politique syrien organise et utilise la forte institutionnalisation du régime autoritaire de sorte à assurer sa propre stabilisation. De ce point de vue, l’un des apports de cet ouvrage est bien d’analyser le leadership syrien au-delà de la personne du chef et de son cercle immédiat, comme l’ont fait la plupart des études portant sur la présidence de Bashar al-Asad parues au cours des récentes années [5], et qui trop souvent limitent leur analyse à l’évaluation, souvent toute « kremlinologique », de la capacité/la volonté ou non du jeune président à réformer le système.
Souhaïl Belhadj détaille notamment trois exemples de la façon dont le président assoit son autorité sur la direction politique syrienne. Un chapitre est consacré à l’analyse minutieuse des agencements et transformations opérés par Bashar al-Asad au sein du parti Ba’th et du système gouvernemental au cours des années 2000, et qui lui permettent de s’affirmer comme celui qui exerce la direction politique en Syrie. Un autre chapitre porte sur l’analyse du maintien du dispositif de politique extérieure hérité de son père, qui permet à Bashar al-Asad de stabiliser la direction politique du régime et son propre ascendant sur le système d’autorité. En effet, au terme d’une décennie pourtant extrêmement difficile (invasion de l’Irak en 2003 et sanctions américaines, retrait de l’armée syrienne du Liban suite à l’assassinat du premier ministre libanais Rafic Hariri en 2005, isolement diplomatique à la suite de cet assassinat), le président a réussi à conforter l’assise stratégique régionale de la Syrie en s’appuyant sur ses alliés (Russie, Iran), en établissant des liens avec deux anciens pays ennemis (Turquie, Irak), et en rétablissant des relations avec la France. Enfin, l’auteur rend compte du fait que le nouveau président annonce vouloir construire une nouvelle « formule nationale », en la fondant d’une part sur une politique de libéralisation économique destinée à renouveler les circuits de redistribution de la croissance, et d’autre part sur une ouverture du jeu politique, ouverture que Souhaïl Belhadj qualifie, à juste titre, de très « (dé)limitée ».
Une alliance sunnito-alaouite au cœur du pouvoir syrien
De façon essentielle, notamment pour comprendre les dynamiques de la crise actuelle, La Syrie de Bashar al-Asad montre que la perpétuation du leadership syrien ne repose pas sur la domination d’une communauté (les alaouites, environ 10% de la population) contrairement à ce qu’avancent bon nombre d’analyses rapides des médias, mais sur une alliance plus large, fondée sur « un partage communautaire du pouvoir » entre alaouites et sunnites [6]. Pour l’auteur en effet, la « domination de long terme » d’une « minorité » est en soi une proposition antithétique, qui n’a d’ailleurs pas de précédent historique. Il estime par ailleurs que ce type d’analyse « fige » la compréhension de la dynamique sociale autour d’antagonismes pensés en termes communautaires alors que ces lignes de front ne sont que le résultat du conflit social aggravé par la confiscation du pouvoir par le régime ba’thiste.
Le livre de Souhaïl Belhadj permet ainsi d’indiquer qu’aucun des groupes qui ont pris le pouvoir depuis le coup d’État ba’thiste de 1963 n’était fondé sur une cohésion à base communautaire, clanique ou familiale. Par ailleurs, il montre qu’il n’y a pas de domination alaouite de l’appareil d’État – bien qu’ils soient surreprésentés par rapport à leur poids démographique. Au moyen d’une documentation détaillée et d’une démarche d’enquête qualitative, il décrit avec précision les dispositifs de partage du pouvoir entre sunnites et alaouites, qui met essentiellement des personnalités sunnites à la tête de la plupart des leviers de l’État. Les services de sécurité – institution-clef qui relève directement du président et dont le fonctionnement, on l’a dit, est singulier et spécifique – illustrent cependant la façon dont le président peut utiliser les appartenances confessionnelles en sa faveur. Les alaouites y sont minoritaires bien qu’ils représentent environ 20% du personnel. Les chefs sont donc très majoritairement sunnites ; mais leurs adjoints sont pour la plupart alaouites, ce qui facilite l’accès à la présidence.
L’ouvrage de Souhaïl Belhadj diverge donc d’un courant de la recherche en sciences sociales sur la Syrie qui, dans la lignée de Michel Seurat [7], place au cœur des dispositifs politiques syrien l’appartenance à l’asabiya, un terme utilisé par l’historien médiéval Ibn Khadouln pour décrire ce qui est traduit par l’esprit de corps. L’esprit de corps, dans cette approche, incarnerait une l’allégeance première, essentielle, de l’individu à une communauté ethno-religieuse. Elle expliquerait la cohésion et la persistance du régime ba’thiste. Cette approche suggère en somme une forte équivalence entre régime ba’thiste et régime alaouite.
Or, Souhaïl Belhadj montre dans son ouvrage que les ressorts de l’allégeance sont bien loin de se superposer à une cartographie communautaire (ou religieuse, ou familiale) exclusive, laquelle ne suffit à expliquer ni la structuration ni la perpétuation du régime ba’thiste et de son leadership. Il indique que si le régime est bien un pouvoir de type communautaire, il repose sur un partage entre deux communautés. Pour se maintenir, il met en œuvre un système d’autorité dont les services de renseignement sont les garants, et qui est fondé sur le contrôle de l’accès aux ressources politiques et économiques par l’intermédiaire d’institutions telles que le Parti Ba’th, les services de renseignement et l’armée.
Quels apports pour comprendre la crise syrienne ?
L’ordre politique fondé par Hafez al-Asad et perpétré par son fils Bashar a donc été celui de « l’instauration d’un système coercitif et clientéliste qui préserve les équilibres communautaires », impliquant la limitation du pluralisme politique et la perpétuation d’une « politique avantageuse pour l’armée, le Ba’th et la minorité alaouite ». Souhaïl Belhadj montre que, sous couvert de protéger un ordre multiconfessionnel, et tout en se présentant comme le défenseur des minorités, le régime des Asad a, tout au contraire, renforcé les antagonismes de toute nature qui traversent la société syrienne : antagonismes de type ethno-religieux, communautaires, et de classe. Plutôt que de libéraliser le jeu politique et de prendre le risque de se voir mettre en minorité, la direction politique syrienne, de Hafez à Bashar al-Asad, a préféré geler le conflit social en mettant en place la « formule autoritaire ba’thiste ».
L’analyse de Souhaïl Belhadj permet ainsi de comprendre le soulèvement révolutionnaire syrien, démarré en mars 2011, comme un symptôme de la réalité de ce conflit social profond, auquel l’autoritarisme syrien n’a su/voulu apporter de réponse. Il est aussi le signe que, au cours de la dernière décennie, alors que la société syrienne changeait et que les Syriens développaient de nouvelles attentes, Bashar al-Asad n’a pas réussi à construire une alternative à ce conflit social. Après le triptyque « Ba’th, socialisme et panarabisme » de l’époque de son père, il n’a pas su mettre en œuvre une formule nationale capable de cimenter la société. Les « masses » urbaines et les ruraux, clientèles traditionnelles du Ba’th, ne se sont pas estimées bénéficiaires des fruits de la libéralisation économique, et ont vu avec inquiétude s’organiser la promotion de nouvelles élites économiques dans le système de pouvoir.
Par ailleurs, l’ouvrage de Souhaïl Belhadj donne des clefs pour analyser le régime syrien aujourd’hui, alors qu’il est pris dans la tourmente. La résistance du régime, au-delà du soutien matériel apporté par le Russie et l’Iran, indique que, jusqu’à présent, les trois piliers du régime – l’armée, les services secrets, et le parti – ne se sont pas désolidarisés de l’option répressive prise par la direction politique, même si l’armée a pris l’ascendant dans la direction politique syrienne, au détriment des services de renseignements et du Ba’th, qui est en voie de décomposition. La formule autoritaire semble encore tenir. Cependant, et alors que la Syrie est déchirée par un conflit qui fait voler en éclat le carcan dans lequel la société syrienne était tenue sous le régime ba’thiste, l’analyse proposée par Souhaïl Belhadj permet de rendre compte différemment des évolutions du régime. Le fait que celui-ci en soit venu à recourir à de hauts niveaux de violence pour se maintenir face à la contestation – comme tout régime banalement minoritaire, en somme – et qu’il mobilise un registre et des tactiques d’ordre nettement communautaire, est peut-être le signe que cette formule autoritaire, fondée sur une direction élargie et l’alliance sunnito-alaouite, est désormais engagée dans une stratégie pour sa survie. (Article publié dans La Vie des idées, 26 février 2014, ISSN: 2105-3030)
_____
[1] Souhaïl Belhaj ayant choisi d’utiliser la transcription anglaise des noms arabes de Bashar al-Asad et du parti Ba’th, cette recension reprend cette transcription.
[2] Voir par exemple l’article de Matthieu Rey, 2012, « Un parlementarisme oriental ? Eléments pour une historie des assemblées au Moyen-Orient des années 1850 aux années 1970 », In Revue d’histoire politique, 2012/1, n°17 L’Harmattan, pp. 162 à 176.
[3] Pour reprendre l’expression de Raymond Hinnebusch, cité par Souheïl Belhadj. Hinnebusch R., 2001, Syria : Revolution from above, London, Routledge.
[4] Michel Seurat, L’Etat de Barbarie, publié en 1989 et réédité par les PUF en 2012.
[5] Voir par exemple Vignal L., 2005, « Bachar al-Assad, les voies étroites de la réforme », in La vie des idées dans le monde, Juillet-Août 2005, Paris.
[6] Les sunnites représentent environ 75% de la population syrienne.
[7] Op. cit.

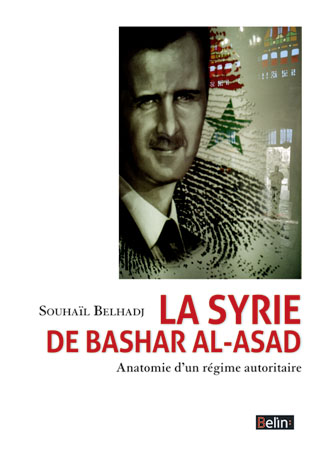

Reste peut-être à mettre le doigt aussi sur le lien mythologique entre Damas et Tel Aviv à partir du conflit de 67, lorsque la radio militaire syrienne annonçait le 10 juin la chute de la capitale provinciale de Quneitra avant qu’elle ne soit effectivement tombée… Par ailleurs, il y a pouvoir réel et pouvoir de façade: juste pour citer quelques noms: Tlas, Khaddam, Shihabi sunnites… mais désarmés!