
Entretien avec Sophie Bessis conduit par Catherine Calvet et Célian Macé
Aujourd’hui encore, sa révolution est regardée depuis tout le monde arabe. Pourquoi la «petite» Tunisie a-t-elle toujours eu une place à part? L’historienne franco-tunisienne Sophie Bessis a longtemps été journaliste. Elle est l’auteure d’une douzaine d’ouvrages dont une biographie de Bourguiba (avec Souhayr Belhassen). Elle partage aujourd’hui sa vie entre Paris et Tunis. Dans son dernier livre, Histoire de la Tunisie. De Carthage à nos jours (Editions Tallandier), elle retrace l’histoire d’un pays petit par la superficie mais remarquable par son expérience et la profondeur de son histoire depuis trois mille ans.
Comment définissez-vous la «tunisianité» ou la singularité tunisienne?
La géographie conditionne en partie l’histoire. Il suffit de regarder une carte pour voir que la Tunisie est un pays largement ouvert sur la mer avec plus de 1200 kilomètres de côtes et très proche de l’Europe du Sud puisqu’une centaine de kilomètres seulement sépare le cap Bon de la Sicile. Ce détroit de Sicile sépare en outre la Méditerranée orientale de la Méditerranée occidentale. La Tunisie est à l’intersection de ces deux mondes méditerranéens. Enfin, c’est un pays peu montagneux, contrairement à l’Algérie et au Maroc. Il n’y a pas de reliefs infranchissables empêchant la traversée de la Tunisie. Et tout au long de son histoire, on y a beaucoup circulé!
La «tunisianité» est aussi une construction historique forgée entre autres par Habib Bourguiba, au pouvoir de 1956 à 1987. Le premier chef d’Etat de la Tunisie indépendante estimait que la personnalité tunisienne ne se résumait pas tout entière dans son arabité et qu’il fallait faire remonter son histoire à la fondation de Carthage au IXe siècle avant notre ère.

Comment l’histoire tunisienne a-t-elle été utilisée, sous Bourguiba mais aussi sous Ben Ali?
En Tunisie, le recours à l’histoire est aussi une façon de se situer politiquement. Pour se démarquer du nationalisme arabe et pour asseoir sa politique de sécularisation, Bourguiba s’est situé dans une histoire longue prenant son départ bien avant l’arrivée de l’islam. Il a érigé le punique Hannibal et le Numide Jugurtha en héros fondateurs de l’histoire officielle. Ben Ali, qui est resté au pouvoir de 1987 à 2011, s’est davantage réclamé du legs arabo-musulman sans pour autant rompre avec le récit bourguibien ni avec la notion de tunisianité.
Qu’est-ce qui change avec l’arrivée de Ben Ali au pouvoir?
De 1956 à 2011, la Tunisie s’inscrit dans la même séquence historique. Les régimes de Bourguiba (juillet 1957-novembre 1987) et de Ben Ali (novembre 87-janvier 2011) ont été tous deux autoritaires, même si leurs modalités d’exercice du pouvoir ont différé. Ce qui change à partir des années 1970, dès avant l’arrivée de Ben Ali à la tête de l’Etat, c’est qu’on constate un reflux de la gauche comme opposition principale au régime et l’émergence de mouvements issus de l’islam politique, parallèlement à un puissant courant de retour du religieux dans la société sur un mode très conservateur, sous l’influence grandissante des monarchies du Golfe. Comme les autres régimes arabes, ce qui relativise sa singularité, les deux régimes qui se sont succédé en Tunisie ont mené à partir de cette période une brutale répression des islamistes tout en valorisant l’islamité du pays, tentant ainsi d’apparaître aux yeux des opinions comme les seuls gardiens légitimes de la religion. Ce parti pris a été plus marqué sous Ben Ali que sous Bourguiba.
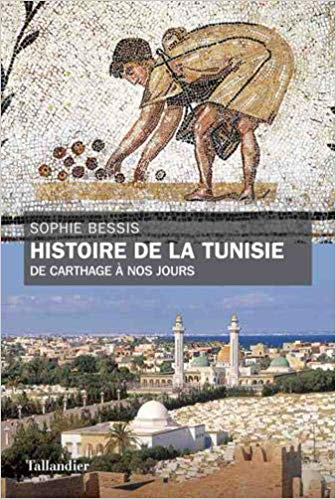 Et quel était le rapport de Ben Ali à l’histoire?
Et quel était le rapport de Ben Ali à l’histoire?
Il s’est servi de l’épaisseur historique de son pays quand il lui a paru nécessaire de le présenter comme un pays ouvert et pluriel. Ce qui est en définitive intéressant dans cette notion de tunisianité, c’est qu’aucune tendance politique ne peut la passer à la trappe dans la mesure où elle a été en grande partie intériorisée par la société. Même les dirigeants islamistes se sont résignés à l’invoquer. Alors qu’à leur arrivée au pouvoir en 2011, ils avaient essayé d’imposer leur vision de l’islam censé devoir régir la sphère publique et la société, croyant que la religiosité et le conservatisme d’une bonne partie des Tunisiens équivalait à une adhésion à leur projet idéologique, ils ont été contraints d’évoluer. Ils se sont, en quelque sorte, «tunisifiés» en reprenant à leur compte la rhétorique des 3000 ans d’histoire. Aujourd’hui, «le roman national» est majoritairement accepté.
Comment définir ce fameux art du compromis que vous rangez dans les critères de la tunisianité?
Il ne faut pas en faire une constante de l’histoire tunisienne qui a connu maints épisodes sanglants. Mais, après la révolution de 2011, elle est le seul pays arabe à n’avoir connu ni le chaos à la libyenne, ni l’atroce guerre à la syrienne, ni une restauration autoritaire comme en Egypte. La capacité à négocier de ses élites est peut-être due aux vieilles traditions d’urbanité dont elles sont porteuses. Depuis l’Antiquité, la Tunisie est plus urbanisée que ses voisins, et les traditions commerçantes des cités littorales sont peu compatibles avec la guerre. Cet habitus, comme l’ancienneté de l’Etat, a probablement joué dans cette capacité à éviter les conflits violents.
Il y a cependant un clivage entre le littoral et l’intérieur du pays, qui a été mis de côté au moment de la révolution et qui a reparu depuis.
Au moment de la révolution, tous les segments de la société étaient d’accord pour renvoyer Ben Ali, sans pour autant s’entendre sur les priorités de l’après-Ben Ali. Les élites urbaines et côtières avaient des attentes de nature essentiellement politique. Les populations appauvries de l’intérieur ont avant tout espéré un mieux-être social. Sur ce plan, les gouvernements qui se sont succédé depuis 2011 n’ont pas répondu aux attentes et ont géré le pays au jour le jour, sans chercher à réparer le tissu social. Le parti Ennahdha [ ], qui a monopolisé le pouvoir de 2011 à 2013, a créé des milliers d’emplois dans le secteur public afin d’élargir sa base. Mais cette hypertrophie de la fonction publique a engendré plus de problèmes qu’elle n’en a résolus [Voir à propos de la grève générale du 17 janvier 2019: dossier publié sur le site alencontre.org]
Par ailleurs, dans les régions intérieures, des revendications le plus souvent légitimes se sont soldées par des arrêts de la production dans le secteur minier essentiellement. Pour de nombreuses raisons, l’économie tunisienne est aujourd’hui fragilisée, ce qui n’aide évidemment pas à résoudre la question sociale. En revanche, tous les Tunisiens se retrouvent dans ce rapport très particulier qu’ils entretiennent avec l’idée de Constitution.
La Tunisie est un pays où l’Etat est ancien. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, la nécessité de transformer le régime beylical en monarchie constitutionnelle s’est imposée aux élites ayant constitué ce qu’on a appelé le «Mouvement réformiste». La Constitution promulguée en 1861 a été la première du monde arabe. Elle a été suspendue au bout de trois ans seulement, mais les Tunisiens restent fiers de cette antériorité. Ce n’est pas un hasard si le premier parti tunisien né après la Première Guerre mondiale, en 1920, a été nommé Destour, «Constitution» en arabe, l’une des revendications principales des nationalistes. Quand Habib Bourguiba crée son parti en 1934, il s’appelle Néo-Destour, conservant le terme. Après la révolution de 2011, une majorité de la population a estimé que la création d’une Deuxième République devait nécessairement passer par l’adoption d’une nouvelle Constitution. Tout le monde s’est emparé de ce projet, et l’on peut dire que la Constitution de 2014 a été débattue partout, dans les partis, les associations de la société civile, dans les manifestations et dans les cafés… Au final, un texte de consensus a été adopté en 2014, très ambivalent, mais qui est le résultat d’un compromis national entre des projets de société et d’organisation des institutions au départ antinomiques.
Depuis la révolution, la Tunisie incarne quelque chose bien au-delà de ses frontières…
Elle a une trajectoire à part. Elle ne peut pas servir de modèle, mais elle est scrutée pour son expérience originale et est devenue un référent important. Par exemple, tous les mouvements féministes du monde arabe regardent la Tunisie. Cela ne veut pas dire que la situation des femmes y est parfaite, très loin de là. La législation n’est pas encore égalitaire, notamment en matière d’héritage – question qui est actuellement débattue. Mais alors que le code du statut personnel a été promulgué en 1956, il reste encore le plus avancé du monde arabe. Cela fait trois générations que les Tunisiennes ne savent plus ce que la polygamie veut dire. Par ailleurs, l’expérience démocratique en cours depuis 2011, en dépit de ses accrocs et de ses fractures, est suivie avec beaucoup d’intérêt. Si c’est possible en Tunisie, pourquoi pas nous, se disent les activistes du monde arabe. Mais les expériences historiques différentes ne produisent pas les mêmes effets, les destins divergents des «printemps arabes» le prouvent amplement. (Entretien publié dans le quotidien Libération, le 18 février 2019, avec autorisation du quotidien mentionné)

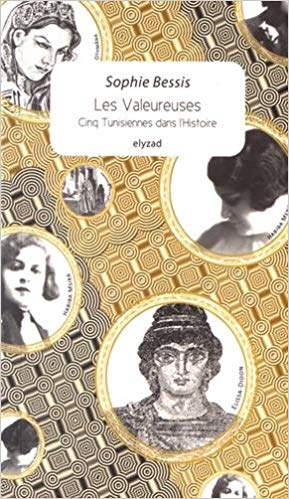

Soyez le premier à commenter