
Entretien avec François Burgat conduit par Clea Pineau
La société syrienne qui a vécu sous l’hégémonie du parti Baath syrien n’était pas connue pour ses clivages interconfessionnels. La majorité démographique était sunnite et l’élite au pouvoir issue de la religion alaouite (branche du chiisme), mais la laïcité était très officiellement revendiquée. Comment en est-on arrivé à la situation dramatique que connaît la Syrie aujourd’hui? De plus en plus, les massacres de l’État islamique envahissent nos écrans. Mais il serait bon de rappeler que Bachar Al-Assad est toujours au pouvoir et continue ses atrocités. Avec François Burgat, directeur de recherches au CNRS et ancien directeur de l’IFPO (Institut Français du Proche-Orient), revenons sur ce conflit et questionnons l’impact des politiques occidentales.
*****
Comment et pourquoi le régime, puis l’opposition, puis les puissances occidentales ont-ils transformé le conflit, qui initialement avait pour but la construction d’institutions transconfessionnelles accordant plus de libertés aux citoyens, en un conflit confessionnel? En d’autres termes, comment expliquer que l’extrémisme sunnite qui monopolise nos écrans aujourd’hui est en réalité le produit des stratégies de ces différents acteurs?
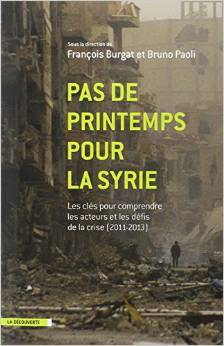 François Burgat: La laïcité du régime syrien était très réelle mais au seul niveau de son discours. Elle était le produit d’une affirmation volontariste, plus «déclarative» qu’effective. Car elle était le résultat apparent de la volonté d’un régime très autoritaire bien plus qu’elle n’était celui d’une alchimie citoyenne intériorisée et appropriée par toutes les composantes du tissu national. En d’autres termes, le dépassement des clivages confessionnels et ethniques n’était pas en Syrie le fait de l’émergence d’une culture citoyenne comme cela a pu être, en partie au moins, le cas au Liban au prix de la terrible guerre civile que l’on sait. Il semblait ne s’être opéré que parce que le régime interdisait toute autonomie d’action ou de parole à chacune des communautés (y compris d’ailleurs la sienne). Mais dans les coulisses de cet affichage laïc, l’élite au pouvoir avait en fait une politique très discriminatoire. Elle favorisait grossièrement l’accès des Alaouites à l’appareil sécuritaire, et l’exclusion, au moins relative, des Sunnites tout particulièrement à partir de l’épisode insurrectionnel de Hama en 1982.
François Burgat: La laïcité du régime syrien était très réelle mais au seul niveau de son discours. Elle était le produit d’une affirmation volontariste, plus «déclarative» qu’effective. Car elle était le résultat apparent de la volonté d’un régime très autoritaire bien plus qu’elle n’était celui d’une alchimie citoyenne intériorisée et appropriée par toutes les composantes du tissu national. En d’autres termes, le dépassement des clivages confessionnels et ethniques n’était pas en Syrie le fait de l’émergence d’une culture citoyenne comme cela a pu être, en partie au moins, le cas au Liban au prix de la terrible guerre civile que l’on sait. Il semblait ne s’être opéré que parce que le régime interdisait toute autonomie d’action ou de parole à chacune des communautés (y compris d’ailleurs la sienne). Mais dans les coulisses de cet affichage laïc, l’élite au pouvoir avait en fait une politique très discriminatoire. Elle favorisait grossièrement l’accès des Alaouites à l’appareil sécuritaire, et l’exclusion, au moins relative, des Sunnites tout particulièrement à partir de l’épisode insurrectionnel de Hama en 1982.
Une telle politique, au lieu de résorber et de dépasser les tensions interconfessionnelles, a donc logiquement contribué à les aiguiser. Cette laïcité «déclarative» ou «discursive» était certes inspirée des convictions tout à fait nobles des fondateurs du parti Baath. Mais en réalité elle était surtout vitale au régime de Bachar al-Assad, parce que, appuyé trop étroitement sur la communauté alaouite, il se savait dangereusement minoritaire et isolé dans le champ religieux.
Dans les failles de cette citoyenneté inachevée, ce régime a, dès le début de la crise, joué très systématiquement, avec un parfait cynisme, la carte de la confessionnalisation. Les exemples abondent, depuis ses campagnes d’affichage insinuant que les opposants voulaient s’en prendre avant tout à la coexistence confessionnelle, jusqu’aux manipulations grossières destinées à effrayer les Chrétiens (et leurs soutiens occidentaux) et dont les campagnes orchestrées par la religieuse Marie-Agnès de la Croix [une propagandiste pro-régime Assad que le Père Paolo dall’Oglio enlevé en Syrie le 29 juillet 2013 avait caractérisée comme une sorte de mandataire du régime Assad] constituent l’une des facettes les plus éloquentes.
Chacun sait qu’il est infiniment plus facile d’allumer le feu sectaire que de le combattre. La stratégie du pire est donc parvenue, peu à peu, malgré les protestations unitaires des manifestants, à marquer des points. Le régime n’est peut-être pas parvenu à augmenter le nombre de ses soutiens. Mais il est manifestement arrivé à multiplier celui des «ennemis de ses opposants».
Quel a été l’intérêt du régime à voir apparaître des groupes extrémistes tel que Al-Nusra ou l’EI à ses frontières et, désormais, comment va-t-il gérer l’ampleur du phénomène? Est-ce toujours un atout pour Bachar al-Assad ou une menace?
A court terme, la visibilité et la centralité prise par les groupes extrémistes confortent la rhétorique («moi ou le chaos islamiste») que, depuis les premières heures du conflit, le régime a tout fait pour crédibiliser. A terme, il n’est pas invraisemblable que l’EI devienne, malgré – ou à cause de – l’intervention occidentale, le seul adversaire réellement menaçant pour le régime. Cela dépend de nombreuses variables. D’abord le degré d’implication de la Turquie, l’un des seuls pays à pouvoir réalistement envoyer des combattants sunnites sur le terrain. Ensuite, et c’est là sans doute le point le plus important, la nature de la relation que les combattants de Daesh [E.I.] sont en train de nouer avec les populations qu’ils ont «libérées», qui vont ou non se dresser contre leurs méthodes ou au contraire, dans une proportion suffisante pour leur permettre de se maintenir, s’en accommoder.
Depuis le début du conflit, Bachar al-Assad a utilisé les médias pour diviser sa population et se faire valoir en tant que défenseur de la laïcité aux yeux de la communauté internationale. Désormais, il utilise les massacres médiatisés de l’EI pour continuer sa violence tout aussi infâme mais oubliée. Que se passe-t-il actuellement en Syrie dans les zones sous l’autorité du régime? Quels sont les objectifs et la stratégie de Bachar al-Assad désormais?
De toute évidence, le régime a mis à profit la montée en visibilité des jihadistes pour poursuivre l’éradication de la partie de son opposition armée susceptible de recevoir le soutien arabe, turc et occidental. Même si les frappes contre l’EI n’ont jamais été sa priorité, la coalition internationale le libère désormais de l’un des deux fronts sur lesquels il devait combattre. Les zones «ibérées» sont à la fois, chaque fois que cela s’avère possible, encerclées et impitoyablement affamées. A défaut d’être affamées, ou en plus de l’être, elles sont soumises à d’incessants bombardements aériens et notamment au lâcher des terribles barils d’explosifs par les hélicoptères. Cette stratégie est proche de celle de «la paix des cimetières» qui a été celle de la Russie d’Eltsine à Grozny [Tchéchénie, 1re guerre: 1994-1996; 2e sous Poutine: août 1999-mai 2000] et que Poutine aide Bachar à mettre en œuvre avec des moyens aériens dont aucune arme occidentale ne protège les civils.
Dans les zones sous contrôle du régime, une normalité apparente (qui peut aller, à des fins de propagande, jusqu’à l’organisation récente, près de Damas, d’un rallye automobile) va de pair avec la poursuite implacable de la répression des opposants. Elle se traduit notamment par la torture systématique des suspects dont seule la carte d’identité est retournée, en guise de faire-part de décès, aux proches qui tentent de s’enquérir de leur sort. Le rapport «Cesar» (présenté notamment au Congrès américain) composé de 50’000 clichés pris par un médecin militaire syrien ayant fait défection, a documenté le décès en détention (pour la seule région de Damas) de 11’000 d’entre eux dans des conditions défiant l’imagination. Les zones contrôlées par le régime sont également le théâtre d’attentats à l’explosif ou de tirs de roquettes venant de l’opposition. Enfin, fut-ce à un moindre niveau que dans les zones «libérées», des pénuries et une terrible inflation rendent à une écrasante majorité de la population la vie quotidienne de plus en plus difficile.
Comment la militarisation ou la non-militarisation du conflit par les puissances occidentales et les pays du Golfe ont-elles participé à l’émergence des groupes extrémistes ?
La question de l’interférence des puissances étrangères est tout à fait essentielle pour comprendre l’émergence des groupes armés extrémistes. Mais il ne faut pas l’aborder sous le seul angle des soutiens, occidentaux ou arabes, à l’opposition.

L’ingérence étrangère majeure, celle qui a fait que très vite la crise syrienne n’a plus eu de syrien que le nom, c’est celle de la Russie et plus encore, par Hezbollah interposé, celle de l’Iran. C’est cela qu’il faut redire sans se lasser. C’est cette véritable perfusion artificielle, par une ingérence extérieure décisive, faite au bénéfice d’un régime affaibli et déchu, qui a conduit à la présente catastrophe. Car ceux qui ont soutenu le régime sont allés immédiatement à l’essentiel, c’est-à-dire au maintien et au renforcement de sa suprématie militaire. A l’inverse, le soutien des Occidentaux à l’opposition est longtemps demeuré plus politique et humanitaire ou même seulement verbal que militaire et donc fonctionnel. Même si les Etats Unis (et la France) ont élevé récemment le niveau des armes (notamment antichars) destinées à l’opposition, les «Amis de la Syrie», notamment arabes ou turcs, n’ont jamais reçu l’autorisation de leurs sponsors américains de transférer ces armes anti- aériennes qui auraient permis d’infléchir réellement le rapport de force. Inéluctablement, ce sont ainsi les groupes jihadistes, parce que grâce à l’appui de pans entiers de la communauté sunnite irakienne ils sont les seuls à avoir réussi à s’affranchir de ces soutiens étatiques, occidentaux ou arabes, qui sont montés en puissance. Ce processus a été d’autant plus rapide que les Occidentaux ont cherché à imposer très tôt à l’opposition dite modérée des exigences idéologiques («pas trop de Frères musulmans s’il vous plaît!») qui ont contribué à perturber une organisation qui, fort logiquement, était déjà terriblement complexe.
A défaut d’éradiquer l’EI, quelles peuvent être les conséquences de l’intervention de la coalition internationale sur le conflit?
Il est difficile de les estimer aujourd’hui avec certitude. Il y a toutefois un risque, chaque jour un peu plus perceptible, que cette mission de combattre l’Etat islamique attribuée à l’opposition dite modérée par une coalition conduite par le plus impopulaire des acteurs mondiaux que sont les Américains ait un effet contre-productif. Tel une sorte de baiser de la mort, il risque à mes yeux non point de la libérer d’une concurrence pernicieuse mais bien de provoquer son affaiblissement. Certains groupes ont d’ores et déjà perdu de leur capacité d’action, sans doute à la suite de défections. Plusieurs autres ont d’ores et déjà basculé dans le camp de l’EI. Une fois cela dit, il ne faut pas sous-estimer l’efficacité militaire des frappes aériennes, qui à défaut de l’anéantir, gêne très réellement la stratégie de l’EI (dans ses déplacements et dans l’usage de son artillerie lourde) désormais sur la défensive.
Comment expliquer l’afflux de jihadistes d’Occident, en particulier de France? Outre celui de notre politique étrangère, signale-t-il l’échec de notre politique d’intégration de nos propres minorités?
Le camp des jihadistes accueille en fait des combattants de trois provenances, ou «produits» par trois dynamiques politiques. Ce sont d’abord des Syriens, il ne s’agit pas de le nier, qui avaient adopté ou bien qui ont été poussés à adopter une attitude radicale, à mesure que la crédibilité des solutions dites «modérées» s’affaiblissait. Ce sont ensuite des Irakiens. Ils ont été fabriqués par une filière où se sont succédé la violence du régime bassiste de Saddam Hussein d’abord, celle, souvent sous-estimée, de l’intervention américaine ensuite, celle enfin du régime sectaire de Nouri al-Maliki installé par les Américains et de ses alliés iraniens. Mais il accueille également ceux que je considère comme les laissés-pour-compte des régimes politiques de près de 80 nations. Dans le cas des Tchétchènes, des Ouïgours ou des Egyptiens, on n’a pas de peine à comprendre les motivations de leur radicalisation. Mais les dysfonctionnements des systèmes politiques occidentaux et leur capacité à fabriquer de «l’exclusion» ne sont pas moindres. En quantités infimes, ne l’oublions jamais, par rapport à la totalité des Musulmans de chacun de ces pays, mais en quantité significative tout de même, on constate qu’ils ont nourri des trajectoires de radicalisation comparables à celles des régimes que nous considérons comme non démocratiques. La présence d’une minorité importante de convertis ne change rien à la problématique dominante.
Dans le cas de la France, j’ai depuis très longtemps exprimé l’idée que la table du «vivre ensemble», c’est-à-dire notre capacité à faire coexister et agir harmonieusement toutes les composantes – notamment confessionnelles – du tissu national, y compris les plus récentes comme les Musulmans, souffrait au détriment de ces derniers, d’un déséquilibre aussi constamment nié qu’il est avéré: un déséquilibre dans la représentation bien sûr, mais tout autant, et plus immédiatement, un déséquilibre radical dans la distribution de la parole publique et médiatique.
Il m’est arrivé de penser que la machinerie à produire de la radicalisation était solidement ancrée dans le plus banal de nos intimes: dès la «tranche du matin» de notre radio nationale France Inter jusqu’à nos «Envoyés spéciaux» des soirées de France 2 (que de très longue date j’avais éprouvé le besoin, chaque fois qu’ils évoquaient le monde musulman, de qualifier d’«Envoyés spécieux») j’ai souvent le sentiment que la prise en compte des attentes respectives des uns et des autres souffre depuis toujours d’un très profond déséquilibre. Je ne suis pas le seul à le penser. Je me souviens m’être entretenu au milieu des années 1990 avec de jeunes Français d’ascendance algérienne: «lorsqu’à la télévision on parle de l’Algérie, de la Palestine ou de l’islam», m’avaient-ils déclaré, «on est obligé de zapper. Eh bien, croyez-nous, nous avons mal aux doigts à force de zapper».
Ainsi, à massacres égaux, Bachar al-Assad, grâce à son amitié toute calculée avec les minorités (en particulier les Chrétiens) face aux épurations ethniques et religieuses de l’EI et l’expansion du sunnisme extrémiste (autrement dit «les descendants de Ben Laden», selon vos dires), remporte la sympathie occidentale. Comment l’Europe et les Etats-Unis ont-ils pu être dupés si facilement ? N’y a-t-il pas d’autres intérêts propres à ces puissances dans la zone ou d’autres challenges en jeu?

«A massacres égaux?» – Non! On ne saurait user d’une telle formule. Elle aboutit à renvoyer les deux camps dos à dos! L’Observatoire syrien des droits de l’homme a rappelé, avec des statistiques très précises, une donnée essentielle: quantitativement, les deux acteurs du drame syrien sont très loin de jouer dans la même catégorie.
Pour le reste, si je ne devais citer qu’une seule origine à cette terrible contre-performance occidentale, qui va en s’empirant une fois de plus, sans sous-estimer la volonté un temps évoquée des Etats-Unis de se désengager, je dirais que c’est l’impossibilité occidentale (américaine et européenne en général, française en particulier) à nouer une relation sereine avec le tissu de l’Islam politique.
C’est cette réaction irrationnelle qui est à l’origine de cette suspicion précoce, apparue presque dès les premiers mois de la révolte, immédiatement relayée, très insidieusement, par une grande partie de l’intelligentsia de gauche, qui nous a conduit à mesurer notre soutien à l’opposition syrienne jusqu’à la présente catastrophe. Alors qu’un petit peu plus de confiance aurait à mon sens permis d’éviter à la fois l’enlisement et la radicalisation.
A Kobané, la Turquie a refusé de protéger les Syriens car elle les trouvait «trop Kurdes » à son goût et, en ce sens, potentiellement dangereux pour ses intérêts nationaux. A Alep et Homs, si les Occidentaux ont laissé mourir des milliers de leurs compatriotes c’est à bien des égards, en dernière instance, parce que nous les trouvions trop… musulmans. (François Burgat, publié dans Mena Post le 26 novembre 2014)


Soyez le premier à commenter