Ce qui peut être interprété comme l’aveu d’une défaite qui affecte toute l’Amérique latine est passé presque inaperçu. Il vient d’être admis que toutes les stratégies de développement mises en œuvre dans la région sont épuisées. Plus encore, que chacune d’entre elles a échoué. Voilà l’aveu du secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL).
Malgré la gravité de la déclaration, ni les gouvernements, ni la presse, ni les citoyens directement liés aux problèmes de développement n’ont réagi. De plus, Alicia Bàrcena [Mexique], du secrétariat exécutif de la CEPAL, a été plus loin en déclarant que c’est l’extractivisme, c’est-à-dire l’exportation des «ressources naturelles» sur le marché mondial, qui est dans une impasse, car «il concentre la richesse en peu de mains et apporte très peu d’innovation technologique» [1].
Nous sommes face à l’aveu de la plus haute autorité de l’organisme économique le plus important du continent, celui qui, d’une part, aurait dû contribuer à éviter cet échec, et, d’autre part, aurait dû assurer la voie vers ce qu’il concevait comme un développement vertueux qui réduit la pauvreté et l’inégalité. Reconnaître que rien de tout cela ne s’est produit, c’est admettre que la CEPAL n’avait pas de stratégies vraiment efficaces à cet effet. Ou alors, si on admet que ses propositions étaient adéquates, les gouvernements porteraient toute la responsabilité de ne pas les avoir suivies. L’une ou l’autre des deux possibilités a de très graves implications.
L’aveu de l’échec
Il est surprenant qu’un tel aveu passe inaperçu. Il faut se demander si la secrétaire exécutive de la CEPAL reconnaît cela en public parce que tout le monde le sait déjà, et que, comme beaucoup en sont responsables d’une manière ou de l’autre, personne n’en sera offensé ou ne demandera à personne d’assumer la responsabilité de cet échec. En effet, il y a une ambiance de fatalisme croissant sur le continent, que l’on ressent dans ces situations et dans d’autres, vis-à-vis des stratégies de développement.
Cela contraste avec l’enthousiasme avec lequel le développement a été discuté dans un passé récent, à la fois par les politiciens ou les universitaires et les militants. Depuis le début des années 2000, toutes sortes d’essais ont proliféré en Amérique latine sur d’autres modalités d’organiser le développement, notamment sur les changements dans le rôle de l’Etat, la régulation des marchés et les politiques publiques. Cet élan était directement associé aux gouvernements dits progressistes et, au fur et à mesure qu’ils s’épuisaient, les attentes vis-à-vis de leurs versions de développement se sont également affaiblies.
La CEPAL a navigué sous différentes pressions et ambiguïtés face aux divers essais de développement au XXIe siècle. Elle n’a jamais été une promotrice enthousiaste de certaines de ces versions, comme la «bolivarienne», mais elle a contribué à légitimer les voies les plus modérées, comme au Brésil sous Lula da Silva [2003-2011]. Elle n’a pas abandonné ses propres propositions, telles celles qui, dans les années 1990, postulaient une «transformation productive» ou l’insertion dans la mondialisation des échanges. Au-delà des déclarations grandiloquentes, la CEPAL est restée fidèle au credo de la croissance économique en tant que moteur indispensable du développement et plaçait ses espoirs dans certaines réglementations pour réduire la pauvreté et les inégalités.
Croissance économique et extractivismes
Une fois obtenue la croissance économique, des concessions peuvent être faites qui ne la mettent pas en danger. C’est là l’origine de l’acceptation des orientations extractivistes. De cette façon, la CEPAL en est venue à soutenir le concubinage des politiques extractivistes avec toutes sortes de plans et stratégies de développement, conservateurs ou progressistes, en se concentrant sur l’amélioration de la gestion technologique (extraction plus propre), sur l’augmentation de la collecte d’investissements (économiquement plus bénéfiques), et pour s’assurer que les protestations citoyennes soient apaisées (moins conflictuelles). Elle a toléré les extractivismes bien que cela allait à l’encontre des positions initiales de la CEPAL lesquelles mettaient en cause un développement fondé sur l’exportation de matières premières. Elle l’a fait parce que cela permettrait d’accumuler du capital, ce qui faciliterait en quelque sorte la réalisation des changements structurels et réduirait les inégalités. En conséquence, la CEPAL n’a jamais élevé la voix de manière énergique afin de dénoncer les graves conséquences négatives des politiques extractivistes.
C’est pourquoi il est extrêmement frappant de constater qu’en 2020, on reconnaisse que les extractivismes concentrent la richesse, apportent très peu d’innovation technologique et font partie de ce développement qui a échoué. C’est tout ce que les organisations citoyennes et quelques hommes politiques ainsi qu’une poignée d’universitaires disent depuis plus d’une décennie, sans être reconnus par la CEPAL.
Au contraire, la Commission a contribué à un nationalisme des ressources naturelles, qui, surtout dans le discours progressiste, insistait sur les exportations de matières premières comme moyen d’assurer la croissance économique, et à partir de là de déployer des plans sociaux. La discussion s’est concentrée, par exemple, sur l’imposition des firmes extractivistes et non sur le type de développement que leurs activités impliquaient. Il n’a pas été compris que ce mode d’appropriation des ressources naturelles a des impacts régionaux de toutes sortes, et qu’il génère également des conséquences qui empêchent une diversification productive.
Comme il a été dit déjà, cette situation est frappante car cette adhésion aux investissements extractivistes contredit quelque peu la préconisation initiale de la CEPAL en faveur de l’industrialisation et de l’autonomie commerciale. Rappelons que le mandat fondateur de la Commission en 1948, puis sous Raul Prebisch [1901-1986, d’origine argentine] dans les années 1950 et partie de 1960, s’efforça de défendre une industrialisation [par substitution des importations, entre autres], la révision des termes de l’échange, et même un marché commun continental. Ce n’est pas qu’ils étaient contre les grands chantiers miniers ou pétroliers, mais ils considéraient comme un facteur rétrograde que ceux-ci ne jouent que le rôle de fournisseurs de matières premières sur le marché international. Les orientations extractivistes, en revanche, affaiblissent les possibilités d’industrialisation et imposent en même temps des subordinations au commerce extérieur mondialisé, car toutes ses règles doivent être acceptées s’ils veulent continuer à exporter des matières premières.
Changement de cap et renversement structurel
Avec le temps, la CEPAL s’est progressivement écartée de ces objectifs initiaux pour répondre à d’autres priorités pour le développement. Par exemple, les propositions de la CEPAL des années 1990, visant à une «transformation productive avec équité», ont ajouté un éventail d’objectifs si vaste que plusieurs d’entre eux ont fini par se contredire [2]. Par exemple, son adhésion à la mondialisation a entravé sa proposition initiale d’industrialisation, tandis que l’insistance sur la croissance économique a rendu impossible une réelle «soutenabilité». Le «régionalisme ouvert» de la CEPAL a accentué ces problèmes [3]. Les propositions de la CEPAL n’ont jamais eu de contenu théorique ou de soutien politique qui permette de s’attaquer aux obstacles à l’industrialisation ou à une autre insertion dans les échanges mondialisés.
 Plus récemment, il semblerait que la CEPAL s’appuie davantage sur le débat mondial sur le développement, comme celui illustré [lors de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015] par le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les Objectifs de développement durable [17 objectifs déclinés en 169 cibles dans les domaines de l’économie, du développement social et de la protection de l’environnement]. Certes, personne ne peut s’opposer à la poursuite de certains des objectifs de ces programmes, par exemple garantir l’eau potable ou l’assainissement, mais ces plans ne surmontent pas les problèmes ni ne résolvent les spécificités latino-américaines.
Plus récemment, il semblerait que la CEPAL s’appuie davantage sur le débat mondial sur le développement, comme celui illustré [lors de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015] par le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les Objectifs de développement durable [17 objectifs déclinés en 169 cibles dans les domaines de l’économie, du développement social et de la protection de l’environnement]. Certes, personne ne peut s’opposer à la poursuite de certains des objectifs de ces programmes, par exemple garantir l’eau potable ou l’assainissement, mais ces plans ne surmontent pas les problèmes ni ne résolvent les spécificités latino-américaines.
Il n’est donc pas surprenant que la CEPAL ait de nombreuses difficultés à gérer la situation actuelle et se sente plus à l’aise dans un passé récent. De nombreuses études sont lancées sur des questions très actuelles, telles que l’impact de la Chine sur le continent sud-américain, mais en même temps, elles continuent de désigner le néolibéralisme des années 1980-90 comme explication des problèmes actuels. Ainsi, lorsqu’Alicia Bàrcena admet que l’Amérique latine a perdu les possibilités de s’industrialiser, de promouvoir l’innovation et de réduire l’écart des inégalités (une autre confession dévastatrice), elle l’explique en accusant le néolibéralisme, qui à son tour renvoie à Milton Friedman et au Consensus de Washington [qui synthétise en dix «commandements» – dont le père est l’économiste John Williamson – une politique de libéralisation économique, en 1989].
Ce faisant, c’est comme si elle avait oublié qu’au XXIe siècle, la région a connu une phase de croissance économique importante et que dans plusieurs pays certaines des contre-réformes libérales ont été démantelées. Dans les explications d’A. Bàrcena, la variété des régimes politiques qui se sont succédé dans le continent s’estompe, chacun d’entre eux avec ses traits particuliers en faveur d’un type de développement, depuis Nestor Kirchner [2003-2007] en Argentine à Juan Manuel Santos [2010-2018] en Colombie, depuis Hugo Chàvez [1999-2013] au Venezuela jusqu’à l’irruption de l’extrême droite au Brésil [depuis janvier 2019]. Toute analyse du développement actuel nécessite de prendre en compte ces circonstances spécifiques latino-américaines.
En outre, il est loin d’être clair si sont comprises effectivement toutes les implications découlant de l’aveu concernant l’épuisement du programme extractiviste, en particulier, et de celui du développement en général. A. Bàrcena affirme qu’il faut opérer un «renversement structurel du modèle» afin de mettre à cet épuisement. Il serait possible de partager cette position, mais la question réside dans quel est le contenu du terme «structurel» et de celui de «changement» au sein de la CEPAL. Un renversement dans les structures qu’impliquent des exportations de matières premières contraindrait, d’une part, à un décrochage sélectif de la mondialisation et, d’autre part, à une intégration régionale au sein de l’Amérique latine, bien que sous d’autres conditions pour organiser une industrialisation. Une position très différente s’impose face à la mondialisation, face aux marchés globalisés et à leurs institutions, comme le définissent les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). La CEPAL n’a jamais fait de progrès décisifs dans ce type de questionnements et d’alternatives. C’est la raison pour laquelle il n’est pas clair en quoi le changement proclamé est d’ordre structurel.
Les fantômes de Prebisch
Que diraient les fantômes de Prebisch et de ses compagnons de la CEPAL de son époque, s’ils apprenaient qu’aujourd’hui il est reconnu que toutes les options de développement ont échoué? Que ressentiraient-ils en découvrant que les matières premières sont toujours les principaux produits d’exportation du continent latino-américain? Comment réagiraient-ils en observant la succession de plans d’industrialisation qui n’arrivent pas à se consolider?
Ces questions et d’autres encore sont légitimes car l’option d’un renversement structurel initial et les débats sur le développement de type prébischien ont toujours critiqué la dépendance due à l’exportation de matières premières propre aux extractivismes. Maintes et maintes fois, ils ont essayé de s’écarter de cette accoutumance.
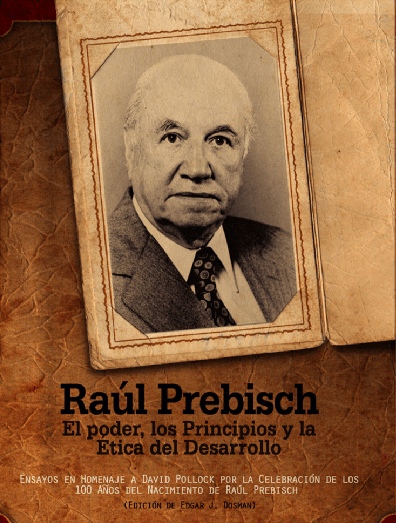 On ne peut pas nier que la situation actuelle de l’Amérique latine est très différente de celle de 1948, lorsque la CEPAL a été créée. Il est donc compréhensible que les propositions actuelles diffèrent de celles de cette époque. De la même manière, les idées de Prebisch, axées sur un «développement vers l’intérieur», ne peuvent pas être transférées comme un tout, dans la phase présente, bien que bon nombre de ces contributions soient toujours valables, et que plusieurs de celles qui ont été rejetées mériteraient d’être ressuscitées. On ne peut pas non plus oublier que Prebisch lui-même a actualisé ses conceptions du développement, comme il l’a fait en 1981 dans l’un de ses derniers livres, Capital périphérique [3].
On ne peut pas nier que la situation actuelle de l’Amérique latine est très différente de celle de 1948, lorsque la CEPAL a été créée. Il est donc compréhensible que les propositions actuelles diffèrent de celles de cette époque. De la même manière, les idées de Prebisch, axées sur un «développement vers l’intérieur», ne peuvent pas être transférées comme un tout, dans la phase présente, bien que bon nombre de ces contributions soient toujours valables, et que plusieurs de celles qui ont été rejetées mériteraient d’être ressuscitées. On ne peut pas non plus oublier que Prebisch lui-même a actualisé ses conceptions du développement, comme il l’a fait en 1981 dans l’un de ses derniers livres, Capital périphérique [3].
Mais ce qui manque, ce sont des attitudes comme celles de Prebisch et de son équipe, membres de la CEPAL d’alors, progressant dans une analyse critique et rigoureuse, indépendante mais en même temps fortement engagée en faveur de l’Amérique latine, et axée sur la recherche d’alternatives. Prebisch disait en 1963: «La propension à importer des idéologies est encore très forte en Amérique latine, aussi forte que la propension des centres à les exporter». Pour être plus clair, il a ajouté: «Il s’agit d’un clair résidu du temps de la croissance vers l’extérieur.» Il ne rejetait pas l’apport venu d’autres espaces et régions, mais il insistait sur le fait que «rien ne nous exempte de l’obligation intellectuelle d’analyser nos propres phénomènes et de trouver notre propre profil dans l’effort de transformer l’ordre des choses existant» [4].
Cette «vieille» CEPAL produisait des idées nouvelles comme réponse aux problèmes les plus aigus de son temps, et beaucoup d’entre elles ont été très incisives. C’est pour cela qu’elles ont rencontré de fortes résistances. Les gouvernements n’étaient pas indifférents, certains les rejetaient, d’autres ont essayé de les appliquer, chacun à leur manière. Il y avait une vision, une ambition et même un rêve d’un grand récit de changement, «la volonté engagée» de transformer l’ordre actuel. C’est ce talent qui s’est estompé au fil des années.
C’est cette position, cette intransigeance dans la recherche de sa propre voie, qui est la plus nécessaire actuellement, car il est reconnu que l’idée de développement elle-même est en crise. Non seulement la conception d’une croissance économique perpétuelle s’est effondrée, mais cela a également entraîné dans une chute la catégorie de développement. Son aveu montre que la CEPAL le comprend et que sûrement beaucoup parmi les gouvernements latino-américains le saisissent de même. La thèse simpliste de la croissance économique qui assure le développement est insoutenable, car presque tous les pays sont récemment passés par une phase d’expansion mais sans résoudre des problèmes tels que la formalisation de l’emploi [contre la fragmentation et la précarisation], l’équité ou l’industrialisation. Aujourd’hui, il est également évident que l‘idée de développement elle-même est épuisée. Tout a été testé et le résultat final a été bien maigre.
Cette reconnaissance fournirait une opportunité remarquable pour aborder un autre type d’alternatives situées au-delà du développement. Mais comme tous sont plus ou moins responsables de cet épuisement, il semble que les barrières qui empêchent ce pas en avant continuent de fonctionner. Il peut être nécessaire de sauver de l’oubli les fantômes de Prebisch pour, comme il le disait, «trouver notre propre voie». (Article publié sur le site Rebelión, 15 février 2020; traduction rédaction A l’Encontre)
Eduardo Gudynas est analyste sur les questions d’environnement et de développement au Centre latino-américain d’écologie sociale (CLAES). Auteur de Extractivismos y corrupción. Anatomía de una íntima relación, Ediciones Desde Abajo, Bogota, 2018. Voir son article «Développement, droits de la Nature et Bien Vivre: l’expérience équatorienne, dans la revue Mouvements, 2011/4, n° 68.
_______
- «América Latina ha perdido el tren de la política industrial y la innovación», I. Fariza entrevista a A. Bárcena, El País, 7 febrero 2020.
- La transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria del desarrollo en América Latina y el Caribe en los años noventa. CEPAL, Santiago, 1990.
- Capitalismo periférico. Crisis y transformación. R. Prebisch. México, Fondo de Cultura Económica, 1981.
- El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La integración económica al servicio de la transformación productiva con equidad. CEPAL, Santiago, 1994.
- Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano. R. Rebisch. México, Fondo de Cultura Económica, 1963 (2da ed., 1971), pág. 20.



Soyez le premier à commenter