Nakba, Pour la reconnaissance de la tragédie palestinienne en Israël, d’Eléonore Merza Bronstein et Eitan Bronstein Aparicio (Ed. Omniscience, octobre 2018) · Longtemps, la Nakba, la tragédie qui aboutit à l’expulsion de centaines de milliers de réfugiés fut une affaire purement palestinienne. Dans un livre, deux militants expliquent comment ils en ont fait une histoire israélienne.
Début 2002, quelque temps avant la « Journée de la terre », un petit groupe de militants de gauche israéliens et de Palestiniens se donnaient rendez-vous sur le site du village de Miska (à 15 km au sud-ouest de Tulkarem), vidé de ses habitants en 1948 et détruit en 1952. D’anciens habitants témoignèrent de leur vie passée dans ce village, et des panneaux en arabe et en hébreu furent apposés sur le site. Eitan Bronstein Aparicio parla ce jour-là du droit au retour des réfugiés. « C’est véritablement notre première action en tant qu’organisation : Zochrot est née sur le terrain, à Miska, en mars 2002 », raconte-t-il.
Zochrot signifie « Elles se souviennent » en hébreu. Pourquoi ce nom ? demande l’anthropologue Eléonore Merza Bronstein à son époux, dans ce livre conçu comme un dialogue au sein de leur couple. Parce que les diverses déclinaisons des mots hébreux en lien avec le sens du « souvenir » (lizkor, yizkor…) sont comme réservées, en Israël, à la mémoire du génocide des juifs. Zochrim (ils se souviennent) alors ? Plutôt Zochrot, « Elles se souviennent », manière de défier doublement, en les mariant, la domination machiste et la domination coloniale. Ces deux militants de la gauche israélienne ont aussi, dans le même ordre d’idée, conjugué leurs voix pour écrire l’histoire d’une prise de conscience traduite dans un combat politique de plus de quinze ans pour sortir la Nakba (la catastrophe en arabe) — l’expulsion de la population palestinienne de l’actuel Israël —, du néant où le narratif colonial d’Israël tente de la maintenir.
« J’ai compris que j’étais un occupant »
Eitan Bronstein Aparicio a grandi dans un kibboutz et fait l’armée « comme un Israélien lambda ». Mais c’était pendant l’invasion du Liban en 1982. Il passe alors de la condamnation morale de la guerre à la conscience politique. « J’ai compris que j’étais un occupant », dit-il. Ce refus de la guerre et de la « répression d’un mouvement légitime de résistance du peuple palestinien qui luttait pour sa libération » le conduira à ce qu’Eléonore Merza Bronstein nomme son « émancipation du sionisme » lors de la seconde Intifada, quand il réalise que l’« État juif » ne peut par définition assurer l’égalité entre ses citoyens juifs et palestiniens. Pire, qu’il désigne comme ennemis tous les Palestiniens, qu’ils soient israéliens ou non. Que la « logique raciste » est « intrinsèque au sionisme ».
Décoloniser l’identité israélienne de l’intérieur, tel est le but que cet « Israélien lambda » s’assigne et qu’il transmet à l’ONG Zochrot. Le récit de son parcours personnel, long d’une centaine de pages et questionné minutieusement par son épouse, est là pour justifier et servir ce projet. Car si Zochrot obtient quelque succès dans ses actions pour faire reconnaître la Nakba palestinienne par les Israéliens, c’est d’abord et avant tout, pour lui, du fait de l’« israélité » de ses membres.
La destruction de l’espoir
Zochrot s’oppose dès l’origine à l’action du Fonds national juif (Keren Kayemeth LeIsrael, KKL) qui fait apposer dans une partie des parcs qu’il a plantés de nombreux panneaux informatifs pour renseigner le public israélien sur l’endroit où il se trouve, n’hésitant pas à « revenir sur les périodes hellénique, romaine, séleucide, mamelouk ou même biblique », mais faisant systématiquement l’impasse sur l’histoire palestinienne plus récente. Une histoire méthodiquement effacée, y compris par la plantation de forêts et la création de parcs sur les ruines des villages palestiniens.
Les militants de Zochrot décomptent, relèvent, documentent et archivent. Et mènent des actions d’affichage et d’information diverses dont certaines sont proches du happening artistique. La cartographie des villages détruits patiemment élaborée sur plusieurs années dénombre, dans sa dernière version en ligne, 57 villages détruits ou abandonnés avant 1948, 615 en 1948 ; après 1967, 11 localités détruites, 70 menacées de destruction, 64 (localités bédouines pour la plupart) non reconnues par Israël ; à quoi il faut rajouter 195 localités syriennes du Golan. Si ces chiffres englobent l’« avant » et l’« après » 1948, c’est pour montrer qu’il y a une politique de colonisation continue qui ne commence pas en 1967, mais avant même 1948. « C’est une carte du continuum historique des destructions causées par le projet sioniste. » Au-delà des destructions matérielles, elle montre « la destruction symbolique de l’espoir et des relations correctes qui existaient entre les populations avant la Nakba. […] Le sionisme n’est pas uniquement venu “dépalestiniser” la Palestine, il est venu détruire la possibilité même d’une cohabitation entre Palestinien.ne.s en divisant au sein de la population palestinienne les Juif.ve.s et les Palestinien.ne.s. »
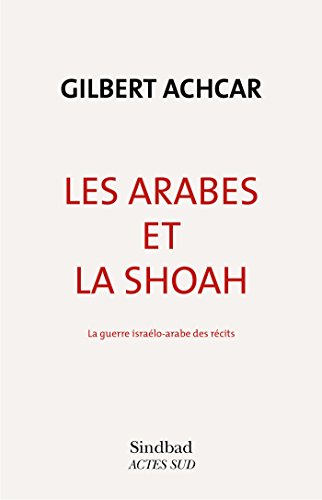
Un déni qui a une histoire
La revendication essentielle qui découle en toute logique de ce travail de mémoire porté au plus près du public israélien est la reconnaissance du droit au retour des Palestiniens. Ce qui apparaît comme une ligne rouge, y compris pour une partie de la « gauche » israélienne peut être dépassé, professe Bronstein, si on laisse de côté la revendication de principe pour se concentrer sur les conditions, la matérialité du retour, en impliquant les Israéliens. Car, « n’en déplaise à certaine.s., on ne pourra pas faire sans les Israélien.ne.s.(…), même si leur arrivée s’est faite sur une base d’injustice et de traumatisme infligé aux Palestinien.ne.s. » (à l’inverse, quasiment, de nombreux militants de la cause palestinienne dans le monde qui privilégient la reconnaissance du droit au retour comme un principe essentiel, symbolique, relevant du droit international, tout en admettant que sa concrétisation est secondaire).
Le déni du désastre palestinien de la Nakba a une histoire en Israël. Elle commence avec le refus du retour des réfugiés et la création de deux narrations séparées : celle d’un désastre selon le point de vue palestinien, et celle de la construction d’un État juif. Selon ce point de vue, la Nakba ne concerne pas l’histoire israélienne, et l’argument du « on n’avait pas le choix » triomphe dès le début des années 1950. Après 1967, l’occupation et les expulsions de 1948 sont effacées de la mémoire collective au profit de l’occupation et des expulsions liées à la guerre de l’été 1967. À la fin des années 1980, l’historien Benny Morris, chef de file des « nouveaux historiens », publie The Birth of the Palestinian Refugee Problem, un tournant dans la remise en question du récit israélien de l’expulsion des Palestiniens qui suscite d’innombrables débats universitaires, mais touche peu l’opinion publique… Surtout lorsque le nouveau récit historique concerne le rôle joué par la Haganah et le Palmach, les groupes paramilitaires sionistes officialisés après 1948 par leur intégration dans la jeune armée. Il se trouve que les archives du Palmach sont ouvertes depuis quelques années à la consultation, et qu’elles contiennent de nombreux témoignages de miliciens. Zochrot en a extrait de précieuses informations sur les exactions opérées par les grands-pères d’un certain nombre d’Israéliens, et révélé quelques « sales petits secrets » de famille malgré l’interdiction de leur publication. Des secrets pas faciles à admettre pour les Israéliens…
Une loi contre la vérité
En 1997, les festivités du « Jour de l’Indépendance » sont troublées par une première « Marche du retour », devenue depuis une tradition. Cette revendication consacre la séparation des deux histoires et les Palestiniens d’Israël l’expriment sans ambiguïté : « votre jour d’indépendance est une tragédie pour nous ». La marche se déroule chaque année dans l’une des localités palestiniennes détruites. Au fil du temps, de plus en plus de juifs s’y sont joints, tandis que des débats israélo-israéliens sur le droit au retour se multipliaient, échappant à tout contrôle officiel. Le régime finit par promulguer la « loi Nakba » pour empêcher que ce versant périlleux de l’histoire d’Israël soit reconnu et étudié. La meilleure preuve que Zochrot est parvenu à ses fins, commente Eitan Bronstein, c’est qu’« on ne fait pas une loi pour contrer quelque chose qui est considéré comme anodin. »
Malgré toutes les tentatives de censure, l’action militante semble en effet avoir payé : la connaissance de la tragédie palestinienne progresse. En 2001, quand on tapait le mot « Nakba » en hébreu sur les moteurs de recherche sur Internet, on ne trouvait pratiquement rien. Le sens même du mot « Nakba » était tout à fait incompris en hébreu. Au bouclage de l’édition française de ce livre, en septembre 2018, cette requête donnait en hébreu près de 85 000 occurrences.
Un sondage commandé par Zochrot en 2015 et exposé en détail révèle notamment qu’environ 1/5 des citoyens juifs d’Israël soutenaient à cette date le droit au retour — un quart parmi les jeunes. Un signe d’espoir pour Eitan Bronstein… et pour Eléonore Merza Bronstein, née d’une mère juive et d’un père tcherkesse et musulman originaire du Golan syrien, expulsé de sa terre natale en 1967. C’est elle qui conclut l’exposé de ce drôle de parcours et de cette drôle de rencontre entre un kibboutznik ancien soldat de l’occupation et colon à son corps défendant et une « féministe radicale judéo-musulmane » en souhaitant qu’ils puissent un jour rebâtir une maison dans le village paternel, sur le Golan. « Une maison d’indigène, pas de colon ». (Article publié sur Orient XXI,en date du 11 février 2019)

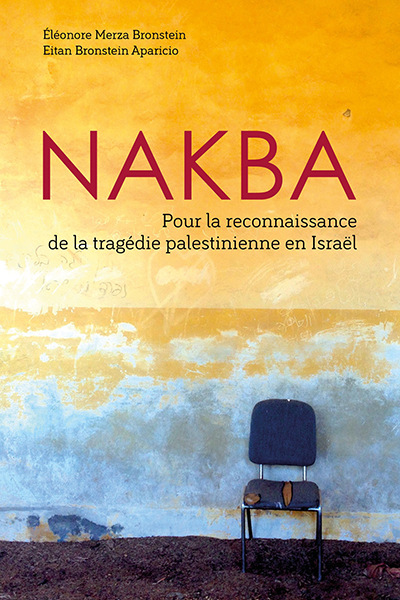

Soyez le premier à commenter