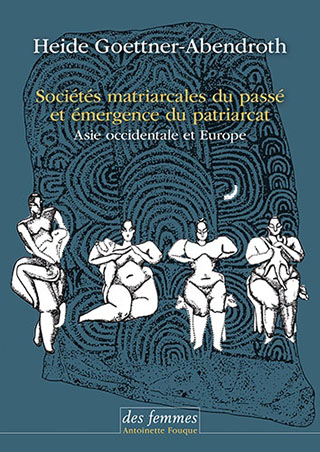 Par Christophe Darmangeat
Par Christophe Darmangeat
L’automne venu, ce ne sont pas seulement les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle : se multiplient également les livres défendant, d’une manière ou d’autre, l’idée que la domination masculine serait un produit tardif des sociétés humaines et qu’auparavant, l’harmonie régnait entre les sexes. La plus outrancière et la plus contestable de ces publications est sans nul doute celle de Heide Goettner-Abendroth, intitulée Sociétés matriarcales du passé et émergence du patriarcat ; elle n’en a pas moins suscité des comptes-rendus élogieux de la part de divers organes de presse, dont Le Monde et Le Nouvel observateur.
Avec quelques collègues, nous avons décidé de rédiger une recension détaillée de cet ouvrage qui, en dépit de ses dehors savants, collectionne les approximations, les erreurs et les biais, et qui tourne le dos aux plus élémentaires exigences d’un travail scientifique. Mais en attendant, il ne me paraît pas inutile de commenter une des recensions qui lui est consacrée, dans la mesure où celle-ci représente un florilège des erreurs à ne pas commettre quand on veut réfléchir sérieusement sur cette question. Je reproduis donc ci-dessous le texte du Nouvel Observateur, signé par Véronique Radier, le commentant au fur et à mesure.
«Les sociétés préhistoriques étaient-elles matriarcales ? Cette thèse étonnante d’une philosophe allemande crée la controverse
Pour la philosophe allemande Heide Goettner-Abendroth, le féminin fut le cœur des sociétés et des croyances pendant des dizaines de millénaires. Une interprétation controversée mais fascinante que nous avons soumise aux spécialistes Jean-Loïc Le Quellec et Pascal Picq.»
En fait, non : il n’y a pas plus de controverse qu’avec l’hydroxychloroquine. Il y a d’un côté le consensus scientifique, et de l’autre le travail d’une chercheuse marginale, complaisamment relayé par les médias. Quant au caractère « fascinant » des thèses de Goettner-Abendroth, concédons qu’il est bien réel. Mais il y a bien des manières possibles pour un livre de susciter la fascination, qui ne sont pas toutes à son avantage.
«Il y a deux manières de lire Sociétés matriarcales du passé et émergence du patriarcat, impressionnante somme que vient de signer Heide Goettner-Abendroth, féministe iconoclaste et philosophe franc-tireuse. La première, critique, soulignerait ses limites scientifiques et son militantisme. La seconde, y voyant un contrepoison, applaudirait le nécessaire désenvoûtement des clichés sexistes.»
À titre d’entrée en matière, on nous propose ici de considérer qu’un travail entaché de « limites scientifiques » – en l’occurrence, l’expression est une douce litote – pourrait néanmoins faire œuvre utile en déconstruisant des clichés. D’emblée, se pose donc une question : dans le même esprit, ne conviendrait-il pas de saluer dans les propos d’un Maître Gims qui affirmait que les pyramides égyptiennes produisaient de l’électricité, l’instrument d’un « nécessaire désenvoûtement des clichés racistes » ?
«Car des chercheuses ont beau tenter de nous ouvrir les yeux, comme Marylène Patou-Mathis dans L’homme préhistorique est aussi une femme (Allary Editions, 2020) ou, en cette rentrée, Claudine Cohen avec Aux Origines de la domination masculine (Passés composés), rien n’y fait.»
Curieusement (ou non), les chercheuses convoquées ici ne sont précisément pas celles qui produisent des études scientifiques, en particulier dans des revues à comité de lecture, sur l’archéologie ou l’anthropologie du genre. Précisément parce que leurs travaux font entendre une tout autre musique ?
«Que des femmes de la préhistoire aient pu tailler des outils, mener un groupe ou chasser nous paraît toujours aussi incongru.»
Sans doute, mais pour quels motifs ? Est-ce en raison de préjugés masculinistes, ou tout simplement parce que ce schéma correspond à l’immense majorité des observations ethnologiques, et que tous les éléments recueillis par l’archéologie suggèrent qu’il correspond aussi aux sociétés passées ?
«Peu importent les découvertes attestant désormais que tout cela existe bel et bien chez nos cousins primates, mais aussi dans certaines tribus encore existantes, comme l’a montré la préhistorienne Sophie de Beaune, le récit trop souvent héroïsé de nos origines ne s’écrit qu’au masculin.»
Sophie de Beaune, qui est préhistorienne, n’a fait aucune découverte sur des « tribus existantes », ce que nul ne saurait lui reprocher. Les exceptions partielles (et minoritaires) à la division standard du travail établies par l’ethnologie sont connues depuis bien longtemps, et aucun anthropologue sérieux ne les a jamais contestées. Mais les arbres ne sont pas les forêts.
«Pas la moindre silhouette féminine en action parmi la pléthore d’albums consacrés à la préhistoire ni dans les ouvrages de vulgarisation. C’est comme si les femmes n’avaient jamais rien accompli, rien inventé : elles ne comptent tout simplement pas.»
Je ne suis pas au fait de ces ouvrages de vulgarisation, mais je parierais volontiers que ce biais, sans doute jadis bien réel, l’est de moins en moins.
«Les rares crânes et fragments les plus anciens de Sapiens ne disent pourtant rien de nos modes de vie ni des rapports de genre voici 300 000 ans, lorsque nous voisinions avec Neandertal, Flores, Denisova, etc. Et la centaine de sépultures remontant au paléolithique supérieur, qui débute il y a 45 000 ans, ne permet toujours aucune conjecture solide.»
Que l’archéologie ne livre sur le sujet que des informations très fragmentaires, c’est tout à fait exact. Pour autant, il est au moins une série d’études qui ont produit des résultats incontestés : celles de Sébastien Villotte, qui suggèrent que la division sexuée des tâches remonte au moins au Gravettien. Pourquoi ne pas les mentionner ? Et dans un autre registre, pourquoi passer sous silence les résultats spectaculaires récemment obtenus par la phylomythologie, qui indiquent la très grande ancienneté des deux marqueurs de la domination masculine que sont les mythes d’un renversement d’une matriarchie primitive, et ceux associés aux secrets masculins du rhombe ?
«Il a fallu l’analyse de l’ADN ancien pour révéler que les tombes contenant des outils et des armes étaient parfois celles de femmes, alors aussi athlétiques que les hommes.»
Oui, les tombes féminines contiennent parfois – mais seulement parfois, et c’est bien là toute la question – des outils majoritairement masculins. Quant à l’affirmation selon laquelle les femmes étaient « aussi athlétiques que les hommes », elle ne repose sur rien. La différence de stature et de musculature entre hommes et femmes est variable d’une population humaine à l’autre, mais on n’en a jamais observé aucune, dans le présent ou dans le passé, chez qui elle n’existait pas.
«L’idée erronée d’une domination masculine universelle découlant des lois de la nature, insufflée notamment par Aristote puis Darwin, infuse tous les travaux depuis le XIXe siècle et demeure comme un paradigme n’ayant nul besoin d’être démontré.»
…ou comment réfuter une idée à bon compte en lui adjoignant un chiffon rouge. Qu’Aristote ait considéré la domination masculine comme un fait naturel et indépassable est une chose. Mais avant de devoir être expliquée (que ce soit par la « nature » ou par autre chose), la domination masculine est un fait, qui peut être établi ou réfuté. La bonne question est donc : dans les sociétés humaines en général, et chez les chasseurs-cueilleurs en particulier, la domination masculine est-elle un phénomène universel ? Majoritaire ? Occasionnel ? Rare ? Si Heide Goettner-Abendroth et ceux qui défendent des thèses semblables évitent toujours de se référer aux données ethnographiques, c’est précisément parce qu’elles contredisent frontalement leurs conceptions établies a priori.
«Et ce alors que chez les primates, ces singes sans queue dont nous faisons partie, une étude du CNRS vient de montrer qu’elle n’est la règle que parmi 20 % des cent vingt espèces étudiées.»
Outre le fait que les primates sont loin de se limiter aux seuls singes sans queue, ce chiffre appellerait quelques nuances – il est intimement lié à la définition choisie de la « domination masculine ». Mais surtout, il ne prouve strictement rien concernant les humains, qui peuvent fort bien se trouver parmi les 20 % en question (ou non).
«“Nos esprits sont colonisés par le patriarcat”, déplore Heide Goettner-Abendroth. Depuis plus de trente ans, elle se consacre à l’étude de rares peuples où subsistent encore aujourd’hui des éléments de matriarcat. Dans le monde académique, « matriarcat » est un gros mot : une société dirigée par des cheffes, vous n’y pensez pas ! Seulement, la philosophe allemande ne défend pas l’existence d’une sorte de patriarcat inversé au féminin, mais celle de sociétés égalitaires.»
Apparemment donc, Heide Goettner-Abendroth ne « pense » pas non plus à des « sociétés dirigées par des cheffes ». Pour une raison simple : si quelques figures féminines ont pu ici ou là assumer des rôles dirigeants, personne, pas même Heide Goettner-Abendroth, n’a jamais pu identifier une seule société humaine dans laquelle les femmes auraient commandé aux hommes. Dès lors, ce qui est ici présenté comme un simple préjugé s’avère bel et bien un invariant sociologique objectif.
«(…) mettant en commun leurs ressources, organisées autour des femmes et du lien maternel, assurant : « Elles ne sont pas un mythe, j’ai moi-même séjourné dans nombre d’entre elles ! Pour les étudier, j’ai dû fonder mon propre centre de recherche. »
Centre de recherche dont le sérieux scientifique se manifeste entre autres par le fait qu’il propose des formations afin de devenir « Prêtresse des Festivals des Mystères du Matriarcat?».
«À ses yeux, ces tribus en voie de disparition constituent une survivance du moule premier de nos valeurs et croyances. Et les vestiges du paléolithique, où symboles et représentations féminines dominent, troublante énigme qui depuis deux siècles stimule l’imagination des spécialistes, en seraient un témoignage explicite : “Les femmes étaient centrales. Dans les grottes, on les trouve partout, gravées, sculptées mais aussi évoquées à travers une avalanche de triangles pubiens, de vulves.” Quant aux vénus, statuettes ainsi baptisées en référence aux statues dénudées de l’Antiquité et dont les plus anciennes remonteraient à 300 000 ans, “leur corps emphatisé et sacré était au centre d’une religion de la renaissance, bien documentée par l’anthropologie : les bébés sont vus comme la réincarnation d’un ancêtre. Ils se forment à partir du sang des règles qui cesse de s’écouler pendant la grossesse”. Leurs formes sont opulentes parce qu’elles sont enceintes et si, dans les grottes, certaines anfractuosités sont rehaussées d’ocre rouge, c’est pour mieux signifier la métaphore de l’utérus. “Dans les sépultures, les corps sont eux aussi recouverts d’ocre, qui évoque le sang, la vie, et inhumés en position fœtale, comme dans le ventre maternel, pour que ceux-ci puissent ensuite y renaître.” Goettner-Abendroth reprend là, mais en l’affinant et en lui donnant une cohérence, une hypothèse du XIXe siècle : le culte primitif de la déesse mère, qui était alors envisagé sans corrélation avec l’importance sociale des femmes.»
Ce passage reprend une interprétation des œuvres préhistoriques dont chaque élément a été maintes fois mis en doute. Rien ne dit que les statuettes opulentes représentent des femmes enceintes – accouchement et allaitement sont même spectaculairement absents de cet art. Quant au fait qu’elles représenteraient une déesse-mère et quant à la réalité du culte voué à une telle divinité, il s’agit d’affirmations qui ne reposent sur aucun élément tangible. Autrement dit, à partir de l’art paléolithique, Goettner raconte (ou plus exactement, répète) l’histoire qu’elle a envie de raconter, sans le moindre égard pour de nombreuses autres hypothèses qui ne seraient pas moins fondées.
«On sait désormais que les femmes vivant côte à côte ont leurs règles au même moment.»
On sait au contraire qu’il s’agit d’un mythe savant : les études sérieuses réalisées pour tenter de répliquer l’observation princeps ayant donné lieu à ce mythe, publiée par Martha McClintock en 1971, ont conclu à l’absence de synchronisation et à un biais dans l’analyse par McClintock de ses données (voir la page wikipedia correspondante en anglais, particulièrement bien renseignée).
«Cette simultanéité et le parallélisme du cycle menstruel avec celui de la Lune aurait marqué les esprits, donnant naissance à un premier cadre temporel, le calendrier lunaire. “Cet ordre social fondé sur le lien mère-enfant-ancêtre, où, maîtresses du temps, les femmes conduisent de la vie à la mort, puis de la mort à la vie, comme la Lune qui croît puis meurt et renaît, a duré un temps considérable, environ 300 000 ans”, assure-t-elle.»
Il faudra évidemment être un esprit chagrin pour demander un début de preuve de cette affirmation aussi générale que péremptoire.
« À nos yeux, le cœur de toute société, c’est papa, maman et leurs enfants, mais, comme les chasseurs-cueilleurs actuels, nos ancêtres vivaient en petites tribus égalitaires, organisées par tranche d’âge et non par parenté, et les personnes en changeaient souvent. »
Voici encore une affirmation proprement stupéfiante. L’idée que les groupes de chasseurs-cueilleurs actuels (ou subactuels) ne seraient pas organisés en fonction de la parenté témoigne d’un mépris souverain (ou d’une ignorance totale), entre autres, de toute l’anthropologie australienne.
«Elle voit un écho de ce passé lointain dans l’habitude, en Afrique, de dire : « mon frère », « ma sœur » en s’adressant à quelqu’un de son âge ou « mon père », « ma mère » pour parler à un aîné. A l’image de ce qui existe chez la plupart des espèces, les femmes, libres de leurs mouvements, auraient donc pu choisir le géniteur de leurs enfants.»
Je ne sais pas si dans la plupart des espèces, les femmes sont libres de leurs mouvements et du choix du géniteur de leurs enfants. Mais chez les humains, en tout cas si l’on fait un peu de cas des informations que procurent les données ethnologiques, la seconde partie de cette affirmation est une fois encore sidérante.
«Et la philosophe d’ajouter : “La pensée d’une lignée héréditaire n’est pas naturelle, elle n’a émergé que lorsque les humains ont commencé à se sédentariser et que les femmes ont commencé à vivre auprès de leurs enfants, petits-enfants, etc. C’est une invention du néolithique.” »
Là encore, on ne peut qu’être confondu par le mépris ou l’ignorance des données ethnologiques concernant les chasseurs-cueilleurs, qui réfutent catégoriquement cette affirmation.
«La domination masculine et les inégalités n’ont pas émergé de l’agriculture, ni même de la naissance des premières villes, c’est désormais l’objet d’un relatif consensus parmi les archéologues.»
Ne croyez pas que par cette phrase la rédactrice admette que la domination masculine remonte à une époque antérieure au Néolithique : c’est tout le contraire – le Néolithique est censé ne pas avoir entamé l’égalitarisme primordial des sexes. Tant pis pour les innombrables observations ethnologiques (dont le célébrissime cas des Baruya de Nouvelle-Guinée, étudié par Maurice Godelier) et pour les travaux d’archéologie, tels ceux d’Anne Augereau sur les cultivateurs du Rubané.
«Reste à savoir où et comment. Heide Goettner-Abendroth postule que des changements climatiques ont poussé certains groupes d’Asie centrale vers l’élevage et la conquête de territoires, puis vers l’asservissement d’autres populations. Elle y voit la racine du patriarcat.»
…avec des arguments aussi faibles (puisque ce sont les mêmes) que Marija Gimbutas, qui a formulé cette thèse il y a de cela des décennies.
«Au cœur des débats, les vestiges d’une grande ville remontant au IXe millénaire avant notre ère, dans le centre de la Turquie : Çatal Höyük.»
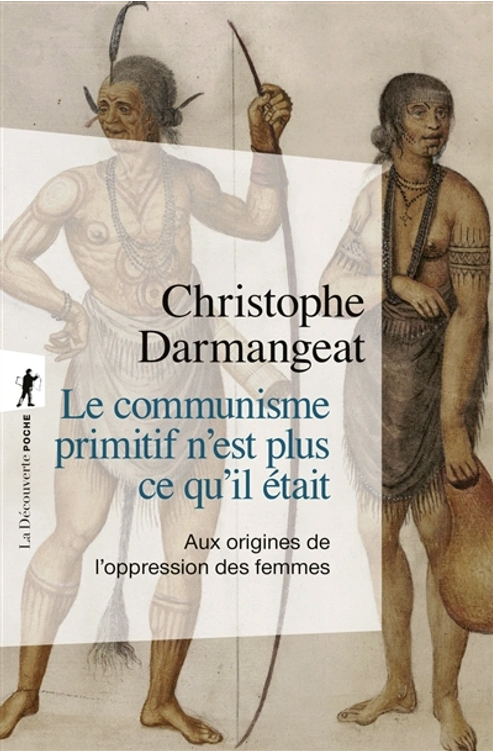
Si les mots ont un sens, Çatal Höyük n’a jamais été une ville mais un village, dans la mesure où les habitants y produisaient leur nourriture. Quant à sa population maximale, traditionnellement estimée à quelques milliers d’habitants, elle pourrait selon des travaux récents s’être limitée à moins de mille. Au temps pour la « grande ville ».
«Pour les uns, ses symboles et statuettes, dont une magnifique « Dame aux fauves », reflètent un pouvoir féminin, pour d’autres, pas du tout. Cet été, l’analyse ADN de squelettes a montré que les occupants des maisons étaient apparentés par la mère. C’est ce que l’on appelle la « matrilocalité », censée refléter un statut féminin élevé.»
Un statut élevé en termes relatifs, c’est incontestable. Pour autant, il s’en faut de beaucoup que la matrilocalité soit toujours synonyme d’une réelle absence de domination masculine. Et surtout, parmi les populations du Néolithique européen, la matrilocalité est l’exception et non la règle. Pourquoi se focaliser sur elle, si ce n’est pour donner une image biaisée du tableau d’ensemble ?
«Même si nos plus proches cousins, chimpanzés et bonobos, sont patrilocaux, c’est-à-dire que les jeunes femelles quittent le groupe maternel pour se reproduire, tel n’était donc pas nécessairement le cas chez les humains. “Au cours des derniers mois, trois études menées en Chine ancienne, en Angleterre à l’âge du bronze et en Micronésie montrent que des femmes apparentées étaient enterrées ensemble, voici 15 000 ans”, souligne à ce sujet l’anthropologue américaine Sarah Blaffer Hrdy.»
Même remarque.
«Des femmes autrefois puissantes, au centre de l’ordre social ? Tous sont loin d’être convaincus. Claudine Cohen souligne que vénus et autres objets du paléolithique peuvent se regarder sous divers angles, enchevêtrant des symboles phalliques et féminins, témoignant non d’une dualité entre les genres mais d’une “intrication, voire de l’unité irréductible des motifs masculins et féminins”. L’anthropologue Charles Stépanoff reproche, lui, à la chercheuse allemande de reprendre “un modèle évolutionniste, uniforme, où des stades homogènes de développement de l’humanité se succèdent, comme on le faisait au XIXe siècle”. Et il rappelle que les sociétés humaines sont une infinie mosaïque : “Même dans celles dites patriarcales, les chamanes sont souvent des femmes aux pouvoirs extraordinaires, possédant le contenu de la yourte. Il faut sortir de ces étiquettes souvent bien trop tranchées.” Jean-Loïc Le Quellec et Pascal Picq formulent eux aussi d’importantes réserves (voir encadrés).»
Soit qu’elles aient été formulées ainsi, soit qu’elles aient subi le filtre du discours indirect, ces réserves légitimes restent néanmoins bien en deçà de l’appréciation que mériteraient réellement les thèses de Goettner-Abendroth.
«Mais en offrant un autre récit de nos origines, cet ouvrage ouvre les imaginaires.»
Certes. Tout comme celui de Maître Gims sur les pyramides électriques. Mais la cause des femmes serait-elle si mal assurée qu’elle aurait besoin de bobards et de sous-science pour se légitimer ?
«Et il nous incite à réfléchir aux conséquences de certaines découvertes. La célèbre anthropologue Françoise Héritier, qui avait conclu à l’inexistence de sociétés réellement matriarcales, ne manquait jamais d’ajouter que la domination masculine n’était qu’une construction intellectuelle, à renverser : “Ce que la pensée a fait, la pensée peut le détruire et le remplacer. Rien de ce qui concerne le rapport des sexes n’est naturel ou ne dérive de causes naturelles.” »
Et c’est là qu’on en arrive au fond de toute cette affaire : pour espérer mettre un jour prochain un terme à la domination masculine, il faudrait impérativement concevoir celle-ci comme un pur produit du cerveau humain, librement décidée et qui sera donc tout aussi librement abolie. Passons sur le fait que Françoise Héritier – qui elle, contrairement à Goettner-Abendroth, était une anthropologue compétente – n’éprouvait nul besoin d’identifier de pseudo-matriarcats pour espérer en un avenir meilleur concernant les rapports entre les sexes. L’idéalisme de ce raisonnement d’une naïveté chimiquement pure laisse tout de même dubitatif : la domination masculine, si elle ne dépend au bout du compte que d’une simple idée, ou de simples valeurs culturelles, n’aurait-elle pas pu ne jamais exister ? Qu’est-ce qui a empêché jusque-là l’humanité de réaliser son erreur et de la remettre en cause ? Aussi, et surtout, si l’on imagine que les hommes ont jadis imaginé l’infériorisation des femmes, pourquoi celles-ci se sont-elles laissé faire, voire ont-elles le plus souvent intériorisé ces conceptions ? Autant de questions qui restent sans réponse dans un cadre de pensée qui refuse d’envisager que les idées, loin de tomber pas du ciel, sont en réalité contraintes par les réalités sociales, techniques, économiques… et naturelles. Une prise en compte qui au demeurant, j’espère l’avoir montré dans mes travaux, ne mène pas à conclure à l’éternité de la domination masculine mais, au contraire, à son inéluctable disparition future.
(Publié sur La Hutte des Classes,le blog de Christophe Darmangeat, le 20 octobre 2025; Christophe Darmangeat a publié Casus Belli: la guerre avant l’Etat, Ed. La Découverte, août 2025; et Le communisme primitif n’est plus ce qu’il était: aux origines de l’oppression des femmes, Ed. La Découverte, Poche, octobre 2025)
__
Commentaire de Jean-Paul Demoule (Professeur émérite de protohistoire européenne à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, il est membre honoraire de l’Institut universitaire de France. Auteur entre autres de La Préhistoire en 100 questions (Ed. Tallandier, 2021):
«Je me permets de donner le lien ici avec mon commentaire critique, de mars 2021, sur le matriarcat préhistorique supposé, à la suite du précédent livre de Heide Göttner-Abendroth, et où je reprenais également l’indispensable critique de Christophe Darmangeat à propos de certaines tombes amérindiennes: https://aoc.media/analyse/2021/03/04/le-retour-du-matriarcat-prehistorique/?loggedin=true
Véronique Radier avait d’ailleurs publié à l’époque, toujours dans l’Obs, un compte-rendu déjà élogieux de ce premier livre, accompagné d’un encadré où je faisais part poliment, sous le titre “Des hypothèses discutables”, de tout ce qui était intenable.»


Soyez le premier à commenter