
Par Henry A. Giroux
«Historiquement, les choses les plus terribles, telles que la guerre, le génocide et l’esclavage, ne sont pas le résultat de la désobéissance, mais de l’obéissance.» – Howard Zinn
Le président américain Donald Trump a saturé la vie publique de mensonges, a transformé les immigrant·e·s et les citoyens et citoyennes noirs en objets de mépris, et fait de la corruption et de la violence la nouvelle grammaire de la gouvernance. Il promet allégeance aux dictateurs, s’entoure de flagorneurs et de malfrts, et utilise le pouvoir de l’État comme une arme: il kidnappe des étudiants étrangers, persécute les immigrants et déclare la guerre à la dissidence politique. Même dans les moments tragiques, il se livre à des actes de brutalité, accusant de manière grotesque la gauche de la mort de Charlie Kirk avant même que le suspect présumé, Tyler Robinson, n’ait été arrêté. Ce qui aurait dû être un moment de deuil collectif s’est transformé en un théâtre de vengeance, en une mise en scène pour attiser la haine et consolider le pouvoir.
Ce n’est pas le langage de la démocratie, mais le lexique d’un régime autoritaire. Chacun de ces actes montre à quel point le pays a sombré: l’appareil d’État s’est désormais retourné contre les plus vulnérables, la contestation est désormais considérée comme une trahison et la violence est sanctifiée comme principe de gouvernement. Les États-Unis ne se dirigent plus lentement vers le fascisme, ils ont sombré dans son abîme, où la vérité est sacrifiée au spectacle, où la raison s’effondre dans le mythe et où le pouvoir se nourrit de la peur.
Trump accuse la gauche
Comme l’a observé Jeffrey St. Clair [animateur de Counterpunch], «les dirigeants de la droite n’ont pas perdu de temps pour conseiller à leurs partisans de se borner à des “pensées et prières” après le meurtre de Charlie Kirk. Avant même que l’assassin ait été identifié ou que le mobile ait été découvert, ils ont accusé la “rhétorique violente” de la gauche d’être responsable de la mort de Kirk.» Ce n’est pas un deuil, c’est la plus vieille astuce du manuel autoritaire: accuser d’abord, ne jamais enquêter, instrumentaliser la tragédie pour consolider le pouvoir. Cette stratégie consistant à utiliser le deuil comme arme a trouvé son expression la plus claire lors des funérailles de Kirk. Lors des funérailles de Charlie Kirk, le président Trump a transformé ce qui aurait dû être une cérémonie solennelle en un rassemblement politique imprégné d’une rhétorique venimeuse.
Dans un discours empreint de ressentiment et de vengeance, Trump a déclaré avec force que la violence qui a coûté la vie à Kirk «provient en grande partie de la gauche», sans fournir aucune preuve et en ignorant commodément la montée accélérée de la violence d’extrême droite. Ses paroles n’étaient pas futiles. Il a présenté les progressistes comme des ennemis de la nation et a signalé sa volonté d’utiliser le pouvoir de l’État contre eux, qualifiant la résistance antifasciste de terroriste. Quelques jours plus tard, il a déclaré que l’«Antifa» était une organisation «terroriste nationale», une déformation cynique, puisque l’Antifa n’est pas une entité structurée, mais un mouvement décentralisé et sans leader de résistance antifasciste. Peu après, Trump a signé un mémorandum présidentiel sur le «terrorisme intérieur» intitulé «Mémorandum présidentiel sur la sécurité nationale» [25 septembre], destiné à déclencher la machine gouvernementale contre la contestation de gauche, allant même jusqu’à nommer le Parti démocrate, George Soros et Reid Hoffman [homme d’affaires critique de Trump qui a soutenue la candidate républicaine Nikki Haley lors des primaires et s’est prononcé pour Joe Biden] comme supposés financeurs de la violence radicale. C.J. Polychroniou fait valoir à juste titre (sur le site Common Dreams le 29 septembre) que «ce mémorandum, qui est bien plus dangereux que le décret sur Antifa, est un véritable plan fasciste qui ordonne au gouvernement fédéral de s’en prendre aux mouvements «antifascistes» et «anticapitalistes» aux États-Unis. Il vise essentiellement toute personne qui s’oppose à Trump et à son idéologie MAGA. Comme Rebecca Falcone l’a averti dans Axios (26 septembre), ce qui se déploie actuellement n’est rien de moins que l’institutionnalisation d’une répression à visée politique, une campagne calculée visant à délégitimer l’opposition et à museler quiconque ose demander des comptes à Trump. Pourtant, R. Falcone s’arrête là. Ce qui nous attend est bien plus inquiétant: la résurrection de spectres fascistes, reconditionnés pour notre époque, qui menacent d’assombrir l’avenir avec la puanteur familière de l’autoritarisme renaissant.
Si les paroles de Trump ont exprimé et légitimé la loi de la répression, la rhétorique de Stephen Miller [chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche] lui a donné le ton d’une menace implacable. Lors de l’éloge funèbre de Kirk, Miller a prononcé ce que Jonathan Chait, dans The Atlantic (22 septembre), a qualifié de «rhétorique stupéfiante», enveloppant son discours dans la grandeur de la civilisation occidentale tout en invoquant une lutte cosmique entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. Pourtant, sous ce langage de pureté morale se cachait le dogme du nationalisme blanc: ceux qui étaient considérés comme mauvais et jetables étaient les immigrants, les personnes de couleur et les contestataires; ceux qui étaient considérés comme dignes étaient les nationalistes chrétiens blancs. En exaltant la vengeance plutôt que le pardon – ignorant même l’appel à la compassion de la veuve de Kirk – Miller et Trump ont sanctifié la croisade comme une vertu civique. Plus inquiétant encore, ils ont fusionné le deuil et la menace, présentant le discours dissident comme de la violence et le pouvoir répressif comme de la justice, déclarant ouvertement que l’État lui-même deviendrait l’arme pour écraser l’opposition.
Dans ce discours empoisonné, les véritables «ennemis intérieurs» ne sont pas les racistes, les insurgés, les entreprises corrompues et les extrémistes de droite qui ont pris d’assaut le Capitole [en janvier 2021], mais plutôt les détracteurs du pouvoir autoritaire ainsi que les groupes désignés comme «autres». Contre eux, Trump et ses alliés mènent une guerre contre le premier amendement, transformant la liberté d’expression, pierre angulaire de la démocratie, en cible. Dans leur discours, la liberté d’expression n’est plus considérée comme un rempart de la démocratie, mais comme son ennemi. Les conséquences de telles distorsions vont au-delà de la rhétorique. Cet avertissement est encore plus urgent aujourd’hui, car la méconnaissance volontaire de Trump libère des passions prédatrices qui nourrissent une culture de violence autoritaire.
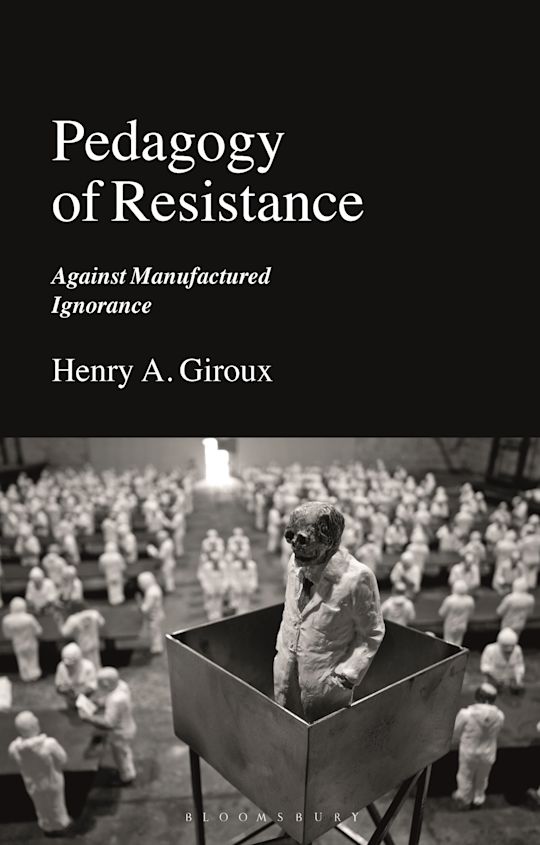 Voix dissidentes
Voix dissidentes
Des comédiens et journalistes aux étudiants, enseignants et groupes indépendants, toutes les voix dissidentes sont qualifiées de conspiratrices pour des crimes imaginaires – leur véritable crime n’étant rien d’autre que de s’être élevées contre la cruauté alors que le silence était exigé. Ou d’avoir commis le crime de ne pas être suffisamment loyales envers Donald Trump. Comme l’a un jour averti Hannah Arendt, sous le totalitarisme, la pensée elle-même devient dangereuse. L’autoritarisme sous ses nombreuses formes résulte en partie de l’incapacité à penser, un avertissement prémonitoire à l’ère de l’ignorance fabriquée [voir de Henry A. Giroux, Pedagogy of Resistance. Against Manufactured Ignorance, Bloomsbury Publishing, 2022]. La normalisation de l’ignorance, de l’irréflexion et de l’aveuglement moral à l’ère Trump est fondamentale pour créer des sujets fascistes incapables de distinguer la vérité du mensonge ou la justice du crime.
Cet avertissement est encore plus urgent aujourd’hui, car il y a une ignorance effrayante chez Trump qui libère des passions de prédateurs, allant de son accueil des criminels de guerre et de son amnésie historique aux frappes meurtrières qu’il a ordonnées contre trois navires soupçonnés de trafic de drogue [accusation sans preuve, à cet égard, portée contre le régime de Maduro]. Pour Trump, la légalité de tels actes n’a aucune importance. La violence associée à la criminalisation de la dissidence est au cœur de la logique d’anéantissement qui est au centre de la politique fasciste.
C’est la manœuvre caractéristique du fascisme. Adolf Hitler l’a fait en 1933 après l’incendie du Reichstag, accusant les communistes et invoquant des pouvoirs spéciaux pour suspendre les libertés civiles. En 1938, Joseph Goebbels a utilisé l’assassinat à Paris d’un fonctionnaire nazi par Herschel Grynszpan, un Juif de 17 ans, pour lancer la Nuit de cristal, qui «a marqué un tournant dans la politique allemande, déclenchant l’extermination systématique par les nazis des Juifs, des Roms, des communistes, des chrétiens, des homosexuels et des malades mentaux». Benito Mussolini a suivi un scénario similaire en 1925 après l’assassinat de Giacomo Matteotti, transformant un moment de crise en justification pour interdire l’opposition et museler la presse. Plus récemment, Orbán a perfectionné cette tactique en Hongrie, désignant comme boucs émissaires les «gauchistes financés par Soros» afin de démanteler les universités, criminaliser les manifestations et éviscérer la presse.
Trump ne fait pas exception. Il exploite la mort de Kirk non pas pour pleurer sa perte, mais pour consolider son pouvoir. Son message est sans ambiguïté: la dissension est une forme de violence, la critique est du terrorisme, la déloyauté est un crime et la liberté d’expression elle-même est une menace pour le panoptique idéologique de Trump. Le renforcement vicieux de cette ligne de pensée toxique est évidente dans la rhétorique de Laura Loomer [théoricienne du complot], conseillère de Trump, qui, après l’assassinat de Kirk, a exigé que l’État «ferme, supprime le financement et poursuive en justice toutes les organisations de gauche». La rhétorique a atteint des sommets hystériques avec Christopher Rufo, un critique d’extrême droite de l’enseignement supérieur, qui a déclaré (The Guardian, 11 septembre): «La dernière fois que la gauche radicale a orchestré une vague de violence et de terreur, J. Edgar Hoover [directeur du FBI de 1935 à 1972] a tout stopper en quelques années. Il est temps, dans les limites de la loi, d’infiltrer, de perturber, d’arrêter et d’incarcérer tous ceux qui sont responsables de ce chaos.» Cette rhétorique est effrayante non seulement par sa brutalié, mais aussi par son acceptation ouverte de la répression et de la menace de violence comme politique d’État.
Le message glaçant de Trump
Les conséquences de l’attaque de Trump contre la dissension brillent comme un immense néon à Times Square, impossible à ignorer. Sous son règne sans loi, même la satire est qualifiée d’«anti-américaine» et considérée comme un «crime de haine», comme si le rire lui-même était devenu une trahison. Les institutions universitaires qui perpétuent la mémoire de l’histoire et des luttes pour la liberté sont harcelées par des menaces mafieuses, des chantages déguisées en patriotisme, des intimidations masquées en loyauté. Des citoyens canadiens sont menacés de révocation de leur visa simplement pour avoir formulé ce que Marco Rubio, Stephen Miller, Pam Bondi [procureure générale des Etats-Unis] et d’autres ont qualifié de commentaires critiques sur la mort de Kirk. Cela envoie un message glaçant: l’emprise autoritaire de Trump dépasse désormais les frontières, étendant son pouvoir de musellement au-delà du territoire américain.
Dans cette logique tordue, même une critique mesurée de Kirk est présentée comme une «célébration de sa mort», une distorsion grotesque et déconnectée de la réalité. Son décès doit certes être pleuré, mais le deuil ne doit pas être confondu avec le silence sur son idéologie d’extrême droite. Condamner ces croyances n’est pas de la cruauté, c’est de la lucidité morale. Il en ressort un schéma à la fois indéniable et effrayant: l’intimidation au sommet renforcée par la complicité institutionnelle. Les universités et les lieux de travail masquent cette capitulation sous le couvert de la neutralité, mais il s’agit en réalité d’un effondrement de la responsabilité éthique – un sombre écho des accommodements qui ont permis le fascisme à une autre époque. Le prix à payer pour s’exprimer est devenu brutalement clair. Comme le rapporte le New York Times (26 septembre), plus de 145 personnes ont subi des représailles sur leur lieu de travail – y compris des licenciements – pour avoir critiqué l’idéologie de Kirk, même lorsqu’elles ont simultanément condamné l’assassinat comme une chose horrible.
Ces actes de musellement ne sont jamais isolés. Ils sont des instruments de pouvoir qui légitiment des formes plus larges de violence étatique. La censure, la propagande et la glorification de la cruauté convergent pour normaliser la répression comme nécessaire et inévitable. Les entreprises et les universités s’inclinent par peur et par cupidité, sacrifiant toute responsabilité publique pour nourrir une soif insatiable de pouvoir et de profit. Nulle part cette capitulation n’est plus honteuse que dans l’enseignement supérieur, où les universités écrasent la contestation et trahissent leurs propres étudiants en livrant les noms à l’administration Trump de ceux qui protestent contre le génocide [à Gaza], répétant tragiquement la lâcheté des campus de l’époque fasciste. Pire encore, Ken Klippenstein rapporte (19 septembre) que «l’administration Trump s’apprête à désigner les personnes transgenres comme des «extrémistes violents» à la suite du meurtre de Charlie Kirk et envisage de dresser une liste de surveillance des personnes transgenres.
C’est un écho effrayant des complicités de l’époque fasciste, un effondrement moral déguisé en neutralité institutionnelle. Cet écho est lancinant et a donné naissance à un nouveau maccarthysme [1947-1954] des informateurs sur les campus, une reprise des complicités honteuses des universités de l’époque fasciste. Comme l’a fait valoir le journaliste David French dans l’émission All In with Chris Hayes sur MSNBC, les attaques actuelles contre la liberté d’expression et les dissidents critiques à l’égard de Trump sont pires que le maccarthysme, car elles sont «plus importantes et plus larges dans leur portée. Elles sont plus agressives. Elles s’étendent à tous les aspects de la société américaine.» Il ne s’agit pas seulement d’un échec institutionnel, mais aussi d’un effondrement moral, d’un rejet de la connaissance, de la conscience et des engagements démocratiques mêmes qui devraient définir la raison d’être de l’université. Nous assistons à la renaissance du maccarthysme avec une vengeance: surveillance, informateurs, listes noires. L’enseignement supérieur dérange depuis longtemps la droite, en particulier depuis les luttes démocratiques des années 1960. Aujourd’hui, cette crainte s’est transformée en quelque chose de plus sombre: il ne s’agit plus seulement d’efforts visant à affaiblir son rôle critique, mais de l’imposition d’une tyrannie pédagogique qui transforme les universités en laboratoires d’endoctrinement.
Et cela empire. Trump, Rubio, Miller, Bondi et leur cohorte d’ennemis de la démocratie menacent désormais de retirer leur passeport aux Américains dissidents, de révoquer leur citoyenneté et de criminaliser la liberté d’expression. Ils hurlent d’indignation lorsqu’on les compare à des fascistes, alors même que leurs actions reflètent le même sinistre scénario: militarisation de la société, répression de la dissidence, concentration du pouvoir entre les mains d’un dirigeant de secte et réanimation de l’héritage de la suprématie blanche et du nettoyage ethnique.
Trump salue Netanyahou, un criminel de guerre, comme un héros de guerre. Avec une inversino grotesque, il dénonce la gauche comme étant les véritables auteurs de la violence. Sur le plan intérieur, sa vengeance est tout aussi corrosive: il se vante d’avoir fait pression sur la chaîne ABC pour que Jimmy Kimmel soit licencié – celui-ci est désormais de retour à l’antenne. Cet acte de vengeance mesquin équivaut à une atteinte au premier amendement et rappelle de manière effrayante à quel point la liberté d’expression devient fragile sous le joug autoritaire. Pourtant, personne ne s’alarme lorsque le présentateur de Fox News, Brian Kilmeade, suggère avec désinvolture d’exterminer les sans-abri par des «injections létales involontaires» (Snopes, 16 septembre). L’administration Trump et la plupart des grands médias ne s’indignent pas non plus de la complicité des États-Unis dans la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza, où, comme le rapporte le Quds News Network (6 septembre) «au moins 19 424 enfants ont été tués lors des attaques israéliennes au cours des 700 jours de génocide à Gaza, soit l’équivalent d’un enfant toutes les 52 minutes. Parmi les victimes, on compte 1000 nourrissons de moins d’un an». Le silence n’est pas ici synonyme de neutralité, mais de complicité avec la barbarie.
Lorsque le comportement des comédiens est criminalisé, il ne s’agit pas simplement d’une question de goût, de décorum ou même d’indignation morale déplacée, mais d’une atteinte directe au principe de la liberté d’expression. La comédie a toujours servi d’espace où l’hypocrisie est démasquée, les abus de pouvoir ridiculisés et les absurdités de la politique autoritaire mises à nu. En fait, lorsque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, l’une des premières cibles de sa répression culturelle a été l’émission de télévision satirique « Kukly » (en russe, « marionnettes »), un spectacle de marionnettes produit par la chaîne indépendante NTV. Apparemment, être qualifié de «petite marionnette du tsar» était trop pour lui. Cet acte de censure impitoyable a été largement considéré comme un tournant dans la consolidation du pouvoir de Poutine. Le véritable problème est que le fait de contrôler ou de punir les humoristes témoigne de la volonté de l’État de contrôler même les espaces du rire et de la satire.
Le canari dans la mine de charbon
Cette criminalisation est plus qu’une simple censure; c’est un canari dans la mine de charbon qui permet de mesurer la progression du fascisme. Lorsque les blagues sont reclassées comme des crimes, l’avertissement ne pourrait être plus clair: ce qui commence avec les humoristes ne s’arrêtera pas avec eux. Cela marque le test des limites, la normalisation de la répression et le musellement de l’une des formes de dissidence les plus anciennes et les plus efficaces. Cette mesure révèle la fragilité des régimes qui ne tolèrent aucune critique, aussi enjouée ou irrévérencieuse soit-elle, et elle témoigne d’un projet plus large visant à restreindre l’espace public jusqu’à ce qu’il ne reste plus que les voix officielles.
En ce sens, l’attaque contre la comédie ne doit pas être considérée comme une question insignifiante ou secondaire. Il s’agit d’une escalade symbolique et pratique de la politique autoritaire, qui révèle le mépris des mouvements fascistes pour l’humour, l’ironie et les discours dissidents. Si le rire est considéré comme un crime, alors la résistance elle-même est déjà mise en accusation. La répression de la dissidence a une longue histoire aux États-Unis, depuis la «peur rouge» des années 1920 jusqu’à la répression intérieure qui a suivi la guerre contre le terrorisme menée par George W. Bush. Les attaques actuelles contre la dissidence sont plus répandues, plus dommageables et plus incontrôlées que la plupart de celles que nous avons connues dans le passé. Pour reprendre une expression de Terry Eagleton, [voir son ouvrage On Evil, Yale University Press, 2025] Trump et ses sbires du MAGA sont ivres «de fantasmes de toute-puissance» et se délectent d’actes de violence, de destruction et de l’exercice d’un pouvoir étatique illimité.
Les parallèles avec l’histoire fasciste ne pourraient être plus inquiétants. Après la Nuit de cristal, les nazis ont suspendu les libertés civiles et emprisonné les communistes; aujourd’hui, Trump déclare que la dissidence mérite d’être censurée et, si l’on en croit Pam Bondi, sera qualifiée de discours de haine et fera l’objet de la répression de l’État. Benito Mussolini a utilisé l’assassinat de Giacomo Matteotti pour consolider davantage son propre pouvoir ; aujourd’hui, Trump utilise la mort de Kirk pour faire taire les étudiants, les enseignants et les journalistes. Orbán a démantelé la presse libre et les universités hongroises en invoquant des ennemis; aujourd’hui, Trump et Miller invoquent «la gauche radicale» comme une menace existentielle.
La violence dans les rues militarisées [présence qui tend à s’étendre de la Garde nationale] des États-Unis se confond désormais avec ce que John Ganz appelle «un tollé hypocrite […] autour des morts martyrisés, une hystérie attisée autour du terrorisme et des désordres publics [et] le pouvoir de l’État exercé contre les personnalités publiques qui s’opposent et critiquent le régime» (Unpopular Front, 18 septembre). La peur est devenue l’arme préférée du régime, utilisée parallèlement à une politique d’effacement, d’amnésie historique et de déni impitoyable.
Jeffrey St. Clair a noté avec une précision sinistre que le meurtre de Kirk est «horrible, dégoûtant et on ne peut plus américain», mais l’hypocrisie réside dans le silence de Trump après les précédents actes de violence commis par les partisans de MAGA: «Lorsque deux parlementaires démocrates et leurs épouses ont été assassinés par un partisan de Trump dans le Minnesota il y a quelques semaines, Trump n’a rien dit. Nada. Zéro.» La violence commise par la droite ne suscite aucune indignation, mais un seul décès utilisé comme arme contre la gauche devient la justification d’une guerre contre la dissidence. Comme le raconte St. Clair, le registre des violences commises par la droite entre 2018 et 2025 se lit comme un requiem: l’attaque du siège du CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), le meurtre de l’officier David Rose lors de l’attaque du CDC d’Atlanta, le complot visant à enlever la gouverneure démocrate [du Michigan] Gretchen Whitmer, le massacre de 23 personnes dans un Walmart d’El Paso et le massacre de 11 fidèles à la synagogue Tree of Life de Pittsburgh. Chaque acte était empreint de barbarie; chaque atrocité frappait comme un avertissement écrit dans le feu et le sang.
Malgré les affirmations malveillantes de Trump, Miller, Bondi et d’autres responsables selon lesquelles la gauche serait responsable de la mort de Charlie Kirk, les faits racontent une autre histoire. NBC News rapporte que «l’enquête fédérale sur l’assassinat du militant conservateur Charlie Kirk n’a pas encore trouvé de lien entre le tireur présumé, Tyler Robinson, 22 ans, et les groupes de gauche que le président Donald Trump et son administration se sont engagés à réprimer». Le régime Trump refuse de le reconnaître, effaçant les preuves et fabriquant un récit destiné à diaboliser ses détracteurs. Cette distorsion suit un schéma historique familier, mais ce que l’administration Trump refuse d’admettre et cache désespérément, c’est que, selon l’Anti-Defamation League, «depuis 2002, les idéologies de droite ont alimenté plus de 70% de toutes les attaques extrémistes et des complots terroristes nationaux aux États-Unis».
Il convient de noter, une fois de plus, que l’assassinat de Kirk, un acte tout à fait déplorable et indéfendable, a également été utilisé pour faire taire les détracteurs de tous bords politiques, des journalistes aux professeurs, qui ont exprimé leur tristesse face à sa mort tout en affirmant clairement leur rejet de son idéologie. Pleurer la perte d’une vie ne signifie pas approuver les idées qu’il défendait, et confondre la critique de ces idées avec une approbation cruelle et festive de sa mort est une déformation dangereuse. Comme Saida Grundy le fait remarquer avec brio et force dans un essai publié dans The Guardian, l’idéologie de Kirk n’avait guère sa place dans une démocratie. Il «régnait sur un fief en ligne où il colportait ses commentaires racistes, xénophobes, islamophobes et misogynes, caractéristiques de sa marque de fabrique». Elle ajoute que son succès ne venait pas d’une persuasion raisonnée, mais de la «popularisation de la brutalité, de l’humiliation et de la déshumanisation de ses adversaires politiques, en particulier des étudiants», qu’il a orchestrée dans un style politique qui a attiré des millions de personnes. Il a un jour rejeté l’empathie elle-même comme «un terme new age inventé qui fait beaucoup de dégâts», un sentiment qui résume son mépris pour la compassion et la solidarité.
Grundy note en outre que les commémorations officielles organisées en l’honneur de Kirk visent à fusionner sa vision d’extrême droite avec les intérêts du gouvernement fédéral, élevant les convictions nationalistes blanches, homophobes et misogynes au rang de priorités nationales. Selon elle, ces commémorations font écho à la logique des monuments confédérés: il ne s’agit pas de commémorations neutres, mais d’instruments de pouvoir, construits pour protéger leurs sujets de tout examen minutieux et pour sanctifier une idéologie d’exclusion. En ce sens, l’utilisation que fait Trump de la mort de Kirk n’est pas seulement un hommage, mais aussi une stratégie, un moyen d’intégrer l’extrémisme de Kirk dans un discours national qui légitime la répression et le suprémacisme blanc.
Célébrer l’extrémisme de droite de Kirk devient ainsi une arme politique. L’administration Trump a utilisé sa commémoration à la fois pour exalter les opinions de Kirk et pour intimider ou harceler ceux qui osent les contester. Il s’agit là de bien plus qu’un déni ou d’une déformation de la réalité; c’est une tromperie calculée. En inversant la réalité, en accusant les dissidents d’une violence largement attisée par leurs propres alliés idéologiques, l’administration mène une guerre contre la vérité elle-même. Les mensonges sont utilisés comme une arme pour justifier le silence des critiques et le renforcement de la répression étatique. C’est l’outil le plus ancien de l’autoritarisme, un scénario bien rodé tiré du manuel fasciste dans lequel les régimes inventent des ennemis internes pour masquer leur propre violence et consolider leur pouvoir.
La machine du fascisme
Voici la machine du fascisme: la désignation de boucs émissaires, l’amnésie historique et la fabrication d’une «menace interne» pour mobiliser la peur et effacer toute responsabilité. Rester silencieux face à de tels mensonges, c’est permettre que les plus sombres schémas de l’histoire se répètent. Le cliquetis sinistre des wagons n’est plus une simple métaphore, c’est une répétition. Les mêmes trains qui transportaient autrefois les ennemis de l’État, les Juifs, les communistes, les Roms et autres vers les camps de concentration, résonnent aujourd’hui dans le discours sur la surveillance, la détention et la déportation. Ces résonnances à l’étranger rendent impossible d’ignorer le danger chez nous. Les premières cibles sont toujours les personnes vulnérables, les immigrants, les réfugiés, les étudiants et les sans-abri. Mais une fois mise en marche, la machine répressive s’étend plus largement. Ce qui commence en marge se déplace toujours par atteindre le centre. Comme le montre l’histoire, la répression s’arrête rarement à ses premières cibles.
D’abord, les voyous masqués de la terreur d’État se sont abattus sur les immigrants, puis sur les étudiants manifestants; ils ont occupé des quartiers, transformé des villes en terrains d’entraînement militarisés et normalisé la violence comme langage d’un régime sans loi. Aujourd’hui, la machine répressive resserre son emprise et se rapproche de plus en plus des citoyens ordinaires. L’ombre d’un passé autoritaire plane sur la république, et à moins qu’elle ne soit combattue, l’avenir fera écho aux sinistres scènes de répression qui se déroulent déjà en Hongrie, en Inde et en Argentine.
Dans tous ces pays, y compris aux États-Unis, les dirigeants du nouveau fascisme parlent avec de la bile dans la bouche et du sang sur les mains. Ils partagent un langage que Toni Morrison qualifie de « langue morte » (discours de l’écrivaine lors de la réception du Prix Nobel de littérature en 1993). C’est un «langage oppressif, [qui] fait plus que représenter la violence; c’est de la violence». Trump et ses sbires utilisent un langage répressif imprégné de pouvoir, censuré et censurant. Impitoyable dans ses fonctions de maintien de l’ordre, il n’a d’autre désir ni d’autre but que de préserver la liberté d’action de son propre narcissisme narcotique, de son exclusivité et de sa domination. Il offre des spectacles de masse à la place de la réflexion, un somnambulisme moral et un engouement psychotique à ceux qui cherchent refuge dans un pouvoir sans limites. Il forge une communauté fondée sur la cupidité, la corruption et la haine, imprégnée d’un scandale de satisfaction creuse.
Tous ces fils convergent dans le présent. En ce moment historique, saturé de vengeance, de racisme systémique et de l’échafaudage d’un État policier, le langage lui-même est transformé en arme, en instrument d’ignorance fabriquée. L’administration Trump transforme le chagrin en cri de ralliement pour la répression. L’imagination radicale est étouffée sous les théories du complot et l’amnésie civique. Une politique creuse de cruauté trouve désormais son pendant dans la machine impitoyable du terrorisme d’État. Dans leur pays, Trump et ses partisans se présentent comme des victimes alors même qu’ils répandent la violence, la misère et la pourriture morale à travers le pays et au-delà.
L’enjeu ne pourrait être plus clair: le silence est complice. Parler, répondre et s’engager dans une action de masse est désormais la condition préalable la plus urgente pour construire des modallités efficaces de résistance collective. Partout dans le monde, les gens montrent déjà à quoi cela ressemble. En Italie, des grèves massives ont éclaté contre le soutien du gouvernement à la guerre génocidaire d’Israël, rappelant que la défiance collective peut interrompre la machine de répression et exposer la faillite morale de ceux qui détiennent le pouvoir. Les lumières s’éteignent rapidement, mais elles ne sont pas encore éteintes. La justice, l’égalité et la liberté peuvent encore être les fondements d’une démocratie radicale, mais seulement si nous agissons. La résistance n’est plus une option, c’est la tâche politique et morale urgente de notre époque. (Article publié sur le site Bullet le 10 octobre 2025; traduction rédaction A l’Encontre)
Henry A. Giroux est actuellement professeur à l’université McMaster pour la recherche dans l’intérêt public et chercheur émérite Paulo Freire en pédagogie critique.


Soyez le premier à commenter