
Entretien avec Thomas Serres
conduit par Catherine Calvet
Pour Thomas Serres, spécialiste de l’Algérie, le changement politique est inéluctable: la preuve que le pire n’est pas sûr.
Quels sentiments vous inspirent ces jeunes qui manifestent depuis un mois?
Je n’avais pas vu venir ce mouvement remarquable, très émouvant, calme et organisé. Après avoir écrit L’Algérie face à la catastrophe suspendue, gérer la crise et blâmer le peuple portant sur ce système politique algérien qui n’en finit jamais de se régénérer sous d’autres formes, du parti unique au «cartel» en place aujourd’hui, je me laissais aller au pessimisme. Ces manifestants démontrent que tout n’est pas écrit. On peut enfin voir qu’une dissidence est possible, qu’elle ne disparaîtra pas forcément dans le chaos. La révolution symbolique a déjà eu lieu, reste à savoir ce qu’il adviendra de leur mouvement politique. Je ne vois pas comment un profond changement pourrait être évité cette fois-ci.
Les militants que j’ai interviewés étaient bien dans une stratégie de résistance dans la durée. Ils sont le terreau d’une révolution pacifique dont les origines remontent bien avant février, avec, par exemple, le Comité national de défense des droits des chômeurs ou des organisations comme le Rassemblement action jeunesse. Il fallait inverser le stigmate: tenter de rendre une dignité au chômeur, au jeune, qui supportait une grande partie de la violence économique et physique du régime.
Est-ce le signe que la menace de catastrophe aurait enfin cessé de fonctionner?
On peut répondre de plusieurs façons. D’une part, la menace sécuritaire, la catastrophe qui guette la population, ne fonctionne plus. Mais on peut aussi voir le présent mouvement comme un véritable péril existentiel pour le régime. Le terme de catastrophe concerne non seulement le pays réel mais aussi la survie du «cartel», du «système» qui tient l’Etat. Même si une reconfiguration de la coalition au pouvoir est possible, car celle-ci est suffisamment diversifiée, pour l’instant ce mouvement révolutionnaire est une catastrophe pour le régime.
Dans votre livre, vous tentez de déchirer le voile d’opacité qui rend ce pays à la fois passionnant, presque littéraire et en même temps bloqué sur lui-même…
Derrière ce jeu d’ombre et de lumière, le plus dur est d’aller au-delà des clichés. Nous avons à notre disposition des données brutes, des exemples de violences physiques. Mais on ne peut pas comprendre l’Algérie de Bouteflika ni son effondrement sans voir la nature éminemment symbolique de ce qui se joue depuis dix ans. Les violences sont bien sûr économiques, policières, physiques mais aussi symboliques. Les simples représentations de ceux qui tiennent le pouvoir et celle de la population sont violentes. Elles faisaient apparaître un pouvoir surplombant et une population infantilisée. Les appareils bureaucratiques et militaires sont toujours là.
Mais pour qu’une fiction du pouvoir soit opérante il faut que ceux qui incarnent ce pouvoir soient capables de parler et de parler bien. Or le principal agent, le magicien en chef, est en fauteuil roulant et incapable d’articuler un mot. Et ceux qui sont censés parler à sa place, comme l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal ou son successeur, lui aussi écarté, Ahmed Ouyahia, sont des gens qui parlent mal, qui sont extrêmement brutaux ou méprisants dans leurs propos.
Qu’entendez-vous dans votre titre par l’expression «blâmer le peuple»?
Il y a une continuité en Algérie. Cela commence dès la colonisation. Le peuple algérien est déjà vu comme une masse anarchique, indisciplinée. Cela se poursuit après l’indépendance, cette foule prétendument immature est perçue comme un problème par le gouvernement bureaucratique hérité de la guerre d’indépendance. Il y a comme un hiatus avec le «peuple» libérateur et héroïque glorifié par l’histoire officielle.
Dans la tradition du nationalisme algérien, le peuple révolutionnaire a une image de sainteté politique qui entre en collision avec une image misérabiliste, paternaliste de la population. En 1988, le régime a donc eu peur de son peuple, dont une partie avait voté pour les islamistes du Front islamique du salut. La punition fut terrible: dix ans de guerre civile dont on a fait porter la responsabilité au peuple qui avait mal voté, qui s’était fait manipuler. Ce discours de la classe dirigeante s’est aussi retrouvé dans la presse privée, même dans celle de l’opposition. Certains opposants qui essayaient vraiment de comprendre la situation ont eux aussi fini par blâmer une population pas assez moderne, incivique, sale, superstitieuse…
Les jeunes manifestants d’aujourd’hui sont l’inverse de ces clichés?
Ils se livrent à un exercice d’autoreprésentation pour détruire ces clichés. Ils font une démonstration publique, et c’est ainsi qu’ils opèrent leur révolution symbolique.
Comment un pays qui a eu autant d’influence dans les années 1960 et 1970, peut-il se retrouver aussi immobile?
On a en effet tendance à oublier qu’Alger a été une capitale de l’anticolonialisme, un lieu où naissaient les idées les plus émancipatrices. C’est aussi là que se situe la violence symbolique de ce régime; comment un pays qui a représenté l’effervescence révolutionnaire a pu se retrouver avec un régime incarné par un vieil homme impotent sur un fauteuil roulant et presque muet. L’idéal de sainteté révolutionnaire qui devait changer le monde dans les années 1960 a dégénéré en un système machiavélien et totalement circulaire. Le pouvoir ne sert plus que le pouvoir. Et il doit donc maintenir en vie un personnage comme Bouteflika pour sa propre perpétuation. Après avoir été à la pointe de l’utopisme, ce régime a laissé tomber le politique pour faire de la politique à court terme afin de rester au pouvoir.
Désormais, toute la société bouge…
Parce que pour la population, cet idéal de sainteté politique incarné par l’Algérie révolutionnaire n’est pas mort, on le voit en ce moment. La population malgré les amnesties-amnésies n’a pas oublié ce vieux fond national. Cet idéal s’est maintenu dans le temps, sur des décennies, notamment au travers de figures de martyrs de l’Etat, comme Mohamed Boudiaf [1919-1992, un des membres fondateurs du FLN, président du 16 janvier au 29 juin 1992, assassiné par les services spéciaux], Lounès Matoub [musicien, militant de la cause kabyle, assassiné en 1998] et tant d’autres… Il n’y a jamais eu d’adhésion massive au régime de Bouteflika. Il avait des électeurs, c’est incontestable, mais ce régime apparaissait comme factice et avait cessé de dire des choses importantes. Il n’était plus question que d’un continuum mou de développement, sans ambition, sans désir de rendre le monde meilleur.
Les médias occidentaux ont aussi été influencés par ce catastrophisme? Pendant les printemps arabes, certains prédisaient que si l’Algérie bougeait aussi, elle risquait le chaos…
Mais parce que la catastrophe n’est pas seulement un mythe, elle s’appuie aussi sur des éléments objectifs, que ce soit la violence du régime, les émeutes récurrentes, sans oublier le terrorisme qui est toujours là. Il y avait des facteurs objectifs, les observateurs ne se sont pas juste laissé avoir par une mystification. Une montée de la violence paraissait possible, malgré la volonté des Algériens de préserver la paix. De plus, la vision de ce pays dans les médias français a longtemps été péjorative ou tout du moins négative. Même les experts dont je fais partie ont du mal à sortir de cette logique de marché informationnel. On répond aux questions qu’on nous pose sans toujours les remettre en cause.
Vous parlez de l’opacité organisée dans ce pays. Le voile se déchire-t-il enfin?
Manifester dans la rue, c’est être en pleine lumière. La politique ne peut plus se faire uniquement dans les officines mais dans la rue. Quand les jeunes manifestent avec des cadres vides, ils revendiquent une souveraineté claire et directe. Bien sûr, nous ne savons pas encore tout ce qu’il se passe en interne, car il y a forcément des négociations, dans les alcôves du pouvoir mais aussi avec les chancelleries occidentales. Mais ces négociations deviennent secondaires, elles ne peuvent générer de légitimité. Ceux qu’on prenait pour une masse mal éduquée se posent en héros et génèrent leur propre pouvoir, sans filtre et contre les clichés.
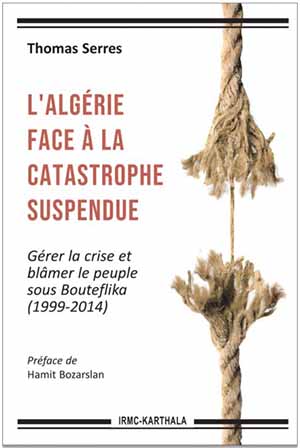 Voyez-vous des analogies avec Mai 68?
Voyez-vous des analogies avec Mai 68?
Il y en a bien sûr, comme entre tous les mouvements révolutionnaires. On peut noter le rôle des étudiants, la nature de certains slogans et les solidarités qui se créent avec d’autres corps de la société. Mais en Algérie, aujourd’hui, il ne s’agit pas de libérer les corps, ou l’éducation ou la société…
Il s’agit de libérer l’Etat de la bande de prédateurs qui l’ont en quelque sorte privatisé. Donc il y a une demande de redistribution des pouvoirs et des richesses. (Entretien publié dans le quotidien Libération, en date du 23 mars 2019; titre rédaction A l’Encontre)
Thomas Serres enseigne à l’université de Californie, à Santa Cruz, il vient de publier ce mois de mars L’Algérie face à la catastrophe suspendue, gérer la crise et blâmer le peuple (éd. Karthala-IRMC Tunis).


Soyez le premier à commenter