Parmi les nombreuses «tribunes», «cartes blanches» et «opinions» sur «le jour d’après» publiées pendant le confinement, celle intitulée «Il faut démocratiser l’entreprise pour dépolluer la planète», initiée par Julie Battilana, Julia Cagé, Isabel Ferreras, Lisa Herzog, Hélène Landmore, Dominique Méda et Pavlina Tcherneva, rejointes par quelque 3000 académiques à travers le monde, a bénéficié d’une très large couverture médiatique. On ne peut qu’être d’accord avec les signataires pour soutenir que «le travail ne peut être réduit à une marchandise» et que la lutte contre l’accroissement des inégalités nécessite de «démarchandiser le travail» [1].
L’argumentation des signataires de cette Tribune en vue de «démocratiser l’entreprise pour sauver la planète» repose sur deux axes: «permettre aux employés de participer aux décisions de l’entreprise» et exiger que «la collectivité garantisse un emploi utile à toutes et à tous». Si l’on peut soutenir sans réserve l’accent mis sur la centralité du travail, il en va tout autrement de la «démocratisation de l’entreprise» telle qu’elle nous est proposée.
«La citoyenneté dans l’entreprise» serait en effet, pour les signataires, la condition pour émanciper les salarié·e·s, définis comme des «investisseurs en travail». Ils devraient avoir accès à la décision tout comme les investisseurs en capital. Les comités d’entreprise devraient en conséquence être dotés de droits similaires à ceux des conseils d’administration de manière à instaurer une sorte de bicaméralisme soumettant «le gouvernement de l’entreprise à une double majorité».
Un retour «au jour d’avant»
Sans que l’on en prenne garde, le «jour d’après» que dessine cette Tribune nous précipite, avec la vieille controverse du contrôle ouvrier contre la cogestion, au «jour avant». Cette controverse avait longtemps divisé le mouvement syndical. Alors qu’historiquement le mouvement ouvrier s’était organisé de manière autonome par rapport au patronat, en Allemagne, après s’être ralliés en 1914-18 à l’effort de guerre, les syndicats avaient obtenu leur reconnaissance dans l’entreprise et conclu un accord instituant dans les entreprises une communauté de travail entre employeurs et salariés. Après la Deuxième Guerre mondiale, le DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund), grande centrale syndicale, mettra la cogestion (Mitbestimmung, «codécision») au centre de son programme, cogestion qui sera instaurée par une loi dès 1951.
Par contre, la grande majorité des syndicats en Europe rejetaient la codécision. En associant les salariés à l’entreprise la cogestion les priverait, soutenaient-ils, de leur autonomie revendicative et dans un marché concurrentiel opposerait les travailleurs d’une entreprise à ceux d’une autre. Ils y voyaient une forme de collaboration de classe dont les travailleurs seraient les perdants. La CGT (Confédération générale du travail) en France, la FGTB (Fédération générale du travail de Belgique) en Belgique ou la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) en Italie tout en s’opposant à la cogestion prônaient le contrôle ouvrier. Selon Alain Touraine, le contrôle ouvrier s’inscrivait dans «la double nature du syndicalisme: tout à la fois instrument de revendication et de ce fait agent de transformation sociale et en même temps partenaire dans la négociation. Le syndicalisme de contrôle, à la différence de la cogestion exclut la participation à la gestion des entreprises. Il se veut contre-pouvoir autonome, séparé du pouvoir de décision économique qu’il entend contrôler et infléchir en fonction des intérêts des salariés» [2].
Les signataires de la Tribune reprochent aux comités d’entreprise, issus de la tradition du syndicalisme de contrôle, leur «incapacité à bloquer la dynamique du capital». Les signataires se rallient par contre au système de codétermination à l’allemande qui a représenté «une étape cruciale mais encore insuffisante». Or, ce système, par ses clauses de paix sociale, a surtout permis de contenir les conflits sociaux et il paraît bien hasardeux de lui attribuer même un semblant de dynamique anticapitaliste.
Une étude récente sur la codétermination à l’allemande montre précisément la détérioration de ce «modèle» [3]. Dans la mesure même où, depuis les années 1980, le poids des accords de branche a diminué au profit des entreprises, pourtant cogérées, le système a perdu sa cohérence. L’étude cite trois sources principales à l’érosion de la cogestion allemande: la financiarisation de l’économie, la mondialisation et l’intégration de l’ancien bloc de l’Est qui a ouvert la voie des délocalisations. Les accords d’entreprise sont devenus des accords «moins disant». Les syndicats ont perdu au cours des 20 dernières années la moitié de leurs adhérents. La codétermination se traduit plus par la gratification de délégués du personnel conformistes que par la prise en compte des intérêts des salarié·e·s.
La question de la «garantie d’un emploi utile pour toutes et tous» prônée par la Tribune paraît plus pertinente mais pèche par son manque de précision. La Commission européenne a déjà développé un programme «garantie emploi jeunes» qui visait à proposer un emploi, un stage ou une formation à chaque jeune, sans que le chômage des jeunes ait été éradiqué pour autant. On pourrait y voir aussi un mécanisme faisant de l’état un employeur en dernier ressort, ce qui donnerait à la proposition un contenu plus prometteur. Sans autre précision sur son contenu et sa faisabilité, la «garantie d’emploi utile pour tous» paraît risquée et pourrait ouvrir la porte à des formes de travail dégradé.
Fin de la centralité de l’entreprise
La transformation du monde par 40 ans de politiques néolibérales (libre circulation des capitaux, expansion du crédit à l’échelle planétaire et numérisation des activités économiques) n’a pas entraîné la fin de la centralité du travail ni sa raréfaction, comme l’ont soutenu nombre d’auteurs dans les années 1980, mais a provoqué la fin de la centralité de l’entreprise qu’ils n’avaient pas perçue. Dans le capitalisme industriel naissant, l’entreprise avait été l’espace de contrôle des ouvriers et le lieu d’organisation de la production. L’invention de la société anonyme avait permis de réunir d’immenses capitaux au service de l’entreprise. Celle-ci, comme siège des intérêts contradictoires des travailleurs et des employeurs, avait aussi été le théâtre des coalitions ouvrières et de l’implantation des syndicats. Avec le capitalisme financier, c’est l’entreprise qui est mise au service de la société composée par les actionnaires. La société anonyme est devenue un outil financier non pas au service de l’entreprise mais bien à celui d’un actionnariat mondialisé. Dans le nouveau régime du capitalisme actionnarial, l’entreprise n’est plus centrale mais le profit repose plus que jamais sur l’exploitation du travail. C’est donc l’entreprise et non le travail, comme certains l’avaient proclamé, qui a perdu sa centralité au profit de la société des actionnaires.
Le vieux débat sur la démocratisation de l’entreprise, même habillé de modernité, est aujourd’hui dépassé et daté. Il surgit comme résidu d’une autre époque. Avec la financiarisation, la mondialisation et la numérisation l’entreprise n’est plus un lieu central de décision. Elle a été vidée de sa substance. Le sort des entreprises ne se décide pas dans leur enceinte ni dans le pays dans lequel elles sont implantées. Des centaines de milliers de salarié·e·s, ubérisés, livreurs, traducteurs, consultants, soignantes… œuvrent en dehors du cadre de l’entreprise. Pour se valoriser le capital fait précisément l’économie du coût que représente pour lui l’entreprise.
Dans ce nouveau monde, il ne suffit pas qu’une entreprise réalise ses objectifs de production tout en demeurant rentable, elle doit encore être plus rentable que les autres, sans quoi les capitaux iraient s’investir ailleurs. Lorsque les investisseurs mécontents vendent leurs actions, les cours baissent et l’entreprise dont la valeur boursière plonge, devient une proie potentielle pour une offre publique d’achat, OPA. C’est pourquoi des usines pourtant rentables se restructurent ou cessent leur activité et procèdent aux «licenciements boursiers». Les salarié·e·s savent alors qu’ils n’ont plus grand-chose à obtenir de leur entreprise. Celle-ci qui était une institution centrale dans la phase précédente du capitalisme a perdu sa consistance et par là même, le mouvement syndical, implanté dans l’entreprise a vu se dérober ses principaux repères organisationnels. Lorsque la privatisation et la marchandisation se substituent à la mutualisation, à la nationalisation et à la régulation des marchés, le mouvement syndical ne peut se laisser enfermer dans le cadre étriqué des entreprises censées se prêter à la codétermination. Les rapports de force qui s’étaient forgés dans le cadre d’une économie régulée se trouvent bouleversés dans une économie financiarisée.
Mutualiser les richesses et réduire le temps de travail
Le mérite essentiel de la Tribune réside dans sa volonté de «démarchandiser le travail». Il est d’autant plus étonnant que le texte ignore le système de protection sociale qui, en protégeant la relation salariale de l’incertitude du marché, a été le principal levier de démarchandisation du travail. La sécurité sociale, en mutualisant les richesses privées pour les réinvestir dans des biens et services collectifs gratuits ou à moindre prix, limite la part marchande de l’économie.
C’est pourquoi les soins de santé et les retraites demeurent toujours l’enjeu majeur des conflits sociaux.
En substituant une «garantie d’emploi» abstraite dans sa formulation, la Tribune occulte la question essentielle de la réduction collective du temps de travail. C’est lorsque, depuis le milieu des années 1970, la réduction de la journée, de la semaine et de l’année de travail s’est ralentie tout comme l’abaissement de l’âge de la retraite, que le chômage s’est installé. On le sait bien, le plein emploi est pour l’essentiel une question de répartition.
En se focalisant sur l’entreprise, les signataires de la Tribune ont raté leur cible pour le jour d’après: la démarchandisation du travail. (6 juin 2020)
Mateo Alaluf, professeur émérite de sociologie auprès de l’Université libre de Bruxelles. Il est l’auteur, entre autres, Contre l’allocation universelle (avec Seth Ackerman), Lux Editeurs, 2016; Mesures et démesures du travail (avec Pierre Desmarez et Marcelle Stroobants), Ed. de l’ULB, 2012. Son ouvrage Le socialisme malade de la social-démocratie sera copublié par les Editions Syllepse (Paris) et Page deux (Lausanne).
_________
[1] Le Monde (15/5/2020). Ce texte a été publié, signale le quotidien, par 27 médias de 23 pays. https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/15/democratiser-pour-depolluer_6039777_3232.html
[2] Alain Touraine, « Contribution à la sociologie du mouvement ouvrier. Le syndicalisme de contrôle », Cahiers Internationaux de sociologie, Vol XXVIII, Janvier-Juin 1960, pp. 57 à 88.
[3] Clément Brébion, « L’Allemagne un modèle de relations professionnelles vraiment coopératif ?», Connaissance de l’emploi, N°158, CNAM, CEET, avril 2020.

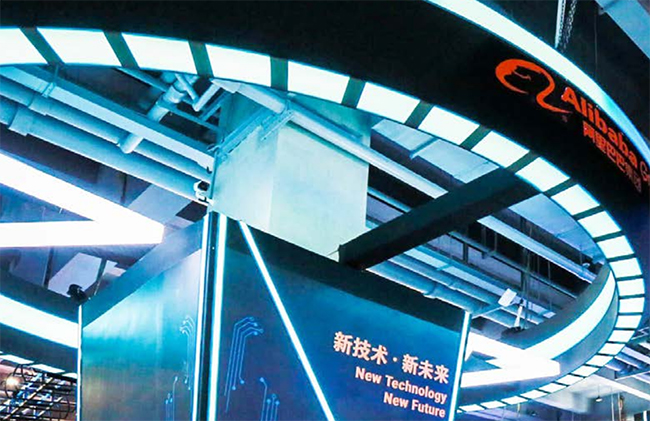

Soyez le premier à commenter