
Par Manuel Gari
«Le franquisme, inexistant dans la réflexion politique, s’est manifesté dans la routine muette de l’effronterie et de l’immoralité.» Francisco Pereña, psychanalyste antifranquiste
Le 20 novembre dernier a marqué le 50e anniversaire de la mort du dictateur espagnol Francisco Franco et, immédiatement après, le 6 décembre, ont eu lieu les festivités pour le 47e «anniversaire» de la Constitution espagnole. Tout cela dans un contexte d’extrême polarisation politique entre les élites des partis représentés au Parlement. Une polarisation extrêmement aiguë et simpliste présente dans toutes les institutions du régime de la Réforme [«Transition démocratique» 1975-1982] qui a succédé à l’architecture de la dictature.
Dans ce climat, il n’est pas exagéré d’affirmer que nous assistons à la mise en scène d’une sorte de coup d’État en douceur, en continu, mené principalement par les hautes instances de la magistrature en collusion avec certains secteurs du monde des affaires et de la police, et orchestré politiquement par les partis de la droite espagnole. Son objectif est de délégitimer le gouvernement présidé par le socialiste Pedro Sánchez, tout en opérant un virage politique vers la droite et en procédant à un ajustement constitutionnel centraliste, autoritaire et antisocial. Le point culminant le plus récent de ce complot putschiste a été le procès-spectacle intenté par la Cour suprême contre Álvaro García Ortiz, ancien procureur général de l’État, d’orientation progressiste, procès qui s’est soldé par sa condamnation sans que le verdict soit connu à ce jour, dans un cas évident de lawfare (utilisation stratégique du droit pour mener une persécution)[1].
Cette situation est alimentée par les médias de droite dans un contexte général de passivité et de démobilisation du mouvement populaire, à quelques exceptions près, comme le mouvement de solidarité avec la Palestine ou celui de la défense des droits nationaux basques. À l’occasion de ces deux commémorations, des événements de divers types ont proliféré, mettant en évidence un degré élevé d’agressivité et de mobilisation de la droite extrême centraliste représentée par le Parti populaire (PP), dont les propositions et le discours sont de plus en plus difficiles à différencier de ceux de l’extrême droite trumpiste de Vox, qui est en pleine ascension. Dans les deux cas, il existe une vision révisionniste de la dictature franquiste qu’ils refusent de condamner, tandis que dans leurs rangs ou dans leur entourage les nostalgiques des «bonnes années du franquisme» commencent à se multiplier.
***
Comment expliquer la persistance d’un courant franquiste sous-jacent au sein de la droite espagnole? Il existe effectivement un essor mondial des idées autoritaires, climatosceptiques, antiféministes et xénophobes qui menacent les droits du travail et les droits syndicaux, portent atteinte à la diversité sexuelle et de genre, sous l’impulsion du «moment Trump» qui prend des visages et des expressions différents dans chaque pays. Mais dans le cas de l’Espagne, il n’y a jamais eu de règlement de comptes avec le passé totalitaire, comme cela a été le cas dans l’après-guerre mondiale dans des pays comme l’Allemagne ou l’Italie. Cela peut expliquer les différences et la singularité de la montée de l’extrême droite dans l’État espagnol à l’heure actuelle.
Les militaires putschistes, les policiers tortionnaires et les voyous phalangistes n’ont pas eu à se cacher, à renier leur passé ni même à le dissimuler. Ils sont devenus du jour au lendemain des démocrates grâce au processus analysé ci-dessous. Pendant des années, ils ont pu exercer leurs fonctions en tant que serviteurs honnêtes des institutions démocratiques sans condamner la dictature franquiste. L’expression la plus aboutie de cet esprit réactionnaire a été récemment donnée par José María Aznar, ancien président du gouvernement espagnol entre 1998 et 2004, lorsqu’il a déclaré avec cynisme qu’il ne pouvait pas critiquer le franquisme parce que son père avait participé activement au régime dictatorial et qu’en tant que fils il ne pouvait pas condamner les actes de son père.
La grande transaction au milieu des années 1970
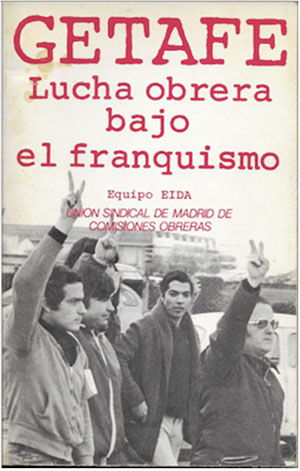
La période dite de transition de la dictature vers un régime de libertés limitées et surveillées comme celui d’aujourd’hui – que seuls la naïveté de la gauche sociale libérale et des héritiers du vieux stalinisme, voire de certains secteurs «repentis» de l’extrême gauche, peuvent qualifier de démocratie pleine et entière – est la pièce maîtresse qui explique le présent. En effet, nous pourrions qualifier cette soi-disant «transition modèle» de véritable «transaction» après la mort du dictateur entre les élites économiques et politiques franquistes et les forces de gauche majoritaires – le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et le Parti communiste d’Espagne (PCE) – avec l’aide de l’ancien Parti nationaliste basque (PNV-Partido Nacionalista Vasco) et de ses équivalents en Catalogne. Un accord contre nature qui s’est imposé (et a désamorcé) le mouvement ouvrier et populaire de masse en pleine ascension[2] dans ses revendications salariales, syndicales et sociales (et nationales dans le cas des nations sans État) qui se profilait comme un nouvel acteur politique dans la lutte pour les libertés complètes.
En réalité, le terme «transaction» explique mieux que ceux de «réforme imposée» par la dictature elle-même ou de «rupture négociée» avec celle-ci, ce qui s’est passé entre 1975, année de la mort de Franco, et 1978, année de l’adoption de la Constitution [en 1977 a été adoptée la loi d’amnistie-Ley de Amnistía]. De manière cynique, Santiago Carrillo, alors secrétaire général du PCE, a inventé la formule «amnistie en échange d’amnésie».[3]
Une amnistie qui, d’ailleurs, a également été accordée aux serviteurs de la dictature, dans le cadre d’une sorte de «ley de punto final» [formule utilisée entre autres en Argentine en 1986] qui les a exonérés de toute responsabilité pour leurs crimes. Les membres de la Brigada Politico Social (Brigade politico-sociale) spécialisée dans la répression de l’opposition ont continué à gravir les échelons au sein du Cuerpo General de la Policia (Corps général de la police, institution armée), tout comme les membres de la Garde civile (Guardia Civil) qui ont conservé leur poste ou ont été promus, les militaires fidèles à Franco qui ont continué à faire partie de l’état-major de l’armée et les juges. Dans ce dernier cas, il convient de noter qu’en 1977, lorsque le Tribunal de l’ordre public (TOP)[4] a été dissous, il comptait 16 membres; tous ont été reclassés comme juges démocrates dans les nouvelles instances judiciaires suprêmes: 10 sont allés à l’Audiencia Nacional [organe ayant juridiction sur l’ensemble du territoire national, donc un tribunal centralisé] et 6 à la Cour suprême (Tribunal Supremo, cour de dernière instance; pour ce qui concerne la Constitution existe le Tribunal constitutionnel).
La bourgeoisie espagnole et une grande partie des politiciens du Mouvement national (proto-parti qui unissait tous les courants de droite soutenant la dictature militaire bonapartiste dans laquelle s’était cristallisé le régime de Franco) étaient parvenus au milieu des années 1970 à une conclusion: la prolongation du franquisme sans Franco n’était pas viable. Le gouvernement des États-Unis, qui avait légitimé le régime franquiste à la suite les accords conclus entre le président Eisenhower et Franco (Accords de Madrid 1953), était parvenu à la même conclusion. À la suite de ces accords, Franco était devenu le champion de la lutte anticommuniste en pleine guerre froide, en échange de bases militaires états-uniennes qui sont toujours présentes sur le sol espagnol.
Ils avaient pris note de l’évolution interne de l’opposition politique, de l’essor du mouvement ouvrier renaissant et de la vigueur du mouvement étudiant qui avait creusé un fossé entre la jeunesse et le régime franquiste, mettant en péril la loyauté des futurs cadres du système capitaliste. De même, ils ont constaté avec stupéfaction la force du mouvement démocratique national en Catalogne, qui exigeait à nouveau le statut d’autonomie, tout comme en Galice ou dans le Pays valencien, puis plus tard en Andalousie, mais surtout la question nationale en suspens dans le Pays basque est devenue visible à partir des actions de l’ETA, qui ont rallié le soutien de la jeunesse. Ils ont également pris bonne note du fait qu’il n’y avait pas de remplaçant continuiste au général Franco après l’assassinat (au sens propre du terme) de son remplaçant, l’amiral Carrero Blanco, le 20 décembre 1973. La révolution des œillets du 25 avril 1974 au Portugal voisin et la fin du régime des colonels et de la monarchie grecque en juillet de la même année, ainsi que l’impossibilité militaire de faire face à la «Marche verte» (novembre 1975) lancée par le monarque alaouite du Maroc (Hassan II) pour annexer le Sahara détenu par l’Espagne après la mort du dictateur, ont été des éléments décisifs qui les ont amenés à rechercher d’autres solutions de remplacement.
Le coup de maître
Dans le but de sauver l’essentiel, la bourgeoisie espagnole a mis en place une tactique particulière de changement qui a surpassé celle imaginée par Giuseppe Tomasi di Lampedusa dans «Le Guépard». L’oligarchie s’est assuré son passeport démocratique post-franquiste à tel point qu’il y a une continuité totale des noms propres des propriétaires et des entreprises dans les secteurs clés de l’économie espagnole de l’époque: banque, construction, sidérurgie, agro-latifundisme et tourisme avant et après les élections générales de 1977 et la Constitution de 1978. À titre d’anecdote révélatrice de ce qui précède, il convient de souligner qu’aujourd’hui, au moment même où la corruption de dirigeants importants du PSOE [José Luis Ábalos, Santos Cerdán] fait la une des journaux, l’agent corrupteur pour l’attribution des marchés publics est Acciona, c’est-à-dire l’entreprise des anciens constructeurs du franquisme Entrecanales y Tavora [fondée en 1931, dissoute en 1997].[5]
Après la nomination de Juan Carlos de Borbón comme roi d’Espagne par le dictateur et donc comme son successeur à la tête de l’État, il fallait établir les lignes rouges du franquisme pour les négociations avec l’opposition. Torcuato Fernández Miranda [1915-1980], homme politique et professeur de droit du futur monarque, a posé les quatre questions incontournables qui ont ensuite été intégrées dans la rédaction du texte constitutionnel comme immuables.
Tout d’abord, l’unité territoriale de l’Espagne comme fondement même de l’idée de nation espagnole, de sorte que la démocratie espagnole ne repose pas sur l’idée de souveraineté nationale ou populaire effective, mais sur le fait de cette unité intangible. Le corollaire de ce qui précède est la suppression du droit démocratique à l’autodétermination nationale, une question très grave dans un pays composé de diverses nations auxquelles on impose une identité et une unité a priori. Afin d’apaiser les revendications nationalistes ou régionalistes, on a instauré ce qu’on appelle l’État des autonomies, qui est un hybride mal conçu entre un État central unitaire et un État fédéral.
Deuxièmement, le rôle constitutionnel prééminent de l’armée est proclamé, celle-ci étant désignée comme le principal garant de la Constitution et de l’unité nationale.

Troisièmement, la monarchie est instaurée comme forme d’État sans consultation populaire ni référendum, ce qu’Adolfo Suárez lui-même – président du dernier gouvernement franquiste et premier président élu aux urnes en 1977 [juillet 1976-février 1981] – craignait de voir aboutir à un résultat républicain contraire à la monarchie. Et pour couronner le sommet de la pyramide du pouvoir qui assure le contrôle de la situation, le roi est le chef suprême des forces armées.
En quatrième lieu, deux éléments intangibles viennent compléter le tableau. D’une part, la propriété privée et l’économie de marché sont instaurées comme régime économique de la nouvelle démocratie. D’autre part, la prééminence de l’Église catholique (renforcée par la signature d’un concordat avec le Vatican: ajustement en 1979 du Concordat en vigueur depuis 1953) est à nouveau consacrée dans le domaine de l’enseignement, tout en respectant l’ensemble des propriétés accumulées pendant la dictature qui, d’ailleurs, ont ensuite été renforcées par une loi du gouvernement Aznar qui leur a automatiquement permis d’enregistrer des milliers de nouvelles propriétés urbaines sans avoir à justifier leur origine. Le Royaume d’Espagne n’est pas confessionnel, mais il en a tous les attributs.
Quelques réflexions sur les limites de cette démocratie post-franquiste
Tout ce qui précède montre bien que le prétendu pacte démocratique entre les forces du régime et la majorité de l’opposition était un pacte asymétrique qui a entravé le plein déploiement des libertés et des droits démocratiques.[6] Il est évident que l’imposition de ces conditions au peuple espagnol et ce discours sur la Transition ont nécessité, comme le souligne Javier Pérez Royo, professeur de droit constitutionnel à l’université de Séville, une importante composante de dissimulation. Il parle textuellement de dissimulation, c’est-à-dire de cache-cache et de mensonge sur la réalité passée et présente.
L’oubli est instauré de manière planifiée et consentie. Des individus tels que les ministres de la dictature Rodolfo Andrés Martin Villa [premier vice-président du gouvernement espagnol décembre 1981-juillet 1982 et antérieurement ministre de l’Administration territoriale septembre 1980-décembre 1981] ou Fraga Iribarne [fondateur du PP en 1989 – qui fut entre autres ministre de l’Information et du Tourisme de juillet 1962 à octobre 1969 et ministre de l’intérieur de décembre 1975 à juillet 1976], coupables d’assassinats, ont incarné la falsification de la vérité et passeront à l’histoire comme les pères de la démocratie. C’est pourquoi il existe encore des documents classifiés que les gouvernements de gauche réformiste eux-mêmes n’ont pas déclassifiés. Des documents qui, de 1936 à nos jours, contiennent des informations de la plus haute importance. C’est pourquoi on continue de passer sous silence officiellement le fait que la torture était pratiquée à la Puerta del Sol (Madrid), à la Vía Laietana (Barcelone), à Intxaurrondo (quartier de Saint-Sébastien)… et dans tant d’autres bâtiments institutionnels ou casernes de police.
Le silence et l’effacement de la mémoire sont à la base du nouveau régime post-franquiste. C’est le résultat de la politique de «réconciliation nationale» menée par le PCE, qui était à l’époque la force clé de la gauche avant les élections de 1977 qui ont donné la primauté au PSOE de Felipe González. La réconciliation a signifié passer sous silence les crimes de la dictature, mais aussi et surtout la lutte antifranquiste comme facteur déterminant de la conquête des libertés. Celles-ci sont donc apparues comme par magie dans le discours dominant suite à l’action et au bienfait du corrompu et kleptomane Juan Carlos Ier de Bourbon. Cette réconciliation a eu de nombreux autres coûts matériels et symboliques: symboles, renonciation au drapeau républicain, acceptation de la monarchie.
L’objectif immédiat de la bourgeoisie dans les années du changement était clair et elle a trouvé dans le PSOE et le PCE les collaborateurs nécessaires: il fallait éviter le débordement populaire ouvrier et nationaliste. C’est ainsi que deux éléments s’installent de manière hégémonique dans la culture de la gauche politique et sociale: l’obsession du consensus comme voie de solution politique face aux résistances de la droite et le fétichisme institutionnel. Cela a conduit à l’abandon de toute perspective de rupture comme horizon de régulation.
Mais cela a également favorisé à la fois le blanchiment de la droite espagnole et sa réorganisation et son renforcement. Les franquistes n’ont jamais abjuré, ils ne sont jamais partis, ils se sont simplement cachés. Les franquistes recyclés ont acquis une légitimité démocratique. C’est pourquoi ils réapparaissent sans complexe 50 ans plus tard. Franco est mort dans son lit, la dictature est morte dans les rues, mais les héritiers du franquisme ont survécu et se sont adaptés. Le discours réactionnaire refait surface dans les salles de classe et dans les entreprises. Mais la gauche marxisante dispose encore d’une influence suffisante pour contrer les discours et les propositions xénophobes, machistes et individualistes.
Pour arrêter la nouvelle vague autoritaire, il est nécessaire de mener un travail de contre-information sur les réseaux sociaux face aux rumeurs et aux mensonges, et de diffusion et de formation dans les établissements d’enseignement, les quartiers et les entreprises afin de parvenir à une nouvelle hégémonie en créant un sens commun révolutionnaire alternatif radicalement démocratique. Pour cela, il est nécessaire de promouvoir une politique de front unique, d’unité d’action, autour de la mobilisation populaire, sans laisser la solution entre les mains des parlementaires et autres responsables institutionnels dont le meilleur travail possible est d’aider le processus d’action populaire. Pour y parvenir, il faut une force sociale et matérielle et une activité indépendante afin d’établir un nouveau rapport de forces au sein du mouvement populaire qui se traduise par un nouveau rapport de forces dans la société. Une fois de plus, la question de l’organisation marxiste révolutionnaire réapparaît à l’ordre du jour politique actuel face à l’évidence du danger. (Article reçu le 8 décembre 2025; traduction rédaction A l’Encontre)
_________
- Álvaro García Ortiz est comparu durant six jours, début novembre, pour, selon l’accusation, avoir divulgué à des journalistes un mail confidentiel concernant un entrepreneur, conjoint d’une figure de l’opposition de droite dans une affaire de fraude fiscale présumée. Plusieurs journalistes ont assuré devant la cour qu’Álvaro García Ortiz n’était pas la personne qui leur avait révélé l’échange de mails. L’entrepreneur mentionné, Alberto González Amador, est le compagnon de la très à droite présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le Parti populaire (PP) – par la bouche de son leader Alberto Nuñez Feijóo – a attaqué très violemment Pedro Sanchez, qui avait appuyé Álvaro García Ortiz. Feijóo et Miguel Tellado, secrétaire du PP, ont réclamé la démission de Sanchez. (Réd.)
- Pour se faire une idée de l’ampleur de la mobilisation ouvrière, il suffit de prendre note des données fournies par le ministère de l’Intérieur (le ministère de l’Intérieur à l’époque franquiste) qui a reconnu qu’au cours du premier trimestre 1976, 17’455 grèves ont eu lieu dans une situation où le droit de grève n’existait pas.
- Malheureusement, un homme politique nationaliste basque très influent a tenu les mêmes propos en utilisant la terrible formule «un oubli de tous pour tous».
- Le TOP, créé en 1963 (24 ans après la fin de la guerre civile!), spécialisé dans la répression du mouvement ouvrier renaissant et du mouvement étudiant nouvellement apparu dans les années 1960, a jugé et condamné plus de 8000 militants.
- Pour mieux comprendre l’économie franquiste, ses continuités et ses discontinuités, nous recommandons le livre La economía franquista y su evolución («L’économie franquiste et son évolution») d’Enrique González de Andrés (édition 2014, Los libros de la Catarata).
- Une réflexion intéressante à ce sujet se trouve dans l’ouvrage d’Emmanuel Rodríguez López Por qué fracasó la democracia en España («Pourquoi la démocratie a échoué en Espagne») (édition 2015, Traficantes de Sueños).


Soyez le premier à commenter