
Par Pablo Stefanoni
Le 12 octobre 2014 presque six millions de Boliviens, comptabilisés dans le registre biométrique en Bolivie et à l’extérieur, se rendront aux urnes afin d’élire le président, le vice-président ainsi qu’un nouveau Parlement. L’état d’esprit de l’opposition est le résultat d’une série d’enquêtes qui donnent au binôme Evo Morales-Álvaro García Linera (président et vice-président) un avantage virtuellement impossible à surmonter: selon le dernier sondage diffusé par El Deber de Santa Cruz de la Sierra, ce dernier obtient 54% des intentions de vote contre 14% pour Samuel Doria Medina [qui se présente pour UD – Union démocratique, un front; selon le gouvernement d’Evi Morales, la fortune de Samuel Doria Medina a passé de 7 millions de dollars à 85 millions entre 2006 et 2014 – La Razon, 23 septembre 2014].
Cette avance dans les sondages a poussé l’analyste Roger Cortez a affirmé lors d’un débat télévisé qu’il faudrait considérer ces élections comme des «comices» parlementaires: l’élection présidentielle étant «résolue», ce qui est vraiment en jeu est de savoir si le soutien inconditionnel du parti au pouvoir [autrement dit à l’oficialismo] atteindra ou non les deux tiers du Congrès – une majorité sur laquelle il peut actuellement compter [pour des changements constitutionnels, entre autres], objectif qui constitue le centre de la campagne du MAS [Mouvement vers le socialisme, fondé en 1997 et dont la figure est l’actuel président de Bolivie, Evo Morales].
Un autre but s’y ajoute néanmoins: gagner le département jusqu’ici rebelle de Santa Cruz [1] qui, jusqu’en 2009, était le fer de lance de l’opposition la plus combative contre le gouvernement d’Evo Morales. Cet objectif paraît aujourd’hui atteignable et il représenterait un revirement de la géopolitique interne du pays. Afin d’y parvenir, le MAS établit diverses alliances, y compris avec des restants de vieux partis traditionnels ainsi qu’avec le maire «populiste» de Santa Cruz, le polémique Percy Fernández, qui a placé trois candidats de son entourage sur les listes du MAS. Pars sa massive fin de campagne nationale aux pieds du Christ Rédempteur de Santa Cruz, les soutiens au pouvoir en place [oficialismo] cherchent à s’imposer dans le territoire mythique où, en 2008, des dizaines de milliers d’habitant·e·s du département se mobilisèrent en faveur de l’autonomie et contre le gouvernement central. Ainsi que l’explique le sénateur et dirigeant paysan Saúl Ávalos, dans un article du journaliste Pablo Ortiz, il s’agit d’une occupation territoriale: le MAS a commencé à s’implanter dans les périphéries où vivent des migrant·e·s de Santa Cruz de la Sierra [2] – comme c’est le cas dans le quartier emblématique Plan 3000 – et cherche désormais à conquérir le centre même de cette grande ville (El Deber, 30/10).
Néanmoins, cette «conquête» devra être ratifiée dans les urnes; ce n’est pas une tâche facile mais, pour la première fois, les sondages donnent Evo vainqueur dans cette zone agro-industrielle de Bolivie. Afin d’assurer de cette «marée bleue», les couleurs du MAS, le président bolivien a promis de réaliser un nombre important de chantiers, allant de barrages aux chemins de fer et, y compris, l’élargissement de la frontière des zones dévolues à l’agriculture et à l’élevage [les exportations de viande de bœuf de Santa Cruz et du Beni vers l’Europe et la Suisse sont en hausse].

L’équation est claire: afin de battre l’élite politique cruceña [de Santa Cruz], le MAS a dû faire des accords avec une partie du patronat et accepter son «modèle d’accumulation». Pour Pablo Banegas, tête de liste aux élections sénatoriales [2] pour le Parti démocrate-chrétien il est logique que le MAS choisisse El Cristo [3]: ceux qui ont déterminé la composition des rassemblements municipaux autonomistes (contre le gouvernement d’Evo Morales dès son entrée en fonction en 2006) – c’est-à-dire les «banquiers, entrepreneurs, agropecuarios, transporteurs et chaînes de télévisions» – sont aujourd’hui du côté du parti au pouvoir (le MAS).
Les propos du candidat de droite qui appuie la candidature de l’ancien président Jorge Fernando «Tuto» Quiroga Ramirez [4], dans l’article de El Deber mentionné ci-dessus, ne manquent pas d’exprimer un certain ressentiment et de la déception. Un entrepreneur résume ainsi ce revirement sur l’échiquier politique: «Auparavant les patrons ne voulaient pas qu’Evo mette les pieds à Santa Cruz, alors que maintenant ils se bousculent pour s’asseoir le plus près possible du président lors d’une quelconque rencontre.» Personne ne veut manquer le boom économique que connaissent le pays et la région.
Le contexte politique bolivien s’est modifié. Si en 2005 l’accusation portée par la droite contre Morales était qu’il transformerait la Bolivie en un nouveau Cuba (ou, dans le meilleur des cas, en un autre Venezuela), aujourd’hui l’analyste de l’opposition Iván Arias peut accuser le MAS de propager une espèce de pragmatisme infini, d’être un «Godzilla [par allusion au monstre du cinéma japonais,créé par T. Tanaka] politique qui n’accorde de poids ni aux principes, ni aux moyens pour atteindre son but» (Página 7, 29 septembre 2014).
Le scénario n’a pas changé uniquement pour ce qui a trait à Santa Cruz. Evo Morales a évidemment lu le rapport du recensement de la population de 2012. Ce recensement a mis en évidence un paradoxe apparent, potentiellement explosif au niveau symbolico-poltique: si en 2001 62% des Boliviens s’auto-identifiaient avec l’un ou l’autre des peuples indigènes, dans le nouvel Etat plurinational, seuls 41% le firent en 2012.
Plusieurs causes peuvent avoir influé sur ces résultats. Parmi celles-ci, un changement de la question qui remplaçait «indigène originel» par «indigène d’origine paysanne» tel que cela figure dans la nouvelle Constitution, précisément au moment où la Bolivie est devenue un pays majoritairement urbain. Non moins important est le fait qu’en 2001 l’identité indigène mettait en question le dit ordre des choses [la domination de l’élite blanche et créole] et qu’aujourd’hui cette identité est officielle [dans la Constitution et par la présidence effective et symbolique d’Evo Morales], sans que la Bolivie urbaine-métisse se sente à l’aise avec cette «indianité d’Etat».
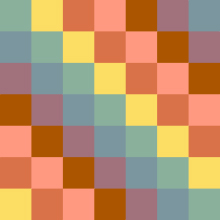
En outre, en Bolivie, la majorité est «un peu» indigène et «un peu» métisse, ce qui fait que les déplacements au sein de la géométrie variable de l’identité ne sont pas rares. Et cela encore plus parmi les populations quechuas, qui sont majoritaires. Ces derniers manquent – ainsi que l’indiquent Pablo Quisbert et Vincent Nicolas dans leur récent ouvrage Pachakuti: El retorno de la nación. Estudio comparativo del imaginario de nación de la Revolución Nacional y del Estado Plurinacional (Fundación PIEB, 2014) – de symboles et de héros ethno-nationaux tels qu’en disposent les Aymaras avec Tupac Katari [5] ou le drapeau multicouleur wiphala (voir ci-contre). Le quechua est plutôt une langue qui unifie diverses «nations» locales.
Evo affirma être surpris par les résultats du recensement, mais ajouta que c’était une question secondaire. Et que, de toute façon, comme lorsque l’on tire les dés, «ce qui apparaît on doit en prendre note». Le vice-président Álvaro García Linera écrivit ensuite un texte intitulé Nation et métissage pour défendre la plurinationalité. Mais Evo, qui sait «prendre note» avec le cacho, un jeu de dés populaire en Bolivie, sait aussi comment faire des ajustements dans ses campagnes électorales grâce à son flair expérimenté de syndicaliste.
Ce n’est pas un hasard que la campagne électorale qui le conduira à l’obtention d’un troisième mandat pour la période de 2015-2019 – jamais auparavant un président bolivien n’était resté aussi longtemps dans le fauteuil présidentiel – a abandonné quelques clichés de l’étape héroïque passée. Sa campagne s’ancre sur la défense de la stabilité et sur le développement économique ainsi que, encore plus, sur le «grand saut technologique». Le dernier spot télévisé du MAS résume, avec une esthétique informatique, les plans visant à créer la Ciudadela del Conocimiento [la citadelle de la connaissance] à Cochabamba qui est comparée, comme le fait Rafael Correa, avec Yachay en Equateur, avec la Silicon Valley aux Etats-Unis (https:/www.youtube.com/watch?v=NNPHapdPJAM).
A cela s’ajoute la promesse de bourses estudiantines pour des universités comme celles de Harvard, Stanford ou Tokyo ainsi que le projet de construction d’hôpitaux de haute technologie dans un pays où les soins sont une question en suspens. Le téléphérique de transport entre La Paz et El Alto est l’un des derniers chantiers étoiles du gouvernement avec le satellite Túpac Katari [sous-traité aux Chinois et lancé en décembre 2013]. Le spot ajoute: «un peuple millénaire muni d’une technologie avancée est invincible». Il n’est pas difficile de voir les sympathies que les grands sauts de pays comme la Corée du Sud récoltent dans cette nation andine où, en outre, les chanteurs de k-pop (Gangnam Style) sont de plus en plus populaires. (Voir sur ce site l’article traitant des rapports entre la Corée du Sud et la Bolivie d’Evo Morales en date du 22 juillet 2013.)
Au-delà de la discussion ponctuelle sur chacun de ces projets, il est certain que la Bolivie connaît une étape nouvelle. La puissance du «gouvernement indigène» – en tant que rénovateur des valeurs traditionnelles – semble avoir donné tout ce qu’un certain indigénisme promettait. Actuellement Evo Morales a capté que les revendications des nouvelles générations ont moins à voir avec les requêtes de type ethnico-national. En partie parce que le pays a progressé vers une plus grande égalité et en partie parce que la Bolivie n’échappe pas à la mondialisation de la consommation, des imaginaires et des aspirations.
Quisbert et Nicolas observent que Túpac Katari conçu par le peintre connu Gastón Ugalde peu avant l’arrivée au pouvoir d’Evo et reproduit par le nouvel Etat n’est déjà plus le martyr dépecé mais un «Katari de palais», avec des airs présidentiels.
En ce sens, le nationalisme indigène – terme que nous utilisions pour définir les horizons de l’«évismo» en 2006 avec Hervé Do Alto [6] – est le centre d’un paradoxe: que l’Etat plurinational soit sans doute le plus nationaliste de l’histoire. Mais plutôt qu’une trahison d’une révolution indianiste idéale, nous faisons face à de profonds changements sociétaux qui redessinent la Bolivie. Sans que nous sachions encore quelle sera l’esquisse finale. Peut-être s’agira-t-il d’un portait post-indianiste, un portrait qui saisit les plis pris par les nouvelles identités émergentes. (Traduction A l’Encontre, article publié sur le site http://www.nodal.am/).
_____
 [1] La Bolivie est un Etat unitaire et décentralisé, selon l’article 1er de la Constitution. Sa division territoriale épouse: des départements, des provinces, des municipalités, et des territoires indigènes paysans. Il y a 9 départements (voir la carte ci-contre); le département est la plus grande subdivision du pays. La nouvelle Constitution de 2010 accorde des larges pouvoirs autonomes à ces entités, à l’exclusion du pouvoir judiciaire. Le département de Santa Cruz, situé en contrebas des Andes, est le plus vaste en superficie et en ressources ainsi qu’un espace (avec Le Beni) d’une concentration de propriétaires terriens comme de secteurs «d’entrepreneurs» très liés au «commerce de contrebande» avec le Paraguay (paradis de ce type «d’échanges» de toutes sortes) et le Brésil. De plus, il y a une tradition dans le département Santa Cruz – dont l’aéroport de la capitale est luxueux, depuis les années 1980, au point d’être quasi drogué au plan architectural – de jouer la carte du séparatisme face à La Paz. La capitale de la province, Santa Cruz de la Sierra, est un centre «financier» et économique de la Bolivie, en grande partie lié à des ressources tels que les gisements de fer – riche en manganèse pour un acier de qualité, résistant – de Mutun, avec le développement d’un centre de sidérurgie qui devrait exporter de l’acier au Brésil, une cimenterie, etc. Le capitalisme brésilien est très présent économiquement dans la région. Le gaz des Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) participe à ce développement industriel régional et a de grandes capacités. Dès lors la capitale et son agglomération sont en croissance importante: plus de 2 millions d’habitant·e·s. (Réd. A l’Encontre)
[1] La Bolivie est un Etat unitaire et décentralisé, selon l’article 1er de la Constitution. Sa division territoriale épouse: des départements, des provinces, des municipalités, et des territoires indigènes paysans. Il y a 9 départements (voir la carte ci-contre); le département est la plus grande subdivision du pays. La nouvelle Constitution de 2010 accorde des larges pouvoirs autonomes à ces entités, à l’exclusion du pouvoir judiciaire. Le département de Santa Cruz, situé en contrebas des Andes, est le plus vaste en superficie et en ressources ainsi qu’un espace (avec Le Beni) d’une concentration de propriétaires terriens comme de secteurs «d’entrepreneurs» très liés au «commerce de contrebande» avec le Paraguay (paradis de ce type «d’échanges» de toutes sortes) et le Brésil. De plus, il y a une tradition dans le département Santa Cruz – dont l’aéroport de la capitale est luxueux, depuis les années 1980, au point d’être quasi drogué au plan architectural – de jouer la carte du séparatisme face à La Paz. La capitale de la province, Santa Cruz de la Sierra, est un centre «financier» et économique de la Bolivie, en grande partie lié à des ressources tels que les gisements de fer – riche en manganèse pour un acier de qualité, résistant – de Mutun, avec le développement d’un centre de sidérurgie qui devrait exporter de l’acier au Brésil, une cimenterie, etc. Le capitalisme brésilien est très présent économiquement dans la région. Le gaz des Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) participe à ce développement industriel régional et a de grandes capacités. Dès lors la capitale et son agglomération sont en croissance importante: plus de 2 millions d’habitant·e·s. (Réd. A l’Encontre)
[2] Un système bicaméral existe en Bolivie (dans l’Assemblée législative plurinationale) avec un sénat de 36 membres élus pour 5 ans, 4 par département, âge requis 30 ans; la chambre des député·e·s est composée de 130 membres dont 68 sont élus directement pour représenter les districts électoraux et 62 sur des listes de partis, selon un système proportionnel, l’âge requis pour être élu: 18 ans. (Réd. A l’Encontre)
 [3] El Cristo, allusion à Banegas et au fait que ce dernier comme sénateur a fait adopter la statue du Christ rédempteurs, les bras ouverts, comme un «patrimoine culturel matériel de l’Etat plurinational de Bolivie». Cochabamba a aussi un Cristo, etc. La photo ci-contre donne l’idée de ce qui est qualifié de patrimoine culturel. (Réd. A l’Encontre)
[3] El Cristo, allusion à Banegas et au fait que ce dernier comme sénateur a fait adopter la statue du Christ rédempteurs, les bras ouverts, comme un «patrimoine culturel matériel de l’Etat plurinational de Bolivie». Cochabamba a aussi un Cristo, etc. La photo ci-contre donne l’idée de ce qui est qualifié de patrimoine culturel. (Réd. A l’Encontre)
[4] Jorge Fernando «Tuto» Quiroga Ramirez figure aujourd’hui sur les listes du Parti démocrate-chrétien. Quiroga Ramirez a présidé la Bolivie durant un an, d’août 2001 à août 2002. En effet, il était vice-président depuis 1998 du gouvernement Banzer; ce dernier décède le 7 août 2001.
Hugo Banzer Suarez fait partie des dictateurs qui ont eu le pouvoir en Bolivie dans les années 1970. Ce dernier prend le pouvoir en tant que «président de facto» en 1971. Il le restera comme dictateur jusqu’en juillet 1978. Il a interdit les partis politiques, a organisé une répression brutale contre la gauche et le mouvement syndical. Il est un des acteurs de «l’opération Condor» qui, durant ces années, va conduire un projet planifié, avec l’aide des Etats-Unis, contre tous les opposants, au Chili, en Argentine, au Brésil, au Paraguay et en Uruguay. Le retour électoral d’un Banzer recyclé, en 1997, a surpris plus d’un observateur, inattentif. (Réd. A l’Encontre)

[5] Tupac Katari (1750-1781). Ce chef de la révolte des indigènes avait épousé Bartolina Sisa et pris comme nom celui de deux dirigeants rebelles historiques: Tomas Katari et Tupac Amaru (Katari signifie grand serpent en aymara et Amaru la même chose en quechua). Il installa sa cour à El Alto (au-dessus de La Paz, comme la ville en partie auto-construite d’aujourd’hui) et avec l’armée qu’il avait levée, il assiégea et encercla La Paz en 1781. Cette lutte contre les colons et militaires espagnols est restée et a été cultivée dans la mémoire des Indiens de Bolivie, y compris avec des médiations au sein de secteurs des mineurs, des syndicats paysans et, avec force, dans le mouvement indigéniste. Sa mort en 1781 s’insère dans la défaite infligée par les troupes coloniales qui disposaient d’armes à feu.
Aujourd’hui, la modernité impérialiste actuelle a d’autres traits. Le recul des installations de téléphériques en Europe, lié aux conditions dégradées d’enneigement et à la fin d’une spéculation dans les stations d’hiver, a stimulé la recherche de nouveaux débouchés: des téléphériques qui sont installés par exemple entre El Alto et La Paz ou dans un ensemble de 12 favelas – quasi touristiques pour certaines – de Rio de Janeiro. Dilma Rousseff a inauguré cette œuvre de 280 millions d’euros en juillet 2011. (Réd. A l’Encontre)
[6] Nous serons des millions: Evo Morales et la gauche au pouvoir en Bolivie, Ed. Raisons d’agir, 2008, en français. (Réd. A l’Encontre)


Soyez le premier à commenter