Avec le départ de Jeremy Corbyn à la tête du parti travailliste britannique, commencent les nécrologies. Pour les experts libéraux et les conservateurs bien pensants – omniprésents dans les médias britanniques – une défaite électorale historique était nécessaire pour venir à bout du corbynisme. De tels récits oublient généralement les élections générales de 2017, lorsque, sous la direction de Corbyn, les travaillistes ont failli renverser les conservateurs sur un manifeste ambitieux à la gauche du centre travailliste.
Mais ayant perdu quatre élections générales en une décennie, sous la direction de ses ailes droite, du centre et de gauche, il est clair que des facteurs plus fondamentaux sous-tendent la crise actuelle du Parti travailliste.
Searching for Socialism: The Project of the Labour New Left from Benn to Corbyn (Verso Books, 2020), une nouvelle étude de la Labour’s New Left de Leo Panitch et Colin Leys, fournit avec bonheur le contexte historique qui manque si souvent au débat. Faisant suite à leur volume précédent, The End of Parliamentary Socialism (Verso Books 2001) leur nouveau livre condense et reprend la thèse de ce dernier, tout en faisant le bilan de l’ère turbulente de Corbyn et de la lourde défaite de Labour aux élections générales de décembre 2019.
Panitch et Leys explorent la relation conflictuelle qu’entretenait la Nouvelle gauche du Labour avec la social-démocratie. Ils s’efforcent de défendre les acquis d’un courant qu’ils ambitionnent également de dépasser. Ils retracent son histoire, de ses origines dans la seconde moitié des années 1960 à ses efforts des années 1970 et 1980 afin de transformer fondamentalement le Labour, ainsi que les innombrables controverses qui ont surgi lors de ces luttes.
Ils concluent en notant qu’avec le corbynisme la nouvelle gauche travailliste gagnait pour la première fois la direction du parti; et que la vieille garde du Labour lui a opposé une contre-offensive destructrice, préférant la politique de la terre brûlée.
Du consensus au conflit
La nouvelle gauche du Labour a commencé à prendre forme sous la direction de Harold Wilson. Après avoir mené le parti travailliste au gouvernement, en 1964, Wilson a d’abord suscité un enthousiasme considérable parmi les socialistes britanniques. Son passé apparemment radical plaidait pour lui. Ancien confrère d’Aneurin Bevan (1897-juillet 1960), Wilson avait suivi son mentor en démissionnant du gouvernement de Clement Attlee en 1951, pour protester contre l’introduction de frais [pour les soins dentaires, entre autres] pour certains services du National Health Service (le Service national de santé, prestigieuse conquête du combat de la classe ouvrière).
Wilson était également doté d’un remarquable «talent pour le double langage», que relèvent Panitch et Leys. Arrivé au pouvoir il a promis de «chauffer à blanc» une «révolution technologique», qui secouerait la structure de classe ossifiée de la Grande-Bretagne et propulserait une nouvelle ère de changement. Mais Wilson eut le malheur de gouverner lors des premiers signes de faiblesse du long boom capitaliste d’après-guerre. Une génération de syndicalistes avait grandi avec l’«affluent society», avec la prospérité d’une société ouverte à de nombreux acquis, et beaucoup ont réalisé que la réalité qu’ils vivaient ne correspondait pas aux images dont les bombardaient la télévision et la publicité.
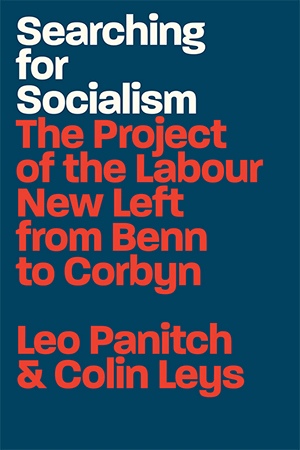 Dans le même temps, un nouveau ferment intellectuel se levait dans les universités avec les mouvements anti-impérialistes, féministes et antiracistes qui défiaient les limites du consensus social-démocrate. Réunir les deux pans de cette Nouvelle Gauche s’avérerait laborieux, même s’ils partageaient un semblable dédain pour les partis traditionnels de la social-démocratie.
Dans le même temps, un nouveau ferment intellectuel se levait dans les universités avec les mouvements anti-impérialistes, féministes et antiracistes qui défiaient les limites du consensus social-démocrate. Réunir les deux pans de cette Nouvelle Gauche s’avérerait laborieux, même s’ils partageaient un semblable dédain pour les partis traditionnels de la social-démocratie.
Malgré cette tension, nombre de militants de la Nouvelle Gauche rejoignirent le Parti travailliste après la chute du gouvernement de Wilson en 1970. L’expérience avait révélé à ces militants les limites de leurs activités éclatées et souvent cantonnées au niveau local. Ils se sont tournés vers le Labour dans l’espoir d’étendre et d’intensifier leurs campagnes.
Leur objectif était de faire du Labour un pôle d’attraction pour les mouvements sociaux, un levier de conscientisation socialiste et une machine électorale. Au cours de la décennie suivante, ces choix eurent des conséquences profondes pour la vie du parti, aussi bien aux niveaux national que municipal.
«Cette option n’existe plus»
Tony Benn (1925-2014) a fourni à la nouvelle gauche travailliste en plein essor le leadership qui lui manquait. Au milieu des années 1970, elle s’est révélée comme une force avec laquelle il fallait compter, au sein du parti comme au sein des syndicats. Alors qu’il semblait être un technocrate moderniste et centriste en phase avec le Zeitgeist de Wilson, la frustration éprouvée à l’occasion de sa participation au gouvernement avait radicalisé Benn. Et mieux que la plupart, il voyait la menace d’une nouvelle droite. Pour préserver les conquêtes de la social-démocratie pendant l’après-guerre, il fallait la dépasser!
Panitch et Leys démasquent sans peine les stéréotypes qui reprochent aux Bennites d’avoir ignoré la montée inexorable de la mondialisation. En fait, c’est au contraire leur compréhension de la menace que constituerait pour le pacte social d’après-guerre un régime basé sur des mouvements de capitaux plus rapides qu’ils pensaient nécessaire de subordonner les mouvements de capitaux aux besoins populaires. Le Manifesto de 1974 du Labour et le célèbre appel de Tony Benn pour «un rééquilibrage fondamental et irréversible des richesses et du pouvoir en faveur des travailleurs et de leurs familles», portaient la marque indiscutable de la Nouvelle Gauche.
La gauche Bennite avait imposé au Parti travailliste, qui retournait au gouvernement en 1974, un programme de gauche auquel sa direction ne croyait absolument pas. Occupant désormais le poste de secrétaire à l’industrie, Benn, pour sa part, a cherché à développer de nouveaux modèles expérimentaux de propriété des travailleurs et de démocratie économique. Il s’est trouvé devoir affronter tout à la fois l’opposition de la direction travailliste qui ne partageait pas ses objectifs, de la presse grand public, et de ses propres fonctionnaires. Après le référendum de 1975 sur l’adhésion au Marché commun européen, au cours duquel Benn avait fait campagne sans succès pour le retrait de la Grande-Bretagne, Harold Wilson en a profité pour démettre ce ministre gênant.
Après que Wilson eut démissionné de son poste de Premier ministre en 1976, son successeur, James Callaghan, est monté à la tribune du congrès du Parti travailliste pour annoncer l’abandon définitif du keynésianisme, dans un discours que seul Milton Friedman accueillit chaleureusement. «Avant, nous pensions possible de sortir de récession et d’augmenter l’emploi en réduisant les impôts et en augmentant les dépenses publiques», a déclaré Callaghan aux délégués et aux médias. «Je vous le dis en toute franchise, cette option n’existe plus.»
La lutte pour la démocratie dans le parti
Les Bennites se sont alors orientés vers la démocratisation du Parti travailliste afin qu’à l’avenir ses dirigeants ne puissent plus ignorer l’opinion de la base de façon aussi désinvolte. Les réformes qu’ils projetaient comportaient l’obligation pour les députés travaillistes sortants d’obtenir un nouveau mandat de leur section avant chaque élection générale et le droit de tous les membres du parti et du syndicat de prendre part aux élections de la direction du Parti travailliste.
Aux yeux des Bennites, démocratiser le Parti travailliste était un préalable indispensable à la démocratisation à venir de l’État britannique. Une évolution politique favorable dans les syndicats a grandement aidé leur campagne: à cette époque, de nombreux syndicats se déplaçaient vers la gauche, desserrant la main de fer avec laquelle la direction du parti avait jusqu’alors exercé son contrôle sur les congrès du parti.
L’intérêt de Tony Benn pour la démocratie de parti n’était ni un moyen opportuniste de stimuler sa candidature à la direction, ni un fétiche. Pour lui, la démocratie était nécessaire pour construire «un soutien populaire de masse et un engagement vers un changement social radical». Benn se voyait avant tout en tribun et en enseignant, ouvrant l’horizon aux exploité·e·s et aux opprimé·e·s. Selon les mots même de Benn, le gouvernement d’un Labour socialiste «serait le libérateur qui ferait tomber les portes des cellules où vivent les gens».
Il voyait bien que ni le Parti travailliste ni les syndicats ne proposaient un programme sérieux d’éducation politique, se limitant plutôt à réformer le capitalisme. Au cours des années 1970 et à mesure que la crise s’aggravait, cette perspective perdait toute validité et l’impossibilité de continuer à la maintenir s’imposait de plus en plus clairement.
Contrecoup
Cette campagne pour la démocratie dans le parti s’est heurtée au rejet brutal de la plupart des dirigeants du Labour. En conséquence, la Nouvelle Gauche Bennite a été contrainte de dépenser une énergie considérable pour surmonter les résistances qu’elle rencontrait dans le parti. Panitch et Leys en rendent bien compte, obnubilée par cette lutte interne au parti, il ne lui restait que peu d’énergie à cette Nouvelle Gauche pour déployer sa propre politique.
À titre de comparaison, la prise de contrôle du Parti conservateur par les Thatchériens n’a rencontré qu’une opposition timide. Alors que les Bennites étaient enlisés dans une guerre intestine, les Thatchériens ont rapidement été en mesure de transmettre leur doctrine au grand public.
Certains députés travaillistes ont aggravé ce problème en colportant des sarcasmes contre les supposés sectarisme et intolérance de la gauche dure à des médias avides de ce genre de propos. Les tentatives de sections locales pour remplacer les députés de la droite travailliste ont vu ces derniers rapidement élevés au rang de martyrs dans les médias.
Bien que les Bennites aient réussi à étendre le droit de vote à l’élection de la direction du Parti travailliste et à obtenir des députés sortants qu’ils sollicitent un nouveau mandat auprès de leurs sections, ces mesures ont divisé le parti. Vingt-huit députés travaillistes ont levé le camp et rejoint le «Social Democratic Party» (Parti social-démocrate dissident) après sa formation en 1981.
Cette fissure dans le vote anti-conservateur s’est avérée dévastatrice, et le gouvernement Thatcher – après avoir traversé une période difficile, y compris une forte récession – était bien placé pour en profiter.
Défaite et repli
Cependant, avant l’introduction du nouveau système d’élection des dirigeants, les députés du Labour intronisèrent Michael Foot avec les anciennes règles. Foot était un autre complice de Bevan, auquel il avait consacré une poignante biographie en deux volumes. Mais Foot, après avoir été l’un des piliers des gouvernements impopulaires Wilson-Callaghan de 1974-1979 n’avait plus rien du héros radical de la Nouvelle gauche.
Bien qu’ayant poursuivi certains axes d’une politique de gauche comme leader travailliste, par exemple le désarmement nucléaire unilatéral, Foot a surtout cherché à jouer un rôle d’unificateur, s’efforçant d’assurer son leadership par une incohérence maladroite, d’apaiser toutes les parties et de n’en satisfaire aucune. Le premier bénéficiaire du système électoral-collégial pour l’élection des dirigeants travaillistes a été Neil Kinnock, qui a considérablement accéléré la contre-révolution contre la nouvelle gauche de Bennite.
Élu leader après la défaite colossale de Labour aux élections générales de 1983, Kinnock a été confronté à une gauche divisée et démoralisée qui ne savait pas comment se comporter à son égard. Protégé de Foot, Kinnock protégeait ses flancs sur sa gauche. Les syndicats, qui souffraient gravement des attaques thatchériennes, avaient abandonné les Bennites. La seule priorité du Labour était d’en finir avec le thatchérisme, sans aucune idée claire s’agissant de comment le remplacer.
La Labour New Left s’est scindée en deux: certains se sont regroupés autour de Marxism Today, organe de l’aile eurocommuniste du Parti communiste britannique, tandis que d’autres ont formé le Socialist Campaign Group, la fraction parlementaire du noyau des Bennite. Alors que Marxism Today s’orientait vers un nouveau «radicalisme du centre» et (dans certains cas, par inadvertance) jeta les bases du New Labour, le Socialist Campaign Group se replia sur une position ouvriériste, dépourvue d’une grande partie de son ancienne créativité, et se barricada pour les temps difficiles à venir.
Du New Labour à la New Left
Les Bennites presque vaincus, l’émergence du New Labour sembla réconcilier le parti avec le capitalisme néolibéral. L’adhésion passionnée de Tony Blair à l’allégement de la réglementation financière, aux privatisations et aux guerres d’agression impérialistes a fait de lui une figure détestée auprès de ce qui restait de la gauche travailliste.
Cependant, ce courant de gauche était mal armé pour résister aux éclats verbaux de Blair contre leurs vielles formules si souvent brandies, et tout particulièrement contre cette «clause IV» en faveur de la propriété publique des moyens de production que Sidney Webb [1] avait poussé le parti à adopter en 1918. Rares étaient ceux qui, au milieu des années 1990, pensaient sérieusement que le Parti travailliste inverserait les privatisations des années Thatcher, et encore moins qu’il s’engagerait dans une voie plus radicale encore.
Sous la direction de Blair le Labour s’est imposé avec trois victoires électorales. Lorsque le système financier mondial s’est effondré en 2008, le rideau est tombé pour le New Labour. Deux ans plus tard, Gordon Brown (juin 2007-mai 2010) a conduit le parti à une défaite sévère. La crise financière et l’austérité qui ont suivi sous David Cameron ont largement effacé les gains modestes de treize ans de réforme sociale sous Blair et Brown, comme le soulignent Panitch et Leys. Et finalement, la sourde rébellion contre la longue dérive droitière du Labour a commencé à se formaliser, dans les syndicats d’abord, puis dans le parti lui-même.
En promettant de rompre avec le New Labour, Ed Miliband a pris la tête du Labour en 2010, mais il devait son élection aux votes des syndicalistes, et non à ceux des membres du parti. Son frère David Miliband, un Blairite pur sucre, avait réuni 44% des voix des travaillistes, contre un peu moins de 30% pour Ed. Les sections locales, si longtemps des bastions de la gauche, avaient été vidées de leur substance.
Faute de bénéficier d’un soutien organisé au sein de la fraction parlementaire ou dans les circonscriptions du parti, Miliband a été acculé à accepter la triste plate-forme dite «d’austérité allégée» par laquelle la coalition gouvernementale Conservateurs/Libéral démocrate démantelait l’État-providence britannique. Une nouvelle défaite des travaillistes en a résulté en 2015, comportant notamment un effondrement presque total en Écosse – un canari dans la mine pour le proche avenir du parti [2].
Corbyn
La démission de Ed Miliband [en mai 2015] a été immédiate et cet été-là les élections à la direction du Parti travailliste ont commencé sous de sombres auspices. A la droite et au centre, des candidats rivalisaient contre le radicalisme prétendument excessif de Miliband. Alors que la droite travailliste se flagellait à propos des dépenses publiques du New Labour, il incomba aux forces épuisées de la gauche Bennite de défendre les aspects les plus progressistes du régime Blairite.
Les militant·e·s de la base faisaient pression pour une alternative. Le résultat fut la candidature inattendue de Jeremy Corbyn, partisan et proche de Tony Benn. Il rejoignit la consultation à la dernière minute et fut élu au premier tour avec près de 60 pour cent des voix et un nouveau mode de scrutin qui attribuait une voix à chaque membre.
Corbyn était grandement respecté comme un remarquable animateur de campagnes. Usant de son mandat parlementaire, il défendait de nombreuses causes, souvent considérées comme marginales. Il s’était investi après 2010 dans le «anti-cuts movement» [3]. Dans ce contexte, il a amené avec lui des centaines de milliers de nouvelles recrues, dont beaucoup s’étaient formées au cours de ce mouvement.
Cependant, en septembre 2015, après avoir pris la présidence du Labour, Corbyn s’est retrouvé isolé. Le groupe ayant mené la campagne s’était étiolé et ne rassemblait plus qu’à peine une douzaine de députés, contraignant le nouveau dirigeant à réunir un cabinet fantôme dont le centre de gravité politique se situait sur sa droite.
Ce cabinet fantôme est tombé en morceaux avec la démission organisée de la plupart de ses membres suite au référendum sur l’Europe (Brexit) de 2016, situation qui nécessitait la réélection de la direction du parti. Corbyn était réélu avec une majorité plus forte encore à la présidence du Labour, mais ses adversaires n’ont jamais reconnu sa légitimité. Le première ministre conservatrice Theresa May a provoqué les élections générales de 2017 afin de capitaliser à son profit le malaise du parti travailliste.
Des dizaines de députés de Corbyn le méprisaient ouvertement, dissimulant à peine leur volonté de précipiter les élections pour le contraindre à la démission. Les cadres dirigeants du Parti travailliste se sont lancés eux aussi dans cette campagne de démolition sans précédent, dont les détails commencent à être révélés. Un tel travail de sape malveillant n’est pas étranger à ce qu’ont connu les partisans de Bernie Sanders dans le cadre des primaires démocrates.
Malgré cela, le Parti travailliste a privé les conservateurs de leur majorité parlementaire – la structure militante du nom de Momentum formée pour soutenir la présidence de Corbyn en 2015 – a joué un rôle déterminant pour établir ce rapport de forces.
Le bourbier
Cependant, l’élection de 2017 a eu des conséquences contradictoires. Comme Panitch et Leys le détaillent, une campagne populaire passionnante a ravivé le parti travailliste, mais le parti s’est ensuite recentré sur Westminster, sur la politique parlementaire – précisément là où Corbyn était le plus faible – alors que la perspective du Brexit atteignait son point critique. La «répudiation de masse» du néolibéralisme que Corbyn avait menée en 2017 s’est dissipée, avec un parti dont les manœuvres parlementaires reprenaient le dessus.
Les projets de réforme du parti sont elles aussi mortes à ce moment: avec la perspective apparemment imminente d’un gouvernement travailliste dirigé par des socialistes, Corbyn a donné la priorité à la cohésion parlementaire du Labour plutôt qu’à sa démocratisation. Ses concessions ne lui ont valu aucune marque de bonne volonté de la part de la droite travailliste.
Pendant ce temps, la question du Brexit a déchiré la base fragile de Corbyn. La gauche travailliste ne pouvait ni plaider de manière convaincante pour un Brexit de gauche – il était évident, comme l’a reconnu Corbyn, que la droite nationaliste était en tête – ni présenter aucune stratégie crédible pour démocratiser de l’intérieur les institutions européennes. Les partisans de Corbyn au sein du parti étaient très divisés sur la question et s’opposaient avec acrimonie.
Tardivement, Corbyn a fini par appeler à un deuxième référendum sur le Brexit, une position qui a non seulement échoué à enflammer la plupart de ses partisans, mais lui a également aliéné nombre d’électeurs dans les circonscriptions de la «rust belt», dans les circonscriptions de la «ceinture de la rouille» tenues par les travaillistes qui, elles, avaient voté pour quitter l’Europe en 2016.
Une grande partie de la droite travailliste, sentant une opportunité, s’était accrochée à la cause anti-Brexit en vue de maximiser l’embarras de Corbyn et de scinder sa base. Cet objectif, ils sont parvenus à l’atteindre, même si certains d’entre eux l’ont payé en échouant lors de leur élection décembre 2019: cinquante-deux des soixante sièges que le Parti travailliste a perdus se situaient dans des circonscriptions qui avaient soutenu le Brexit trois ans et demi plus tôt. Et dans ce processus, ils ont aidé à mettre en tête des conservateurs et à la tête du gouvernement un partisan dur du Brexit: Boris Johnson. Cela juste avant que ne surgisse la pandémie Covid-19.
La tentative de Corbyn de renouveler et de réinventer la social-démocratie d’une nouvelle ère a été défaite avec succès par ses opposants au sein du parti, ceux-là mêmes qui ont fait tant de foin pour s’attribuer à eux-mêmes un label social-démocrate, sans faire le moindre effort pour expliquer leurs intentions.
Prisonniers de la Grande Eglise
Leo Panitch a observé dans une autre contribution (entretien dans New Politics, hiver 2013) que la responsabilité de maintenir l’unité du Parti travailliste pèse le plus lourdement sur son aile gauche: c’est toujours elle qui est le plus facilement accusée d’être coupable. L’appel à l’unité de Keir Starmer (dirigeant du Labour depuis le 4 avril 2020) a eu un écho auprès des membres fatigués d’un parti marqué par un sentiment de culpabilité suite à sa défaite de décembre. Keit Starmer gagna dès lors de nombreux anciens partisans de Corbyn.
Starmer a laissé entendre qu’il maintiendrait la ligne du parti plus à gauche de ce qu’elle était avant que Jeremy Corbyn n’en assume la direction. S’il est sérieux, il devra affronter l’opposition de la droite travailliste dans des conditions que ni Miliband ni Corbyn ne sont parvenus à réunir, ce qui semble très peu probable.
Pour comprendre l’amertume des rivalités internes au Labour sous Corbyn, nous devons apprécier la nature profonde des divisions au sein du parti. Le Labour a toujours été une coalition de fractions aux perspectives divergentes, à la limite de l’incohérence. Le simple fait de maintenir le parti comme force électorale sérieuse et possible parti de gouvernement nécessite un flou idéologique certain.
Il en résulte, comme Raymond Williams l’a relevé : «l’évidente pauvreté théorique» des travaillistes, pour qui «toute tentative d’aller au-delà de définitions générales soumet aussitôt leur alliance compliquée sous de fortes tensions» (in New Left Review, mars-avril 1965) L’improbable montée de Corbyn à la tête du parti a immédiatement conduit ces tensions latentes à point d’ébullition.
Au Parti travailliste, des projets politiques antagonistes l’un à l’autre – principalement ceux du socialisme réformiste et du libéralisme centriste – sont intimement liés à la conduite de ce lourd véhicule politique. L’antipathie mutuelle que se vouent ces camps conflictuels montre que leur lien n’a rien à voir avec un mutuel engagement en faveur du pluralisme.
En réalité, la vieille mythologie de la «Grande église du Labour» renvoie à la seule nécessité de s’adapter à un système électoral majoritaire uninominal qui punit sévèrement les divisions, ce qu’illustre l’exemple de Change UK, scission centriste du Labour de février 2019, qui avait complètement disparu à la fin de l’année.
Résister au reflux
Où en est Momentum? Ses effectifs ont atteint plus de quarante mille membres et l’organisation s’est rapidement imposée comme une machine de campagne très efficace, mobilisant par milliers les militant·e·s travaillistes lors des élections générales de 2017 et 2019.
Ses pratiques étaient rodées: en 2016 le défi de Corbyn à la direction du parti, qui a vu se dérouler d’importants rassemblements pro-Corbyn dans les villes de Grande-Bretagne, s’est avéré être une répétition générale utile pour la campagne des élections générales de l’année suivante. Sa présence sur les réseaux sociaux, du moins au cœur de la campagne, a été pleine d’esprit, forte et provocante.
Mais malgré ses intentions initiales, le succès de Momentum a été nettement moindre lorsqu’il s’est agi de réorienter le Labour vers les mouvements sociaux, ou d’assurer une éducation politique socialiste. L’organisation a été submergée par ses responsabilités, forcée de servir simultanément d’instrument de campagne électorale, d’organe de propagande, de force d’organisation des factions et de garde prétorienne pour un chef de parti en difficulté.
Ses progrès dans la réforme du parti ont donc été très limités et les structures du Labour n’ont pour ainsi dire pas changé depuis 2015. Il sera assez facile pour Keir Starmer de défaire les modestes réformes entreprises sous Corbyn; de toute évidence se profile un pénible reflux après quatre ans et demi d’une âpre guerre civile.
Le corbynisme après Corbyn?
Jeremy Corbyn quitte la scène politique pour finir sa carrière sur les bancs de Westminster, sous les huées ricanantes de ses nombreux adversaires. Il n’a été réélu que pour survivre à l’extraordinaire campagne de diffamation dirigée contre lui.
Les partisans de Corbyn étaient aussi diabolisés. En fait, le vitriol que jetaient la presse et les médias sociaux de droite était si violent qu’en décembre dernier deux scrutateurs âgés du Parti travailliste ont dû abandonner la campagne électorale avec des os cassés. Les médias britanniques, normalement si scrupuleux sur le respect des normes de civilité en politique, se sont peu intéressés à ces attaques.
Sans aucun doute, Corbyn a commis des erreurs en tant que leader travailliste, et certaines erreurs graves. Pourtant, il a également suscité un enthousiasme sincère, un regain d’intérêt pour le socialisme après des décennies de marginalisation, Il a inspiré un mouvement de plusieurs centaines de milliers de personnes: des réalisations qu’aucun de ses détracteurs n’est susceptible d’égaler à jamais.
Même si ce mouvement est aujourd’hui découragé et très désorienté, les colères qui l’ont alimenté – les criantes inégalités de richesse et de pouvoir, l’aliénation sociale, les injustices d’une décennie de coupes dans les services publics et la menace imminente de la dégradation du climat demeurent. L’histoire qu’ont écrite Panitch et Leys nous rappelle de façon précieuse et opportune que, malgré toutes les défaites subies au fil des ans, la New Left du Labour a été obstinément résiliente.
Il convient de noter le changement d’orientation de Panitch et Leys sur les perspectives d’une avancée socialiste à l’intérieur du Labour. Les deux auteurs avaient précédemment conclu The End of Parliamentary Socialism convaincus que l’échec du Bennisme et le New Labour avaient réglé la question de savoir si le Labour pourrait jamais encore porter une politique socialiste: leur réponse était «non». Dans Searching for Socialism, en revanche, ils estiment peu probable qu’une gauche travailliste rétablie «ouvre une voie autre que la poursuite de la lutte au sein du Parti travailliste».
L’échec des nouveaux partis de gauche européens de réaliser la percée qu’ils espéraient est lourd de conséquences: l’éclipse de Syriza après ses débuts prometteurs fut bouleversante. D’autres partis de gauche, comme Podemos, ont, selon Panitch et Leys, au mieux «servi de partenaires mineurs dans des coalitions avec les principaux partis sociaux-démocrates». Et ces formations pesaient probablement plus que tout éventuel équivalent britannique ne pourrait l’espérer aussi longtemps que le scrutin uninominal majoritaire à un tour reste en place.
Les auteurs considèrent toutefois 2019 comme une ligne de partage des eaux: l’indication que la génération gauchiste travailliste mûrie dans les années 1970 n’est plus à même de poursuivre son projet. C’est désormais à la génération attirée dans le Labour par l’insurrection corbynite de trouver sa propre voie, de «découvrir et développer de nouvelles formes politiques» au long de son chemin.
Cela prendra du temps, mais les forces dispersées du corbynisme vont se retrouver, se reconstruire et reprendront leur lutte. Il reste un monde à gagner, même si nous manquons de temps pour l’accomplir. (Article publié sur le site de Jacobin en date du 24 avril 2020; traduction rédaction A l’Encontre)
____
[1] Ancien membre de la « Fabian Society», l’économiste Sidney Webb (1859-1947) rédigea en 1917 la clause IV originale, Cet article IV de la constitution du Parti travailliste, adopté en 1918, appelait à une propriété collective de l’industrie. Elle fut par la suite combattue. Après la défaite du Labour aux élections générales de 1959, Hugh Gaitskell, déjà, tenta de la supprimer. Sidney et Beatrice Web furent des supporters zélés de Joseph Staline. (Réd.)
[2] Les mineurs de charbon descendaient dans la mine avec un canari. Quand l’oiseau ne chantait plus, un coup de grisou était à craindre et la mine était évacuée précipitamment. (Réd.)
[3] L’Anti-cuts movement organisa dès 2010 des mobilisations massives (entre autres en 2011) s’opposant aux coupes dans les dépenses publiques. (Réd.)


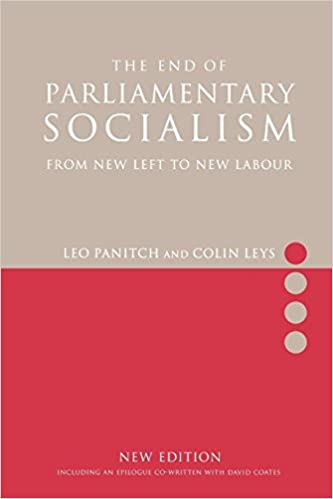

Soyez le premier à commenter