La question des classes sociales est à nouveau un peu passée de mode. Des sociologues continuent à étudier les différents groupes sociaux et l’extrême-gauche à se référer à la lutte des classes mais, au moins en France, domine largement sur le plan médiatique le thème de l’opposition entre métropoles assimilées à la bourgeoisie, traditionnelle et nouvelle, et zones périurbaines et rurales où seraient reléguées les classes populaires [1]. La pertinence du rassemblement des exploité·e·s et opprimé·e·s comme fondement d’un projet émancipateur est relativisée par les tenants d’un projet transversal de «construction d’un peuple» à l’instar de Chantal Mouffe qui, après Ernesto Laclau, se veut l’inspiratrice d’un «populisme de gauche» [2].
Pour une fraction de la gauche radicale, la classe dominante se réduit aux «1%» auxquels s’opposeraient quasi indistinctement les 99%; vision justement dénoncée par Serge Halimi dans «Le leurre des 1%» [3]. Quant à l’analyse des classes en Europe, s’il existe divers travaux universitaires, la gauche radicale en France s’est polarisée sur l’existence ou non d’une bourgeoisie européenne fusionnant tout ou partie des bourgeoisies nationales, tout en affirmant, de façon juste (mais parfois un peu abstraitement), la solidarité des exploité·e·s de tout le continent face aux dénonciateurs du «plombier polonais».
Dès l’introduction de leur ouvrage – Les classes sociales en Europe-Tableau des nouvelles inégalités sur le vieux continent (Agone, 2018) – Cédric Hugrée, Etienne Pénissat et Alexis Spire (ci-dessous désignés comme HPS) affirment l’essence de leur projet: réintroduire les classes sociales et les inégalités dans la lecture des clivages qui partagent les populations au sein de l’Union européenne (UE). Certes, les rapports de classe se sont largement construits dans le cadre des Etats mais, dans chacun des participants à l’UE, ces rapports sont désormais remodelés par le cadre européen.
Un travail sociologique fondé sur des enquêtes statistiques
Qu’on ne s’attende pas dans ce livre à des références directes à Marx (les auteurs se situent plutôt dans la postérité de Bourdieu). Il s’agit ici de se livrer à un travail sociologique empirique et non de produire une analyse des classes partant d’hypothèses théoriques et agrémenté de quelques éclairages à partir des travaux partiels. Sont utilisées quatre grandes enquêtes statistiques européennes supervisées par Eurostat (l’office statistique de l’UE) pour trois d’entre elles et une relevant de la Fondation de Dublin qui observe les conditions de travail. Cela permet d’obtenir une masse de données avec des limites inhérentes, soit aux questions des enquêtes, soit aux conditions dans lesquelles ces enquêtes sont menées dans les différents pays. Pour agréger ces données, a été utilisée une nomenclature européenne récente qui distingue trente groupes socio-professionnels que HPS ont agrégés en trois classes sociales en utilisant différentes dimensions des hiérarchies sociales (possession de capitaux, niveau culturel, statuts professionnels, conditions de travail).
Ils distinguent donc les classes populaires, les classes moyennes et les classes supérieures. HPS soulignent eux-mêmes les limites de cette classification, notamment à propos des «classes moyennes». D’ailleurs, tout en parlant de «trois classes», ils utilisent toujours le pluriel pour les désigner: LES classes populaires, LES classes moyennes, LES classes supérieures. Nous reviendrons ci-dessous sur ce problème, mais il faut aussi noter d’emblée que leur classification agglomère des salarié·e·s et des non-salarié·e·s (ceux-ci avec la petite paysannerie représentent même une partie importante de l’agrégat «classes populaires» à l’Est de l’Europe).
Les données publiées par la Commission européenne mettent surtout en évidence les disparités entre Etats (pour comparer les pays entre eux, voire pour les mettre en concurrence) et portent peu sur les groupes sociaux. Les travaux menés par Thomas Piketty ont le mérite de montrer les inégalités de richesse, mais les auteurs soulignent que se limiter aux inégalités passe sous silence les autres dimensions essentielles des classes sociales: subordination des classes populaires par rapport aux centres de pouvoir, rapports de force politique, évolution interne des différentes classes… Le terme «classes populaires» est largement absent des débats européens: sont généralement utilisés d’autres mots comme «pauvres» ou «exclus» qui, comme le soulignent HPS, réduisent les positions à une somme de situations individuelles et rendent invisibles les rapports de domination.
Prolétariat et classes populaires ne disparaissent pas
Les différentes prophéties sur l’homogénéisation des structures sociales en Europe et sur la dissolution du prolétariat dans une immense classe moyenne ont été démenties par les faits. De même, le discours sur la marche inéluctable de l’Europe vers une «société de la connaissance» où, avec les robots, disparaîtraient les métiers manuels peu qualifiés. En fait, les disparités entre structures sociales nationales se maintiennent. L’industrie a globalement régressé en Europe, surtout à l’Ouest, mais est loin de s’être évanouie: dans la plupart des pays d’Europe centrale et orientale, elle occupe entre 20 et 30% des actifs contre 17 % à l’Ouest de l’Europe (et 21% en Allemagne dont l’évolution est particulière). Cela renvoie notamment aux vagues de délocalisation, notamment dans l’automobile. Le gonflement du tertiaire a comme conséquence l’expansion de métiers tertiaires qualifiés mais n’est pas synonyme de disparition des classes populaires; progressent aussi des métiers dont la qualification est peu reconnue (et les salaires «faibles»): aides-soignantes, aides à domicile, magasiniers, vendeuses, etc.
Les classes populaires représentent 43% des actifs européens (les classes moyennes et supérieures respectivement 38% et 19%). Elles se situent au-dessus de cette moyenne à l’Est et au Sud et y ont été particulièrement frappées par la crise et les politiques néolibérales: les salaires y sont bas et de nombreux jeunes ou travailleurs sont contraints d’émigrer. Dans les autres Etats-membres comme la France, l’Allemagne, les classes moyennes (telles que définies par les auteurs) et les classes populaires s’équilibrent plus ou moins avec des différences entre Etats. Les classes populaires sont essentiellement composées de salarié·e·s (ouvriers et employés) auxquels s’ajoutent, dans la classification adoptée, pour 15% du total, des agriculteurs et des artisans ainsi que des «travailleurs autonomes», nombreux en Espagne.
Une des caractéristiques des classes populaires européennes est la mise en concurrence: mise en concurrence interne aux différents pays (ainsi les camionneurs indépendants servent à peser sur les camionneurs salariés; joue dans le même sens l’emploi de salariés sous différents statuts) ou entre les pays (avec les délocalisations). Du fait des mouvements migratoires, la composante étrangère est plus importante dans les classes populaires que dans les autres classes.
Au-delà de la diversité des situations nationales, partout les membres des classes populaires sont plus exposés au chômage que les autres classes sociales. Les contrats précaires y sont plus fréquents et leur taux de temps partiel est plus élevé; ce temps partiel est plus souvent subi et cette forme de travail touche avant tout les femmes; la flexibilisation des marchés du travail impulsée par le patronat et les gouvernements se fait en premier lieu à leur détriment. Le vieillissement de la population et le développement du travail des femmes (en particulier des plus qualifiées) entraînent, dans le cadre d’un système patriarcal, la prise en charge des vieillards et des tâches ménagères par des femmes des catégories populaires, souvent étrangères.
Les membres des classes populaires sont les plus exposés à la pénibilité et aux risques du travail et les progrès technologiques ne mettent pas fin aux contraintes qui pèsent sur eux, comme en témoignent les conditions de travail dans les entrepôts d’Amazon. Dans toute l’Europe, les inégalités de santé augmentent, ce qui conduit une fraction des classes populaires à devoir renoncer à des soins pour des raisons économiques ou bien car il faut attendre trop longtemps avant de pouvoir accéder à un médecin. Certes, il y a des écarts au sein des classes populaires, entre les ouvriers agricoles et ceux de l’électronique par exemple, mais les traits communs l’emportent: vulnérabilité économique, situation de subordination, mise en concurrence, subordination politique. Les mobilisations sociales sont difficiles mais elles existent sans se fédérer.
Des classes moyennes hétérogènes
Viennent ensuite les classes moyennes qui dans la classification de HPS représentent 38% des actifs. Tout en construisant une telle catégorie, les auteurs insistent sur les risques de son usage fallacieux et extensif afin de camoufler les conflits de classe. Ils distinguent quatre pôles dans les classes moyennes, caractérisés chacun, d’une part, par le secteur d’emploi (privé ou public, le public constitue une part importante des emplois des classes moyennes) et, d’autre part, par la situation dans le travail: une certaine autonomie ou bien une position de subordination. Ceux qui sont en situation d’autonomie sont en général plus diplômés.
 Les auteurs regroupent dans les classes moyennes les enseignant·e·s, les techniciens de l’industrie, les professions intermédiaires de santé (comme les infirmières), les employé·e·s de bureau, les commerçants, etc. Ces catégories bénéficient de conditions d’emploi et de travail globalement meilleures que celles des classes populaires. mais des disparités importantes existent en leur sein, en termes de risque de chômage ou de bien-être au travail. La propriété de leur logement y est plus fréquente que dans les classes populaires et les pratiques culturelles (habitudes de lecture,…) les en distinguent aussi. Les classes moyennes du public subissent directement les conséquences des politiques d’austérité tandis que celles du privé se sentent fragilisées, elles-mêmes ou dans l’avenir de leurs enfants. Il en résulte une montée du scepticisme par rapport à l’Union européenne et, dans le Sud de l’Europe, des mobilisations sociales (comme le mouvement des Indignés espagnols), tandis qu’en Europe centrale et orientale le mécontentement est capté par des forces nationalistes.
Les auteurs regroupent dans les classes moyennes les enseignant·e·s, les techniciens de l’industrie, les professions intermédiaires de santé (comme les infirmières), les employé·e·s de bureau, les commerçants, etc. Ces catégories bénéficient de conditions d’emploi et de travail globalement meilleures que celles des classes populaires. mais des disparités importantes existent en leur sein, en termes de risque de chômage ou de bien-être au travail. La propriété de leur logement y est plus fréquente que dans les classes populaires et les pratiques culturelles (habitudes de lecture,…) les en distinguent aussi. Les classes moyennes du public subissent directement les conséquences des politiques d’austérité tandis que celles du privé se sentent fragilisées, elles-mêmes ou dans l’avenir de leurs enfants. Il en résulte une montée du scepticisme par rapport à l’Union européenne et, dans le Sud de l’Europe, des mobilisations sociales (comme le mouvement des Indignés espagnols), tandis qu’en Europe centrale et orientale le mécontentement est capté par des forces nationalistes.
Les classes supérieures ne se réduisent pas aux 1%
Enfin, les classes supérieures. Les auteurs insistent sur le fait que l’on ne peut les réduire aux «1%» dénoncés par Occupy Wall street: d’autres fractions des classes supérieures concourent au maintien d’un ordre social dont elles tirent avantage. Relèvent donc des classes supérieures ceux qui disposent d’un pouvoir dans le domaine économique (chefs d’entreprise et cadres dirigeants), dans l’appareil d’Etat (hauts fonctionnaires) et les sommets des professions libérales et intellectuelles. Au total, 19% des actifs. Ces classes supérieures sont d’abord «ceux et celles qui définissent les règles du travail» pour elles-mêmes et, surtout, pour l’ensemble des salarié·e·s.
Les membres de ces classes se distinguent évidemment par leur richesse économique. Alors que pour la majorité de la population les revenus proviennent pour la plus large part de l’activité individuelle de chacun, les membres des classes supérieures cumulent des salaires (élevés) et les revenus de leur capital (bousier, foncier, immobilier). Au sein même des classes supérieures, les inégalités sont cependant considérables et le sommet (les 1%) capte une part de plus en plus grande des revenus.
Les revenus élevés des classes supérieures sont souvent justifiés dans le discours dominant par les risques associés à leurs responsabilités. HPS soulignent le caractère fallacieux de cet argument: les dirigeants peuvent plus facilement que les salarié·e·s se protéger des conséquences d’une erreur (et risquent au plus une baisse de leurs revenus). Une autre justification de la légitimité des classes supérieures est la possession de compétences particulières; celles-ci sont associées à des filières scolaires sélectives vers lesquelles s’orientent prioritairement leurs enfants et dont ils constituent une part essentielle des effectifs. Mais le «capital culturel» ne se limite pas à la possession d’un diplôme, il renvoie aussi à une forte consommation de biens culturels et à des compétences permettant de voyager et de travailler au-delà des frontières nationales. HPS font remarquer que les classes supérieures, toujours promptes à vanter la nécessité de l’ouverture sur l’international, sont dans leur composition peu ouvertes aux étrangers non européens, contrairement aux classes populaires.
La domination sociale des classes supérieures se double d’une domination politique illustrée de façon de plus en plus caricaturale par la disparition des ouvriers et des classes populaires en général dans les institutions politiques, y compris parmi les élus des partis sociaux-démocrates et communistes. Cette domination politique est redoublée par les positions occupées par la symbiose entre classes supérieures et haute administration. Est également mis en exergue le renforcement de la ségrégation des espaces dans un certain nombre de grandes villes européennes, à l’Ouest comme à l’Est (à Budapest comme à Londres), avec des quartiers accaparés par les plus riches. Les classes populaires ne disparaissent pas des centres-villes mais leur profil se modifie: les ouvriers disparaissent, remplacés par un nouveau prolétariat du tertiaire comportant une forte proportion d’étrangers. La ségrégation sociale marque aussi les banlieues avec des communes où sont reléguées des classes populaires et d’autres qui sont résidentielles.
L’articulation du niveau national et européen
Tous les groupes sociaux sont d’une façon ou d’une autre remodelés par la division du travail entre pays européens: si la détermination nationale reste forte, les rapports de domination ne sont plus strictement nationaux et bon nombre d’institutions nationales (jusqu’aux systèmes d’éducation) sont restructurées. Ces évolutions sont plus ou moins contraignantes pour les membres des différentes classes.
Globalement les classes supérieures sont dans la situation la plus favorable. HPS soulignent leur relative homogénéité et une convergence au-delà des frontières nationales plus marquée que pour les autres classes. Elles manifestent généralement une forte adhésion à l’Union européenne et aux politiques menées dans ce cadre. Mais cela ne signifie pas que les différentes classes supérieures nationales pèsent de la même façon dans l’espace européen. Les classes supérieures de l’Est de l’Europe sont, pour reprendre une expression des auteurs, des «dominants dominés» dépendant de normes et de modes d’organisation qui leur sont imposés. Ainsi, bon nombre de grandes entreprises sont désormais pilotées par des capitaux étrangers et, sur place, «managées» par des cadres venus d’autres pays européens; pour espérer y faire carrière, les cadres de l’Est doivent maîtriser parfaitement l’anglais et calquer leur comportement ainsi que leur mode de vie et leur habillement sur le «modèle» du manager occidental.
Les classes moyennes et populaires sont plus disparates et plus marquées par les différences entre les Etats où elles vivent. La situation des différentes classes populaires varie ainsi selon le rythme et les modalités des restructurations économiques, la place de l’agriculture, l’importance du travail non déclaré, l’envergure des systèmes de protection sociale,… A tout point de vue, c’est en Europe de l’Est et du Sud que leur situation est la plus difficile. Quant aux classes moyennes, leur configuration est pour une part modelée par l’importance du secteur public, même si les spécificités en sont de plus en plus attaquées par les politiques néolibérales menées avec la bénédiction de l’UE. Pour les membres des classes moyennes et populaires, l’unification européenne telle qu’elle se fait apparaît plus souvent porteuse de contraintes et d’incertitude.
Les trajectoires de «ceux d’en bas» apparaissent donc plus disparates et éclatées que celles des classes supérieures. Cela complique la constitution d’un mouvement social européen, d’autant que le soulignent les auteurs, ni les partis de gauche, ni les syndicats européens ne prennent en charge les problèmes communs, comme les conditions d’emploi et de travail.
Dangers et limites des populismes
Dans ce contexte, un grand espace est laissé au populisme de droite qui, comme l’écrivent justement les auteurs, réussit à «transformer un mécontentement social en repli national». Certains (les auteurs citent Podemos et la France insoumise) prétendent répondre à ce danger par un «populisme de gauche», opposant le peuple à l’oligarchie et valorisant le cadre national comme espace de protection. HPS en soulignent les limites: il s’agit au mieux de réponses à court terme face au dumping social et à la casse des services publics. Le véritable enjeu est de reconstruire un rapport de force social plus large que les cadres nationaux, et pour reprendre la dernière phrase de l’ouvrage «une gauche sociale et politique capable de se déployer à la même échelle que celle des firmes capitalistes, c’est-à-dire au niveau européen». On ne peut que souscrire à cette conclusion.
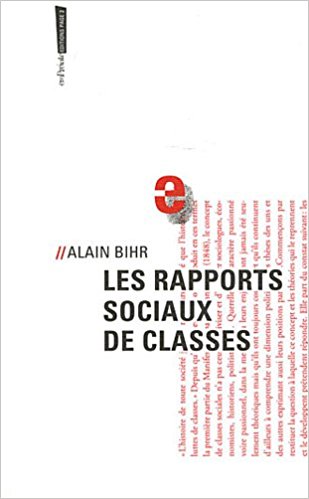 Divers aspects de cet ouvrage mériteraient discussion. En premier lieu, la définition des classes est quelque peu éclectique. L’agrégation des salarié·e·s et non-salarié·e·s est évidente pour les classes supérieures et a des fondements pour les classes populaires (une large partie des non-salarié·e·s qui y sont inclus sont clairement et irrémédiablement des «perdants» face au capitalisme néolibéral). Par contre, il y a problème pour les classes moyennes [4], des «classes moyennes» dans lesquelles HPS incluent des groupes professionnels qui font indéniablement partie du prolétariat moderne (comme les informaticiens et techniciens, les infirmières, les réceptionnistes et guichetières). Nous avons noté d’ailleurs au début de cet article que tout en parlant de trois classes, le pluriel était toujours employé pour les désigner.
Divers aspects de cet ouvrage mériteraient discussion. En premier lieu, la définition des classes est quelque peu éclectique. L’agrégation des salarié·e·s et non-salarié·e·s est évidente pour les classes supérieures et a des fondements pour les classes populaires (une large partie des non-salarié·e·s qui y sont inclus sont clairement et irrémédiablement des «perdants» face au capitalisme néolibéral). Par contre, il y a problème pour les classes moyennes [4], des «classes moyennes» dans lesquelles HPS incluent des groupes professionnels qui font indéniablement partie du prolétariat moderne (comme les informaticiens et techniciens, les infirmières, les réceptionnistes et guichetières). Nous avons noté d’ailleurs au début de cet article que tout en parlant de trois classes, le pluriel était toujours employé pour les désigner.
D’un point de vue marxiste, il y aurait aussi matière à objections à des classes non vraiment définies par les rapports sociaux de production et dont les rapports réciproques ne sont que peu caractérisés. Ainsi que le résume Alain Bihr qui a écrit une synthèse sur la conception marxiste des classes sociales: «ce sont les rapports entre les classes plutôt que les classes sociales qu’il faut placer au centre de l’analyse: […] les classes n’existent et ne peuvent se comprendre que dans et par les rapports qui les unissent entre elles. Rapports qui trouvent leurs fondements dans les rapports capitalistes de production, avec leurs dimensions irréductibles d’exploitation et de domination.» [5]
Tout cela est exact mais ne réduit pas l’intérêt de cet ouvrage qui fournit au lecteur une masse d’informations et des repères utiles pour engager «l’analyse concrète d’une situation concrète» [6]. (Article publié dans le mensuel L’Anticapitaliste, de mars 2018; revu par l’auteur)
_____
[1] Un des principaux tenants de cette opposition est le géographe Christophe Guilluy dont les thèses sont présentes dans les travaux de Jean-Claude Michea sur lequel nous avons publié dans notre numéro 87 de mai 2017 un entretien avec Isabelle Garo: https://npa2009.org/idees/politique/jean-claude-michea-la-reaction-sous-le-masque-de-lanticapitalisme
[2] On peut lire sur Chantal Mouffe son entretien avec Regards en 2016 «Il me semble urgent et nécessaire de promouvoir un populisme de gauche» http://www.regards.fr/web/article/chantal-mouffe-parler-de-populisme-de-gauche-signifie-prendre-acte-de-la-crise
[3] Le Monde diplomatique, juillet 2017.
[4] La question des «classes» ou «couches» moyennes situées entre les deux classes fondamentales (bourgeoisie et prolétariat) constitue un vieux problème de l’analyse marxiste des classes. Certains auteurs (Nikos Poulantzas et Baudelot, Establet, Malemort) ont, dans leurs travaux respectifs durant les années 70, distingué petite-bourgeoisie moderne et petite-bourgeoisie traditionnelle. Pour sa part, Alain Bihr souligne ainsi l’hétérogénéité des supposées classes ou couches moyennes: «La petite-bourgeoisie se forme sur la base de rapports précapitalistes (la production marchande simple) que le capitalisme tout à la fois détruit et intègre, les “couches moyennes salariées” se forment sur la base des rapports capitalistes et se développent au rythme de ses derniers.»
Dans son ouvrage Entre bourgeoisie et prolétariat – l’encadrement capitaliste (L’Harmattan, 1989) il souligne aussi: «Ni sur le plan politique, ni sur le plan idéologique, cet ensemble de classes et de fractions ne constitue une unité lui permettant de relever d’un même concept.» D’autres aspects des développements d’Alain Bihr, peuvent susciter plus de réserves, notamment le point central de son analyse: l’existence d’une troisième classe fondamentale entre bourgeoisie et prolétariat: «l’encadrement capitaliste».
[5] «Les rapports sociaux de classes, entretien avec Alain Bihr», Mediapart, 21 janvier 2014: https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/article/210114/les-rapports-sociaux-de-classes-entretien-avec-alain-bihr
Dans cet entretien, Alain Bihr présente son ouvrage sur les classes Les rapports sociaux de classes, Lausanne, Editions Page deux. Ce livre est accessible en version électronique: http://classiques.uqac.ca/contemporains/bihr_alain/rapports_sociaux_de_classes/rapports_sociaux_de_classes.html
[6] https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/06/vil19200612.htm



Soyez le premier à commenter