Faire parler du travail comme activité concrète, comme rapport social, comme source d’exploitation et de dominations multiples, mais aussi comme réalisation de soi: voilà le défi auquel s’est attelé Nicolas Latteur dans ce livre très attachant, aussi riche à mes yeux qu’important. [Voir ci-dessous l’intervention – youtube – de Nicolas Latteur à propos des 44 témoignages de salarié·e·s réunis dans son ouvrage.]
Sa richesse provient tout d’abord de la diversité des témoignages qui sont restitués et qui permettent au lecteur de rentrer dans différents univers de travail, plus ou moins valorisés socialement: des chaînes de restauration rapide au gardiennage, des grands groupes industriels au laboratoire de recherche. Si comme le dit l’une des enquêtées, Nadia, infirmière dans une maison de repos, «personne ne veut venir parce que c’est un travail de merde», la restitution de plus de quarante parcours professionnels dans des entreprises privées de l’industrie et des services, dans la fonction publique, dans le monde associatif montre qu’aucun univers professionnel n’est protégé ou «privilégié». Au fil de ces histoires de vie livrées de façon très fine, le lecteur partage les attentes et les représentations des salarié·e·s, comprend ce qu’ils investissent dans leur travail et combien ils se confrontent à une absence de reconnaissance et de valorisation.
«La misère du monde… du travail»
L’ouvrage pourrait s’intituler La misère du monde… ?du travail tant il fait écho, d’une certaine façon, à la démarche de recueils d’entretiens que Pierre Bourdieu et son équipe ont menée au début des années 1990 afin de rendre compte des implications sur des existences individuelles des politiques néolibérales et du retrait de l’État. Il fait également écho au Parlement des invisibles lancé par Pierre Rosanvallon [Le Seuil, janvier 2014] pour rendre accessible, via de petits livres, les vies dont on ne parle pas et le sens donné à leur travail par des ouvriers, des juges, des cuisiniers, etc. Bien que distinctes, ces démarches ont un point commun avec celle adoptée par Nicolas Latteur: donner la parole aux salarié·e·s sur leur travail, contribuer à faire émerger cette parole dans l’espace public.
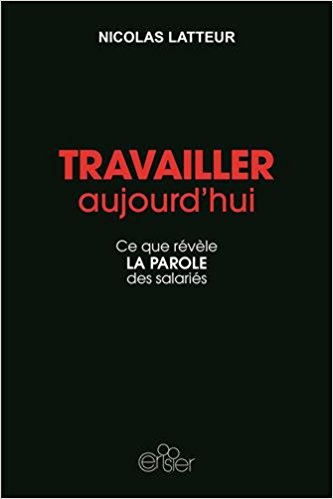 Cependant, dans le livre de Nicolas Latteur, il ne s’agit pas d’adopter un point de vue surplombant, celui du sociologue, mais de penser avec les salarié·e·s, de reconnaître leur pleine légitimité à dire ce qui se joue dans le travail et la dimension éminemment politique de cette connaissance pratique.
Cependant, dans le livre de Nicolas Latteur, il ne s’agit pas d’adopter un point de vue surplombant, celui du sociologue, mais de penser avec les salarié·e·s, de reconnaître leur pleine légitimité à dire ce qui se joue dans le travail et la dimension éminemment politique de cette connaissance pratique.
Les quarante-quatre récits de vie donnent à voir cette misère du monde du travail, si l’on entend celle-ci comme le produit d’une emprise des logiques de rentabilité financière sur la production de biens et de services. Les discours dominants sur la nécessaire flexibilité de l’emploi, sur le «coût» du travail, sur l’adaptabilité dont devraient faire preuve des salariés menacés par le chômage contribuent à masquer la réalité de ce qui se joue dans la sphère du travail. Au fil des récits, ce sont tout d’abord les formes les plus brutales et violentes des rapports d’exploitation et de domination qui apparaissent: le non-respect des droits les plus élémentaires (comme les repos, les congés, le paiement des heures supplémentaires), la mise en concurrence permanente entre salarié·e·s, le harcèlement moral et parfois sexuel, l’exposition dramatique de la santé, comme dans le cas d’Arthur exposé à des rayons X.
Loin de cette entreprise vitrine, entité supposée homogène, qui est présentée dans le discours néolibéral comme le seul acteur producteur de richesses, la restitution des conditions d’emploi et de travail rappellent ici combien l’entreprise est d’abord le lieu où s’exercent des rapports de pouvoir, parfois de façon très unilatérale. Ces formes brutales de domination passent aussi par un contrôle permanent des salarié·e·s: les récits des salarié·e·s travaillant dans le commerce ou les services rendent bien compte, par exemple, de la permanence d’une organisation du travail de type taylorienne qui refuse toute autonomie aux salarié·e·s et les soumet à une logique disciplinaire très forte.
Ces rapports d’exploitation et de domination peuvent revêtir des formes plus subtiles: via l’évaluation individualisée imposée aux salarié·e·s, voire des procédures d’autoévaluation; via des hiérarchies introduites entre des situations de précarité.
Sophie préfère ainsi son emploi à temps partiel dans une librairie plutôt que dans une chaîne de restauration rapide: les abus par rapport au droit du travail y sont différents, mais la précarité tout aussi présente. L’intensité de ces contrôles et de ces pressions, l’impossibilité de bien faire son travail et la peur d’être licencié constituent autant d’éléments qui pèsent sur la vie hors travail des salariés. Le récit de Nathalie, employée dans un call-center, qui commet une faute lourde pour être licenciée est ici bouleversant: quitter son emploi est la condition pour retrouver goût à la vie.
 A lire les différents témoignages, on saisit combien la précarité ne se limite pas aux formes d’emploi: c’est aussi d’une précarité du travail et d’une précarité des droits qu’il est question, de façon fortement imbriquée, et ce y compris lorsque le salarié dispose d’un contrat de travail stable.
A lire les différents témoignages, on saisit combien la précarité ne se limite pas aux formes d’emploi: c’est aussi d’une précarité du travail et d’une précarité des droits qu’il est question, de façon fortement imbriquée, et ce y compris lorsque le salarié dispose d’un contrat de travail stable.
Car l’une des forces de ces récits est de restituer les contradictions qui traversent l’organisation même du travail: entre les logiques de rentabilité, de maximisation des profits, imposées par les employeurs et la façon dont les salariés pensent l’utilité de leur travail, la façon de le réaliser pour lui donner du sens. Personne dans la hiérarchie ne comprend le mode de facturation établi par l’entreprise, mais il faut que les employés du call-center obtiennent quand même le paiement des clients. La distance est forte, on le sait, entre le travail prescrit et le travail réel: ce que restituent les salarié·e·s rencontrés pour ce livre est justement la façon dont ils déploient une ingéniosité permanente pour conférer une autre finalité à leur travail (aider les usagers, les clients, trouver les moyens de bien nettoyer malgré l’absence de produits d’entretien suffisants, etc.).
Ces salarié·e·s racontent combien ils se heurtent, dans les entreprises privées comme publiques, à des contraintes bureaucratiques dépourvues de sens, à des formes de contrôle étroit et de subordination, à la recherche permanente du profit et à une absence de reconnaissance sociale.
«Faire émerger une parole collective», malgré tout
Cette misère du monde du travail se répercute sur les conditions de l’engagement: faire émerger une parole collective ou se présenter sur une liste syndicale expose des salariés à des discriminations plus ou moins camouflées, voire à une répression directe.
Il est important de le rappeler et les récits livrés par les enquêtés le montrent bien: faire exister des droits d’expression et une représentation collective dans la sphère du travail n’est jamais acquis, mais renvoie à des rapports de force, à des luttes pour tenter de démocratiser un minimum un espace où les travailleurs perdent d’une certaine façon leur qualité de citoyens.
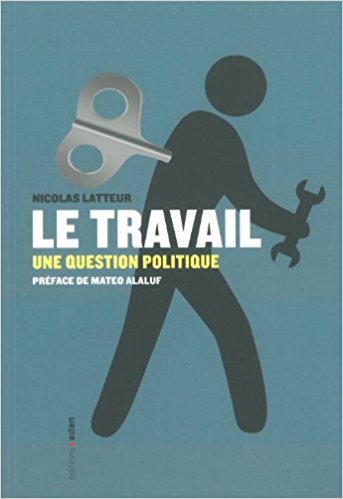 S’il parle donc de la misère actuelle du monde du travail, remettant les représentations à l’endroit à l’heure où une partie de la classe politique tente de nous faire croire que le droit du travail et les protections des salarié·e·s constituent une entrave pour l’emploi, le livre de Nicolas Latteur n’est en rien misérabiliste. Bien au contraire, les expériences qui sont restituées parlent aussi de résistances individuelles et collectives, de démarches pour faire exister une représentation, d’engagement dans les syndicats.
S’il parle donc de la misère actuelle du monde du travail, remettant les représentations à l’endroit à l’heure où une partie de la classe politique tente de nous faire croire que le droit du travail et les protections des salarié·e·s constituent une entrave pour l’emploi, le livre de Nicolas Latteur n’est en rien misérabiliste. Bien au contraire, les expériences qui sont restituées parlent aussi de résistances individuelles et collectives, de démarches pour faire exister une représentation, d’engagement dans les syndicats.
Ces formes de résistances sont parfois déployées en dehors de tout relais syndical tant il est attendu peu de choses de la délégation syndicale car celle-ci semble intégrée à l’ordre de l’entreprise. Ce sont parfois des salarié·e·s très isolés, désespérés de trouver des points d’appui, qui entretiennent un rapport très distant, parfois utilitaire, parfois méfiant au syndicalisme.
N’occultant rien de ces difficultés, cet ouvrage propose une profonde réflexion, comme prolongement aux entretiens, sur les perspectives ouvertes pour le mouvement syndical. Dans une partie des travaux contemporains sur le syndicalisme, il est question de «renouveau» syndical ou de redéploiement. Ces travaux sont pour l’essentiel ceux de chercheurs de pays anglophones et notamment de chercheurs étasuniens qui ont étudié l’introduction de méthodes d’organizing dans une partie des syndicats américains.
Il est alors question de démarches volontaristes des organisations pour mener des campagnes de syndicalisation auprès de celles et ceux qui ne sont pas organisés, en particulier des travailleurs et travailleuses exposés à différentes formes de précarité. Le regard porté sur le «renouveau syndical» passe alors par une attention aux modalités d’action et à la construction de liens avec d’autres types de collectifs (communautés, associations, etc.).
Ce n’est pas de ce type de renouveau dont parle le livre de Nicolas Latteur, dans un système de relations professionnelles d’ailleurs très différent du système américain. Mais son approche nous apparaît à la fois complémentaire à ces réflexions et beaucoup plus percutante en termes de potentiel émancipateur. Le renouveau dont il est question ici –?et ces débats sont également très présents dans une partie du syndicalisme français – passe par l’idée d’ancrer davantage ou d’ancrer de nouveau pleinement l’action syndicale dans une connaissance concrète de ce qui se joue dans le travail.
C’est une incitation à déployer une forme de syndicalisme qui ne se laisse pas entièrement accaparer par le travail de représentation et de négociation dans les institutions, bien que ces arènes de pouvoir soient bien sûr importantes. Il s’agit pour les militant·e·s et pour les délégué·e·s d’être en capacité de recueillir la parole, les expériences des salarié·e·s?–?comme cela a été fait dans l’ouvrage?–?pour construire avec eux des revendications et différentes formes d’action.
La démarche peut paraître évidente, mais elle ne l’est pas, tant il est parfois plus facile de partir de ce que l’on croit savoir sur tel secteur, sur telle profession et d’imposer un discours revendicatif construit par en haut dans un rapport de représentation qui devient distant et extérieur. Il ne s’agit pas pour les syndicalistes d’être des experts, reconnus comme tels par les parties adverses ou les autorités publiques, d’être des professionnels de la représentation.
 Il s’agit au contraire d’être les chevilles ouvrières qui vont faire émerger cette parole individuelle des salarié·e·s pour construire du collectif, pour mettre en œuvre une démarche réflexive sur le sens de leur travail, mais aussi sur les façons de produire des biens et des services, sur leurs usages. En faisant de la connaissance que les salariés ont de l’organisation du travail et des savoirs pratiques qu’ils ont développés pour améliorer celle-ci, le socle de l’action syndicale, l’objectif consiste à profondément renouveler celle-ci et à la démocratiser.
Il s’agit au contraire d’être les chevilles ouvrières qui vont faire émerger cette parole individuelle des salarié·e·s pour construire du collectif, pour mettre en œuvre une démarche réflexive sur le sens de leur travail, mais aussi sur les façons de produire des biens et des services, sur leurs usages. En faisant de la connaissance que les salariés ont de l’organisation du travail et des savoirs pratiques qu’ils ont développés pour améliorer celle-ci, le socle de l’action syndicale, l’objectif consiste à profondément renouveler celle-ci et à la démocratiser.
Dans son ouvrage La Cité du travail, la gauche et la crise de fordisme [Ed. Fayard, 2012 ], Bruno Trentin, ancien dirigeant syndical de la CGIL en Italie, critiquait de façon vive le fait que les syndicats n’aient pu délaisser durant la période de croissance de l’après-Seconde guerre mondiale une critique des conditions de travail pour privilégier des revendications quantitatives (sur les salaires notamment) vécues comme autant de compensations pour les salariés. Il reprochait aux syndicats d’avoir accepté, dans le cadre de ce compromis fordiste, que l’organisation du travail ne relève que de la seule direction des entreprises. Selon lui, le mouvement syndical était alors passé à côté d’un enjeu majeur: comment rendre visible la gauche et la crise du fordisme de parole, de délibération collective, pour que cette connaissance soit dite et constitue un vecteur pour l’élaboration de solidarités et de revendications?
C’est bien de cet enjeu que nous parle avec force Nicolas Latteur et tout son ouvrage plaide de façon très convaincante en ce sens. Comme il le souligne dans les conclusions, il se rapproche de ce point de vue des réflexions, mais aussi des recherches-actions, qui sont menées actuellement sur la santé au travail. Car cette entrée a justement favorisé le fait d’irriguer les conceptions et les pratiques syndicales à partir d’une connaissance concrète de ce que produisent des organisations du travail profondément transformées dans l’entreprise néolibérale et dans une fonction publique soumise aux normes gestionnaires du new public management. La thématique de la santé du travail et des risques psychosociaux a permis de renouer avec une critique de l’organisation du travail qui s’appuie directement sur l’expérience des salariés. Comme y invite Nicolas Latteur, il faudrait ouvrir davantage encore cette porte pour rendre de la capacité d’action aux syndicats et par là même aux salariés.
Trois grands défis
Et de ce point de vue, trois grands défis sont imbriqués. Le premier consiste à adapter l’outil syndical à la structuration des entreprises, aux usages par les grands groupes des sous-traitances en cascade, des filiales, des «franchises» [les multiples «entreprises» franchisées, allant des salons de coiffure, des magasins d’habillement, en passant par les kiosques ou les unités de restauration], à leur recours à l’externalisation de la main-d’œuvre vers des petites entreprises où les salarié·e·s sont encore plus exposés aux différentes formes de précarité.
Le second passe par un renouveau des pratiques de représentation afin de réfléchir à la façon dont le syndicalisme en tant qu’espace social est lui-même traversé par différents rapports de domination (rapports sociaux, de sexe, de classe, racialisés, mais aussi générationnels).
Et le troisième défi, indissociable des deux premiers, est justement celui de partir du travail comme expérience concrète, individuelle et collective, expérience profondément ambivalente et contradictoire dans le cadre du rapport salarial, pour faire de la connaissance pratique des travailleurs le fil d’un nouveau projet d’émancipation.
- Sophie Béroud est maître de conférences de sciences politiques à l’université Lumière Lyon-2, Elle a publié Quand le travail se précarise, quelles résistances collectives?, Paris, La Dispute, 2009 (codirection avec Paul Bouffartigues (dir.), Le retour des classes sociales : inégalités, dominations, conflits, nouv.éd., Paris, La Dispute, 2015, p. 221-236.
- Nicolas Latteur est sociologue et formateur au CEPAG (Centre d’éducation populaire André Genot, Belgique). Il a publié, en 2013, Le Travail, une question politique, avec une préface de Mateo Alaluf. (Aden, 2013).



Soyez le premier à commenter