
Par Didier Fassin
Le 14 janvier, l’interview de Caroline Fourest sur Sky News au sujet des attaques contre Charlie Hebdo s’est brutalement interrompue au moment où, à l’insu de son hôte, l’invitée a brandi le dernier exemplaire du journal pour en montrer la couverture au public britannique. La journaliste Dharshini David s’est alors excusée auprès des téléspectateurs qui auraient pu être «offensés» en rappelant que la politique de sa chaîne était de ne pas montrer les caricatures du Prophète. Cette censure a immédiatement déclenché des réactions d’indignation de la part des médias français et l’intéressée a parlé «d’une violence inouïe et d’une hypocrisie absolue».
L’épisode s’inscrit dans un contexte plus large où deux pratiques éditoriales s’opposent. Les uns, notamment en France, considèrent qu’il est important de montrer pour défendre le droit d’expression. Les autres, particulièrement en Grande-Bretagne mais aussi aux Etats-Unis, estiment qu’il est préférable de ne pas montrer pour ne pas blesser les musulmans. Nombre de commentateurs revendiquent la première posture et stigmatisent la seconde, dans laquelle ils voient au mieux de la complaisance, au pire de la lâcheté. Je voudrais suggérer que, plutôt que de caricaturer, si j’ose dire, on peut essayer de comprendre, et plutôt que d’imaginer que s’affrontent une position morale et une autre immorale, penser que ce sont deux éthiques qui sont en jeu. On n’aurait donc pas un combat entre le bien et le mal, entre ceux qui ont raison et ceux qui ont tort, mais une confrontation de deux approches éthiques de la politique.
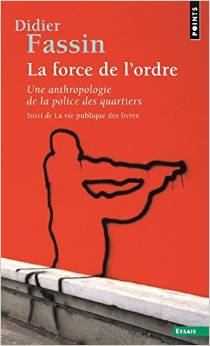 Le sociologue allemand Max Weber peut nous aider sur ce plan. Dans une conférence fameuse sur la politique, il écrit que «toute activité orientée selon l’éthique peut être subordonnée à deux maximes totalement différentes et irréductiblement opposées». D’un côté, «l’éthique de conviction» repose sur le principe kantien du devoir: il faut agir en fonction de principes supérieurs auxquels on croit. De l’autre, «l’éthique de responsabilité» relève de la philosophie conséquentialiste: il faut agir en fonction des effets concrets que l’on peut raisonnablement prévoir. Bien sûr, précise le sociologue, «cela ne veut pas dire que l’éthique de conviction est identique à l’absence de responsabilité et l’éthique de responsabilité à l’absence de conviction». Néanmoins, face à une décision politique engageant des choix éthiques, l’une ou l’autre de ces positions prévaut: «Lorsque les conséquences d’un acte fait par pure conviction sont fâcheuses, le partisan de cette éthique n’attribuera pas la responsabilité à l’agent, mais au monde, à la sottise des hommes ou à la volonté de Dieu qui a créé les hommes ainsi. Au contraire, le partisan de l’éthique de responsabilité comptera justement avec les défaillances communes de l’homme et il estimera ne pas pouvoir se décharger sur les autres des conséquences de sa propre action pour autant qu’il aura pu les prévoir.» Homme de conviction, Max Weber penche cependant vers l’éthique de responsabilité.
Le sociologue allemand Max Weber peut nous aider sur ce plan. Dans une conférence fameuse sur la politique, il écrit que «toute activité orientée selon l’éthique peut être subordonnée à deux maximes totalement différentes et irréductiblement opposées». D’un côté, «l’éthique de conviction» repose sur le principe kantien du devoir: il faut agir en fonction de principes supérieurs auxquels on croit. De l’autre, «l’éthique de responsabilité» relève de la philosophie conséquentialiste: il faut agir en fonction des effets concrets que l’on peut raisonnablement prévoir. Bien sûr, précise le sociologue, «cela ne veut pas dire que l’éthique de conviction est identique à l’absence de responsabilité et l’éthique de responsabilité à l’absence de conviction». Néanmoins, face à une décision politique engageant des choix éthiques, l’une ou l’autre de ces positions prévaut: «Lorsque les conséquences d’un acte fait par pure conviction sont fâcheuses, le partisan de cette éthique n’attribuera pas la responsabilité à l’agent, mais au monde, à la sottise des hommes ou à la volonté de Dieu qui a créé les hommes ainsi. Au contraire, le partisan de l’éthique de responsabilité comptera justement avec les défaillances communes de l’homme et il estimera ne pas pouvoir se décharger sur les autres des conséquences de sa propre action pour autant qu’il aura pu les prévoir.» Homme de conviction, Max Weber penche cependant vers l’éthique de responsabilité.
Dans le cas de la publication des caricatures, on voit clairement se dessiner les deux positions. L’éthique de conviction se réfère au principe supérieur de la liberté de la presse et, au-delà, de la liberté d’expression: la démocratie suppose que chacun puisse dire ce qu’il veut, même si cela peut offenser une partie des citoyens. Représenter le Prophète nu dans une position grotesque demandant «tu les aimes mes fesses» ou lui faire dire qu’il est «dur d’être aimé par des cons» peut être vécu comme outrageant par des musulmans mais fait partie du droit de rire de tout et, notamment, au nom du principe de laïcité, des religions. On n’entrera pas ici dans la discussion sur les limites juridiques de cette liberté d’expression et de ce droit de rire tels qu’elles ont été fixées dans la loi française, ce qui implique des exceptions à la règle.
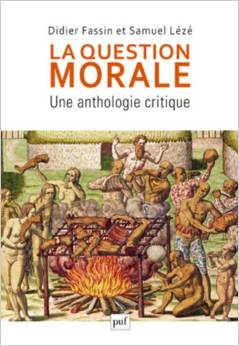 L’éthique de responsabilité invoque, de son côté, les conséquences prévisibles, en sachant que toutes ne le sont évidemment pas. Elles se situent à plusieurs niveaux. D’abord, de nombreuses personnes peuvent se sentir blessées par l’atteinte à ce qu’elles ont de plus sacré et parce qu’elles perçoivent comme des insultes explicitement dirigées contre elles. Ensuite, les réactions hostiles peuvent prendre des formes violentes à la fois dans le pays de publication, mais aussi, compte tenu de la circulation de l’information, partout dans le monde, mettant en péril non seulement des journalistes mais aussi bien d’autres. Enfin, l’indignation suscitée peut favoriser la radicalisation de certains segments de la population musulmane ou fournir des armes idéologiques aux fondamentalistes dans leur guerre contre le monde occidental, aggravant ainsi les tensions internationales.
L’éthique de responsabilité invoque, de son côté, les conséquences prévisibles, en sachant que toutes ne le sont évidemment pas. Elles se situent à plusieurs niveaux. D’abord, de nombreuses personnes peuvent se sentir blessées par l’atteinte à ce qu’elles ont de plus sacré et parce qu’elles perçoivent comme des insultes explicitement dirigées contre elles. Ensuite, les réactions hostiles peuvent prendre des formes violentes à la fois dans le pays de publication, mais aussi, compte tenu de la circulation de l’information, partout dans le monde, mettant en péril non seulement des journalistes mais aussi bien d’autres. Enfin, l’indignation suscitée peut favoriser la radicalisation de certains segments de la population musulmane ou fournir des armes idéologiques aux fondamentalistes dans leur guerre contre le monde occidental, aggravant ainsi les tensions internationales.
Les partisans de l’éthique de conviction n’éludent toutefois pas une responsabilité plus diffuse, en particulier au regard de conséquences lointaines (comme la construction d’un espace démocratique), de même que les partisans de l’éthique de responsabilité ne manquent pas de conviction, notamment en termes de tolérance à l’égard des croyances des autres (on peut être athée et se défendre d’attaquer la religion) et de respect de la dignité (on peut critiquer une religion sans en avilir les symboles). Il ne s’agit donc pas de simplifier les positions, d’autant que de nombreuses variantes existent, mais de rendre compte du type d’argument qui prévaut in fine pour ceux qui décident de publier et pour ceux qui décident de ne pas publier.
Du reste, on peut aussi, «provincialiser l’Europe», comme y invite l’historien indien Dipesh Chakrabarty, en se rappelant que ces éthiques sont aussi mobilisées ailleurs par d’autres. L’éthique de conviction, en matière de liberté d’expression, prend un sens particulier et implique un remarquable courage dans des pays non ou peu démocratiques: songeons à Cheikh Ould Mohamed Ould Mkheitir condamné à mort pour apostasie en Mauritanie à la suite d’écrits critiquant la sévérité plus grande du Prophète à l’encontre de ses ennemis juifs que de ses ennemis arabes et la légitimation par l’islam du système inique des castes ; pensons aussi à Raif Badawi puni de dix ans de prison et 10’000 coups de fouet en Arabie Saoudite pour avoir défendu la liberté d’expression sur son blog ; rappelons encore Baher Mohamed, Mohamed Fahmy et Peter Greste, journalistes d’Al-Jezira emprisonnés en Egypte pour avoir fait des reportages sur les violences du régime militaire contre les défenseurs de la démocratie. L’éthique de responsabilité, dans le contexte actuel de tensions, se manifeste aussi dans les discours de ceux des chefs religieux et des responsables politiques qui, dans les pays musulmans, prônent la modération et le dialogue.
On peut certes défendre l’une ou l’autre éthique, mais on ne peut considérer qu’une position est éthique et que l’autre ne l’est pas. L’ironique paradoxe serait en effet que ceux qui défendent la liberté d’expression radicalisent leur position au point de n’être plus en mesure d’accepter que s’expriment d’autres opinions que la leur. (Publié dans Libération, 20 janvier 2015, p. 20)
_____
Didier Fassin est professeur de sciences sociales à l’Institute for Advanced Study de Princeton. Il est l’auteur de La Question morale (PUF) et de L’Ombre du monde (Seuil).
*****
«Distinguer les idées qui choquent de l’incitation à la haine»
Propos de Mireille Delmas-Marty recueillis par Natalie Levisalles

Pour Mireille Delmas-Marty, juriste spécialiste des questions de droit international et de terrorisme, il faut «résister, responsabiliser et anticiper».
Que peut faire le droit après ce qui s’est passé? Je vais essayer de répondre en reprenant le titre d’un de mes livres [Résister, responsabiliser, anticiper ou comment humaniser la mondialisation», Ed. Seuil, 2013]: le droit peut permettre de résister, de responsabiliser et d’anticiper. Ou en tout cas y contribuer.
Résister d’abord. Il ne faut pas se leurrer, le monde est dangereux. Pour la première fois depuis longtemps, la France est au cœur de la tourmente. Le danger est à double face. D’un côté, le risque de ne rien faire et de laisser alors se propager les fureurs identitaires. Je dis fureur parce que c’est quelque chose qui échappe à la raison et qui conduit à la barbarie. De l’autre, le risque d’en faire trop: légaliser des dérives sécuritaires détruirait l’Etat de droit. Comme l’a dit la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH): «Il ne faut pas détruire la démocratie au motif de la défendre.»
Comment résister alors? En sanctionnant les criminels. Le terme «criminel», plus précis, est à utiliser de préférence à «terroriste», compte tenu du cortège d’émotions qui se rattache à ce mot. Il faut situer la répression dans le champ pénal plutôt que dans celui d’une «guerre contre le terrorisme». Même «l’Etat islamique» n’est pas un Etat, mais une organisation criminelle avec laquelle il n’y a ni accord ni traité de paix possibles. S’il s’agit d’une guerre, elle sera illimitée.
C’est pourquoi les acteurs publics doivent assumer la responsabilité de leurs décisions. Il leur revient d’assurer à la fois la sécurité et la protection des libertés. Des restrictions aux droits de l’homme sont admises quand elles sont suffisamment motivées pour qu’un juge puisse contrôler si ces mesures sont nécessaires et proportionnées, et les dérogations doivent rester exceptionnelles et donc provisoires. Sinon, elles contaminent toute la société.
Il faut aussi anticiper, c’est-à-dire remonter en amont du crime pour le prévenir. Mais pas à n’importe quelles conditions. Après le 11 Septembre, le Conseil de sécurité des Nations unies avait considéré que les attentats étaient un acte d’agression et que les Etats-Unis étaient en état de légitime défense. Ces derniers ont alors invoqué le concept de défense préventive pour justifier la guerre en Irak. On a vu les résultats, ils ont mis à feu et à sang une partie du globe, avec les dommages collatéraux que l’on sait.
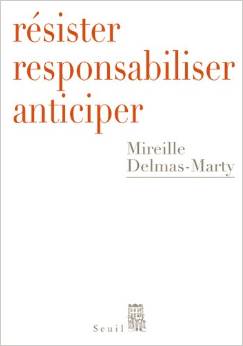 La difficulté est de prévenir le terrorisme sans renoncer à l’Etat de droit. Il est sur ce point rassurant que le gouvernement français ait écarté le modèle du Patriot Act et son cortège de dérives: fichage généralisé, légalisation de la torture, détention à durée indéterminée notamment à Guantánamo, exécutions extrajudiciaires, etc. Il reste à savoir comment se fera la mise en application de cette politique pénale.
La difficulté est de prévenir le terrorisme sans renoncer à l’Etat de droit. Il est sur ce point rassurant que le gouvernement français ait écarté le modèle du Patriot Act et son cortège de dérives: fichage généralisé, légalisation de la torture, détention à durée indéterminée notamment à Guantánamo, exécutions extrajudiciaires, etc. Il reste à savoir comment se fera la mise en application de cette politique pénale.
Enfin, il faut compter sur les acteurs civiques et préserver le pacte citoyen. Une initiation aux droits de l’homme est possible, et nécessaire. Elle devrait être renforcée dès le lycée autour de deux pôles: la Déclaration universelle des droits de l’homme de décembre 1948 (et les instruments qui ont suivi) et la déclaration, suivie de la convention, de l’Unesco sur la diversité culturelle de novembre 2001, qui affirment que le pluralisme des cultures et des religions est «le patrimoine commun de l’humanité».
On devrait donc aussi intégrer aux programmes scolaires la formation au pluralisme tel qu’il est défini par la CEDH qui dit: «La liberté d’expression vaut non seulement pour les informations et idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives, indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique.»
Ensuite, bien sûr, la question est: jusqu’où peut-on aller? Comment distinguer les idées qui choquent dans un esprit de pluralisme et d’ouverture de celles qui relèvent de l’incitation à la haine, de la provocation au crime et de l’apologie du crime? C’est tout le débat actuel. (Publié dans Libération, 18 janvier 2015, p. 11)
_____
Mireille Delmas-Marty est juriste spécialiste des questions de droit international et de terrorisme. Elle est l’auteur notamment de Résister, responsabiliser, anticiper ou comment humaniser la mondialisation», Ed. Seuil, 2013.


Soyez le premier à commenter