
Entretien avec Françoise Bouchet-Saulnier
conduit par René Backmann
Le jeudi 15 octobre 2015, au palace Beau-Rivage, à Lausanne, se réunissaient, «pour rien», Kerry, Lavrov ainsi que des représentants de la Turquie, de l’Arabie saoudite et du Qatar, ces derniers «soutiennent» la rébellion. L’Iran, engagé militairement auprès de Damas, était aussi représenté. S’y ajoutent, pour les bienfaits du Beau-Rivage, des représentants de l’Egypte, de l’Irak et de la Jordanie. Sans oublier l’envoyé très spécial de l’ONU: Staffan de Mistura. Dans la foulée de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, le 8 octobre 2016, durant laquelle la Russie a opposé son veto à une résolution de la France, la saisie de la Cour pénale internationale a été brandie par divers pays. René Backmann, pour le site Mediapart, s’est entretenu à ce sujet avec Françoise Bouchet-Saulnier, auteure du Dictionnaire pratique du droit humanitaire (La Découverte, 2013) et directrice juridique de Médecins sans frontières (MSF), dont plusieurs hôpitaux ont été bombardés en Syrie. (Rédaction A l’Encontre)
Les menaces, brandies par la France et d’autres pays occidentaux, de saisir la Cour pénale internationale pour juger les responsables des crimes de guerre en Syrie sont-elles crédibles?
La question de la justice internationale doit être abordée avec beaucoup de précaution. Elle me fait penser à l’émergence des interventions militaires internationales, qui reposent sur l’idée qu’on peut imposer une punition par la guerre, en invoquant le droit d’ingérence et la responsabilité de protéger. Comme s’il s’agissait, en ayant recours à la puissance militaire, de faire prévaloir un ordre public international, de prendre une sorte de revanche sur la réalité politique, la réalité du monde. Or la réalité du monde, c’est que le pouvoir c’est de la force. Les équilibres de pouvoir sont des équilibres de forces et de puissances, dans l’affrontement desquelles les populations sont malmenées, attaquées, massacrées. Le tout s’inscrivant dans la recomposition du monde post-guerre froide. L’alternative à ce recours à la force, c’est le droit. Il constitue le moyen de poser, autrement que par la force, des règles d’arbitrage de la violence. Soyons clairs: la justice pénale internationale est un phénomène nouveau qui répond à l’échec des interventions militaires internationales.
Les premiers tribunaux ont été créés pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda…
Oui. Ils faisaient suite à l’échec du recours à la force armée internationale pour imposer ou rétablir l’ordre public. Point important: ils comportent la notion de punition. Faute de pouvoir ressusciter les victimes, la communauté internationale affirme son existence par la punition. En gros, on peut dire que ces tribunaux sont destinés à éviter que la violation du droit ne conduise à la disparition du droit. Des crimes ont été commis, mais la communauté internationale considère que son autorité et sa légitimité ne sont pas ébranlées puisqu’elle réaffirme le droit en punissant le criminel. C’est ainsi qu’émerge la justice pénale internationale. Le problème, c’est qu’elle intervient comme une promesse nécessaire, comme une forme d’illusion. En fait, l’idée de punir me pose beaucoup de problèmes. D’abord parce qu’elle peut justifier qu’on ne fasse rien, ou presque, pour empêcher un crime en invoquant le fait qu’ensuite, on le punira. Or punir les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les crimes de génocide, cela ne ressuscite pas les victimes. Dans ces conditions, que signifie punir?
La justice implique en principe deux éléments: le rétablissement de la norme et le rétablissement des victimes. Dans le cas de la justice pénale internationale, c’est un mensonge. Après un génocide, un crime contre l’humanité, un crime de masse, ou après Alep, on ne rétablit pas les victimes. Elles sont mortes. A Srebrenica, la population massacrée a disparu. D’autres en ont profité. A Alep, il y aura un jour une nouvelle donne économique, politique, religieuse, sociologique, démographique, mais on ne ressuscitera pas les victimes. Que reste-t-il alors de cette justice? Il reste la fonction symbolique de réaffirmer la norme et de proclamer un principe: ce n’est pas parce que tel dirigeant a utilisé des armes chimiques que n’importe quel autre chef d’Etat aura le droit d’utiliser des armes chimiques.
Ce n’est pas inutile…
Non. Mais cette justice véhicule des illusions. Le droit pénal, en réalité, est dangereux pour le droit tout court. Car il s’interprète de façon très stricte. Il suppose que ce qui est interdit soit très rigoureusement défini et délimité. Il suppose aussi que la punition et le niveau de punition appliqué soient tout aussi strictement définis. La justice pénale est également très contraignante par rapport à la preuve. La preuve doit en effet être apportée au-delà du doute raisonnable – lequel, comme on sait, doit prévaloir à l’accusé. Dans des situations comme celles que nous trouvons sur le terrain, où nous voyons que chaque jour, des crimes sont commis, et même des crimes de masse, il faut encore prouver l’intention criminelle et déterminer l’identité des criminels. Car le droit pénal international n’est pas celui de la responsabilité politique des Etats, des armées ou des groupes armés, c’est celui de la responsabilité pénale individuelle. Il faudra donc remonter jusqu’à l’identité de quelqu’un.
Cette question des enchaînements de responsabilités dans une chaîne de commandement qui peut remonter très haut était bien prévue par le droit de la guerre, elle pose des problèmes beaucoup plus complexes dans le cas de la responsabilité pénale, où il faut accéder à des éléments de preuve très difficiles à réunir.
Ce sont donc des certitudes très fragiles que l’on vend à la population en invoquant la menace de la justice pénale internationale. Je comprends que le droit pénal international représente pour certains une avancée, mais je constate aussi qu’il constitue une réelle menace d’illusion, d’hypocrisie, notamment en introduisant l’idée qu’il suffirait de punir pour que justice soit faite.
A vous entendre, il semble assez compliqué d’utiliser les armes du droit contre la Syrie.
Soyons clairs: je ne dis pas que des punitions contre la Syrie ne sont pas nécessaires. C’est même une évidence compte tenu de certains des crimes qui ont été commis. Mais je constate que pour le moment, du point de vue juridique, il n’y a pas grand-chose d’applicable. Ce sera sans doute l’un des défis de l’après-guerre de rendre la justice. Peut-être passera-t-on par un tribunal national. L’Irak l’a fait. Ce qui ne fut pas très glorieux. Et l’expérience a montré que cela ne produit ni plus de paix, ni moins de chaos.
Quand on voit les images des bombardements d’Alep, lorsqu’on lit ou entend les récits des témoins, il est presque incroyable d’apprendre que du point de vue juridique si peu de textes soient applicables.
 C’est pourtant un fait. Ce qui s’est passé en Syrie, c’est une guerre qui s’est inscrite, dès le début, en dehors du droit de la guerre. Comme l’ont fait les Américains dans la guerre contre le terrorisme, comme l’avaient fait les Russes à Grozny, le régime syrien, peut-être guidé par ces exemples, s’est lancé dès les premiers jours dans cette forme de guerre. Dès les premières manifestations, les gens qui protestaient contre le régime et réclamaient sa chute ont été qualifiés par le pouvoir de terroristes.
C’est pourtant un fait. Ce qui s’est passé en Syrie, c’est une guerre qui s’est inscrite, dès le début, en dehors du droit de la guerre. Comme l’ont fait les Américains dans la guerre contre le terrorisme, comme l’avaient fait les Russes à Grozny, le régime syrien, peut-être guidé par ces exemples, s’est lancé dès les premiers jours dans cette forme de guerre. Dès les premières manifestations, les gens qui protestaient contre le régime et réclamaient sa chute ont été qualifiés par le pouvoir de terroristes.
Le gouvernement a expliqué qu’il était confronté non à des revendications politiques, mais à un problème d’ordre public, et que les populations étaient abusées par des terroristes qui se cachaient au milieu d’elles. Première conséquence de cette stratégie: un terroriste n’étant pas un combattant, puisque nous ne sommes pas dans un conflit classique, il n’est pas considéré lorsqu’il est blessé ou malade comme un combattant, relevant d’une catégorie de gens qui ont droit aux secours. Un terroriste n’a pas droit aux secours.
Dans le silence le plus total, le droit humanitaire est mort dès ce moment-là en Syrie. On a ainsi privé les combattants blessés de secours, mais aussi du soutien de la population. Et on a criminalisé tous ceux qui leur fournissaient de l’aide: pharmaciens, médecins, infirmières. On peut juger abominable et scandaleuse une telle incrimination, mais le fait est qu’elle existe aussi aux Etats-Unis, en Turquie, en Russie, en Australie, au Royaume-Uni, en Suède et en France. Oui, le concept de soutien matériel au terrorisme existe aussi chez nous.
En juin dernier, j’ai été entendue par le comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l’ONU pour demander, au nom de MSF, que le secours médical en période de conflit soit exclu de toute législation antiterroriste. Je n’ai toujours pas de réponse. Nous avions pris cette décision à la suite des attaques dont plusieurs hôpitaux avaient été la cible, en Syrie et ailleurs. Nous avions lancé une campagne pour montrer que les attaques d’hôpitaux n’étaient pas des accidents ou des coïncidences, mais la conséquence logique de la criminalisation du secours.
Dans cette nouvelle forme de conflit, un terroriste blessé reste un terroriste, alors qu’en application du droit de la guerre, un combattant blessé est hors de combat. Il faut que ce soit clair, et c’est ce sur quoi nous entendons nous battre: dans la guerre contre le terrorisme, le droit au secours a disparu.
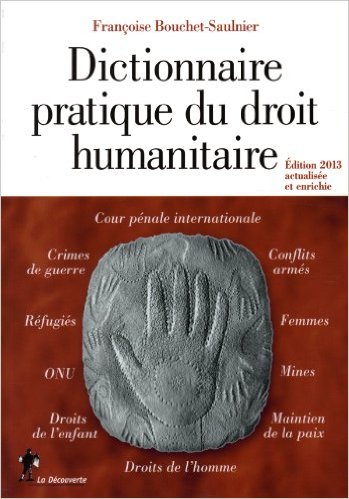 Autrement dit, après l’invention de cette forme de guerre par Bush, les guerres qui ont suivi ont changé de nature du point de vue de la protection des civils.
Autrement dit, après l’invention de cette forme de guerre par Bush, les guerres qui ont suivi ont changé de nature du point de vue de la protection des civils.
Exactement. Je dois ajouter que Bush n’est pas le seul responsable de cette évolution. Les Russes avaient ouvert la voie en Tchétchénie. Il y a eu, de ce point de vue, une sorte de complicité russo-américaine qui a duré quelque temps. Les Etats-Unis et la Russie ont partagé la même grille d’analyse et le même détachement par rapport aux contraintes du droit de la guerre. Ils en ont aujourd’hui des lectures symétriques. Israël a aussi été très en pointe dans la doctrine de lutte contre le terrorisme, avec un raffinement juridique remarquable qui peut déboucher sur un véritable vertige opérationnel. Mais j’insiste sur ce point: ce qui relève de la spécificité du conflit israélo-palestinien ne peut pas devenir la matrice juridique de la gestion des problèmes du monde. Or aujourd’hui, on constate partout ce type d’évolution effrayante et les Etats, que ce soit à Bahreïn ou en Syrie, ont repris avec zèle ce modèle juridique puisqu’il leur permet de mener des guerres totales au nom du maintien de l’ordre.
Comment, dans ces conditions de distorsion du droit, s’explique le fait que certains dirigeants se retrouvent quand même devant des tribunaux, internationaux ou non, où ils sont jugés pour leurs crimes de guerre?
L’explication est simple: le droit et la justice fonctionnent lentement. Avec le temps, certains individus qui ont joué un rôle important dans un processus civil ou militaire peuvent paraître moins indispensables, et se retrouver lâchés par l’Etat qu’ils servaient. C’est le cas par exemple de Slobodan Milosevic, qui a signé les accords de Dayton avant de se retrouver devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie de La Haye. Dans d’autres cas – je pense à feu Mouammar Kadhafi, pour faire un exemple –, beaucoup ont à redouter de ce qu’ils pourraient dire devant un tribunal et on s’arrange pour que cela n’arrive pas.
C’est parce que le facteur temps est important, dans le domaine du droit de la guerre, que la justice a inventé le principe d’imprescriptibilité. En fait, ce principe d’imprescriptibilité intègre la notion de rapport de force. Il permet d’attendre que l’heure de la justice arrive. La justice est un idéal, une valeur morale. Dans un monde confronté aux horreurs de la guerre, il serait désastreux qu’un usage abusif des idéaux conduise à la disparition des idéaux. Faire croire que la justice peut se manifester, partout, sous la forme d’une transcendance quasi métaphysique, c’est profondément dangereux. C’est pourquoi le droit de la guerre est si important. Parce qu’il ne demeure que lui lorsque tout le reste a disparu. (Entretien publié sur le site Mediapart le 14 octobre 2016; titre réd. A l’Encontre)


Soyez le premier à commenter