 Par Pierre Dardot et Christian Laval
Par Pierre Dardot et Christian Laval
Pierre Dardot, philosophe et Christian Laval, sociologue invitent à s’engager dans le mouvement des gilets jaunes pour s’assurer que «l’esprit profondément démocratique du mouvement» se perpétue et éviter «les tentations fascisantes qui pourraient se développer en cas d’échec et de pourrissement».
***
Rarement dans l’histoire un président de la République n’a été à ce point haï comme l’est aujourd’hui Emmanuel Macron. Son intervention télévisée du 10 décembre, solennisée à souhait, et les miettes qu’à cette occasion il a distribuées avec «compassion» aux plus pauvres, sans revenir en aucune façon sur les mesures les plus injustes encouragées ou décidées par lui-même, d’abord en tant que conseiller de Hollande, puis comme ministre de l’économie et enfin comme président, ne changera rien à ce fait.
L’explication de ce rejet massif, on la connaît: le mépris de classe dont il a fait preuve, à la fois dans ses actes et dans ses paroles, lui revient violemment, avec toute la force d’une population en colère, et il n’y a là rien que de très mérité. Avec le soulèvement social des gilets jaunes, le voile se déchire, au moins pour un moment. Le «nouveau monde» c’est l’ancien en pire : tel est le message principal envoyé par les porteurs de gilet jaune depuis novembre dernier. En 2017, Macron et son entreprise «En marche» se sont servis de la profonde détestation des classes populaires et moyennes envers des gouvernants qui n’avaient eu de cesse jusque-là que d’aggraver leur situation au travail et dans leur vie quotidienne pour s’imposer contre toute attente dans la course à la présidence.
Dans cette conquête du sommet des institutions, Macron n’a pas hésité à utiliser cyniquement le registre populiste du dégagisme et de la table rase pour l’emporter, lui qui ne fut jamais que le «candidat de l’oligarchie», et notamment de sa corporation d’élite, l’inspection des finances [1]. La manœuvre était grossière mais elle a fonctionné par défaut. Il a gagné, avec des idées minoritaires, par un double vote de rejet, au premier tour celui des partis néolibéraux-autoritaires (les jumeaux du Parti socialiste et des Républicains) et au second tour, celui de la candidate du parti néofasciste français. En guise de renouveau, depuis le printemps 2017, les électeurs ont eu droit à une aggravation et à une accélération sans précédent de tout ce qu’ils avaient rejeté auparavant. Ils ont subi, sidérés, un déferlement de mesures qui, l’une après l’autre, affaiblissaient le pouvoir d’achat et le pouvoir d’agir des classes populaires et moyennes, et ceci au profit des classes les plus favorisées et des grandes entreprises.
Le clivage de classe
Les sondages récents sur ce point ne trompent pas: le clivage de classe apparaît au grand jour dans les condamnations de la politique macronienne. Que le rétablissement de l’ISF (Impôt sur la fortune), l’augmentation des minima sociaux et du SMIC et le rétablissement de l’indexation des retraites sur l’inflation se retrouvent dans les principales revendications des gilets jaunes qui vont bien au-delà de la suppression de la hausse de la taxe sur les carburants et le moratoire sur le coût de l’électricité et du gaz, en dit long et beaucoup sur la signification sociale du mouvement. Seule la propagande éhontée du gouvernement sur les Ligues de 1934, les «séditieux» et les «factieux», complaisamment relayée par les médias inféodés et par quelques «personnalités médiatiques» ou par quelques dirigeants syndicaux dévoyés, a pu faire croire à certains que le mouvement était intrinsèquement fasciste.
Il faut le dire et le redire ici avec force: si l’extrême droite a tenté de récupérer cette colère populaire, et si elle y parvient éventuellement, ce ne sera que par la faillite de la gauche politique et des syndicats dans leur fonction de défense sociale des intérêts du plus grand nombre. Les gilets jaunes, que cela plaise ou non, ont réussi ce que trente ans de luttes sociales n’ont pas réussi à faire: mettre au centre du débat la question de la justice sociale. Mieux, ils ont imposé on ne peut plus clairement la question fondamentale pour toute l’humanité du lien entre justice sociale et justice écologique.
Une révolte anti-néolibérale
On ne peut comprendre cette révolte sociale qu’en la mettant en rapport avec le type de transformation que l’actuel pouvoir entend renforcer par l’acharnement fiscal et la brutalité réglementaire. La «révolution» macronienne n’est jamais que la mise en œuvre sur un mode radical et précipité d’une conception dominante de la société fondée sur la concurrence, la performance, la rentabilité et le «ruissellement» de la richesse depuis son sommet. Prolongeant une politique constante de défiscalisation du capital et des entreprises, il a continué et amplifié le transfert de la charge fiscale et sociale vers les ménages, surtout les plus modestes, en augmentant les impôts les plus inégalitaires qui portent sur la consommation au nom de la «compétitivité». En d’autres termes, c’est en choisissant la voie la plus purement néolibérale que Macron a cherché à transformer la France, voulant ainsi, par cette «révolution» qui lui servait de programme, se faire le bon élève tout à la fois du patronat, des commissaires européens, et des «investisseurs internationaux». Il n’était pas le premier, il ne sera sans doute pas le dernier, mais il a voulu exceller dans le genre, mieux que Sarkozy et Hollande réunis.
Mais il n’a sans doute pas eu les épaules assez larges ni toute l’adresse requise pour transformer les «gaulois réfractaires», les «illettrés» et les «gens de rien» en adeptes de la «start-up nation» et en partisans de la baisse du coût du travail. Gérer l’État et diriger le gouvernement comme un grand patron le ferait dans une multinationale, selon les nouvelles normes d’une haute fonction publique convertie aux idéaux capitalistes, n’y a pas suffi. La centralisation et la verticalité de la Cinquième République, la répression policière tous azimuts, l’enrégimentement, jusqu’à la néantisation, d’une majorité parlementaire composée de fades néophytes et d’opportunistes patentés, ont été jusqu’à ce jour des moyens institutionnellement puissants mais néanmoins insuffisants pour faire accepter à la population la dégradation de ses conditions de vie et la réduction de ses moyens d’agir, aussi bien à l’échelle communale qu’au niveau des lieux de travail.
La vie réelle l’a emporté sur les illusions d’une oligarchie aveuglée par sa «vérité» et qui avait cru son heure venue par la miraculeuse élection d’un président infantilement ivre de la toute-puissance politique que lui donnaient des institutions foncièrement anti-démocratiques. Le soulèvement social des gilets jaunes, en enrayant la machine néolibérale de Macron, a montré les limites de ce qu’il faut bien appeler son bonapartisme managérial.
Une dernière manœuvre?
Cette pratique autoritaire du gouvernement a fait que le néolibéralisme a atteint un point de rupture. Sans doute les actuels gouvernants, soutenu par le patronat, tentent-ils une dernière manœuvre dont on peut d’ores et déjà deviner la nature, et qui consiste à utiliser la crise sociale et politique pour renforcer la néolibéralisation de la société plus subtilement que le «Blitzkrieg» de la première saison de Macron. On en connaît déjà les principaux arguments. Le premier, avec l’appui sans aucun scrupule déontologique de toutes les chaînes de télévision et de radio, c’est l’habituel appel à l’ordre devant les «violences» attribuées unilatéralement aux manifestants, naturellement complices des jeunes délinquants qui se sont livrés au pillage en fin de manifestation.
Faire peur et en même temps solliciter l’aide de toutes les forces « responsables », c’est non seulement exonérer le gouvernement de ses propres responsabilités, c’est aussi masquer toutes les violations des libertés les plus fondamentales comme celle de manifester (2000 interpellations arbitraires), et justifier les méthodes violentes utilisées par les forces de police contre les manifestants (notamment l’usage dangereux de flash balls et de grenades dites de désencerclement). De ce point de vue, l’humiliation collective imposée aux lycéens de Mantes-la-Jolie rappelle les pires méthodes du colonialisme, dans la continuité du «traitement» de la révolte de 2005, et rend les propos de Ségolène Royal particulièrement révoltants.
 Le second consiste à reprendre aux manifestants tout ce qui, dans leurs revendications disparates, va dans le sens d’une réduction des dépenses publiques. C’est la tactique déjà choisie par Geoffroy Roux de Bézieux, porte-parole du MEDEF, n’hésitant pas à vanter l’efficacité de la baisse des taxes par Trump! Faire de cette grande mobilisation sociale un mouvement néopoujadiste de petites entreprises écrasées d’impôts et de charges sociales, mus par le «ras-le-bol» fiscal plutôt que par l’injustice sociale, a l’avantage de faire croire que le seul moyen d’augmenter le pouvoir d’achat consiste à réduire la part socialisée du revenu et à diminuer l’offre de services publics consécutivement à une baisse d’impôts (car il n’est pas question dans le contexte actuel de baisser dépenses militaires et policières). A moins que, sur un mode plus sarkozien, et cela semble la voie choisie par Macron qu’il s’agisse d’inciter aux heures supplémentaires défiscalisées, comme en rêve là encore le MEDEF. Cela évite évidemment de toucher aux privilèges fiscaux des plus riches, à la liberté accordée à l’évasion de la richesse, aux scandales du CICE et du CIR, dispositifs qui, sans aucune contrepartie, ni contrôle ni contrainte, consistent à transférer des dizaines de milliards aux entreprises dont la plupart n’ont pas besoin.
Le second consiste à reprendre aux manifestants tout ce qui, dans leurs revendications disparates, va dans le sens d’une réduction des dépenses publiques. C’est la tactique déjà choisie par Geoffroy Roux de Bézieux, porte-parole du MEDEF, n’hésitant pas à vanter l’efficacité de la baisse des taxes par Trump! Faire de cette grande mobilisation sociale un mouvement néopoujadiste de petites entreprises écrasées d’impôts et de charges sociales, mus par le «ras-le-bol» fiscal plutôt que par l’injustice sociale, a l’avantage de faire croire que le seul moyen d’augmenter le pouvoir d’achat consiste à réduire la part socialisée du revenu et à diminuer l’offre de services publics consécutivement à une baisse d’impôts (car il n’est pas question dans le contexte actuel de baisser dépenses militaires et policières). A moins que, sur un mode plus sarkozien, et cela semble la voie choisie par Macron qu’il s’agisse d’inciter aux heures supplémentaires défiscalisées, comme en rêve là encore le MEDEF. Cela évite évidemment de toucher aux privilèges fiscaux des plus riches, à la liberté accordée à l’évasion de la richesse, aux scandales du CICE et du CIR, dispositifs qui, sans aucune contrepartie, ni contrôle ni contrainte, consistent à transférer des dizaines de milliards aux entreprises dont la plupart n’ont pas besoin.
Cette manœuvre obligera à désigner des boucs émissaires, évidemment. Pourquoi ne pas cibler, non les «riches» comme le voudraient sans doute la majorité des gilets jaunes, mais les fonctionnaires de la base, trop nombreux, trop bien payés, pas assez productifs ? Pourquoi ne pas leur demander quelques sacrifices supplémentaires au nom de la solidarité avec les plus pauvres ? On sait que parmi «les corps intermédiaires» syndicaux, il y en a qui ont déjà le stylo à la main pour entériner les reculs sociaux les plus flagrants. A moins encore, et ce n’est pas le moins scandaleux de l’allocution présidentielle, qu’il ne s’agisse de remettre la «question de l’immigration», voire de l’islam, au centre du débat, alors même qu’elle n’est pas du tout au cœur des discours des gilets jaunes.
Les deux voies
Cependant rien n’est joué avec l’intervention télévisée de Macron du 10 décembre. Rien ne dit que la colère ne rentrera dans son lit rapidement. Ce serait bien étonnant tant le pouvoir est ébranlé. Deux autres voies s’ouvriront bientôt à la société française comme elles s’ouvrent à toutes les sociétés du monde. La voie nationaliste, protectionniste, hyperautoritaire, anti-écologiste, celle des Trump, Bannon, Salvini, Le Pen, Bolsonaro, Orban ou Erdogan, qui prospère un peu partout dans le monde en exploitant toutes les frustrations et ressentiments engendrés par le néolibéralisme. Loin d’être une alternative à ce dernier, cette voie en est une version historique nouvelle, radicalement anti-démocratique, à un moment où les conséquences sociales, politiques et environnementales posent la question du changement de fond en comble du système économique et politique. Il s’agit de faire croire que la restauration d’un État-nation gouverné d’une main de fer, doté de tous ses attributs de souveraineté interne et externe, capable de fermer ses frontières aux migrants, d’imposer à la population les lois les plus dures de la finance et du marché et de refuser tous les accords de coopération internationale sur le climat, est la seule manière d’améliorer la situation sociale de la grande majorité de la population. Trump est aujourd’hui le champion toute catégorie de cette ligne et il est grandement aidé dans ce rôle par Macron.
La voie démocratique, écologique et égalitaire, qui s’est affirmée depuis plusieurs décennies dans toutes les luttes sociales et les résistances au néolibéralisme, dans l’altermondialisme, dans le mouvement des places, dans les multiples laboratoires des communs, est la seule capable d’éviter l’effondrement des écosystèmes et le délitement et la fragmentation des sociétés. Elle a pour seul défaut de n’avoir pas encore d’expression majoritaire et de forme politique nouvelle. C’est qu’elle a d’abord pâti de la trahison de la gauche gouvernementale, notamment «sociale-démocrate», et qu’elle est aujourd’hui tragiquement affaiblie par les divisions de dirigeants d’organisations plus soucieux de leurs intérêts de boutique que par leur responsabilité historique.
La question la plus actuelle est donc de savoir si le soulèvement des gilets jaunes permettra ou non de faire que la ligne démocratique, écologique et égalitaire, l’emporte sur la ligne identitaire, nationaliste, aux relents fascistes qui a gagné en Italie et aujourd’hui au Brésil.
Le refus de la représentation politique et l’auto-organisation du mouvement
On l’a souvent observé, le mouvement réunit des individus de différentes classes, d’âges différents, d’opinions différentes. Certaines dérives de type raciste, misogyne ou franchement fasciste ont eu lieu, et peuvent encore survenir ici et là, et même se développer. Des pillages et des cassages de boutiques par des bandes de jeunes ont eu lieu dans certains quartiers de la capitale et dans plusieurs centres-villes, qui ont servi d’alibi pour discréditer le mouvement social. Ce n’est pourtant pas la logique profonde du mouvement, divers, pluriel et souvent animé à la base par des femmes. Si un illuminé isolé a appelé un général au pouvoir, il n’est en rien le représentant légitime d’un mouvement qui refuse justement toute usurpation par la représentation.
La logique actuelle et profonde du mouvement n’est pas de s’en remettre à un leader incarnant le peuple, n’en déplaise aux théoriciens du populisme pour qui c’est le représentant qui fait le peuple et lui donne son unité. Il n’est pas non plus de renouveler la «représentation nationale» après dissolution, n’en déplaise aux dirigeants de la France insoumise ou du Rassemblement national qui cherchent à canaliser le mouvement sur le terrain parlementaire. Chacun sait, ou devrait savoir, qu’à ce jeu-là, c’est le parti néofasciste qui raflera la mise. Sans préjuger du dénouement du mouvement des gilets jaunes, la première leçon qu’on peut en dégager est la capacité instituante dont ils ont fait preuve, en refusant d’avance toute récupération et en ne se fiant qu’à leur force collective pour se faire entendre et formuler leurs revendications sans calcul tactique d’appareil, en partant des seules conditions insupportables vécues par des individus réels et jusque-là invisibles.

Ce qui a été à longueur d’antennes et de plateaux de télévision présentée comme la principale faiblesse du mouvement, son «incapacité» à se faire représenter, est pourtant sa caractéristique la plus remarquable, dont il faut comprendre la portée: ce n’est pas d’une «incapacité» dont il faut parler, c’est d’un refus de principe de toute représentation. Et ce refus est pleinement justifié. Qu’il y ait là une conséquence d’une profonde crise de légitimité des gouvernements, des élus, des médias et même des syndicats, crise provoquée et accentuée par la radicalisation néolibérale des oligarchies, cela ne fait guère de doute. Mais il y a un autre aspect, qui n’est guère relevé par le commentaire et qui est pourtant la contrepartie positive de ce refus de toute représentation. C’est que face à cet évidement d’une démocratie représentative qui ne représente plus la société, la réponse la plus spontanée des gilets jaunes a été l’auto-organisation des actions, des barrages, des blocages et des manifestations, jusqu’à l’élaboration collective, au cours de réunions et d’assemblées, des revendications collectives.
Formidable leçon pour les partis et les organisations syndicales dont le réflexe traditionnel est d’encadrer les masses et de faire descendre du haut vers le bas les demandes, les consignes et les mots d’ordre. Ce n’est plus Nuit debout sans doute, mais le point commun avec l’occupation des places est bien le désir mis en action de prendre les affaires collectives en mains propres. L’appel des gilets jaunes de Commercy [le texte a été publié avec une vidéo en date du 5 décembre 2018 sur le site A l’Encontre] est exemplaire de l’esprit de démocratie directe qui anime les comités de base. Il vaut la peine d’en citer de larges extraits:
« Ici à Commercy, en Meuse, nous fonctionnons depuis le début avec des assemblées populaires quotidiennes, où chaque personne participe à égalité. Nous avons organisé des blocages de la ville, des stations-service, et des barrages filtrants. Dans la foulée nous avons construit une cabane sur la place centrale. Nous nous y retrouvons tous les jours pour nous organiser, décider des prochaines actions, dialoguer avec les gens, et accueillir celles et ceux qui rejoignent le mouvement. Nous organisons aussi des « soupes solidaires » pour vivre des beaux moments ensemble et apprendre à nous connaître. En toute égalité. Mais voilà que le gouvernement, et certaines franges du mouvement, nous proposent de nommer des représentants par région ! C’est-à-dire quelques personnes qui deviendraient les seuls « interlocuteurs » des pouvoirs publics et résumeraient notre diversité. Mais nous ne voulons pas de « représentants » qui finiraient forcément par parler à notre place ! (…) Ce n’est pas pour mieux comprendre notre colère et nos revendications que le gouvernement veut des « représentants » : c’est pour nous encadrer et nous enterrer !» Comme avec les directions syndicales, il cherche des intermédiaires, des gens avec qui il pourrait négocier. Sur qui il pourra mettre la pression pour apaiser l’éruption. Des gens qu’il pourra ensuite récupérer et pousser à diviser le mouvement pour l’enterrer.
«Mais c’est sans compter sur la force et l’intelligence de notre mouvement. C’est sans compter qu’on est bien en train de réfléchir, de s’organiser, de faire évoluer nos actions qui leur foutent tellement la trouille et d’amplifier le mouvement ! Et puis surtout, c’est sans compter qu’il y a une chose très importante, que partout le mouvement des gilets jaunes réclame sous diverses formes, bien au-delà du pouvoir d’achat ! Cette chose, c’est le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. C’est un système nouveau où « ceux qui ne sont rien » comme ils disent avec mépris, reprennent le pouvoir sur tous ceux qui se gavent, sur les dirigeants et sur les puissances de l’argent. C’est l’égalité. C’est la justice. C’est la liberté. Voilà ce que nous voulons! Et ça part de la base!
«Si on nomme des « représentants» et des «porte-parole », ça finira par nous rendre passifs. Pire : on aura vite fait de reproduire le système et fonctionner de haut en bas comme les crapules qui nous dirigent. Ces soi-disant « représentants du peuple » qui s’en mettent plein des poches, qui font des lois qui nous pourrissent la vie et qui servent les intérêts des ultra-riches ! Ne mettons pas le doigt dans l’engrenage de la représentation et de la récupération. Ce n’est pas le moment de confier notre parole à une petite poignée, même s’ils semblent honnêtes. Qu’ils nous écoutent tous ou qu’ils n’écoutent personne !
« Depuis Commercy, nous appelons donc à créer partout en France des comités populaires, qui fonctionnent en assemblées générales régulières. Des endroits où la parole se libère, où on ose s’exprimer, s’entraîner, s’entraider. Si délégués il doit y avoir, c’est au niveau de chaque comité populaire local de gilets jaunes, au plus près de la parole du peuple. Avec des mandats impératifs, révocables, et tournants. Avec de la transparence. Avec de la confiance.»
Quiconque a vu les auteurs de cet appel se relayer à tour de rôle devant le micro pour éviter toute captation de la parole par un «représentant» comprend instantanément la profondeur de l’exigence démocratique qui anime ce mouvement. Encore une fois c’est beaucoup plus qu’une défiance, c’est un refus de la substitution en vertu de laquelle une minorité s’arroge le droit de parler et d’agir à la place du plus grand nombre. Il faut saluer la grande clairvoyance de cette déclaration : dès le 6 décembre, les « représentants » syndicaux, à l’exception notable de Solidaires, se sont empressés de venir au secours d’un Macron totalement isolé et sonné, ce qui n’a pas manqué de susciter une réaction de révolte à l’intérieur même de la CGT. Les fameux « corps intermédiaires » relèvent pleinement de la logique de la représentation et c’est bien pourquoi ils ne peuvent qu’aider Macron à reprendre la main, bien loin de pouvoir incarner une issue positive à la crise du régime.
Bien évidemment, rien ne garantit que les possibles ouverts par cette démocratie en action se réaliseront. La seule chose qui importe en cet instant, c’est qu’il vaut la peine de lutter pour cette réalisation. Laissons aux néoblanquistes de «l’insurrection qui vient» et aux autres célébrants de la «violence pure » leur mépris pour l’invention démocratique. Les casseurs qui se greffent sur les manifestations et qui ne participent en rien aux décisions collectives contribuent également à déposséder le mouvement de sa démocratie interne. Toute la question est de savoir si l’esprit profondément démocratique du mouvement sera assez profond pour se perpétuer et immuniser la société des tentations fascisantes qui pourraient se développer en cas d’échec et de pourrissement. Et cette seule question engage bien évidemment notre responsabilité, toute notre responsabilité.
Le quiétisme politique est une faute
Un étrange raisonnement révèle bien l’embarras profond d’une partie de la gauche dite « radicale » face à ce mouvement singulier et inédit qui déjoue toutes les catégories de son lexique politique conventionnel. Il consiste à faire valoir qu’un tel mouvement «risque» de dériver dans un mauvais sens, réactionnaire ou fascisant, dans la mesure où il ne présente pas toutes les garanties requises pour nous rassurer sur son avenir politique. C’est cette appréciation du risque qui commande une attitude de prudence, quand ce n’est pas un refus de se commettre avec ceux qui ne satisfont pas aux critères qui permettent de reconnaître qu’on a bien affaire au «peuple», au vrai, à celui qui porte les authentiques valeurs de la gauche, s’identifie à ses objectifs et à ses combats et, qui, lui, ne risque pas d’être entraîné sur la pente du fascisme.
 Ce raisonnement appelle deux remarques. La première concerne l’usage du mot « peuple ». Manifestement, il est ici investi d’un sens tout idéal : il est «le» peuple au singulier, auprès duquel le peuple réel, nécessairement impur et bigarré, fait pâle figure, sommé qu’il est de se conformer à cet idéal afin de mériter cette dénomination prestigieuse. S’il n’y parvient pas, il justifie par cet échec qu’on s’écarte de lui et qu’on le laisse à lui-même. Malheureusement, ce peuple idéal n’existe pas, si ce n’est dans le ciel quasi platonicien du gauchisme inaltérable. Pas plus que « le » peuple entendu comme « communauté des citoyens », si cher à la tradition dite « républicaine » et rituellement ressuscité à chaque grande élection en même temps que la mystification de l’« intérêt général », qui n’est jamais qu’«un» peuple construit sur mesure par les institutions politiques existantes pour le plus grand profit de l’oligarchie.
Ce raisonnement appelle deux remarques. La première concerne l’usage du mot « peuple ». Manifestement, il est ici investi d’un sens tout idéal : il est «le» peuple au singulier, auprès duquel le peuple réel, nécessairement impur et bigarré, fait pâle figure, sommé qu’il est de se conformer à cet idéal afin de mériter cette dénomination prestigieuse. S’il n’y parvient pas, il justifie par cet échec qu’on s’écarte de lui et qu’on le laisse à lui-même. Malheureusement, ce peuple idéal n’existe pas, si ce n’est dans le ciel quasi platonicien du gauchisme inaltérable. Pas plus que « le » peuple entendu comme « communauté des citoyens », si cher à la tradition dite « républicaine » et rituellement ressuscité à chaque grande élection en même temps que la mystification de l’« intérêt général », qui n’est jamais qu’«un» peuple construit sur mesure par les institutions politiques existantes pour le plus grand profit de l’oligarchie.
Il faut s’y résoudre : le peuple réel n’est jamais le peuple idéal. Laissons aux bureaucrates et autres avant-gardistes patentés le rêve du peuple idéal. Au lendemain du soulèvement populaire du 17 juin 1953 à Berlin Est Brecht demandait déjà : «Ne serait-il pas plus simple alors pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d’en élire un autre? [2]» Sauf à verser dans une demande non moins extravagante du type «changeons de peuple!», qui met assurément à l’abri de toute déception, il faut se résoudre à l’hétérogénéité et à l’impureté du peuple réel. Tout le reste n’est que diversion.
Faut-il pour autant renoncer à distinguer entre le «peuple social» et le «peuple politique»? Le peuple social se définit par opposition aux élites ou à l’oligarchie, par la pauvreté et la misère, mais il n’est rien moins qu’homogène et unifié, tant il est traversé de tensions et de contradictions, comme on le voit justement aujourd’hui. Le vrai peuple politique n’est pas le peuple des électeurs, ni le peuple sociologiquement défini par la pauvreté ou la misère, il est le peuple qui agit, le peuple-acteur qui invente dans l’action de nouvelles formes d’auto-organisation.
Ce peuple-là n’est jamais «le» tout, il n’est toujours qu’une partie, mais il est cette partie qui ouvre de nouvelles possibilités au «tout», c’est-à-dire à toute la société. C’est cette partie qui est aujourd’hui en mouvement, et cela suffit pour se déterminer. Le «peuple de gauche» n’est qu’une invention mensongère des vieux partis dont la seule fonction est de remobiliser leur base électorale à l’approche de certaines consultations ou lorsqu’ils sont mis en difficulté. De manière plus générale, il n’y a que «des» peuples, dont l’irruption est imprévisible et à chaque fois singulière, et l’Un-Tout n’est qu’une illusion mortifère. La coïncidence du peuple social et du peuple politique dans un «grand soir» fantasmé n’est qu’un mythe dont la gauche critique doit se défaire une fois pour toutes.
La seconde remarque est relative à la conclusion pratique que cet argument est destiné à justifier. Aussi surprenant que cela puisse paraître, pareil raisonnement n’est pas sans présenter une certaine similitude avec un argument très ancien, connu de la philosophie grecque sous le nom d’«argument paresseux» ou encore «inerte». Cicéron l’expose dans son Traité du destin en indiquant que si nous l’admettions, nous resterions toute notre vie dans une complète inaction. Il dit en substance à peu près ceci: si tu es malade et que ton destin est de guérir, tu guériras, que tu appelles le médecin ou que tu ne l’appelles pas; mais si ton destin est de ne pas guérir, que tu appelles ou non le médecin, tu ne guériras pas. Or ton destin est de guérir ou de ne pas guérir. Il est donc vain que tu appelles le médecin [3].
On voit en quoi cet argument mérite bien son nom d’argument paresseux : il justifie l’abstention de toute action et incline au quiétisme (ce qui signifie repos en latin). On se récriera contre un tel rapprochement en arguant que ceux qui mettent en garde contre un danger de dérive droitière du mouvement refusent d’invoquer le destin ou la fatalité et se bornent à supputer des risques, c’est-à-dire de simples possibilités. Mais toute la question est justement de savoir quelle attitude adopter à l’égard de ce qui n’est pour l’heure que des «possibilités».
La vertu du rapprochement proposé est de faire ressortir l’attitude quiétiste qui découle de cette supputation distante des possibilités. On raisonne comme si la réalisation de telle possibilité plutôt que de telle autre était complètement indépendante de notre propre action. On se dit sans vraiment oser se l’avouer: si la pire des possibilités se réalise, elle se réalisera, que nous intervenions ou non pour tâcher de la prévenir. C’est par là que l’on retrouve le «sophisme du paresseux». On se place dans la position de celui qui dégage par avance sa propre responsabilité. La prémisse sur laquelle repose cette attitude est la suivante : quelle que soit la possibilité qui finira par advenir, même si c’est la pire, nous n’y sommes pour rien. Ou bien cette possibilité adviendra, ou bien elle n’adviendra pas, mais dans les deux cas il est vain d’intervenir. Si d’aventure elle advient, on en rejette par avance la responsabilité sur les insuffisances et les ambiguïtés du mouvement.
Or s’abstenir d’intervenir pratiquement, ce n’est pas simplement observer de l’extérieur le cours d’une évolution, c’est, qu’on s’en défende ou non, favoriser la réalisation de la possibilité la plus inquiétante et la plus menaçante, celle qui était précisément chargée de justifier le refus d’agir. Il est d’autant plus facile après-coup de dire « on vous l’avait bien dit » que l’on a soi-même directement contribué à faire de cette possibilité négative une réalité.
Aujourd’hui, tout particulièrement, il convient de mettre en garde contre une telle attitude: le quiétisme politique fait le jeu de l’adversaire, et c’est en quoi il est impardonnable. L’urgence commande d’agir dans le mouvement tel qu’il est et avec les gilets jaunes en les prenant tels qu’ils sont et non tels que nous voudrions qu’ils soient, en appuyant résolument tout ce qui va dans le sens de l’auto-organisation et de la démocratie. Répétons-le, rien n’est encore joué. Le présent est neuf, l’avenir est ouvert et notre action importe, ici et maintenant. Acte V. (Blog des auteurs sur Mediapart, publié le 12 décembre 2018)
______
[1] Laurent Mauduit, «Emmanuel Macron, le candidat de l’oligarchie», 11 juillet 2016.
[2] Bertolt Brecht, «La solution», in Anthologie bilingue de la poésie allemande, 1993, La Pléiade, p. 1101.
[3] Cicéron, Traité du Destin, Les Stoïciens, 1978, La Pléiade, p. 484.

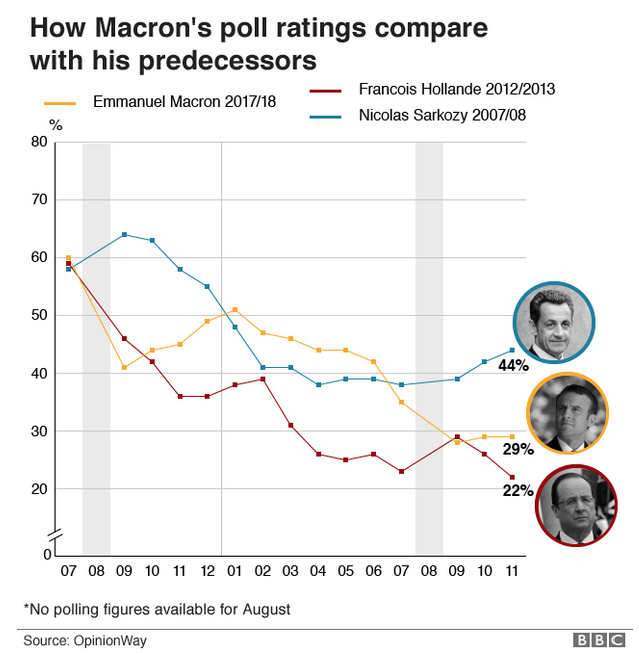

Soyez le premier à commenter