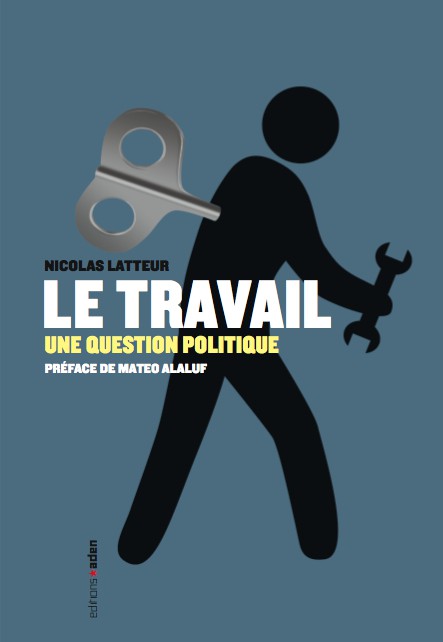 Par Nicolas Latteur, préface de Mateo Alaluf
Par Nicolas Latteur, préface de Mateo Alaluf
Formateur au Cepag (Centre d’éducation populaire proche du mouvement syndical FGTB-Belgique), Nicolas Latteur vient de publier l’ouvrage Le travail, une question politique, paru aux Editions Aden. Préfacé par Mateo Alaluf, cet ouvrage propose de remettre le travail au cœur des rapports de force. Il analyse les fondements de l’organisation du travail sous le mode de production capitaliste. Il décortique ensuite leurs caractéristiques et identifie les dispositifs qui permettent un exercice du pouvoir despotique tant sur le travail que ses conditions et son organisation. Cette perspective sert de base pour construire un positionnement critique qui vise à redéfinir les conditions d’un contre-pouvoir ayant pour projet la transformation politique et l’émancipation sociale. Ce livre est le fruit de rencontres avec des salarié·e·s de différents secteurs d’activité et est basé sur une lecture critique des situations de travail. Il s’interroge sur les conditions de constitution de formes d’actions et de résistances collectives. Nous publions ci-dessous, sous forme de «bonnes feuilles», la préface de Mateo Alaluf et l’introduction. Un livre fort utile pour une réflexion sur la mise en œuvre d’un syndicalisme de combat. (Rédaction A l’Encontre)
Préface
Au début de l’industrialisation, on pouvait lire à l’entrée de certains ateliers: «Il est interdit d’apporter son travail à l’usine.» Le travail salarié consiste à travailler pour des fins extérieures à celui qui exécute la tâche. C’est pourquoi l’activité de travail est rémunérée, normée et légalement codifiée. Le salarié se doit certes d’appliquer les consignes pour conserver son emploi, mais dans un même temps, il coopère avec ses collègues, peut aussi se donner des objectifs propres visant à mieux réaliser son travail, épargner ses efforts, sa santé et celle de ses collègues. Partant de la nécessité personnelle d’occuper un emploi, il se donne au travail des objectifs plus collectifs.
Contrairement aux théories qui ont prôné «la perte de la centralité du travail», il suffit d’observer les efforts des chômeurs pour occuper des emplois, souvent peu rémunérés, déconsidérés et pénibles ou encore d’écouter les personnes privées d’emploi pour comprendre l’importance que revêt le travail dans la vie des individus et les dégâts causés par le chômage. Comme en témoigne, s’il en était encore besoin, la lutte du mouvement féministe contre la domination masculine, le travail n’est pas seulement fait de contraintes et de souffrances mais est aussi et avant tout un facteur d’émancipation sociale et l’enjeu politique le plus disputé.
Dans la pensée libérale, l’offre et la demande déterminent le prix du travail. «La loi d’airain des salaires» postule la vanité de toute coalition ouvrière pour obtenir une hausse des salaires. En effet, si le prix du travail devait augmenter par la pression des ouvriers, l’offre de travail augmenterait simultanément par l’attraction des salaires élevés, de telle sorte que les salaires baisseraient à nouveau pour retrouver leur état équilibre. Pour s’émanciper de la misère qui caractérisait au début de l’industrialisation la condition ouvrière, il fallait donc soustraire le salaire aux «lois du marché».
La négociation collective des salaires, la limitation légale de la journée du travail, le financement de la protection sociale par une cotisation prélevée sur le salaire furent autant de moyens de définir le salaire par la délibération collective. Sous l’effet de sa «socialisation», selon le terme de Bernard Friot, le salaire n’était plus alors un prix fixé par le marché, mais un barème issu de la délibération collective. La relation de travail échappait désormais au marché pour relever de la loi.
À partir des années 1980, le tournant néolibéral imprimé par le nouveau régime du capitalisme financiarisé se caractérisera par la volonté obstinée de restauration de la «loi d’airain». La productivité érigée en norme salariale deviendra le levier principal pour «remarchandiser» le salaire et le soustraire au champ politique. Comme le montre Anne Dufresne, les institutions de l’Union européenne et en particulier la Banque centrale européenne (BCE) pèseront de tout leur poids dans ce courant tendant à «dépolitiser le salaire»[1].
La profondeur de la crise actuelle, depuis 2007, résultant pourtant de la pression constante à la baisse des salaires et des prestations sociales et de l’accroissement de la dette privée pour compenser la modération salariale, n’a pas suffi à juguler les mouvements sociaux ou les résistances aux politiques d’austérité malgré l’affaiblissement des capacités de négociation des syndicats lié au chômage de masse. En Belgique, l’offensive pour supprimer l’indexation de manière à permettre, sous couvert de compétitivité, que le salaire redevienne «un prix du marché» n’a pas abouti. La volonté d’introduire, partout en Europe, sous le contrôle de la Banque centrale européenne, «un maximum salarial autorisé» ne parvient pas à s’imposer. Aussi, patronat et milieux libéraux, même s’ils obtiennent des résultats indéniables, ne peuvent pas agir à leur guise.

En pensant le travail comme une question politique, Nicolas Latteur s’inscrit dans le fil d’une histoire sociale qui progressivement a arraché le travail aux mécanismes de marché pour en faire un objet de délibération publique et de négociation collective. Il propose cependant simultanément, face à l’action patronale corrosive sous couvert de flexibilité, d’élargir la capacité d’intervention syndicale à l’organisation du travail.
En vertu de la déclaration commune sur la productivité de 1954, les employeurs acceptaient une répartition équitable des gains de productivité entre les salariés et les entreprises mais gardaient leur prérogative en matière d’organisation du travail. Ce partage des rôles a façonné jusqu’ici les pratiques syndicales focalisées à juste titre sur les salaires, le temps de travail et l’emploi tout en les tenant à distance des questions liées à l’organisation du travail. Or, face à l’agressivité du patronat qui a érigé la flexibilité et la réforme du marché de l’emploi en priorités, Nicolas Latteur prône la nécessité de faire de l’organisation du travail, au même titre que le salaire et l’emploi, une dimension à part entière pour l’action syndicale.
Cette perspective a des implications pratiques pour l’action syndicale. Alors que la négociation salariale au sens large du terme s’inscrit prioritairement dans des conventions collectives sectorielles et des accords interprofessionnels, l’organisation du travail a pour siège l’entreprise. Prendre en compte syndicalement l’organisation du travail nécessite en conséquence de s’appuyer davantage sur les délégations syndicales d’entreprise.
Le travail, pour échapper au marché et devenir une question politique, requiert une mobilisation syndicale constante. Celle-ci cependant doit s’élargir, à la mesure de l’offensive patronale, à l’organisation du travail. Les questions liées aux conditions de travail, à la santé des salariés doivent être prises en compte à leur racine, dans les ateliers, les bureaux, les écoles, les hôpitaux et toutes les cellules de travail. La perspective d’élargir la capacité d’intervention des travailleurs sur leur travail et de diminuer en conséquence l’arbitraire patronal sur l’organisation du travail ne manque certes pas d’audace. C’est pourtant ce qui manque le plus pour conjurer la passivité qui toujours menace. Le livre de Nicolas Latteur constitue incontestablement un outil précieux pour l’action.
Le travail comme question politique et démocratique selon l’expression de Nicolas Latteur engage non seulement l’action syndicale de la base au sommet, mais aussi ses modalités d’intervention et ses structures internes. Le refus de déléguer l’organisation du travail à l’entreprise va, de ce point de vue, de pair avec l’exigence des collectifs de travail de maîtriser les modalités de leur intervention. Pour répondre au «management» qui vise à disqualifier la représentation syndicale en s’appuyant sur les aspirations des salariés à plus d’autonomie, les organisations syndicales doivent approfondir leur démocratie interne. Quelle serait en effet la crédibilité des organisations qui garderaient en leur sein ce qu’elles combattent dans les entreprises? – Mateo Alaluf
Introduction
Ce texte est le fruit de rencontres avec des travailleuses et des travailleurs de différents secteurs d’activités. L’expérience de formateur m’a donné à entendre leurs paroles sur les conditions dans lesquelles le travail s’exerce, sur les formes d’organisation qui l’encadrent et souvent le transforment.
Généralement, dans ces réflexions, une impression de fatalité et d’impuissance domine. Le travail devient de plus en plus intenable physiquement et psychiquement, mais il est souvent entendu qu’on ne peut rien y faire. Certains sont gagnés par le sentiment «qu’on est trop petit pour dire ou faire quoi que ce soit». Un sentiment tenace d’infériorité cantonne nombre de travailleurs dans un rôle de mineur social: ce n’est pas à eux à discuter du travail. Tout au plus peut-on en retirer un revenu et quelque peu l’aménager en reconnaissant sa pénibilité.
Mais d’autres expériences se développent. Certains travailleurs témoignent de leur volonté d’influer sur les conditions de travail et invitent à dépasser tout sentiment d’infériorité ou d’illégitimité. Tournant le dos aux discours sur l’indispensable adaptation à l’univers de travail impitoyable d’aujourd’hui, ils entendent se positionner sur les politiques qui les relèguent d’emblée au rang d’objets à évaluer sur base de leurs performances, à flexibiliser pour qu’ils s’adaptent davantage aux flux des commandes, etc. Plutôt que de concéder aux experts le soin de planifier leurs procédures et leurs conditions de travail, les travailleurs s’occupent ici de ce qui les concerne.
C’est dans ce positionnement politique (élaborer un savoir utile à l’action collective, intervenir sur ce qui nous concerne et sur notre devenir) rencontré et partagé dans des situations de formation que ce texte se situe. Il a pour ambition de proposer une analyse des relations de travail contemporaines et d’identifier des perspectives d’action.
Le travail, une question politique et démocratique
La démarche générale qui sous-tend la rédaction de ce livre pose le travail comme question politique et démocratique.
La politique, entendue au sens large, est le champ où se règle la destinée des populations. Elle concerne la mobilisation d’une capacité d’agir de la société sur elle-même. Elle ne se résume pas à l’action des gouvernements, mais englobe l’activité des mouvements sociaux, des associations et de différents collectifs qui interviennent sur différents espaces (locaux, régionaux, nationaux, internationaux).
La démocratie ne désigne pas ici une forme de gouvernement et d’exercice de pouvoir «raisonnable» de type parlementaire. Elle est une pratique. Suivant Jacques Rancière, la démocratie «est l’action qui sans cesse arrache aux gouvernements oligarchiques le monopole de la vie publique et à la richesse la toute-puissance sur les vies»[2]. Sa logique est la prise de parole et la mise à égalité de ceux qui sont réduits à l’invisibilité.
Une politique démocratique ne peut donc intervenir que dans un sens de mise en cause des rapports de domination. Le travail dans son organisation capitaliste est le théâtre de rapports inégalitaires. Qui décide du travail? Qui le conçoit? Qui l’exécute? Pour qui? À quelles conditions? Les réponses à ces questions mobilisent une lecture des rapports sociaux de domination entre différents groupes sociaux.
Mettre en œuvre une politique démocratique, c’est donc s’inviter et intervenir sur des questions desquelles les travailleurs sont exclus. S’approprier politiquement le travail, c’est-à-dire instituer des délibérations collectives le concernant (quelle activité? quelles conditions? quelles organisations?), est en ce sens partie intégrante d’un processus démocratique.
Cette perspective conçoit la légitimité d’une délibération démocratique sur les fins et les moyens du travail. Elle invite les travailleurs à se dégager d’une place de mineur social où ils auraient pour seul droit de retirer un revenu de leur travail.
Un débat égalitaire est indispensable, loin des formes de dépossession contemporaines qui attribuent à des experts la légitimité de priver des populations d’intervenir dans les domaines qui les concernent, ou à la prétendue main invisible du marché (en réalité les détenteurs de capitaux) le rôle de régulation économique. Comme l’affirme Frédéric Lordon, «ce que l’entreprise (productive) doit fabriquer, en quelle quantité, à quelle cadence, avec quel volume d’emploi et quelle structure de rémunérations, sous quelle clé de réaffectation des surplus, comment elle accommodera les variations de son environnement: aucune de ces choses ne peut par principe échapper à la délibération commune puisqu’elles ont toutes des conséquences communes»[3]. Ce qui affecte tout le monde doit dans ce positionnement politique être l’objet de tous.
L’enjeu du travail comme question politique et démocratique est la réappropriation par les classes populaires des questions essentielles qui règlent leurs conditions de vie. Le mouvement ouvrier – et singulièrement les syndicats – est l’acteur qui a permis une certaine politisation du travail. Si historiquement, le salaire était une question privée soumise selon les employeurs aux contraintes du marché (la loi de l’offre et de la demande), il deviendra une question politique soumise à des délibérations collectives entre les parties suite à la formation de coalitions ouvrières qui vont progressivement imposer une négociation autour des conditions de travail. De même que le temps de travail, le chômage, les accidents de travail, les maladies professionnelles seront définies comme questions politiques.
Définir la démocratie comme un processus qui arrache du pouvoir aux gouvernements oligarchiques et à la richesse, c’est aussi concevoir son déploiement comme produit de rapports de forces. Les sociétés capitalistes sont caractérisées par un principe de division de la population en deux ou plusieurs groupes[4]. Ces groupes sont différenciés par leurs rôles, leurs statuts, traversés par d’autres relations (entre les sexes, entre les générations, entre les cultures, etc.) et sont hiérarchisés les uns par rapport aux autres. Ils sont plus ou moins organisés (syndicats de travailleurs, d’employeurs, lobbies, etc.), développent leurs propres stratégies (disposer ou non de relais politiques) et se confrontent dans le cadre de relations inégalitaires en perpétuelles transformations.
Remettre le travail au cœur des rapports de force
Précarisation des salariés par le recours massif au travail intérimaire et à la sous-traitance, menace de délocalisation, peur du chômage, restructuration, harcèlement continuel des travailleurs soumis à des impératifs de productivité intenables, individualisation des relations de travail, procédures d’évaluation individuelles, troubles musculo-squelettiques, substances dangereuses, risques d’accidents de travail… sont le lot de la plupart des salarié·e·s.
Que faire? Il n’y a aucun livre de recettes ni aucune boîte à outils. Car ces derniers délivrent des modèles d’intervention clef sur porte, souvent conçus comme de simples techniques à exécuter afin de diminuer la charge psycho-sociale. Or ces réalités sont produites par des acteurs qui interviennent au sein de rapports sociaux sur lesquels il s’agit de peser. Aucune technique n’est neutre. Dans la logique managériale contemporaine, la conception du travail est définie par des procédures à respecter par les travailleurs. Il serait ironique que le combat contre ces formes d’organisation épouse cette logique de dépossession et fasse des travailleurs les simples exécutants de modèles d’intervention définis par d’autres.
Chercher collectivement à comprendre ces rapports sociaux, mobiliser des savoirs et des expériences, identifier les modes d’action possible fait partie intégrante d’une démarche de réappropriation des questions politiques. Ce positionnement nécessite de construire des lectures critiques des rapports sociaux. Critiques au sens où ces «logiciels de pensée» sont élaborés grâce à des confrontations d’expériences. Les connaissances ne font pas autorité, elles sont mobilisées et produites afin de dégager des formes d’émancipation possibles. Ces lectures supposent donc la capacité de chacun à être un acteur politique et non la compétence d’une minorité à éclairer les dominés sur les rapports de domination dont ils sont l’objet. Elles sont également critiques car elles ne se résignent pas à la réalité et ne visent pas à la légitimer.
Cette démarche trace des lignes de démarcation avec d’autres approches. De manière générale, le monde patronal propose de psychologiser les relations de travail et de stimuler la motivation afin de poser comme enjeu central l’adaptation des individus aux exigences de la production capitaliste. Activer les chômeurs et assurer l’employabilité des forces de travail deviennent des priorités gouvernementales. Dans cette perspective, les politiques mises en œuvre porteront sur la gestion de soi (de son stress, de ses compétences, de son «savoir-être»). La réappropriation politique du travail par les mouvements sociaux passe par la mise en question de son utilité (sociale et écologique notamment), des critères de définition de la valeur économique (comment attribue-t-on de la valeur à certaines activités et pas à d’autres, sur base de quels critères) et par la construction de résistances collectives fortes afin de redéfinir démocratiquement le travail et ses conditions.
Afin de créer ce rapport de forces, les mouvements sociaux ne partent pas de rien. Des expériences existent et sont vitales pour informer ceux et celles qui luttent aujourd’hui. Elles sont fondées sur leur autonomie. Car la manière de se représenter les situations conditionne les revendications et les moyens d’action qui seront choisis afin d’intervenir sur elles. Analyser le travail, ses conditions et ses formes d’organisation est dès lors beaucoup plus qu’une affaire de mots. C’est proposer une autre carte de ce qui est pensable afin qu’elle puisse contribuer à construire des points d’appui pour des pratiques de transformation sociale. C’est se préparer à intervenir en fonction des caractéristiques des forces en présence et de leurs réactions possibles.
Proposer une analyse et des moyens d’action suppose que l’on construise un positionnement impliquant massivement les travailleurs. La pratique du contrôle démocratique suppose l’indépendance des militants. Celle-ci est déterminante à construire d’autant que nombre de pratiques d’organisation du travail – par exemple le management participatif – veulent la briser en tentant de faire de l’équipe syndicale un allié gestionnaire.
Cette question est fondamentale car les militants s’entendent trop souvent dire que l’employeur doit décider seul de telle chose, qu’ils ne sont pas habilités à intervenir sur tel sujet, etc. Sans arrêt, dans ces rapports de forces, les forces opposées tentent de limiter la sphère d’activité de la partie adverse, voire même de la redéfinir entièrement. Ils proposent d’ailleurs souvent «qu’on se mette à leur place». Or, précisément, les mouvements sociaux se sont construits en imposant l’existence de populations, de leurs situations jusque-là invisibles, et en forçant la création de nouveaux espaces qui permettaient l’exercice de droits sociaux là où l’arbitraire organisait auparavant des zones de non-droit. C’est pourquoi il est déterminant de refuser de se mettre à leur place et de définir l’espace sur lequel on s’estime légitime. Cette définition est nécessairement politique car il engage le statut de chacun des membres d’une société.
Suivant le positionnement du mouvement syndical socialiste, les travailleurs n’ont pas à se dessaisir de quelque question que ce soit. Au contraire, si l’émancipation ne peut qu’être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes, rien ne peut justifier qu’une équipe syndicale, que des travailleurs soient dépossédés des questions sociales, en particulier de toutes celles qui concernent le travail, ses conditions, et son organisation.
D’autre part, s’intéresser aux maux du travail sans le requestionner, considérer qu’il n’est pas du ressort des travailleurs et des mouvements sociaux, ne conduit qu’à une approche compassionnelle du monde du travail qui ne permet pas de penser en dehors du périmètre du capital. Une telle pratique mène à l’impasse de l’adaptation des travailleurs aux contraintes du travail et de l’économie telles qu’elles sont définies par d’autres acteurs sociaux. Elle reproduit la conception selon laquelle les salariés sont des mineurs sociaux auxquels on reconnaît seulement le droit d’obtenir un revenu en contrepartie de leur travail et auxquels on dénie toute légitimité à intervenir sur les moyens et les fins du travail [5].
Il s’agit de prendre au sérieux le fait que les richesses sont produites grâce à ce que le travail et les travailleurs apportent. Rappeler que les capitalistes (et parmi ceux-ci la finance capitaliste) n’obtiennent que ce qu’ils s’approprient du travail et de ses résultats débouche sur des perspectives d’action: «Les travailleurs ne sont plus alors considérés comme les victimes du système, mais comme des protagonistes d’un affrontement social. En contestant l’organisation du travail, en créant sur le terrain spécifique du travail un rapport de force, on contribue aussi à contester le système économique.» [6]
Ce positionnement politique implique que des arbitrages collectifs – qui engagent la société dans son ensemble – soient réalisés. Comme le soulignent Erwan Jaffrès et Raphaël Thaller: «Considérer (ou non!) que la souffrance est le sacrifice nécessaire que doivent consentir certains travailleurs pour garantir le taux de rentabilité du capital, relève, par exemple, d’un arbitrage politique. À l’échelle d’une entreprise, définir une organisation du travail, des stratégies commerciales ou de maintenance, des orientations de recrutement,… relève aussi du politique puisque cela aura des impacts sur le produit, le sens et le contenu du travail.» [7] Arbitrer ces questions sur base de critères économiques ou de critères de santé relève également du champ politique.
Dans cet ouvrage, des analyses critiques du travail, de ses conditions et de ses formes d’organisation sont proposées. Critiques car elles n’adhèrent pas au travail tel qu’il est aujourd’hui conçu et ouvrent dès lors la perspective à d’autres formes de relations collectives de travail. C’est pourquoi les liens entre travail et capitalisme seront interrogés, comme seront détaillées les différentes grandes formes d’organisation du travail qui bouleversent la donne du travail salarié. Ensuite, des perspectives d’actions syndicales et politiques seront débattues. – Nicolas Latteur
[1] Anne Dufresne, Le salaire. Un enjeu pour l’euro-syndicalisme, Presses universitaires de Nancy, 2011.
[2] Jacques Rancière, La haine de la démocratie, La Fabrique, 2002, p. 105
[3] Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude, La Fabrique, 2010, p. 170
[4] Alain Bihr, Les rapports sociaux de classe, Page Deux, 2012 et Roland Pfefferkorn, Genre et rapports sociaux de sexe, Page Deux, 2012.
[5] Bernard Friot, L’enjeu du salaire, La Dispute, 2012
[6] Erwan Jaffrès, Raphaël Thaller, «Une lecture “politique” des risques psychosociaux», Droit d’alerte, octobre 2009, p. 3.
[7] Ibidem.

Soyez le premier à commenter