
en mars 1917
Par Maurice Carrez
En date du 14 mai 2017, nous avons publié un article historique sur la «révolution en Finlande». Nous publions une deuxième contribution de Maurice Carrez qui permet de saisir de manière plus complète ce processus révolutionnaire qui est resté, pour l’essentiel, fort peu connu. Dans une autre contribution, l’auteur trace les prodromes de ce soulèvement qui révèle les interactions à l’œuvre dans l’empire russe et ses frontières: «Les événements de 1905 en Russie furent l’occasion de desserrer l’étreinte de l’oppression. En novembre éclata la Grande Grève patriotique, lancée par les ouvriers et soutenue par les constitutionnels et les activistes. La revendication essentielle était l’abrogation des décrets illégaux. Mais le mouvement ouvrier était décidé à pousser son avantage et à réclamer, comme le fit Yrjö Mäkelin à Tampere, un système politique démocratique, un renforcement de l’autonomie et des réformes sociales. Malgré leurs réticences, les partis bourgeois, inquiets de voir surgir un peu partout des gardes rouges, acceptèrent de reprendre à leur compte le premier point. Le tsar pour sa part annula le Manifeste de février et accorda en 1906 le droit d’élire un parlement unicaméral au suffrage universel masculin et féminin (pour la première fois dans le monde). Les derniers soubresauts révolutionnaires furent alors matés au grand soulagement de la bourgeoisie finlandaise, désireuse de contenir la poussée social-démocrate. En 1907, pourtant, celle-ci se manifesta sur le plan électoral par un score de 37% des suffrages, score d’autant plus remarquable qu’il était obtenu dans un pays à forte majorité rurale.
Mais le nouveau système politique n’avait que l’apparence de la démocratie. Le tsar de Russie, qui conservait le droit de décision et de dissolution, s’empressa de refuser toutes les lois qui l’indisposaient et renvoya maintes fois les députés devant les électeurs.
A partir de 1909, une deuxième vague de russification s’abattit sur le pays, menée avec brutalité par le gouverneur général Seyn. La Douma, dominée par les nationalistes, apporta son honteux concours à l’opération. Elle décida en 1910 d’étendre la législation impériale à la Finlande. En 1912, il devint possible à des citoyens russes de siéger au Sénat finlandais.
A la veille de la guerre de 1914 fut publié un programme de russification. Cette fois, les Finlandais présentèrent un front plus uni face à l’agression mais, davantage isolés, ils ne purent empêcher le pire. Quand la guerre commença, l’idée de l’indépendance pleine et entière avait déjà germé dans de nombreuses têtes. En 1915, quelques centaines de jeunes activistes n’hésitèrent pas à s’engager dans un régiment de chasseurs équipé et entraîné par l’Allemagne. Ce fut toutefois la révolution de février 1917 qui donna le signal décisif. Le gouvernement provisoire russe abolit tous les décrets anticonstitutionnels. Le Parlement finlandais, à majorité social-démocrate depuis 1916, se déclara, en août 1917, souverain en matière de politique intérieure. Kerenski n’hésita pas alors à le dissoudre, soutenu en cela par les partis bourgeois effrayés par l’ampleur des troubles sociaux liés à une situation économique soudainement aggravée.
Les nouvelles élections, perdues de peu par les sociaux-démocrates, furent à l’origine d’une grande amertume de la classe ouvrière qui lança une grève générale en novembre, marquée par des incidents sanglants qui préfiguraient la guerre civile. Les gardes rouges se reconstituèrent. Dans ce contexte dramatique, le Sénat bourgeois, soucieux d’éviter une collusion entre les socialistes et le gouvernement bolchevique, estima l’heure venue de déclarer l’indépendance, proclamée officiellement le 6 décembre 1917. Ainsi s’achevaient dix-huit années d’oppression qui avaient amené les Finlandais à prendre en main leur destin.»
Une révolution défensive (1)
Le 28 janvier 1918, une révolution éclata en Finlande (2). Le pays, qui venait d’accéder à l’indépendance le 6 décembre 1917, se trouvait alors dans une situation socio-économique dramatique: graves problèmes d’approvisionnement, chômage massif, effondrement du niveau de vie étaient le quotidien des couches populaires, voire d’une partie des classes moyennes. L’armée allemande n’attendait qu’un signe pour intervenir sur le sol de l’ancien grand-duché; elle était pressée de mettre à genoux l’adversaire russe, qui était aux abois depuis bientôt deux ans et se voyait contraint de négocier à Brest-Litovsk les conditions d’une paix humiliante.
La guerre civile qui s’ensuivit fut d’une terrible intensité. Durant les combats, des milliers d’hommes et de femmes trouvèrent la mort. Mais la défaite des rouges, accélérée par le débarquement de la division Von der Goltz, entraîna une répression impitoyable, où périrent près de 10% de la classe ouvrière. Ce lamentable épisode n’émut guère en son temps la presse bourgeoise européenne. Au contraire, les vainqueurs réussirent à construire la fable d’un châtiment proportionné à la monstruosité des actes commis par des révoltés sanguinaires. De nombreuses recherches ont depuis montré l’inanité d’une telle interprétation. Pis, des travaux récents mettent en lumière la manière dont les autorités blanches tentèrent de maquiller les massacres dont elles se rendirent parfois coupables (3)…
Ces faits justifient à eux seuls qu’on s’intéresse à cet épisode trop peu connu de l’histoire du Vieux Continent. Il convient de s’interroger à la fois sur ses causes, ses modalités et ses conséquences immédiates ou lointaines. Dans le cadre de ce court article, nous nous contenterons de mettre l’accent sur l’engrenage événementiel menant à l’affrontement, sur les principales phases du conflit et sur les effets politiques de la répression de masse. Nos lecteurs auront ainsi, nous l’espérons, les éléments de base pour apprécier l’importance de cette tranche d’histoire du mouvement ouvrier.
Aux origines immédiates du conflit: la conjoncture politique
de mars 1917 à janvier 1918
Il est bien évident que les causes de la révolution finlandaise ne peuvent être réduites à de simples événements politiques. Il faudrait aussi faire référence à l’évolution des structures sociales, aux bouleversements d’ordre culturel et mental de la fin du XIXe siècle, ainsi qu’à la montée du sentiment national et à ses contradictions. Nous n’avons malheureusement pas le temps de traiter ici ces aspects essentiels de la question. Signalons simplement qu’ils font l’objet de débats passionnants entre historiens, les uns estimant que la révolution est plutôt une parenthèse dans la tradition intégrative du mouvement ouvrier (Risto Alapuro), les autres considérant qu’elle est en partie le fruit des contradictions sociales (Pertti Haapala) ou bien la conséquence d’un ressentiment construit par les acteurs (Jari Ehrnrooth).
Cela dit, les facteurs strictement politiques ont compté. Avant 1917, par exemple, la Finlande avait été touchée par la vague révolutionnaire de 1905. En novembre de cette année-là, la grande grève patriotique avait rapidement abouti à des tensions assez graves entre les premières gardes rouges du capitaine Kock (connu pour ses sympathies socialistes révolutionnaires) et les gardes civiques commandées à Helsinki par le capitaine Theslöff. Au mois d’août 1906, dans le cadre de la révolte des marins russes de Viapori (la forteresse commandant le port d’Helsinki), elles avaient abouti à des échanges nourris de coups de feu sur le marché populaire d’Hakaniemi, au nord de la capitale. Il y avait eu plusieurs morts, une intervention des Cosaques et des dizaines d’arrestations, parfois arbitraires. L’année suivante, des éléments qualifiés d’anarchisants avaient réalisé quelques braquages “révolutionnaires”, que la direction social-démocrate s’était empressée de condamner (4).

Ces épisodes n’avaient cependant pas la même importance que ceux de l’année 1917. L’écroulement soudain du tsarisme en Russie créa alors un vide institutionnel propice aux turbulences. Les sociaux-démocrates l’avaient certes pronostiqué par le passé, mais dans un avenir plus lointain. Otto Wilhelm Kuusinen, le meilleur analyste du parti dans ce domaine, avait prévu, dans deux séries d’articles parus en 1911, puis en 1914, que le tsarisme pourrait se prolonger encore avec l’appui des classes dirigeantes russes, sauf si des événements imprévus, une guerre par exemple, venaient le saper de l’intérieur. Il ne pensait pas qu’une révolution pût éclater dans l’immédiat. Il fallut donc improviser des lignes successives, toujours mises en péril par les rebondissements politiques en Russie et la relative lenteur des canaux d’information entre Petrograd et Helsinki.
La question nationale, très présente depuis le début du règne de Nicolas II, évolua en outre très rapidement. On passa en quelques mois chez tous les protagonistes finlandais d’une problématique de l’autonomie élargie à une problématique de l’indépendance; cela entraîna des jeux subtils de la part des partis bourgeois et des sociaux-démocrates pour se prendre mutuellement de vitesse en conquérant à leurs vues l’opinion, fondamentalement hostile désormais à la tutelle impériale. Dans le même temps, la population, tenaillée par la disette, hantée par le spectre du chômage et la peur des désordres, exigeait des mesures immédiates pour améliorer la situation.
Dès que fut connue l’abdication du tsar, les principales formations politiques finlandaises se précipitèrent à Petrograd. La direction du SDP (Parti social-démocrate) envoya pour sa part une délégation pour s’enquérir de la situation; composée d’Oskari Tokoi, Karl Wiik et Väinö Tanner, elle envoya dès le 17 mars un télégramme à la commission exécutive du parti. Une deuxième délégation partit dans les jours suivants, avec Tokoi, Kuusinen, Gylling et Manner, afin d’entamer des tractations avec le gouvernement provisoire russe. Elle exigea non seulement le retour à l’ancienne autonomie, mais des réformes institutionnelles, ainsi que la promulgation de toutes les lois votées par le Parlement finlandais et jusqu’alors repoussées par le souverain. Les sociaux-démocrates, qui disposaient depuis 1916 de la majorité des sièges à la Chambre et pouvaient prétendre à la direction du Sénat (nom attribué à ce qui tenait lieu de gouvernement autonome), souhaitaient sans doute voir si le jeu en valait la chandelle. En réalité, aucune formation n’était pressée d’accéder au pouvoir: les partis bourgeois, parce qu’ils étaient minoritaires, se méfiaient du gouvernement provisoire et craignaient d’assumer les responsabilités de la crise socio-économique; le SDP, parce qu’il était divisé à propos de la participation gouvernementale.

Finalement, après quelques péripéties, les sociaux-démocrates acceptèrent de former un gouvernement mixte avec six des leurs et six bourgeois en congé de parti, présidé par Oskari Tokoi. Ils prenaient ainsi le risque d’apparaître comme des gestionnaires de la crise et de se trouver en porte-à-faux avec des masses radicalisées. Anthony Upton y voit de l’aventurisme face à un pari impossible. Je pense, pour ma part, qu’ils n’avaient guère le choix s’ils voulaient éviter de recourir à de nouvelles élections générales, pari encore plus risqué. Très vite, Tokoi, plus ou moins appuyé par le groupe parlementaire et la direction du parti, mit l’accent sur le renforcement de l’autonomie pour essayer d’élargir le soutien à son gouvernement. Le 20 avril, il tint devant le Parlement un discours remarqué, où il fixait comme terme l’indépendance. Les socialistes qui venaient de se réunir à la conférence internationale de Stockholm dénoncèrent cette orientation “nationaliste” des camarades finlandais: Branting et Kautsky y allèrent de leur couplet contre l’égoïsme du SDP vis-à-vis de la révolution russe. De même, les zimmerwaldiens et Karl Radek se déclarèrent surpris par une telle orientation. Seule la direction bolchevique (par le biais d’Alexandra Kollontaï) apporta son soutien, parce qu’elle avait compris que cela mettait en difficulté le gouvernement provisoire. Le sommet de cette orientation socialo-nationaliste fut atteint le 18 juillet 1917, quand la majorité parlementaire vota la “loi sur la répartition des pouvoirs” (Valtalaki), due à la plume habile de Kuusinen. Ce texte, que les sociaux-démocrates ne voulurent pas faire ratifier par le gouvernement provisoire, dont ils estimaient la chute prochaine, n’exigeait pas l’indépendance directe, mais une autonomie élargie et la souveraineté du Parlement finlandais dans les affaires intérieures. Les partis bourgeois, dans leur majorité, y étaient hostiles, car ils craignaient des représailles russes et ne voulaient pas être dessaisis par leurs adversaires du prestige que le combat nationaliste leur avait conféré. Ils pariaient sur une stabilisation du pouvoir en Russie, qui leur serait plus favorable pour reprendre la main. Sur le plan socio-économique, d’ailleurs, les choses s’avéraient très délicates pour le gouvernement Tokoi. Il y avait, bien sûr, quelques succès d’estime, comme la loi des huit heures et la réforme démocratisant les municipalités. Mais le monde du travail attendait bien davantage, en particulier dans le domaine de l’approvisionnement.
De nombreuses grèves et manifestations
De nombreuses grèves et manifestations pour l’augmentation des salaires et les huit heures avaient émaillé le printemps, y compris dans le secteur agricole. Les résultats obtenus se heurtaient toutefois à la pénurie de biens de consommation courante, qui faisait augmenter les prix de façon dramatique. Or les canaux habituels d’approvisionnement étaient désorganisés par le blocus de la Baltique et la déliquescence de l’agriculture russe. Les responsables socialistes avaient le plus grand mal à calmer les esprits. Le sénateur Tanner se fit même huer par les métallos en grève de Turku en voulant leur prêcher la patience. De leur côté, la droite et les agrariens critiquaient l’action des sociaux-démocrates et les accusaient d’irresponsabilité dans les conflits du travail. Selon eux, Tokoi utilisait la démagogie pour se maintenir en place (5).
L’effondrement de l’appareil policier issu du tsarisme
De fait, le maintien de l’ordre était devenu un véritable enjeu politique, surtout avec l’effondrement de l’appareil policier issu du tsarisme. Dès le mois de mai se formèrent des milices de grève, dont la plus importante était celle de Turku. Elles avaient pour mission d’éviter les débordements et les provocations. Mais comme s’y mêlaient parfois des soldats russes, les partis bourgeois en profitèrent pour essayer de les déconsidérer. Le sénateur Serlachius tenta pour sa part de les épurer et de créer des unités de maintien de l’ordre à sa main. Il se heurta aussitôt à une grève des milices, qui empêchèrent la réalisation de son projet, mais hâtèrent dans le pays la formation plus ou moins officieuse de milices bourgeoises, camouflées en général en associations de pompiers volontaires ou en sociétés de gymnastique. L a gauche social-démocrate n’était pas en reste dans cette lutte sourde d’influence. Durant le mois de juin, certaines milices de grève décidèrent de donner à leur activité un caractère durable. C’était le premier pas vers une future création de gardes rouges. A Helsinki, le 9 juin, deux figures de la fédération social-démocrate du Nyland (Uusimaa), Hermann Hurmevaara et Jussi Vatanen, appelèrent discrètement à une réunion en faveur de la création de gardes prolétariennes sous égide socialiste. En juillet, l’existence de milices ouvrières, d’un côté, et bourgeoises, de l’autre, semblait un processus irréversible. Même un dirigeant social-démocrate réputé modéré, comme Yrjö Mäkelin, ne croyait plus en la possibilité d’une action concertée dans le domaine du maintien de l’ordre. Au demeurant, la croissance très rapide des gardes civiques indiquait que les bourgeois en avaient pris leur parti (6).

Le tournant décisif fut cependant l’échec du soulèvement bolchevique de juillet 1917 et la décision du nouveau gouvernement provisoire de Kerenski de dissoudre le Parlement finlandais. C’était pour les sociaux-démocrates autochtones un véritable scandale, qui les obligeait à remettre en cause leur stratégie, plutôt conciliante jusque-là vis-à-vis de la bourgeoisie nationale. Les éléments les plus modérés du parti choisirent alors de se mettre sur la touche, tandis que ceux de la gauche radicalisaient leur discours. La colère populaire était, il est vrai, à son comble. La base comprenait mal la décision d’accepter la mise en vacances des députés, que Manner, le président du Parlement dissous, ne rappela qu’à la fin de septembre, lorsqu’il était trop tard pour résister. La croyance dans les méthodes parlementaires vacillait. L’idée d’un recours systématique à la pression de la rue faisait son chemin, attisée par les éléments les plus radicaux, parfois bolchevisés, comme les frères Rahja ou Adolf Taimi.
Consciente du fossé qui était en train de se creuser entre le mouvement ouvrier organisé et une partie des travailleurs, désespérée par la situation, la direction du parti mena une campagne très dure, qui stigmatisait la collusion entre les bourgeois nationaux et le gouvernement provisoire. La défaite électorale du début octobre entraîna une grande amertume, bien qu’elle fût loin d’être déshonorante (45% des suffrages et une progression en voix). Le groupe Sirola-Manner-Kuusinen commença vers cette époque à radicaliser ses positions au sein du SDP; les dirigeants syndicaux (Tokoi, Haapalainen) de même. Cette évolution inquiétait la droite du parti et certains dirigeants comme Wiik, un zimmerwaldien de la première heure, qui dénonçait dans son journal “l’esprit d’aventure” d’une partie de la commission exécutive. Les bourgeois, quant à eux, se sentaient encouragés dans leur intransigeance. Partout, leurs partisans les pressaient de rétablir l’ordre, y compris par la force. Le 27 octobre, un bateau arriva d’Allemagne, chargé d’armes et de chasseurs, ces volontaires nationalistes partis en 1915 combattre l’armée russe au sein d’un régiment spécifique de l’armée allemande. L’intention était de forger le noyau d’une future force d’intervention. La droite fourbissait ses armes.
“Nous exigeons”
Le 8 novembre, le groupe social-démocrate présenta au Parlement une déclaration intitulée Me vaadimme (“Nous exigeons”), rédigée par Kuusinen. Volontairement impérieuse, elle posait toute une liste de revendications immédiates, dont le démantèlement des gardes civiques, en pleine floraison sur l’ensemble du territoire national. Elle n’écartait pas, en cas de refus, le recours à l’action extraparlementaire. Il faut dire que des gardes rouges apparaissaient elles aussi un peu partout dans le pays et que de nombreuses organisations de base poussaient à l’action directe. Pour canaliser cette énergie, les dirigeants sociaux-démocrates imaginèrent de créer un Conseil central révolutionnaire (TVKN). Réuni entre les 9 et 11 novembre, il posa ouvertement la question d’une prise de pouvoir par la force. Les dirigeants syndicaux, davantage au courant de l’état d’esprit de la base, n’étaient pas les moins virulents. En revanche, d e s hommes classés généralement plus à gauche hésitaient encore, voire réprouvaient l’idée d’un soulèvement, dont ils mesuraient les risques pour le mouvement ouvrier.
La grève générale
Finalement, il fut décidé de lancer une grève générale. C’était un compromis acceptable par tous, accueilli de plus avec sympathie par les nouveaux maîtres de Petrograd, les bolcheviks. Kuusinen pensait qu’elle suffirait à éclaircir la situation. La grève commença dans la nuit du 14 novembre 1917. Certaines gardes rouges en profitèrent pour s’emparer du pouvoir local pour quelques jours. Mais les divergences entre les tenants de la voie parlementaire et ceux de l’action directe fragilisèrent le processus. De plus, un certain nombre de violences eurent lieu. Le TVKN finit par donner l’ordre de reprendre le travail. C’est précisément à ce moment-là que Kuusinen changea d’option. Il avait, jusque-là, combattu la prise de pouvoir. Mais il estimait désormais que les violences liées à la grève générale montraient une poussée anarchique dans les masses, qu’il fallait canaliser sous peine de dérapages. C’était un renfort de poids pour la cause révolutionnaire. Mais il ne réussit pas à entraîner avec lui la majorité du groupe parlementaire social-démocrate, qui voulait attendre le congrès exceptionnel du parti pour se décider. Entre-temps, Lénine avait envoyé aux dirigeants de la gauche une exhortation à passer à l’action.
Le congrès extraordinaire des 25, 26 et 27 novembre 1917 ne parvint pas à trancher nettement en faveur de l’option révolutionnaire. Les délégués restaient partagés, y compris dans leur for intérieur. L’instauration d’une dictature du prolétariat, prônée par Taimi, Rahja et une partie des représentants des gardes rouges, apparaissait à beaucoup comme irréaliste après l’échec de la grève générale, qui avait douché l’enthousiasme des chefs syndicaux. Les bourgeois, qui sentaient ces hésitations, décidèrent pour leur part de tailler dans le vif. Effrayés par la combativité ouvrière, ils confièrent le gouvernement à l’énergique Svinhufvud, un nationaliste jeune-finnois, décidé à s’appuyer sur l’Allemagne et à obtenir le plus vite possible le départ des troupes russes. L’homme ne tarda guère à montrer ses intentions. Il commença par déclarer unilatéralement l’indépendance, alors que les sociaux-démocrates considéraient comme nécessaire de la négocier. Il fit pression sur les garnisons russes pour qu’elles évacuent rapidement leurs casernes. Il annonça surtout la création d’une force armée nationale à partir des gardes civiques et des chasseurs revenus au pays. Pour l’encadrer, il avait déjà pris contact avec un certain nombre d’anciens hauts officiers du tsar d’origine finlandaise. Parmi eux, un certain baron Mannerheim, qui devait s’imposer à la tête de l’armée blanche quelques semaines plus tard.
Les gardes rouges, comme la direction sociale-démocrate, y virent à juste titre des mesures d’intimidation à l’égard du mouvement populaire. Il s’agissait vraisemblablement d’une sorte de provocation destinée à exaspérer la base pour inciter les chefs soit à se couper d’elle en se soumettant, soit à commettre l’irréparable en choisissant la confrontation. Ce vieux renard de Svinhufvud ne s’était pas trompé. Début décembre, la direction du SDP tenta de desserrer l’étreinte des gardes rouges en les soumettant à un contrôle plus rigoureux, en particulier à Turku et Helsinki. Ce fut un échec. Dès lors, seule l’option dure paraissait réaliste. Au début janvier, la majorité des dirigeants sociaux-démocrates était gagnée à l’idée que la voie parlementaire était bouchée et que la bourgeoisie se préparait au coup de force. Il ne pouvait être question de laisser aux gardes rouges les plus radicalisées l’initiative d’un soulèvement. Il fallait donc, dans un réflexe défensif, prendre la direction du mouvement populaire pour éviter qu’il ne parte à la bataille sans aucune chance de réussite. C’est l’idée que défendirent Sirola et Kuusinen le 19 janvier au conseil du parti. Ce dernier refusa cependant de créer une commission de préparation à la révolution, malgré leur menace de démission (agitée aussi par Turkia et Manner). Il y avait pourtant urgence: le même jour, les gardes civiques et les gardes rouges de Viipuri en étaient venues à l’affrontement armé. Finalement, après d’interminables palabres et rebondissements, la nouvelle commission exécutive du parti commença le 23 janvier à prendre les mesures concrètes en faveur d’un futur soulèvement. Letonmäki et Haapalainen furent peu après placés à la tête d’un comité ad hoc, qui en fixa la date pour le 27, puis le 28 janvier. Ces tergiversations avaient fait perdre un temps précieux. Déjà, l’armée blanche attaquait en Ostrobotnie et en Carélie. En effet, Mannerheim était devenu le 15 janvier président du comité militaire institué par le gouvernement légal. Il était parti quatre jours plus tard pour Vaasa, et, dès le 25, avait pris la décision d’attaquer les garnisons russes de la région, afin de créer une base solide depuis laquelle il pourrait éventuellement intervenir contre les gardes rouges (7). (A suivre sur ce site en date du 17 mai 2017; la contribution de Maurice Carrez a été publiée dans le numéro 23 des Cahiers du mouvement ouvrier, édité par le CERMTRI)
____
(1) Cet article est la transcription écrite de trois des quatre parties d’une conférence donnée au CERMTRI en mai 2003. Il manque en particulier, pour des raisons strictement éditoriales, la réflexion initiale sur les causes profondes de l’événement.
(2) Deux ouvrages de nature universitaire peuvent rendre compte de l’événement, avec des présupposés et des interprétations différents: Anthony Upton, The Finnish Revolution, Minneapolis, 1980; Viktor Holodkovski, Finliandskaïa Revolioutsia 1918 goda, Moscou, éditions du Progrès, 1978.
(3) Heikki Ylikangas, Tie Tampereelle (“La Route vers Tampere”), Helsinki, WSOY, 1993. Marko Tikka et Antti Arponen, Koston kevät (“Le Printemps de la vengeance”), Helsinki, WSOY, 1999.
(4) Sur toutes ces questions, le meilleur auteur est Antti Kujala, Vallankumous ja kansallinen itsemäärämisoikeus. Venäjän sosialistiset puolueet ja suomalainen radikalismi vuosisadan alussa (“Révolution et autodétermination nationale. Les partis socialistes russes et le radicalisme finlandais au début du siècle”), Helsinki, 1989.
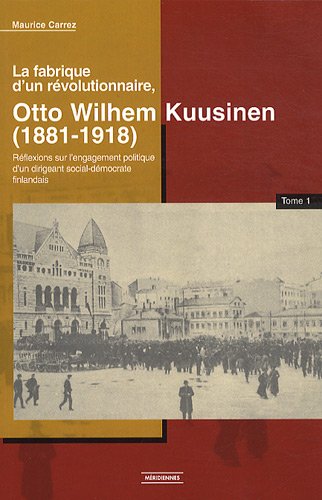
(5) Pour l’ensemble de ce paragraphe, j’ai utilisé, outre les ouvrages cités ci-dessus, les procès-verbaux des séances de la commission exécutive, du conseil national et du groupe parlementaire du SDP, conservés aux Archives ouvrières (Työväen arkisto) d’Helsinki. On peut aussi consulter en finnois des synthèses commodes, comme celles de Jussi Lappalainen, Itsenäisen Suomen synty (“La Naissance de la Finlande indépendante”), Jyväskylä, Gummerus, 1977, ou Eino Ketola, Kansalliseen kansanvaltaan. Suomen itsenäisyys, sosialdemokraatit ja Venäjän vallankumous 1917 (“Vers la démocratie nationale. L’indépendance finlandaise, les sociaux-démocrates et la révolution russe en 1917”), Helsinki, Tammi, 1987. En français, la thèse de Jean-Jacques Fol, L’accession de la Finlande à l’indépendance, Paris, 1977, donne de bons éclairages.
(6) Sur ces problèmes, Marja-Leena Salkola, Työväenkaartien synty (“La naissance des gardes ouvrières”), deux tomes, Helsinki, 1985, dans la série Punaisen Suomen historia (“Histoire de la Finlande rouge”), étude collective financée par le ministère de l’Education.
(7) Pour la période qui va de septembre 1917 à janvier 1918, outre les sources et la bibliographie précitées, j’ai eu beaucoup recours à la documentation rassemblée pour mon étude sur Otto Wilhelm Kuusinen, dirigeant social-démocrate finlandais, 1903-1918, qui doit paraître en finnois fin 2004 ou début 2005, ainsi qu’Hannu Soikkanen, Kohti kansanvaltaa (“Vers la démocratie”), tome 1, Helsinki, 1975, qui est une histoire du SDP avant 1937. Des éléments également dans la thèse de David Kirby, The Finnish Social-Democratic Party, 1903-1918, 1970.

Soyez le premier à commenter