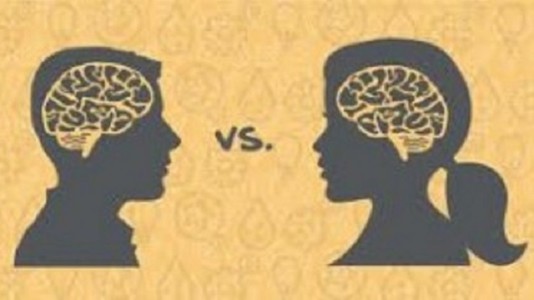 Entretien avec Catherine Vidal
Entretien avec Catherine Vidal
Neurobiologiste à l’Institut Pasteur, Catherine Vidal est spécialiste du cerveau, de la douleur. Elle s’intéresse également aux études de genre. Scientifique, elle est aussi connue pour son engagement féministe. Elle est l’auteur, parmi d’autres ouvrages, de Cerveau, Sexe et Pouvoir (Ed. Belin 2015, en collaboration avec Dorothée Benoit-Browaeys); de Féminin/Masculin. Mythes et Idéologies (sous dir.); Egale à Egal. Nos cerveaux, tous pareils tous différents (Ed. Belin, 8 septembre 2015); Hommes-Femmes. Avons-nous le même cerveau? (Ed. Le Pommier, 2012); Le Cerveau évolue-t-il au cours de la Vie? (Ed. Le Pommier, 2009); Les filles ont-elles un cerveau pour les Maths? (Ed. Le Pommier, 2012).
Catherine Vidal a travaillé, initialement, dans le domaine des mécanismes physiologiques de la douleur, dans les années 1980, au moment de la «découverte des endorphines, ces fameuses substances que l’on produit naturellement et qui miment les effets de la morphine». Elle précise que, aujourd’hui, à l’Institut Pasteur (Paris), elle essaye (nous essayons): «de répondre à des questions qu’on ne peut pas tester directement sur l’être humain…» et que ce «qu’elle aime c’est les systèmes, les régulations, c’est la physiologie, c’est essayer de comprendre comment un organisme interagit avec son milieu environnant».
Elle souligne que «contrairement à une idée reçue souvent partagée par un grand public, la science n’est pas neutre. La science s’inscrit dans un contexte social, économique, politique. (…) Elle est faite par des êtres humains, qui vont décider de leurs sujets d’étude, des méthodes utilisées, qui vont interpréter leurs objets d’étude souvent de façons différentes. (…) C’est ça qui fait toute la force de la science parce que rien n’est jamais acquis définitivement.» Dans son entretien avec Laure Adler, sur France Culture le 15 février 2016 – entretien que la rédaction de A l’Encontre a décrypté – Catherine Vidal expose le résultat de ses recherches. Et cela avec une capacité d’assurer une sorte de relation réciproque entre le contenu de ses informations et la disposition des auditeurs et auditrices à être informés sur un sujet fort important pour la compréhension de processus interactifs (organisme-milieu environnant) et, dans la foulée, pour les mobilisations plurielles dans une perspective d’émancipation. (Rédaction A l’Encontre)
*****
Laure Adler: Catherine Vidal, vous êtes neurobiologiste, vous avez été longtemps directrice de recherche en neurosciences à l’Institut Pasteur, vous avez fait des recherches approfondies sur le rôle de la douleur, sur le rôle du cortex cérébral dans la mémoire, sur l’infection du cerveau par le virus du sida et puis, petit à petit, et peut-être que ce sont vos recherches qui vous ont amenée à devenir une spécialiste du cerveau ainsi qu’une militante féministe. Avant de revenir sur votre parcours et sur vos différentes publications, je voudrais savoir comment vous avez été conduite à avoir une vocation scientifique. Etait-ce une vocation, une attirance?
Catherine Vidal: La raison tient essentiellement à une professeure de sciences naturelles au lycée qui contribué à la transmission, à tous les élèves de la classe, sa passion pour la biologie. Elle nous a donné le goût de poser des questions, le goût d’être curieux.
Ensuite, par quelles réflexions personnelles la recherche sur la douleur a-t-elle été motivée?
Lorsque l’on décide de faire des études à l’université pour devenir chercheur, chercheuse en l’occurrence, on suit tout un cursus: il faut passer les examens, une thèse de docteur et après on s’oriente dans un laboratoire qui travaille sur des thèmes qui nous séduisent. J’ai la chance, très vite après ma thèse, d’être recrutée par l’Institut Pasteur pour travailler sur un sujet qui concerne les mécanismes physiologiques de la douleur. Je dois dire que c’était une aventure absolument prodigieuse. Nous étions dans les années 1980, au moment de la découverte des endorphines, ces fameuses substances que l’on produit naturellement et qui miment les effets de la morphine. C’était une révolution dans le monde de la neurophysiologie et de la douleur. L’avoir vécu était une chance exceptionnelle.
Comment travaille-t-on à l’Institut Pasteur sur les mécanismes de la douleur? Sur de vrais cerveaux?

Non, à l’Institut Pasteur, on fait surtout de la recherche fondamentale, c’est-à-dire que l’on essaie de répondre à des questions que l’on ne peut pas directement tester chez l’être humain. On travaille d’abord sur des modèles animaux. La pertinence de la recherche scientifique consiste à essayer, lorsque l’on veut aborder une question, de trouver le meilleur modèle pour y répondre. Souvent les rats, les souris mais aussi les approches in vitro (des cellules en culture) peuvent nous aider à répondre à ces questions fondamentales de recherche. C’est là que, dans la compétition internationale, celui ou celle qui trouve le bon modèle aura les meilleurs résultats.
C’est ce qui vous est arrivé.
Eh bien, j’ai eu assez de chance dans ce domaine-là. Ce n’était pas forcément une chance, j’ai en fait toujours eu un souci particulier à m’intéresser à ce qui concerne la physiologie. C’est-à-dire non pas décortiquer les systèmes au niveau moléculaire, au niveau cellulaire – il s’agit en fait d’une approche très pointue, très réductionniste, si j’ose dire. Ce que j’aime: c’est les systèmes, les régulations, c’est la physiologie, essayer de comprendre comment un organisme interagit avec son milieu environnant et, dès que l’on agit avec son milieu environnant, nos comportements prennent du sens.
Avez-vous l’impression que la recherche a beaucoup évolué depuis une vingtaine d’années, date à laquelle vous avez commencé à travailler sur les mécanismes de la douleur? N’avez-vous pas l’impression que toute la société porte ses efforts pour vivre dans un monde où il n’y ait plus de douleur, où la douleur s’efface? Où le mot même de douleur ne devrait plus exister?
Oui, c’est comme la mort finalement [rires]. Ce qui concerne les démarches autour de la prise en compte de la notion de douleur, c’est aussi la même évolution que d’autres façons dont on va considérer l’être humain. Auparavant il était davantage considéré dans sa globalité et, par exemple, dans les relations médecins-malades il y avait une prise en compte aussi de la vie psychique et de l’environnement social, culturel, de la personne qui faisait que l’expression des symptômes s’inscrivait dans une histoire. A l’heure actuelle, on a de plus en plus tendance à vouloir tout réduire à des circuits de neurones, à des molécules chimiques, à des gènes qui seraient censés expliquer toute la complexité de l’humain. En fait, on se fourvoie lorsque l’on va dans cette direction parce que l’on ne peut pas balayer toute la complexité de la structure psychique d’une personne, la complexité de ce qui donne un sens à sa vie et comment, à travers son corps et ses pathologies, elle va exprimer certaines souffrances.
Nous allons écouter la voix de François Jacob [auteur, en 1970, de la Logique du vivant] à propos de la question de l’inné et de l’acquis chez l’être humain. Il s’agit d’une archive INA du 28 juin 1971.
François Jacob: «Si l’on regarde l’évolution et si l’on considère les organismes de plus en plus compliqués, de plus en plus hiérarchisés, il est très difficile de caractériser la direction de l’évolution si l’on ne veut pas être trop anthropocentrique et si l’on ne veut pas immédiatement tomber dans la notion de progrès. Or, la façon probablement la meilleure de décrire l’évolution, c’est de dire que ce qui se développe chez les organismes à mesure de l’évolution, ce sont les mécanismes à recueillir de l’information, des informations, sur leur milieu et à les utiliser. Ceci veut dire que la rigidité de l’hérédité est de moins en moins grande, si vous voulez, que le programme génétique est de plus en plus souple. Cette souplesse se manifeste au maximum avec le développement du système nerveux et, en particulier, du développement du système nerveux humain. Au niveau de l’homme et au niveau d’un système nerveux central et du cerveau aux traits développés, il y a un jeu incessant entre la part innée et la part apprise, si vous voulez. Par exemple, prenons un cas simple, celui du langage. Ce que donne l’hérédité au petit homme, c’est le pouvoir d’apprendre un langage, c’est la capacité à apprendre un langage et cela uniquement, c’est vrai, dans le genre humain. Aucun autre être vivant n’a la possibilité, n’a la capacité génétique d’apprendre une langue. Ce que détermine l’hérédité, c’est purement et simplement la capacité d’apprendre une langue. Maintenant, quelle langue il va apprendre, cela dépend de son milieu, cela dépend de ce qu’il va apprendre. Tous les linguistes, je crois, s’accordent à penser qu’un enfant mis dans une famille française apprendra le français, mis dans une famille anglaise apprendra l’anglais, je parle comme première langue, ou mis dans une famille de Nouvelle-Guinée, apprendra le langage qui est parlé dans cette tribu de Nouvelle-Guinée.»

Nous venons d’entendre la voix de François Jacob. Je pense qu’il a été très important dans votre itinéraire. Qu’a-t-il apporté de fondamental? Cette thématique de l’inné et de l’acquis constitue une orientation majeure dans votre itinéraire et dans vos engagements, Catherine Vidal. Qu’a-t-on apporté de plus dans cette problématique qu’a si bien définie François Jacob, aujourd’hui?
Je voudrais déjà saluer la pensée lumineuse de François Jacob. Il était non seulement un immense scientifique, mais aussi un très grand humaniste. François Jacob a non seulement réalisé des travaux d’exceptions, qui lui ont valu avec André Lwoff et Jacques Monod le prix Nobel [en 1965], mais François Jacob avait un souci particulier de participer à la diffusion des connaissances scientifiques et, aussi, par là même à lutter contre des idées qui laisseraient croire que les êtres humains, dès la naissance, sont enfermés dans un destin, sous prétexte qu’ils seraient programmés génétiquement. Lorsque François Jacob dit que, comme tout organisme vivant, l’être humain est programmé génétiquement, mais qu’il est programmé pour apprendre, cette phrase est merveilleuse parce qu’elle permet à tout un chacun de comprendre à quel point les vieilles querelles sur quelle est la part de l’inné, quelle est la part de l’acquis, toute cette opposition n’est plus de mise. Il y a en fait une interrelation permanente entre le biologique et le culturel. A partir du moment où l’on fait comprendre cela au plus grand nombre, cela met à mal toutes les thèses essentialistes qui laisseraient croire que nous sommes tous, dès le départ, nés différemment parce que programmés génétiquement de façon différente. Comme vous le savez, toutes les thèses essentialistes, qui hélas sont toujours bien présentes, forment la base des idées qui soutiennent les différences entre les humains, l’inégalité des races, le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie et aussi, bien sûr, le sexisme.
Pensez-vous, vous qui êtes militante et, comme la scientifique que vous êtes, que cela constitue un combat des Lumières pour faire passer les idées les plus élémentaires qui ont été établies scientifiquement, considérez-vous que la science aujourd’hui fait assez son travail de vulgarisation pour faire passer à l’intérieur de notre société des éléments rationnels que, vous scientifiques, vous avez établis?
Vous posez la question très intéressante du statut de la science dans la société. Je crois qu’il faut réaliser, contrairement à une idée reçue, souvent partagée par un grand public, que la science n’est pas neutre. La science s’inscrit dans un contexte historique, social, économique, politique. La science est faite par des êtres humains, qui vont décider de leurs sujets d’étude, des méthodes utilisées, qui vont interpréter leurs objets d’étude souvent de façon différente. C’est-à-dire que les regards des scientifiques sur un même objet d’étude peuvent être différents. Ils peuvent s’accorder, ils peuvent s’opposer et donc cette notion de neutralité de la science ne correspond pas à la réalité de la pratique scientifique. Mais, le fait justement qu’il y ait des divergences dans les interprétations, et dans la façon de recueillir les résultats, c’est cela qui fait toute la force de la science: rien n’est jamais acquis définitivement, en tout cas les interprétations peuvent changer, même s’il y a des faits difficiles à contester. Mais ce qui est important, c’est que la science n’est pas le nouveau Dieu que l’on va encenser à l’heure actuelle, qui serait censé nous apporter toutes les réponses à nos interrogations. [… ]
Depuis de nombreuses années, vous vous intéressez au cerveau, à la plasticité du cerveau. Vous avez mené un combat, que vous continuez en ce moment même, pour dire ce qui me paraît évident, mais qui ne l’est manifestement pas étant donné les nombreuses attaques que vous essuyez, que le cerveau de l’homme est équivalent à celui de la femme. Ou plus exactement celui de la femme est équivalent – est exactement le même – à celui de l’homme. Est-ce que vous pensez que nous avons encore aujourd’hui, au XXIe siècle, hérité des thèses soi-disant scientifiques de certains médecins, spécialistes du cerveau, qui avaient expliqué à nos ancêtres que le cerveau de la femme était beaucoup plus petit, beaucoup plus léger et que, donc, elle était forcément inférieure?
A nouveau, on fait face à une question qui est celle de l’exploitation des résultats scientifiques dans un contexte social, politique et culturel [donné], qui fait qu’une donnée scientifique en tant que telle va pouvoir être instrumentalisée selon l’idéologie d’une époque.
Et réinstrumentalisée, on le voit bien aujourd’hui.
Au XIXe siècle, on découvrait le cerveau. Auparavant cet organe était encore assez mystérieux. On a commencé à pouvoir conserver les cerveaux dans le formol, à pouvoir les couper en tranches et à regarder ce qu’il y avait à l’intérieur. Ces premières études sur les cerveaux ainsi que les observations des cliniciens, suite à des lésions dans le cerveau, lorsque l’on regardait les déficits qui s’ensuivaient, ont entraîné évidemment un engouement des médecins de l’époque. Très vite, la question s’est posée: est-ce que le cerveau des femmes est différent? Les résultats montraient qu’en moyenne le poids des cerveaux des hommes est plus important de quelque 4-5% que le poids moyen des cerveaux des femmes. Ce résultat statistique a été employé pour justifier la soi-disant intelligence supérieure des hommes sur les femmes. On l’a utilisé également pour dire que s’il y avait des différences entre les Blancs et les Noirs, c’est parce que les Blancs avaient un cerveau plus gros que les Noirs et aussi que celui des patrons était plus gros que celui des ouvriers [1]. Cette instrumentalisation a toujours existé. Elle n’est pas nouvelle. C’est aussi ce contre quoi se battait François Jacob. C’est-à-dire que laisser croire qu’il y a des données biologiques incontournables qui vont présider au destin d’une personne, c’est cela qui faisait qu’il a eu besoin d’écrire des livres de vulgarisation et de sortir de son laboratoire. C’est cela aussi qui m’a incitée à me dire: il y a des moments où il faut enlever sa blouse blanche et puis tenter, dans un langage simple, d’expliquer à un grand public quelles sont les avancées scientifiques et comment, justement, cette notion de plasticité cérébrale, parce que c’est très important d’insister sur ce concept, qui est nouveau, avant il était plus théorique que pratique, que démontré concrètement. Maintenant, avec les techniques d’imagerie cérébrale par IRM, on peut vraiment voir le cerveau se modifier en fonction des expériences de vie, en fonction des apprentissages.
Vous expliquez, par exemple, dans un de vos bouquins qu’un pianiste n’a pas le même cerveau que quelqu’un qui ne joue pas du piano parce qu’il a développé à l’intérieur d’une zone du cerveau, par cette plasticité dont vous parlez, quelque chose que le non-pianiste n’aura pas. De la même manière, vous citez un jongleur avec trois balles qui, lui aussi, n’aura pas le même cerveau parce qu’une partie de son cerveau… Donc, cette notion de plasticité, comment peut-on la faire comprendre? Est-ce le résultat d’une succession d’expériences, la répétition des expériences qui, finalement, remonte vers le cerveau? Comment comprendre tout cela?
Cette notion de plasticité, déjà, on peut l’appréhender lorsque l’on s’intéresse au développement du cerveau. Contrairement au reste de l’organisme, le cerveau à la naissance n’est pas du tout mature. Un petit bébé arrive au monde avec un corps qui est quasiment déjà «préconstruit»: il a des petits poumons, un petit cœur, des petits os… Mais, plus tard, tous ces organes vont se contenter de grandir. Alors que le cerveau à la naissance, ce n’est pas du tout cela. Le cerveau à la naissance est vraiment dans un état d’immaturité, il possède 100 milliards de neurones, ces neurones à la naissance vont cesser de se multiplier mais seulement 10% d’entre eux sont connectés. Cela veut dire que 90% des connexions entre nos milliards de neurones vont se fabriquer à partir du moment où l’enfant est en interaction avec son milieu extérieur. Cette interaction – à comprendre au sens large avec le milieu physique, affectif, culturel, social – va réellement permettre au cerveau de se construire. C’est bien ce que disait, à nouveau, François Jacob lorsqu’il parlait du langage. Justement de réfléchir à l’interaction entre l’inné et l’acquis. On va dire que l’inné c’est la capacité des neurones à se connecter entre eux, mais l’acquis c’est la réalisation effective de ce «câblage». Ce câblage, justement, puisqu’il est le fruit d’une interaction avec l’environnement social, culturel, affectif, etc. sera différent pour tous les individus qui existent sur Terre. Chacun de nous à une histoire différente, chacun de nous a traversé des histoires de vie qui ne ressemblent pas à celles des autres. Nous avons donc, toutes et tous, des cerveaux différents. Nous sommes sept milliards d’individus sur Terre, c’est-à-dire autant de personnalités différentes et autant de cerveaux différents. Ce que les études d’imagerie cérébrale ont montré, c’est que les différences entre les cerveaux de personnes d’un même sexe sont tellement importantes qu’elles dépassent la plupart du temps, sur le plan statistique, les différences entre les sexes. C’est cette notion de diversité qui est fondamentale et qui est totalement associée à celle de plasticité cérébrale, puisque l’on sait maintenant que notre cerveau, pour se construire, à besoin d’être en interaction permanente avec l’environnement.
Donc chacun se construit son propre cerveau, selon ses aspirations et ses désirs?
Selon son itinéraire de vie. Bien sûr, on peut trouver des différences entre les cerveaux des hommes et des femmes. Il n’est pas…
Et ce, jusqu’à la fin de notre vie? La plasticité existe jusqu’au dernier moment…
Ah oui! Bien sûr. Enfin, elle ne s’exprime pas nécessairement de la même façon, mais on ne peut pas dire qu’il existe un âge limite au-delà duquel tout est fini, et que l’on a plus d’espoir d’être capable d’apprendre et d’évoluer dans nos adaptations à l’environnement. Bon, c’est plus difficile effectivement lorsque l’on est plus âgé. Néanmoins, cela existe. Pour revenir à la question des cerveaux des garçons, des filles et des hommes et des femmes. Il est bien évident qu’il y a des différences. Ces différences peuvent aussi se traduire par des différences d’aptitudes et de comportement. Il n’est pas question de nier les différences, bien évidemment, mais le point pertinent est d’essayer de comprendre d’où viennent ces différences.
Alors, prenons des expériences. Vous êtes une femme de science, vous établissez des protocoles, vous démontrez ce que vous avancez et vous observez. Et là, vous parlez de plusieurs expériences, notamment la différence entre un petit garçon et une petite fille, je crois jusqu’à l’âge de trois ans, il se trouve tout de même, et c’est un fait, ce n’est pas l’idéologie d’une société, que les petits garçons jouent avec des choses qui s’assemblent, que l’on pourrait appeler les Lego, et les petites filles jouent aux poupées. Pourquoi? C’est le cerveau, c’est avant que la plasticité n’envahisse nos cerveaux?
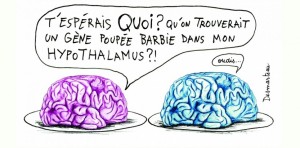 Pour essayer de comprendre quelle est la part du biologique et quelle est la part du culturel et de l’environnement dans ces différences que l’on peut observer dans le développement des garçons et des filles, il faut faire des études très précises qui s’intéressent au développement des enfants et au moment où des différences que l’on peut noter émergent. Ensuite, on essaie de comprendre le devenir de ces différences. Récemment, selon une étude remarquable qui rassemblait tous les articles scientifiques portant sur la question du développement de l’enfant de 0 à 3 ans, il s’avère que la seule différence très précoce que l’on peut observer, c’est une différence dans la tonicité musculaire des garçons. A la naissance, et jusqu’à l’âge d’environ 2 mois, ils sont un tout petit peu plus toniques que les filles. En ce qui concerne le développement des autres capacités, par exemple le babillage, les capacités à se repérer dans l’espace, les choix des jouets, toutes ces différences que l’on peut observer entre les enfants, garçons et filles, en fait n’apparaissent qu’à partir de six mois ou un an, c’est-à-dire à des âges où l’enfant a déjà été largement en contact avec son environnement.
Pour essayer de comprendre quelle est la part du biologique et quelle est la part du culturel et de l’environnement dans ces différences que l’on peut observer dans le développement des garçons et des filles, il faut faire des études très précises qui s’intéressent au développement des enfants et au moment où des différences que l’on peut noter émergent. Ensuite, on essaie de comprendre le devenir de ces différences. Récemment, selon une étude remarquable qui rassemblait tous les articles scientifiques portant sur la question du développement de l’enfant de 0 à 3 ans, il s’avère que la seule différence très précoce que l’on peut observer, c’est une différence dans la tonicité musculaire des garçons. A la naissance, et jusqu’à l’âge d’environ 2 mois, ils sont un tout petit peu plus toniques que les filles. En ce qui concerne le développement des autres capacités, par exemple le babillage, les capacités à se repérer dans l’espace, les choix des jouets, toutes ces différences que l’on peut observer entre les enfants, garçons et filles, en fait n’apparaissent qu’à partir de six mois ou un an, c’est-à-dire à des âges où l’enfant a déjà été largement en contact avec son environnement.
C’est l’acquis, ça?
C’est l’acquis en interaction bien sûr avec le biologique… On ne peut pas dire tant de pour cent d’acquis, tant de pour cent d’inné. Les deux sont totalement indissociables. Mais lorsque l’on dit cela, cela veut dire que le biologique n’est pas le maître qui décide de tout et de notre destin.
Cela veut dire qu’aucune différence dans le cerveau n’est innée?
Il peut y avoir des différences à la naissance, qui soient innées, comme vous dites, mais la question est que ces différences vont ensuite, peut-être, être complètement submergées par l’acquis, justement par l’expérience de l’enfant dans son environnement qui va faire que de nouvelles connexions entre les neurones vont se former en fonction du style d’éducation, de la façon dont l’enfant sera – ou pas – dans un confort affectif, par exemple. Ce qui va orienter, bien sûr, la façon dont nos cerveaux se façonnent.
Les cerveaux des hommes et des femmes sont donc exactement les mêmes.
Non! Ils sont tous différents.
Oui, chacun… oui, non mais, l’égalité de cerveaux, si j’ose dire, entre hommes et femmes est quelque chose que l’on peut prouver scientifiquement aujourd’hui…
Non, il y a une inégalité dans les capacités et dans les aptitudes intellectuelles, dans les capacités de raisonnement, les capacités de pensée, de mémoire, d’imagination,… Toutes ces capacités cognitives sont les mêmes chez les hommes et chez les femmes, chez les garçons et chez les filles. Ce qui va changer, c’est la façon dont l’expérience propre à chacun va forger et va canaliser certaines aptitudes dans un sens ou dans un autre. Le plus souvent, en ce qui concerne les femmes et les hommes, il y aura l’influence des normes sociales qui vont faire que les petites filles vont davantage se conformer à des stéréotypes qui correspondent au féminin, et les petits garçons des stéréotypes qui correspondent au masculin. Cela ne signifie pas que si, à une époque de notre vie, on a été très imprégné d’une façon très stéréotypée de se comporter que c’est une imprégnation qui est là à tout jamais. Pas du tout, puisque justement grâce à cette plasticité cérébrale, à tous les moments, à tous les âges de la vie, on peut changer d’opinion, on peut changer d’attitudes…
On peut changer de sexe.
On peut changer de sexe aussi, ça c’est de la bonne plasticité. On peut changer d’itinéraire de vie. C’est cela qui est le plus important: expliquer que l’être humain a une spécificité qui réside dans la liberté de choix dans ses actions et dans ses comportements. Il n’est pas une sorte de machine neuronale qui répond à un programme génétique.
 Ah ces hormones! Mais il n’y a pas que les hormones, il y a aussi toute la domination masculine. Et cette domination masculine nous a fait croire, depuis des siècles, depuis l’aube de l’humanité, que les femmes étaient inférieures aux hommes. La science s’y est employée pendant très longtemps. Dans votre dernier ouvrage, qui s’intitule Nos cerveaux, tous pareils, tous différents, vous citez en exergue cette phrase magnifique de Dostoïevski, tirée du texte L’adolescent (1875): «L’homme est une machine si complexe que souvent on ne s’y retrouve plus, surtout si cet homme est une femme.»
Ah ces hormones! Mais il n’y a pas que les hormones, il y a aussi toute la domination masculine. Et cette domination masculine nous a fait croire, depuis des siècles, depuis l’aube de l’humanité, que les femmes étaient inférieures aux hommes. La science s’y est employée pendant très longtemps. Dans votre dernier ouvrage, qui s’intitule Nos cerveaux, tous pareils, tous différents, vous citez en exergue cette phrase magnifique de Dostoïevski, tirée du texte L’adolescent (1875): «L’homme est une machine si complexe que souvent on ne s’y retrouve plus, surtout si cet homme est une femme.»
Oui, les citations qui sont rassemblées dans ce livre sont assez croustillantes parce qu’elles illustrent vraiment les points de vue d’une époque. Je citerai aussi Albert Einstein qui disait «il est plus difficile de lutter contre un stéréotype que de désagréger un atome». Lui aussi, savait à quel point la lourdeur de certains préjugés constitue des entraves pour l’avancement des idées en science. Il avait complètement conscience de l’impact des rapports entre science et société, et de l’importance de s’adresser à la société pour parler de science.
Science, idéologie, féminisme… ce n’est pas tout à fait les mêmes combats car, vous Catherine Vidal, vous avez des opposants, mais aussi des opposantes. Au mois de juin dernier, une psychologue, je crois Canadienne, qui s’appelle Susan Pinker [auteure, entre autres, de Le sexe fort n’est pas celui qu’on croit: un nouveau regard sur la différence hommes-femmes, Les Arènes, 2009], vous a opposé des expériences qu’elle avait faites aussi sur des cerveaux hommes et des cerveaux femmes, où elle explique qu’il y a des différences. Que dit la science? [2]
A nouveau, ce n’est pas ce que dit «la science», mais ce que disent les expériences.
Et les protocoles d’expérience et le nombre de personnes qui se soumettent à ces expériences…
Exactement. Très souvent, pour défendre l’idée d’un déterminisme génétique dès le départ, qui ferait que les cerveaux des petites filles et des petits garçons seraient câblés différemment, deux types d’expériences sont très régulièrement citées pour, justement, soi-disant, conforter cette idée d’un déterminisme dès le départ. Il y a une expérience qui est très reprise dans les médias. Elle a été réalisée dans les années 2000 sur des petits bébés d’un jour et demi. Cette expérience montrait, telle qu’elle est relatée, que les petits bébés filles regardaient plus les visages alors que les petits bébés garçons regardaient plus les mobiles, les objets mécaniques. Lorsque l’on entend ça…
Un jour et demi. Oui, c’est un peu jeune…
Voilà. Ce qui est important face à ce genre d’arguments, qui ont l’air imparables, on va regarder les détails des conditions d’expérience. On s’aperçoit que l’expérience ne montre pas ça du tout. Parmi la cinquantaine de bébés qui ont été testés, la majorité ne s’intéressait à rien du tout. Parce que, au bout d’un jour et demi, fixer son attention, fixer son regard, n’est pas quelque chose de généralisé. En outre, surtout, le visage en question, c’était le visage de l’expérimentatrice. Le mobile en question c’était simplement un ballon avec dessus, collé, un fil et une bille. Vous voyez, ce n’est pas du tout la notion d’objet mécanique qui laisserait croire qu’ensuite les garçons seront naturellement attirés vers les sciences et les techniques, les filles vers les professions d’attention aux autres, de soins et d’éducation.
Susan Pinker, elle, vous oppose tout de même des différences…
Eh bien oui, elle met en avant cette expérience, par exemple, pour dire «vous voyez, on a démontré que dès la naissance il y a des différences».
Pourquoi des chercheuses s’obstinent-elles à essayer d’expliquer la supériorité des hommes?
Ce n’est pas une question de chercheuses ou de chercheurs, c’est la question d’une réalité sociale, économique, politique, culturelle qui fait qu’aux Etats-Unis, en particulier, existent des courants très importants qui militent pour mettre en avant les idées déterministes biologiques qui feraient que, dès le départ, les garçons et les filles seraient différents parce que, derrière, il y a aussi des enjeux de société. Par exemple, il existe dans certains Etats des écoles qui ne veulent plus qu’il y ait des classes mixtes et qui considèrent que, puisque soi-disant les cerveaux des filles ne sont pas les mêmes, il faut leur donner des programmes scolaires différents et il faut leur adapter des méthodes pédagogiques différentes. Ils veulent aussi qu’il y ait des contenus différents, où, soi-disant, les filles…
Pas des mathématiques, il faut de la couture, quoi… Comme on faisait il n’y a pas si longtemps.
Le problème est que les écoles où l’on prône cette séparation des élèves dès le plus jeune âge, c’est aussi des écoles où est enseigné le créationnisme au même titre que le «darwinisme». Donc, vous voyez, il faut remettre dans un contexte social, à nouveau, sciences-sociétés, c’est cela le mot clé. On ne peut pas comprendre la science ou les sciences si on ne la remet pas dans son contexte historique, social et culturel.
Nous allons écouter la voix de Maurice Godelier [voir, entre autres, son livre L’idéel et le matériel], à propos de l’anthropologue et de son rapport avec la politique. C’est une archive du 22 octobre 1975. Je souligne que vous, Catherine Vidal, vous êtes une scientifique dure et pure, mais que vous utilisez tous les champs disciplinaires des sciences humaines pour alimenter votre réflexion.
Maurice Godelier: «Je pense que la situation actuellement est de transformation radicale du rapport entre la connaissance et l’action, la science et la société dans laquelle l’homme qui poursuit des recherches scientifiques se trouve engagé. Bien des anthropologues, se refusant à être complices d’une intervention sur les sociétés qu’ils étudient, veulent abandonner des disciplines. Certains, même pour des raisons politiques, préféreraient rester dans le pays où ils sont pour combattre aux côtés des peuples dominés contre la domination. Dans ce cas-là, la mise en question de la discipline devient radicale, on aboutit à un abandon et à un changement de vie par l’anthropologue. Je pense qu’il y a là une erreur profonde. Je comprends les raisons de certains. Il y a une erreur profonde. Le rapport entre l’anthropologue et les sociétés qu’il étudie, c’est aussi le rapport entre l’anthropologue et sa société à lui, et la société dans laquelle il va travailler. Je pense donc qu’il est tout à fait normal qu’un anthropologue prenne ses responsabilités et, devant des actions historiques et politiques, soit amené à critiquer ces actions, mais il doit le faire, si vous voulez, en agissant sur sa propre société. C’est-à-dire, c’est en dehors même et au-delà du champ de la discipline scientifique, du travail abstrait, c’est dans les racines profondes de sa société, contre les structures mêmes de cette société qui entretiennent un certain type de rapport de domination avec l’Afrique, ou l’Amérique ou l’Asie. C’est là que porte le combat et il dépasse largement et le travail scientifique, et le monde académique, et la carrière professionnelle. C’est une attitude qu’il doit avoir avec d’autant plus de responsabilités qu’il est mieux informé, qu’il doit avoir dans sa société pour transformer sa société et établir de nouveaux rapports entre nations, entre sociétés et donc, en quelque sorte, une partie de ces problèmes aura sa solution d’un changement de sa société.»
Vous êtes comme Maurice Godelier, Catherine Vidal, une militante au nom de la science, pour une évolution des rapports dans notre société? Une transformation peut-être même.

la première de «Die Weltwoche», 24 février 2016, l’hebdomadaire de l’intelligentsia que l’’UDC travaille au «corps» et/ou au «cerveau», avec son directeur Roger Köppel, conseiller national UDC de Zurich.
Oui, des transformations cela serait formidable si ça se faisait rapidement [rires]. Ce qui est important justement lorsque l’on prend conscience qu’il existe des liens intimes entre l’activité scientifique, le produit de nos connaissances et les conséquences, l’impact sur la société à tous les niveaux. On voit bien à l’heure actuelle les nouvelles technologies. Les gens sont dans une espèce d’incompréhension. Ils ont de nouveaux outils et ils ne comprennent pas, au départ, ce qui a amené à la fabrication de ces outils et comment ils fonctionnent. Lorsque l’on est scientifique et que l’on essaie de diffuser justement auprès d’un large public l’avancée de nos connaissances scientifiques, cela participe à donner à ce public un moyen de compréhension du monde qui l’entoure. Et si l’on comprend le monde qui nous entoure, à ce moment-là, au lieu de subir des modes de technologie sans comprendre ce qui se passe, on est capable aussi d’avoir un avis critique, parce que l’on comprend mieux. Et, en fait, c’est aussi un moyen face à toutes les thèses obscurantistes et conservatrices qui voudraient que l’ordre biologique soit finalement le moteur de l’ordre social, on peut à ce moment-là comprendre, quand on sait comment la science se développe et comment les sociétés se développent, avoir plus d’avis critiques et plus de moyens d’action sur ce monde qui nous entoure.
Enfin, on voit bien quand même que la psychologie évolutionniste dont vous parliez tout à l’heure gagne du terrain. Pas seulement aux Etats-Unis, mais aussi en Europe et même en France. On a bien vu certaines manifestations, les foules qui descendaient contre le mariage pour tous. On voit bien que dès qu’on porte atteinte à ce prétendu ordre biologique, il y a une partie de la population qui se sent agressée au cœur même de sa propre intimité. Comment l’expliquez-vous? Et pourquoi justement aussi peu de rationalisme?
Le rationalisme, il peut exister dans la démarche scientifique. Et encore pas toujours. Mais il faut déjà, pour en parler, s’intéresser et convoquer les sciences humaines et sociales. Ces disciplines-là sont les premières qui peuvent expliquer la persistance des idéologies, la persistance des préjugés, pourquoi justement cet ordre social fait l’objet de tels discours qui veulent ne rien changer à une société qui aurait soi-disant été fondée de tout temps par la nature, parce que, pour un certain public, si c’est naturel, cela veut dire que c’est normal et immuable. Donc, bien évidemment, face à cette vision des choses, si j’essaie d’apporter une petite brique dans la compréhension des sociétés qui nous entourent en montrant que les cerveaux des femmes, des hommes, de tous les êtres humains ne sont pas formatés dès la naissance pour ensuite être prédestinés, c’est pour faire en sorte que les hommes, les femmes ne se sentent pas mis dans des cases et sans aucun choix dans leurs chances dans la vie parce que nés garçon ou fille. Le plus important, c’est d’œuvrer pour cette égalité des chances entre tous les êtres humains, et entre les filles et les garçons, dans les choix d’éducation, dans la vie professionnelle et dans tous les aspects de la vie en général.
___
[1] A ce sujet, parmi bien d’autres, principalement quant à l’utilisation de théories «scientifiques» aux XIXe et XXe siècles pour asseoir le racisme, le sexisme et la supériorité des classes dominantes, voir l’ouvrage remarquable de Stephen Jay Gould, La mal-mesure de l’homme, Ed. Odile Jacob 2009, édition originale de 1981.
[2] Voir, en 2012, sur le même débat, la réponse apportée par Catherine Vidal dans une interview accordé à Rue 89.

Soyez le premier à commenter