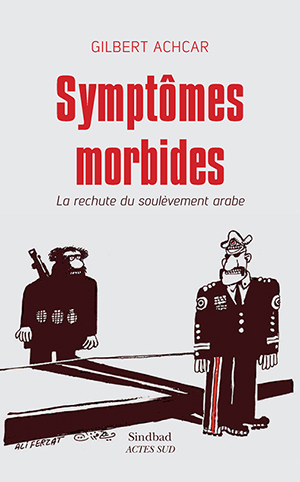 Entretien avec Gilbert Achcar
Entretien avec Gilbert Achcar
conduit par Mathilde Rouxel
Nous reproduisons ci-dessous l’entretien avec Gilbert Achcar publié les 26 et 27 février 2018 sur le site Les clés du Moyen-Orient. Le site A l’Encontre a publié à de nombreuses reprises des articles et entretiens de Gilbert Achcar. Nous reproduisons toutefois la présentation de Gilbert Achcar faite par Les clés du Moyen-Orient et Mathilde Rouxel.
Originaire du Liban, Gilbert Achcar a enseigné à l’Université de Paris-8, puis travaillé comme chercheur au Centre Marc Bloch de Berlin, avant d’être nommé en 2007 professeur en études du développement et relations internationales à l’Ecole des études orientales et africaines (SOAS) de l’Université de Londres.
Parmi ses nombreux ouvrages, traduits en une quinzaine de langues: Le Choc des barbaries. Terrorismes et désordre mondial (2002, 2004, 2017); La Poudrière du Moyen-Orient, avec Noam Chomsky (2007); Les Arabes et la Shoah. La guerre israélo-arabe des récits (2009); Marxisme, Orientalisme, Cosmopolitisme (2013); Le Peuple veut. Une exploration radicale du soulèvement arabe (2013); et Symptômes morbides. La rechute du soulèvement arabe (2017).
Mathilde Rouxel: Votre dernier ouvrage, Symptômes morbides. La rechute du soulèvement arabe publié en 2017 aux éditions Sinbad/Actes Sud fait suite à un premier, publié en 2013 et intitulé Le Peuple veut. Une exploration radicale du soulèvement arabe. Qu’est-ce qui vous a incité à l’écrire?
Gilbert Achcar: Cette suite devait être un chapitre de mise à jour pour la nouvelle édition de l’ouvrage. Toutefois, en travaillant dessus, je me suis vite rendu compte qu’un chapitre ne suffirait pas pour rendre compte des changements en cours. J’ai donc décidé de consacrer un nouvel ouvrage à ce qui m’apparaissait comme une nouvelle phase dans ce bouleversement qui a commencé en 2011 et que j’avais qualifié de processus révolutionnaire de longue durée, un processus devant inévitablement passer par des phases successives de révolution et de contre-révolution. Je soutiens, en effet, que la vague révolutionnaire a été retournée en 2013. Nous sommes entrés depuis lors dans une phase réactionnaire. Nous y sommes encore, même si les prémices de nouvelles explosions se font sentir de temps à autre, comme ce fut le cas de manière spectaculaire au début de cette année 2018.
Les analyses et pronostics du Peuple veut me semblent avoir été confirmés. J’expliquais alors que le processus révolutionnaire enclenché en Tunisie en décembre 2010 allait se poursuivre sur une longue période. Il m’apparaissait déjà clairement qu’il allait connaître inévitablement des hauts et des bas. Nous sommes entrés depuis 2013 dans une phase de régression à l’échelle régionale, après la vague révolutionnaire analysée dans Le Peuple veut. Dans Symptômes morbides, il s’agissait donc d’analyser les ressorts de la «rechute» après avoir analysé les ressorts du «soulèvement».
Qu’en est-il de l’opposition en Égypte? Aucun heurt n’a été reporté lors de l’anniversaire de la révolution le 25 janvier dernier, et la volonté révolutionnaire semble s’être évaporée.
Il y a au contraire une énorme frustration en Égypte. La révolution a été confisquée une première fois par les Frères musulmans, parvenus au pouvoir parce qu’ils avaient des moyens organisationnels et financiers bien supérieurs à ceux des mouvements que l’on peut qualifier de «progressistes» – cet éventail qui va des réformistes libéraux à la gauche radicale. C’est pourtant cet arc de forces qui a fait le 25 janvier 2011. Les Frères musulmans n’ont pas participé à l’appel initial au rassemblement; ils ne sont intervenus officiellement que trois jours plus tard et ont tout fait pour confisquer la Révolution à ceux qui l’avaient déclenchée. Par cela même, ils se sont rapidement aliénés une grande majorité – y compris parmi les personnes qui avaient voté pour leur candidat au second tour de la présidentielle pour faire barrage au candidat de l’armée. Cela a permis à celle-ci d’opérer une grande manœuvre politique, pour récupérer une nouvelle fois le mouvement de masse et revenir au pouvoir en 2013 pour la seconde fois depuis le renversement de Moubarak en 2011. Après une phase de transition, cela a débouché sur le régime du maréchal al-Sissi.
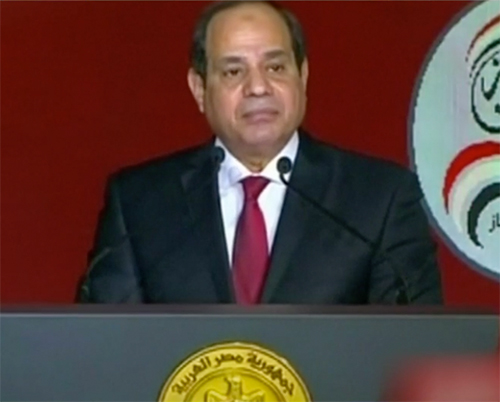
Le régime égyptien actuel est plus répressif que ne l’était celui de Moubarak avant 2011. Il suscite une grande frustration auprès des jeunes qui ont été au cœur des grandes mobilisations de 2011 et 2013. On l’a vu aux élections de 2014, avec la très forte baisse de participation, particulièrement chez les jeunes, qui se sont abstenus de voter dans leur grande majorité. L’abstention est l’expression d’une grande frustration en l’absence d’alternative, car les forces politiques progressistes égyptiennes se sont discréditées par leur appui à l’armée en 2013. Profitant de ce vide politique comme du climat répressif instauré depuis l’écrasement brutal des Frères musulmans, le régime Sissi applique les recettes du FMI, dégradant brutalement le niveau de vie de la population. Si le mécontentement social n’a pas encore éclaté en Égypte comme on l’a vu récemment en Tunisie, au Soudan, au Maroc et même en Iran, c’est en raison du climat répressif et du désarroi politique. Mais ce n’est que partie remise. Le régime de Sissi va droit dans le mur. Sur le plan socio-économique, il imagine pouvoir créer un miracle économique grâce aux recettes du FMI, mais ce n’est qu’une grande illusion.
Que peut-on dire du bilan de ce premier mandat du président al-Sissi?
Le bilan est désastreux. Si tel n’était pas le cas, si Abdelfattah al-Sissi avait la certitude que sa légitimité était solide et qu’il pourrait remporter de vraies élections haut la main, il aurait laissé d’autres candidats lui faire face aux présidentielles qui doivent avoir lieu en mars. Or, bien au contraire, par arrestation ou intimidation, il a empêché tout candidat sérieux de se présenter. Devant le retrait de tous les autres, le régime a poussé un inconditionnel de Sissi à se porter candidat face à son maître de façon tout à fait grotesque. Cela montre bien que le président actuel se sait en position de faiblesse. Il ne faut pas oublier qu’il a longtemps dirigé les renseignements de l’armée: il est bien informé et sait fort bien qu’avec des élections libres, il risquerait aujourd’hui d’être battu. Face au grand mécontentement de sa population, il a donc décidé de ne prendre aucun risque.
La question aujourd’hui est jusqu’à quand ce mécontentement va-t-il rester ainsi refoulé, car avec le régime en place, une nouvelle explosion est hautement probable. La répression se révélera cette fois-ci bien plus sanglante sans doute que celle de 2011, à moins que les forces armées ne parviennent à la conclusion que Sissi a failli à la tâche et qu’il doit être démis à son tour. Tout est possible: croire que le cycle qui a commencé en 2011 s’est terminé avec Sissi, c’est se tromper lourdement.
Les derniers heurts de ces dernières semaines ont encore une fois témoigné du caractère très international de la guerre en Syrie. Pouvez-vous nous parler des implications russes et américaines dans le pays?
La Syrie est devenue le théâtre privilégié de tous les conflits régionaux – et même au-delà: lorsque les États-Unis et la Russie sont tous deux impliqués, c’est l’ordre mondial qui est en jeu. Les deux chapitres principaux de Symptômes morbides traitent l’un de l’Égypte et l’autre de la Syrie; or, le chapitre sur la Syrie est consacré en bonne partie à la dimension régionale et internationale du conflit. En 2015, le régime syrien, alors en mauvaise posture malgré l’intervention de l’Iran à ses côtés depuis 2013, a imploré l’intervention russe. À partir de ce moment, le conflit syrien est devenu une carte entre les mains de Moscou, notamment dans ses rapports avec les pays occidentaux sur fond de conflit en Ukraine et de sanctions contre la Russie. La Syrie est devenue pour Moscou en 2015 un atout stratégique d’autant plus précieux que l’importance de la situation syrienne s’est considérablement accrue aux yeux des gouvernements européens à partir de la même année, avec la formidable poussée de réfugiés vers l’Europe doublée de la vague d’attentats terroristes sur le sol européen. En s’imposant comme maîtresse du jeu en Syrie, la Russie détient un atout majeur dans ses relations avec les pays occidentaux, et notamment face aux États-Unis.
Pourtant, les États-Unis ne s’opposent pas, ou plus, au maintien au pouvoir du régime de Bachar Al-Assad
Pour les États-Unis, le problème n’est pas le régime de Bachar Al-Assad. C’était déjà le cas sous Barack Obama, qui n’a montré aucune détermination véritable à renverser le régime Assad. S’il avait voulu agir dans ce sens, il aurait suffi que les États-Unis arment l’opposition syrienne et lui donnent les moyens de neutraliser l’aviation du régime. La situation aurait été aujourd’hui considérablement différente. Quant à Donald Trump, il a clairement fait savoir qu’il était disposé à s’accommoder du maintien d’Assad au pouvoir. Déjà au cours de sa campagne électorale, il avait affirmé que, bien qu’Assad fût un dictateur sanguinaire, il n’en représentait pas moins l’option la plus acceptable en Syrie.
 Sur le fond, la Syrie n’est pas un pays convoité par les États-Unis. Washington n’a pas cherché à bouter la Russie hors de Syrie, même dans la période de la plus grande faiblesse russe dans la foulée de l’effondrement de l’Union soviétique. C’est que la Syrie ne jouit pas de ressources importantes et le régime Assad a joué à plusieurs reprises un rôle tout à fait utile pour Washington: en 1976, il est intervenu au Liban contre l’OLP et ses alliés de la gauche libanaise; par la suite, il s’est confronté plusieurs fois aux Palestiniens du Liban; en 1990, il a pris part à la guerre contre l’Irak au sein de la coalition menée par les États-Unis.
Sur le fond, la Syrie n’est pas un pays convoité par les États-Unis. Washington n’a pas cherché à bouter la Russie hors de Syrie, même dans la période de la plus grande faiblesse russe dans la foulée de l’effondrement de l’Union soviétique. C’est que la Syrie ne jouit pas de ressources importantes et le régime Assad a joué à plusieurs reprises un rôle tout à fait utile pour Washington: en 1976, il est intervenu au Liban contre l’OLP et ses alliés de la gauche libanaise; par la suite, il s’est confronté plusieurs fois aux Palestiniens du Liban; en 1990, il a pris part à la guerre contre l’Irak au sein de la coalition menée par les États-Unis.
Le seul vrai problème pour Washington, et plus encore pour l’administration Trump, est celui de la présence iranienne en Syrie. C’est leur souci majeur, et c’est ce qui dicte le comportement des États-Unis aujourd’hui dans la région.
Les États-Unis soutiennent-ils la récente intervention israélienne contre l’Iran en Syrie?
L’administration Trump a réaffirmé son soutien au droit d’Israël à attaquer tout ce qui pourrait menacer sa sécurité. C’est un principe intangible de la politique américaine quel que soit le président – Barack Obama aussi bien que Donald Trump. Dans ce cas particulier, le soutien à Israël est d’autant plus fort qu’il s’agit d’un affrontement avec l’Iran. Israël a visé des objectifs liés à l’Iran, ce qui ne peut que recevoir la bénédiction de Washington. Il est toutefois intéressant de constater qu’Israël agit également avec le feu vert russe. La Syrie est hérissée de batteries de missiles anti-aériens installés par Moscou pour parer à toute éventualité. Ces missiles n’ont pas une seule fois été utilisés contre l’aviation israélienne, qui frappe régulièrement des objectifs liés à l’Iran sur le sol syrien. Israël s’en prend notamment à l’acheminement d’armement au Hezbollah libanais à travers la Syrie, comme à la création de bases à proximité du Golan occupé.
Les États-Unis ont annoncé qu’ils avaient l’intention de maintenir leurs positions en Syrie pour une durée indéterminée. Ils se sont appuyés dans leur lutte contre Daesh sur les Unités de protection du peuple (YPG) kurdes et leurs alliés arabes dans le cadre des Forces Démocratiques Syriennes (FDS) dans le Nord-Est syrien. Bien que Daesh soit en voie d’être éradiqué dans cette grande partie du territoire syrien située à l’Est de l’Euphrate, les États-Unis veulent y maintenir leur présence militaire parce qu’il s’agit d’une zone stratégique aux confins de la Turquie et de l’Irak. Elle est aujourd’hui sous contrôle des FDS, avec la présence directe et l’appui de troupes américaines. Les États-Unis savent bien que s’ils retiraient leurs troupes, l’Iran chercherait à reprendre le contrôle de ce territoire avec des troupes du régime syrien. Pour les États-Unis, ce serait une défaite. Ils s’engagent donc à rester sur place jusqu’à un règlement dont la condition sine qua non est, pour Washington, le retrait des troupes et supplétifs de l’Iran du territoire syrien. Ce sera donnant-donnant. La région est aujourd’hui le théâtre d’un grand affrontement impliquant de multiples forces régionales et internationales. Les possibilités de déflagration militaire y sont plus grandes que nulle part ailleurs, plus même que dans la péninsule coréenne.
Au milieu de tous ces jeux d’alliance, qu’est devenue l’opposition syrienne?
L’opposition syrienne est en déliquescence depuis très longtemps. Il y avait une occasion historique de lui permettre de se construire et de jouer un rôle de premier plan à ses débuts, à la fin de l’année 2011 et en 2012. Si cette opposition, qui affichait alors un visage démocratique et laïque, avait été soutenue fermement par les États-Unis et leurs alliés européens, s’ils lui avaient donné les moyens de s’organiser et de se battre contre Assad plutôt que de la rendre dépendante de la Turquie, du Qatar et des Saoudiens, la situation aurait certainement été très différente aujourd’hui. Pas seulement en Syrie d’ailleurs, mais dans l’ensemble de la région. En effet, le retournement de la vague révolutionnaire en phase contre-révolutionnaire au printemps 2013 a commencé avec le passage du régime syrien à la contre-offensive avec le soutien direct de l’Iran. On a alors assisté au renversement de la vague populaire inaugurée en décembre 2010 par le soulèvement tunisien et qui avait entraîné la chute de plusieurs régimes arabes à la manière de dominos. C’est la résistance du domino syrien qui a inversé la tendance. Depuis 2013, un contre-choc a été observé partout, avec le retour de l’Égypte à un gouvernement d’ancien régime encore plus répressif, ainsi qu’avec les guerres civiles de Libye et du Yémen.
Si les gouvernements occidentaux avaient été fidèles à leurs valeurs proclamées et avaient soutenu ceux qui représentaient ces valeurs en Syrie, le désastre actuel n’aurait pas eu lieu. L’administration Obama n’ayant pas voulu s’engager dans le conflit, elle s’en est remise aux États du Golfe et à la Turquie. Toutefois, ni l’émirat du Qatar, ni le royaume Saoudien n’ont la moindre affinité avec une révolution démocratique et laïque: ce sont des valeurs radicalement opposées à ce qu’ils représentent eux-mêmes. C’est bien pourquoi ils se sont livrés à une surenchère dans le financement de groupes intégristes qui ont dévoyé ce qui était un combat démocratique en bataille sunnite intégriste et confessionnelle. Ces groupes ont provoqué l’éclatement de l’Armée libre syrienne (ALS) formée en 2011. C’est ainsi que s’est produite la dégénérescence de l’opposition armée: au lieu d’une force armée unifiée sous une bannière démocratique et laïque, on a vu proliférer des groupes représentant tout l’éventail de l’intégrisme islamiste, des Frères musulmans jusqu’à Daesh. Cela a été une catastrophe non seulement pour la Syrie, et non seulement pour la région dans son ensemble, mais aussi pour le monde entier, puisque la situation a débordé bien loin des frontières de la Syrie ou de l’Irak. Quant à la représentation politique de l’opposition, elle est naturellement devenue de plus en plus chétive, minée par des conflits d’influence entre le Qatar et le royaume saoudien qui l’ont corrompue et lui ont fait perdre tout crédit. L’opposition syrienne n’est plus en mesure de constituer une alternative au régime. C’est pour cela que tous les grands acteurs internationaux se sont rangés à l’idée d’une représentation de l’opposition au sein d’une coalition qui agirait dans le cadre d’un régime syrien maintenu. Il n’est plus question de renverser ce régime. Pour Washington, il n’en avait d’ailleurs jamais été question: c’est seulement la question de la présidence d’Assad qui était posée. Aujourd’hui, tous disent être prêts à s’accommoder de cette présidence, ne serait-ce qu’à titre provisoire.
Une dernière question, de prospective: comment voyez-vous l’avenir de la région?
Lorsqu’on me pose cette question, je réponds toujours que la seule prédiction qu’on puisse faire de manière catégorique est qu’il n’y aura pas de stabilisation dans la région dans un avenir proche. Nous nous trouvons aujourd’hui devant la perspective de plusieurs années, voire plusieurs décennies, de grande instabilité. Le point d’ébullition atteint en 2011 dans la région a débouché sur un bouillonnement qui continuera longtemps encore, et qui ne s’arrêtera que si un changement démocratique, entraînant un déblocage radical de la situation économique, parvenait à s’imposer au niveau de la région. Tant que ce ne sera pas le cas, la région va connaître crise sur crise, et risque malheureusement de connaître de plus en plus de tragédies. (27 février 2018)

Soyez le premier à commenter