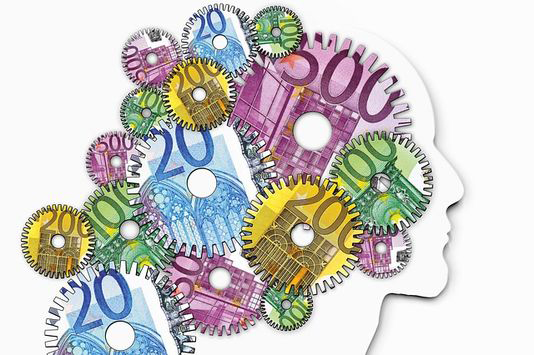 Par Sandrine Cabut
Par Sandrine Cabut
et Pascale Santi
D’études scientifiques en rapports internationaux, il n’y a plus guère de doute: les enfants sont les principales victimes de la pauvreté et leur cerveau est en péril. Dans les pays en voie de développement, ils sont 385 millions à grandir dans une «extrême pauvreté» (définie par un revenu inférieur à 1,90 dollar (1,80 euro) par personne et par jour dans un foyer familial), selon une récente analyse de l’Unicef et de la Banque mondiale.
Les pays dits riches sont loin d’être épargnés. Aux Etats-Unis comme en France, environ 1 enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Soit 15 millions de petits Américains; et 2 à 3 millions de mineurs en France. Ce dernier chiffre varie selon les sources et la définition du seuil de pauvreté. L’Insee privilégie de le fixer à 60 % du revenu médian, soit 1700 à 2100 euros mensuels pour une famille avec deux enfants de moins de 14 ans. Cet indicateur, qui recouvre des réalités très diverses, fait cependant débat dans la société.
En matière de santé publique, les conséquences sont lourdes. Si la mortalité infantile est en baisse dans le monde, les enfants des familles les plus pauvres ont un risque deux fois plus élevé de mourir avant 5 ans que ceux des foyers les plus aisés. La précarité prédispose à de nombreuses maladies physiques et mentales (complications de la prématurité, malnutrition, maladies infectieuses…), qui sont potentiellement d’autant plus sévères qu’elles se conjuguent à un moins bon accès aux soins.
Les effets délétères de la pauvreté
Et puis il y a donc le cerveau, dont le développement peut être affecté. Certes, c’est le cas de la plupart des tissus ou organes exposés au stress et à des conditions matérielles difficiles. «Sauf qu’être équipé d’un cerveau performant est précisément ce dont ont le plus besoin les enfants issus de cette strate sociale pour espérer un jour accéder à l’ascenseur du même nom», soulignait la neuroscientifique Angela Sirigu dans nos colonnes en 2012 (supplément Science & médecine du 13 octobre).
Le sujet, délicat, n’est pas nouveau. Les effets délétères de la pauvreté sur les capacités cognitives et émotionnelles ont été décrits dès les années 1950 par des chercheurs en psychologie du développement, en sciences sociales et de l’éducation… Une nouvelle page s’est ouverte avec les approches neuroscientifiques visant à comprendre comment un statut socio-économique (SES) défavorable influence le développement du cerveau.
Les débuts de ces «neurosciences de la pauvreté» ont été houleux. Quand l’Américaine Martha Farah (Université de Pennsylvanie) a cherché des subventions pour ses travaux, elle s’est d’abord vu répondre: «Vous pathologisez les enfants pauvres, ce sont des recherches irresponsables.» Finalement, cette pionnière a pu évaluer avec une batterie de tests les capacités cognitives de 60 enfants de 5 ans, la moitié issue d’une famille à SES faible, l’autre à SES moyen. Les résultats, publiés en 2005 dans la revue Developmental Science, ont fait date. Les enfants pauvres étaient significativement moins performants que les autres dans deux domaines: le langage et les fonctions exécutives, qui supportent l’élaboration de stratégies, la planification, l’attention, ou encore la flexibilité mentale.
Depuis, tout un corpus d’études menées de la toute petite enfance à l’adolescence, avec des tests cognitifs et/ou des examens d’imagerie, ont enfoncé le clou. L’Américain Seth Pollak a ainsi suivi avec des IRM (Imagerie par résonance magnétique) l’évolution du cerveau de 77 enfants depuis leurs 5 mois jusqu’à leurs 4 ans, classés en trois niveaux de SES. «Les enfants de familles à faible revenu ont un moindre volume de matière grise, tissu essentiel pour le traitement des informations et l’exécution des actions», conclut-il dans PLOS ONE, en 2013. Imperceptibles à l’âge de 5 mois, les différences de volume augmentent progressivement entre les trois groupes. Elles concernent les lobes frontaux et pariétaux, et s’associent à l’émergence de troubles du comportement.
Plus récemment, Kimberly Noble, élève de Martha Farah, et désormais à l’université Columbia de New York, a étudié le cerveau de plus d’un millier de jeunes de 3 à 20 ans. Ses travaux (publiés dans Nature Neuroscience en 2015) ont mis en évidence une corrélation entre les revenus du foyer ou le niveau d’éducation des parents et la surface du cortex. La corrélation était particulièrement marquée dans les zones impliquées dans des fonctions comme le langage, la lecture, le contrôle de soi.
Aujourd’hui, de nouvelles études ont montré que ces empreintes sont repérables très tôt. L’équipe de Martha Farah vient ainsi d’observer des différences de volume de la substance grise selon le SES chez des bébés (filles) âgés de seulement 1 mois.
Les neurosciences de la pauvreté et leurs défis
Malgré des centaines de publications – dont quelques-unes issues de cohortes françaises comme EDEN [1] ou Elfe [2] – certains restent sceptiques. «Les différences de structure observées dans les régions supportant le langage n’indiquent pas nécessairement des différences sur les habiletés neurocognitives», estiment ainsi des chercheurs de Stanford dans une récente revue de la littérature (Developmental Cognitive Neuroscience).
«Il n’y a pas de doute quant aux effets délétères de la pauvreté sur un cerveau en développement, les données sont impressionnantes» estime au contraire Angela Sirigu. Mais il faut continuer à préciser quelles structures sont affectées, et de quelle manière. Jusqu’ici, les études ont été surtout anatomiques. L’enjeu est de décrypter les aspects dynamiques. Des modèles primates seraient utiles notamment pour étudier les neurotransmetteurs.»
Les neurosciences de la pauvreté ont encore bien des défis à relever. Niveau d’étude des parents, stimulation de l’enfant par la famille et l’école, réseau social, nutrition, état de santé mentale de la mère, exposition à des violences, à un stress chronique… Outre les revenus du foyer familial, de nombreux paramètres relatifs à la pauvreté peuvent être délétères sur un cerveau en formation, mais leur poids respectif n’est pas encore parfaitement élucidé. Chez l’adulte, une série d’expériences menée par une équipe de Princeton (publiée en 2013 dans Science) a montré qu’à elle seule, la charge mentale induite par des difficultés financières ampute de 13 points le quotient intellectuel (QI), l’équivalent d’une nuit sans sommeil. Qu’en est-il chez leurs enfants?
«Il ne faut pas oublier que le neurodéveloppement commence à la conception et se termine à la fin de la puberté, ajoute le neuropédiatre et chercheur David Germanaud (hôpital Robert-Debré, AP-HP). Si on choisit de mettre en avant les paramètres de la petite enfance, il ne faut pas occulter pour autant l’importance de facteurs plus précoces anténataux et périnataux, qu’ils soient liés à l’environnement comme la consommation d’alcool, ou bien génétiques. Ce d’autant que les caractéristiques de ces deux périodes ne sont souvent pas indépendantes, ce qui peut biaiser l’interprétation que l’on fait de leurs impacts respectifs.» Pour ce spécialiste, si l’on veut apprécier pleinement l’impact des conditions socio-économiques sur le développement du cerveau, il faut des études incluant la période de la grossesse. Et elles doivent porter sur les capacités adaptatives au sens large, qui reposent à la fois sur les performances cognitives (au-delà d’un QI pas toujours mesurable), les habiletés sociales et les ressources affectives…
La question du «fond génétique» de l’intelligence, avec en arrière-plan celle d’un cercle vicieux de la pauvreté, est encore plus sensible. «Le lien entre SES et QI est au moins en partie génétique, cela a été établi depuis des décennies. En moyenne, les personnes les plus défavorisées socialement sont aussi les plus désavantagées génétiquement», résume Franck Ramus, directeur de recherche au CNRS et à l’Ecole normale supérieure de Paris. La quête des bases génétiques de l’intelligence a commencé avec des études chez des jumeaux ou des enfants adoptés, qui ont estimé la proportion de facteurs génétiques à environ 50 %. Depuis, des centaines de gènes intervenant dans le développement et le fonctionnement du cerveau ont été identifiés, mais leur importance et leur rôle exact ne sont pas toujours clairs.
Les recherches font désormais appel à de nouvelles stratégies, comme les études d’association pangénomique, qui visent à corréler un trait donné et des séquences d’ADN. A partir de l’analyse du génome de 3000 enfants, l’Américain Robert Plomin (King’s College, Londres) conclut que non seulement les facteurs génétiques mesurés expliquent en partie le QI (à hauteur de 28 %), mais en partie aussi le niveau socio-économique (à hauteur de 21 %), et une bonne part du lien entre les deux. Ces résultats ont été publiés en 2014 dans Intelligence.
Programmes d’éducation préscolaire
Que proposer à ces familles pour limiter les dégâts? L’histoire de la lutte contre le saturnisme est emblématique des succès possibles. Dès la fin des années 1980, Médecins du monde (MDM) et Médecins sans frontières ont les premiers mis en lumière les effets de l’habitat précaire intoxiqué au plomb dans les logements construits avant 1949 et l’ampleur du problème du saturnisme. «Cette pathologie du mal-logement occasionne des troubles irréversibles du système nerveux», explique le docteur Jean-François Corty, directeur des opérations internationales à MDM.
Appuyé par l’association des familles victimes du saturnisme (AFVS), MDM a obtenu la reconnaissance du problème dans une loi de 1998, imposant le signalement des cas de saturnisme infantile, et des travaux dans les bâtiments contenant du plomb. La prévalence du saturnisme a été divisée par 20 en cinq ans, passant de 2,1 % à 0,11 %, entre 2004 et 2009 chez les 1-6 ans. «L’exposition au plomb reste toutefois très forte dans les populations très précaires, notamment chez les populations roms, en raison de pratiques de ferraillage», déplore le docteur Corty.
Des programmes d’éducation préscolaire à l’attention d’enfants défavorisés sont apparus dans les années 1960 aux Etats-Unis, comme le Perry Preschool Project, le Carolina Abecedarian (transposé en 2005 au Québec)…
Les enfants, aujourd’hui adultes, ont été suivis pendant des décennies, avec des résultats indiscutables: meilleure réussite scolaire, meilleure santé, moins de violences et, dans certains cas, une progression de 10 à 15 points du QI.
Le chercheur émérite Michel Duyme (Inserm, CNRS) a lui publié une série d’études à partir des années 1980, dont certaines dans des revues majeures comme Science, montrant que, contrairement à une idée reçue, tout ne se joue pas dès la petite enfance en matière de développement intellectuel.
Des enfants de 4 à 6 ans, adoptés par 65 familles, ont vu cinq à dix ans plus tard leur QI, au départ inférieur à la moyenne, progresser parfois de plus de 10 points, cette hausse étant corrélée au niveau socio-économique des familles d’accueil.
A 4 ans, «un enfant pauvre a entendu 30 millions de mots de moins qu’un enfant issu d’un milieu –favorisé» et son QI est inférieur de 6 points en moyenne, ont constaté en 2004 deux psychologues américains. Partant de ce constat, ils ont conçu des programmes pour accompagner les familles. Les résultats sont concluants. Ce constat figure en introduction du rapport du think tank Terra Nova, «La lutte contre les inégalités commence dans les crèches», publié en 2014. «La politique de la petite enfance est le meilleur levier de réduction des inégalités», plaide l’organisation, pour qui il est urgent d’agir. Elle propose de développer des places de crèches à «haute qualité éducative», en priorité pour les familles pauvres.
Lutte contre la précarité et la petite enfance
Ainsi du programme Parler Bambin, qui vise à développer le langage chez les enfants défavorisés. Mis en place en 2008 dans de nombreuses crèches de Grenoble, il a été étendu à Lille, en région parisienne, etc., et concerne environ 18’000 enfants. Plus inédit, Kimberly Noble est en train de lancer une étude auprès de 1000 mères à faible revenu en apportant une aide financière.
Certains misent sur une intervention avant même la naissance. En France, le projet Capedp, piloté par le professeur Antoine Guédeney, pédo-psychiatre à l’hôpital Bichat (AP-HP), s’est adressé à 440 femmes suivies dans dix maternités franciliennes.
Pour participer, elles devaient être âgées de moins de 26 ans, accoucher pour la première fois, et présenter au moins l’un des trois critères suivants: un niveau d’étude inférieur à douze ans (niveau bac), se déclarer socialement isolées et bénéficier de la CMU (Couverture maladie universelle) ou de l’AME (Aide médicale de l’Etat). Ces familles ont été réparties par tirage au sort en deux groupes: l’un bénéficiant d’un suivi habituel par la PMI (Protection maternelle et infantile), l’autre ayant en plus des visites à domicile de psychologues, du troisième trimestre de grossesse jusqu’aux 2 ans de l’enfant. L’objectif était notamment d’agir sur la dépression pré et post-natale, qui touchait environ 30% de ces femmes (contre 10 % à 15 % dans la population générale), et de prévenir les troubles psychologiques chez leurs enfants.
Les interventions ont consisté à faire connaître aux jeunes mères les aides dont elles pouvaient bénéficier et à leur fournir une guidance parentale. «Les résultats, qui vont être publiés, montrent que le lien avec le bébé est meilleur, et il y a moins de comportements désorganisants de l’attachement», détaille Antoine Guédeney.
Ce n’était pas gagné d’avance. «A l’époque, nous avions été critiqués au motif que nous considérerions que des parents pauvres ne sauraient pas éduquer leurs enfants, les stigmatisant, se rappelle-t-il. C’est faux évidemment, mais lorsque plus de trois facteurs de risque indépendants s’accumulent, le QI de l’enfant est affecté.»
Le rapport de Terra Nova a lui aussi suscité des réserves dans le milieu de la petite enfance. La question de l’efficacité à long terme est aussi posée. «Les études d’intervention améliorent la trajectoire des enfants, mais la plupart des résultats suggèrent que les effets ne durent que le temps de l’intervention», pointe M. Ramus.
A l’approche de l’élection présidentielle en France, les politiques se saisiront-ils de ce sujet, au nom de l’égalité des chances? «La lutte contre la précarité et ses effets sur la santé ne semble pas une priorité des politiques publiques ni même des candidats à l’élection présidentielle, estime le docteur Corty. Il y a peu d’études, ni épidémiologiques ni d’intervention. Et peu de financements alloués.» (Article publié dans Le Monde, en date du 15 mars 2017, supplément Science et Médecine, pages 1 et 5; titre A l’Encontre)
____
[1] EDEN, la première étude d’envergure menée en France par des équipes de l’Inserm, sur les déterminants pré et post natals précoces du développement psychomoteur et de la santé de l’enfant. (Réd.)
[2] L’étude Elfe – Etude longitudinale française depuis l’enfance –a pour but de mieux connaître les différents facteurs (environnement, entourage familial, conditions de vie, etc.) qui peuvent avoir une influence sur le développement physique et psychologique de l’enfant, sa santé et sa socialisation. (Réd.)
*****
«L’impact des conditions socio-économiques»
Entretien avec Kim Noble par Sandrine Cabut
Kim Noble, pédiatre de formation, dirige le Neurocognitive Early Experience and Development Lab (NEED Lab) à l’université Columbia de New York, un laboratoire de recherche qui étudie l’influence des expériences précoces sur les apprentissages et la croissance des enfants.
Que sait-on aujourd’hui de l’impact de la précarité sur le cerveau des enfants?
 Plusieurs études ont montré que de la petite enfance à l’adolescence, il existe des disparités socio-économiques dans le développement du langage, des capacités de mémorisation et d’auto-contrôle. Point important, aucun effet de ces disparités socio-économiques sur le cerveau n’a été constaté à la naissance. C’est cohérent avec l’hypothèse que ce sont les expériences post-natales qui comptent, même si nous n’en avons pas de preuve formelle.
Plusieurs études ont montré que de la petite enfance à l’adolescence, il existe des disparités socio-économiques dans le développement du langage, des capacités de mémorisation et d’auto-contrôle. Point important, aucun effet de ces disparités socio-économiques sur le cerveau n’a été constaté à la naissance. C’est cohérent avec l’hypothèse que ce sont les expériences post-natales qui comptent, même si nous n’en avons pas de preuve formelle.
Récemment, des travaux en neuro-imagerie, dont ceux de notre équipe, ont permis de confirmer que l’impact des conditions socio-économiques est perceptible au niveau structurel, précisément dans les régions cérébrales qui supportent le langage, la mémoire et l’autocontrôle. La surface et l’épaisseur du cortex de ces zones sont significativement réduites chez les enfants vivant dans des familles en situation de précarité.
De nombreux paramètres peuvent être impliqués dans les liens entre pauvreté et développement cérébral, et des études sont en cours pour déterminer leur poids respectif. Notre laboratoire s’intéresse en particulier à deux facteurs dont le rôle paraît majeur: la qualité et la quantité d’exposition au langage; et le stress, physiologique ou ressenti.
Vous allez débuter une étude inédite pour évaluer si ces troubles du développement cérébral peuvent être prévenus par une aide financière apportée aux familles en difficulté. Comment allez-vous procéder en pratique?
Nous prévoyons de recruter 1000 mères à faible revenu, au moment de leur accouchement, sur plusieurs sites à travers les Etats-Unis. Après un tirage au sort, la moitié d’entre elles recevront un complément confortable (333 dollars mensuels, soit 283 euros), l’autre moitié un montant symbolique (20 dollars mensuels, soit 19 euros).
Nous suivrons leurs enfants durant les trois premières années de leur vie, période où le cerveau en développement est particulièrement sensible aux différences d’expériences. Le postulat de départ est simple, mais c’est une étude ambitieuse, sans précédent. Le coût total du projet est évalué à 16 millions de dollars (15 millions d’euros). Les Instituts nationaux de la santé (NIH) devraient prendre en charge les évaluations, c’est-à-dire les coûts de la recherche proprement dite. Le budget correspondant aux aides financières sera, lui, assuré par des fonds privés et des philanthropes. Douze millions de dollars ont été levés ou sont en passe de l’être, et nous recherchons activement des fonds pour les quatre millions restants. Si nous y parvenons, l’étude pourrait commencer courant 2017.
Ne craignez-vous pas que les familles qui reçoivent seulement 20 dollars par mois quittent l’étude, par manque de motivation?
Il faut préciser qu’outre les transferts mensuels, toutes les familles percevront une compensation financière pour leur participation à la recherche: 50 dollars lors de l’inclusion, autant lors des contrôles réalisés au premier et deuxième anniversaire de l’enfant, et 200 pour le bilan pratiqué au laboratoire à trois ans. L’étude pilote que nous avons menée auprès de 30 familles suggère que même dans le groupe contrôle, un supplément mensuel de 20 dollars constitue une aide. Dans cet essai, le taux de rétention – niveau de participation – des volontaires est resté élevé, dans les deux groupes.
Pourquoi ne pas débuter le soutien financier pendant la grossesse, pour améliorer les conditions de celle-ci et pour protéger plus précocement le développement du cerveau de l’enfant?
Nous avons envisagé cette possibilité, mais du fait des contraintes logistiques, nous avons conclu que la faisabilité serait plus élevée si le recrutement était réalisé à la maternité au moment de la naissance: aux Etats-Unis, la plupart des femmes accouchent à l’hôpital, mais le suivi prénatal est très variable.
L’objectif majeur de ce que l’on appelle aujourd’hui les neurosciences de la pauvreté est de mettre en lumière les mécanismes qui produisent des inégalités. C’est fondamental pour mettre en place des stratégies fondées sur les preuves, qui permettront d’augmenter les chances que tous les enfants atteignent leur plein potentiel de développement. J’en suis convaincue, la pauvreté est la plus grande barrière pour atteindre cet objectif. (Entretien publié dans Le Monde, en date du 15 mars 2017, supplément Science et Médecine, pages 1 et 5; titre A l’Encontre)

Soyez le premier à commenter